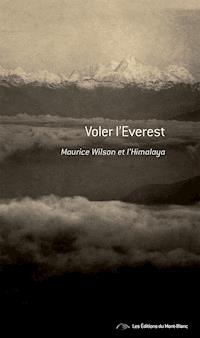
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Montblanc
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Maurice Wilson, à l’aube de ses 35 ans, entreprend de se rendre en monoplan monomoteur à cockpit ouvert sur les flancs de l’Everest pour planter le premier drapeau à son sommet
Ce projet semble fou à bien des égards : l’Anglais n’est ni aviateur, ni alpiniste. Il ne connaît de la marche que les quelques cent kilomètres qu’il aura parcouru dans le Yorkshire en guise d’entraînement. De plus, en 1935, l’aviation en est encore à ses balbutiements et peu auront, avant lui, parcouru de si longues distances sans dommages.
En s’appuyant sur le journal qu’il a tenu tout au long de son voyage, Ruth Hanson relate la formidable épopée de Maurice Wilson. Plus que l’entreprise, c’est l’homme qui fascine : sa foi, son ambition, son obstination… tout chez lui n’est que démesure. Si bien que la finalité du projet (malheureusement trop prévisible), n’est en rien la finalité du récit. Mieux vaut s’attacher à l’homme et aux raisons qui le poussèrent au-delà du raisonnable. Son rêve n’était-il que pure folie ?
Quoi qu’il en soit, son exploit aura marqué l’histoire de l’Everest, quant à sa réussite, certains aiment à y croire encore…
Un récit de voyage captivant !
EXTRAIT
Gravir l’Everest en solitaire ! On dirait un projet fou, rêvé dans un bar, à la f in d’une longue soirée… Mais Maurice Wilson était abstinent, ne fréquentait aucun pub et voulait vraiment voler jusqu’au Tibet, atterrir sur les pentes inférieures de la montagne, continuer à pied et devenir le premier homme à atteindre le sommet ! Il n’avait aucune expérience de l’alpinisme et ne savait pas piloter, mais il pensait que là était son destin et que Dieu guiderait ses pas sur les rochers et les glaciers himalayens.
J’ai entendu parler de Maurice Wilson pour la première fois un jour de l’an, alors que j’étais en vacances avec des amis en Écosse. Recroquevillée sur un divan, avec du thé et des crêpes, après une marche glaciale, je parcourais un livre sur l’Everest, donné à Noël par un ami. Soudain, une photographie jaunie éveille mon attention. Elle montre Maurice Wilson, debout devant un petit biplan. Il a les mains sur les hanches, un casque en cuir sur la tête, il porte des lunettes d’aviateur et f ixe la caméra avec un léger sourire narquois. Je lis le passage qui le concerne et quelque chose chez cet homme me frappe. Son projet insensé peut-être, ou alors d’avoir été si loin sachant que la plupart des gens – dont moi – l’aurait pris pour un fou ou encore nos racines communes du Yorkshire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Comme Maurice Wilson,
Ruth Hanson est née et a grandi à Bradford. Depuis 1991, elle a voyagé de nombreuses fois au Népal, mais aussi au Tibet, au Sikkim et au Bhoutan. Elle travaille dans un cabinet juridique et vit avec son compagnon dans le Yorkshire du Nord. Ruth Hanson entendit parler pour la première fois de Maurice Wilson pendant des vacances en Écosse, un jour de l’an. Plus elle en apprenait sur cet homme, plus elle était intriguée.
« Il était bien connu dans le milieu des alpinistes et son histoire avait déjà été racontée, mais malgré cela, je fus captivée et pensais qu’il y avait plus à dire. »
C’est ainsi que l’idée de ce livre prit forme, un livre qui non seulement raconterait l’histoire de Wilson, mais décrirait la couleur et la beauté d’une région – l’Himalaya – à laquelle Ruth est familière.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
REMERCIEMENTS
Ruth Hanson
De nombreuses personnes et organisations ont aidé de diverses manières à faire de la vague idée que j’avais de ce livre une réalité imprimée et je les en remercie tous.
Je suis tout particulièrement redevable aux personnes suivantes :
Dawn Robertson d’Hayloft pour son travail d’édition et d’assemblage du texte et des photos ; encore plus pour son soutien, sa patience et sa foi enthousiaste dans l’ensemble du projet.
Audrey Salked pour m’avoir généreusement laissé accéder aux documents qu’elle détient sur Maurice Wilson dans ses dossiers sur l’Everest ; et plus encore pour son intérêt, ses suggestions, ses encouragements.
Glyn Hughes et ses collègues de la bibliothèque de l’Alpine Club pour m’avoir permis d’accéder à l’information et aux archives qu’ils détiennent à la fois sur Maurice Wilson et sur l’expédition à l’Everest de 1935.
Doug Scott pour sa préface.
Dominic Webster du Daily Mail pour avoir accepté de collaborer avec moi à la recherche de plusieurs journaux et pour m’avoir envoyé un véritable trésor sous la forme d’un paquet d’articles de l’époque.
Les amis avec lesquels j’ai voyagé et les nombreuses personnes que j’ai rencontrées pendant mes treks et périples divers en Himalaya. Sans eux je n’aurais pu voir, apprécier, apprendre autant de choses ni vivre autant d’expériences et ma vie aurait été moins riche.
Enfin et surtout, ma mère d’avoir cru en ma capacité à finir ce livre ; et puis George, Elaine et Crispin de m’avoir aidée et encouragée sans relâche et de leurs suggestions sur mon premier brouillon.
PRÉFACE
Doug Scott, CBE,printemps 2008.
Maurice Wilson, cet « homme du Yorkshire sur l’Everest » était la quintessence même de l’homme du Yorkshire : intransigeant, sentimental, honnête, sûr de lui jusqu’à l’entêtement, un homme de convictions prêt à mourir pour elles… ce qui se produira !
Ruth Hanson a merveilleusement décrit l’aventure de Maurice Wilson, avouant avoir été touchée par son « courage, son altruisme et la sincérité de son engagement. » J’ai été frappé par cette l’histoire très prenante, la lisant d’une traite pour découvrir cet Anglais excentrique qui voulait à tout prix faire l’ascension de l’Everest en solitaire pour montrer aux hommes comment il fallait vivre.
En 1932, Maurice Wilson est en plein marasme. Il n’a visiblement pas retrouvé son équilibre après les deux terribles années de sa jeunesse passées dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Après l’échec de ses deux mariages, il présente tous les symptômes d’une dépression et souffre, de surcroît, de la tuberculose. Il rencontre un guérisseur qui lui conseille de jeûner pendant 35 jours en ne buvant que quelques gorgées d’eau et de prier Dieu pour qu’il lui accorde une renaissance. Il suit ces instructions à la lettre et s’endurcit mentalement pour lui permettre de se retirer dans la Forêt Noire. Il s’y ressource complètement et retrouve sa prodigieuse force physique. Pour la première fois depuis des années il connaît la paix et le bonheur. Or, comme tout homme de foi, il souhaite prêcher sa bonne parole à travers le monde, partager sa découverte spirituelle.
Maurice Wilson était conscient de la souffrance et de la misère du monde… mais aussi de l’énorme difficulté qu’il allait affronter pour y répandre sa bonne parole. Comment convaincre le reste de l’humanité de l’efficacité de sa nouvelle foi ? Il allait bientôt avoir 35 ans, âge où tous les hommes sont au sommet de leur force physique et de leur endurance et où chacun, traditionnellement, recherche une élévation spirituelle.
Un jour, dans un café à Fribourg, il réalisa soudain ce qu’il devrait faire et comment il pourrait maîtriser sa force physique et son ouverture spirituelle pour le bénéfice du monde entier : il gravirait l’Everest en solo… ! Il ne portait aucun intérêt aux montagnes en elles-mêmes, mais un article sur la disparition de Mallory et d’Irvine en 1924 avait attiré son attention et enflammé son imagination. Il s’était convaincu qu’il réussirait seul, là où une lourde expédition officielle avait échoué. S’il pouvait réaliser ce projet, le monde se lèverait et prendrait en compte la puissance de la foi. Ainsi, au début du moins, sa motivation relevait d’un désir spontané de partager avec les autres, d’aider le reste de l’humanité – idée plutôt louable.
Projet magnifique, mais insensé… et d’autant plus fou que Maurice Wilson, qui n’était pas plus aviateur qu’il n’était alpiniste, décida de rejoindre l’Everest en avion, seul, à bord de l’Ever Wrest1, un bimoteur Gipsy Moth, qui devrait atterrir… en s’écrasant sur le glacier du Rongbuk !
L’auteure, elle-même, n’est ni alpiniste ni aviatrice, mais elle a su évoquer de façon rafraîchissante l’aviation et l’alpinisme des années 1930. Elle décrit également de manière intéressante le climat politique de cette époque en Asie, tout comme le bouddhisme tibétain, en particulier celui de la vallée de Rongbuk, qu’elle a visitée.
Tout s’opposait à son dessein et pourtant Wilson pilota l’Ever Wrest jusqu’en Inde. Il avait vaincu l’hostilité farouche des auto rités britanniques, supporté ces heures d’ennui et d’attente qui embrument le cerveau, traversé des tempêtes, il avait survécu au manque d’essence et aux atterrissages approximatifs… sans jamais perdre son objectif de vue. Il écrira plus tard à propos de la bureaucratie du Moyen-Orient : « Ma foi, l’Everest n’est pas le Caire, je continue donc jusqu’à Bagdad. »
Arrivé en Inde, il s’engagea à ne pas survoler le Népal pour se rendre au glacier de Rongbuk (Tibet). Il alla donc à Darjeeling d’où, déguisé, il marcha jusqu’au camp de base de l’Everest, malgré de nouveaux problèmes avec les autorités et malgré la rigueur climatique du plateau tibétain. Mais de fait, Maurice Wilson mettra dix jours de moins que l’expédition précédente pour ce voyage au cours duquel précédemment des alpinistes étaient morts. Pas étonnant donc qu’il ait pensé réussir à « enflammer le monde » : il avait réalisé sans aucune aide un temps aussi bon en évitant les autorités locales des villes et des villages et accompagné seulement de trois sherpas qu’il avait engagés à Darjeeling comme compagnons !
À Rongbuk, il prit « un bon bain et se décrassa », se félicitant, dans son journal, d’être arrivé aussi loin sans jamais avoir mis un vêtement de laine, « j’en ressens maintenant le bénéfice ». Qu’aurait-il pu accomplir dans une expédition classique ? Difficile à dire ! Il était sans aucun doute très robuste et s’acclimatait très bien au froid et à l’altitude.
Malheureusement, ce n’était pas un alpiniste, il n’avait fait que des marches d’endurance entre Londres et Bradford en guise de préparation… et se sentit complètement désemparé face à l’abrupt glacier qui rejoint le col Nord.
Ce sont sur ces pentes que l’expédition de Shipton découvrira en 1935 son corps et son journal.
Il était allé au-delà du point où il aurait encore pu se rendre compte de la réalité de sa situation : l’altitude a parfois cet effet annihilant sur le cerveau et le corps des personnes peu habituées au manque d’oxygène. Il n’y a, chez lui, aucun « désir de mort », son journal l’atteste. De sa mère, il écrit : « je vais l’emmener voir les lieux de mon enfance lorsque je rentrerai. » Il ne méprise pas non plus les autres : il connaissait les joies de l’amitié et, en montagne, il souffre de sa solitude. Il note au retour de l’isolement qu’il s’était imposé après sa première tentative pour atteindre le col Nord : « Tewang se précipita à ma rencontre, les mains en avant et une rangée de dents blanches éclairait son visage. Puis vint Tsering, couvert de lourds vêtements pour la nuit, lui aussi avec un grand sourire, suivi ensuite de Rinzing. Tous très contents. »
Les sherpas ont tant aidé Maurice Wilson, ils m’ont, de même, toujours apporté une assistance de premier ordre pendant toute ma carrière d’alpiniste (35 ans d’escalades en Himalaya). D’où cette idée, née il y a maintenant quinze ans, de créer la Community Action Nepal2 pour les aider, eux et leurs familles.
1. [N.d.T.] Ever Wrest en français « Toujours Vaillant ».
2. Community Action Nepal : voir l’article p. 190.
Pour Georges, avec amour.
ILS L’APPELAIENT « LE FOU DU YORKSHIRE »
Si tu peux obliger ton cœur, tes nerfs, ta moelle À te servir encore quand ils ont cessé d’être, Si tu restes debout quand tout s’effondre en toi Sauf une volonté qui sait survivre à tout…
Rudyard Kipling
Gravir l’Everest en solitaire ! On dirait un projet fou, rêvé dans un bar, à la fin d’une longue soirée… Mais Maurice Wilson était abstinent, ne fréquentait aucun pub et voulait vraiment voler jusqu’au Tibet, atterrir sur les pentes inférieures de la montagne, continuer à pied et devenir le premier homme à atteindre le sommet ! Il n’avait aucune expérience de l’alpinisme et ne savait pas piloter, mais il pensait que là était son destin et que Dieu guide-rait ses pas sur les rochers et les glaciers himalayens.
J’ai entendu parler de Maurice Wilson pour la première fois un jour de l’an, alors que j’étais en vacances avec des amis en Écosse. Recroquevillée sur un divan, avec du thé et des crêpes, après une marche glaciale, je parcourais un livre sur l’Everest, donné à Noël par un ami. Soudain, une photographie jaunie éveille mon attention. Elle montre Maurice Wilson, debout devant un petit biplan. Il a les mains sur les hanches, un casque en cuir sur la tête, il porte des lunettes d’aviateur et fixe la caméra avec un léger sourire narquois. Je lis le passage qui le concerne et quelque chose chez cet homme me frappe. Son projet insensé peut-être, ou alors d’avoir été si loin sachant que la plupart des gens – dont moi – l’aurait pris pour un fou ou encore nos racines communes du Yorkshire.
Plus j’en apprenais à son sujet, plus il me fascinait. Oui, c’était un homme audacieux, vaniteux, excentrique et je comprends très bien que la presse des années 1930 l’ait surnommé « le Fou du Yorkshire ». Naïveté ou insouciance… il sous-estimait la difficulté de l’ascension et se reposait entièrement sur sa foi absolue, ne faisant ainsi aucun effort pour apprendre les techniques qui auraient pu l’aider. Je pense qu’il était inflexible, d’un entêtement démesuré et qu’il n’acceptait aucun compromis. Mais il y avait aussi beaucoup de courage, d’altruisme et une grande sincérité dans son ambition. Je sais qu’il n’avait pas plus d’expérience en alpinisme que moi, et je trouve donc son histoire fascinante, même s’il est loin d’être le seul à avoir essayé de gravir le plus haut sommet de notre terre et à avoir échoué dans cette entreprise. Ce qu’il réussit à faire témoigne de sa foi et de sa confiance en lui. Pour moi, chez les hommes qui tentent envers et contre tout de faire de leur rêve une réalité il y a quelque chose qui nous interpelle, nous tous, quelle que soit notre situation. Maurice Wilson est l’un de ces hommes. Il est allé sur l’Everest en 1934, soit dix ans après la célèbre tentative de Mallory et Irvine, et au milieu d’une succession d’expéditions officielles dont faisaient partie quelques-uns des alpinistes les plus expérimentés de l’époque. Or, il faudra encore attendre dix-neuf ans avant qu’Hillary et Tenzing n’atteignent le Toit du Monde et n’en redescendent pour raconter leur aventure.
Maurice Wilson est né à Bradford le 21 avril 1898 ; il avait trois frères. Ses parents, Mark et Sarah Wilson, étaient connus pour leurs actions charitables en faveur des pauvres qui vivaient difficilement dans les rues encombrées et enfumées du quartier qui s’élevait sur la colline jusqu’à Great Horton. À la naissance de Maurice, Mark Wilson était contremaître dans une fabrique de tissu en laine peignée, puis il réussit à devenir fabricant de laine, principal associé de la Mark Wilson Limited de Holme Top Mills. Il pensait, bien sûr, que ses fils travailleraient avec lui dans le textile, Maurice Wilson commença donc son apprentissage en 1914.
Comme bien des projets personnels de tant de familles, la Première Guerre mondiale va balayer les ambitions de Mark pour son fils. En avril 1916, à l’âge de 18 ans, Maurice s’engage comme soldat dans le 5e bataillon du régiment du West Yorkshire (régiment du Prince de Galles). Après une formation en disciplines physiques, en techniques de combat, en maniement des armes et en commandement, il est nommé sous-lieutenant, puis envoyé en France en 1917.
Son régiment fait partie de la 146e brigade d’infanterie (49e division) qui participe, cette année-là, aux longues batailles d’Ypres. Maurice Wilson est membre d’un groupe connu dans l’Armée sous le nom de PBI, « Poor Bloody Infantry ». On leur confie les missions les plus dangereuses sur le front et on leur assigne, en plus, des tâches physiques très pénibles comme le transport de lourdes charges, le nettoyage des tranchées, la réparation des murs de bois et des sacs de sable ou la pose de barbelés. Le régime habituel est quatre jours au front, puis quatre jours en réserve dans les tranchées, derrière les premières lignes, et enfin quatre jours de repos. Les hommes sont entassés, formant comme un bourbier de corps, de maladie et de vermine, et passent de longues heures d’attente et d’ennui rompues seulement par les ordres de passage à l’action avec tout ce que le combat peut impliquer.
Maurice Wilson reçut la Croix de Guerre pour sa participation à ces combats sans espoir. Toutes les remises de médailles pour bravoure pendant la Première Guerre mondiale étaient publiées dans les gazettes officielles, aujourd’hui disponibles sur internet. Je me bagarrai avec le logiciel de recherche… et triomphai en trouvant finalement la mention de sa médaille, citée l’année suivante, dans l’un des suppléments de la London Gazette du 13 septembre 1918. Il n’y a qu’un seul paragraphe, parmi des centaines, concernant tant d’autres hommes, et chaque paragraphe est un bref compte-rendu imprimé en petits caractères. Même sur l’écran d’un ordinateur, le sobre contenu de ces vieilles pages donnaient l’image poignante de cette sombre époque, tout comme ces photos de croix alignées dans les cimetières militaires. Chaque compte-rendu rappelle de manière sèche et concise l’histoire de chacun. Voici celui concernant Maurice Wilson :
Sous-lieutenant Maurice Wilson, W York RPour sa remarquable bravoure et son dévouement au devoir. A tenu un poste en avant de la ligne sous un très fort bombardement et sous le feu de mitrailleuses venant de chaque flanc, après le retrait des mitrailleuses couvrant ses flancs. L’attaque de l’ennemi échoua en grande partie grâce à son courage et à sa détermination à tenir son poste.1
Après cet événement, mais toujours pendant sa période à Ypres, Maurice Wilson fut gravement blessé par le feu d’une mitrailleuse. Il passa alors plusieurs mois à l’hôpital, en convalescence, d’abord en France puis en Angleterre. Il se remit suffisamment pour rejoindre son régiment et servir comme capitaine jusqu’à l’armistice, mais son bras gauche affaibli ne guérit jamais tout à fait et le fit souffrir le restant de sa vie.
En songeant à la boue, à l’horreur et à la mort dans les tranchées, il me semble aisé de comprendre pourquoi Maurice Wilson eut du mal à s’adapter à la routine et à la monotonie de l’activité textile à Bradford. Il savait désormais que le monde avait de plus vastes horizons, il se rendait également compte que ses pensées, émotions et souvenirs l’avaient suivi à son retour de France. Après la mort de son père, il épousa alors Béatrice Hardy Slater, peut-être pour tenter de se construire une vie normale et ordinaire, peut-être aussi pour retrouver un peu de stabilité ou même pour apaiser les craintes de sa mère à son sujet. La cérémonie eut lieu le 20 juillet 1922 en l’église Saint-Jean, Great Horton. Il avait 24 ans, le registre du mariage indique qu’il était commerçant et que son épouse avait 22 ans. Mais les cloches du mariage ne garantissent pas le bonheur et même l’amour partagé du jeune couple ne réussit pas à attacher Maurice Wilson au Yorkshire.
Il partit donc à Londres, y resta quelque temps, avant d’émigrer, d’abord aux États-Unis puis en Nouvelle Zélande où, après s’être occupé d’élevage, il dirigea avec succès une boutique de vêtements à Wellington. C’est là que son mariage avec Béatrice se termina par un divorce en février 1926. Quatre jours plus tard, il épousait Ruby Russell qui venait de Tasmanie, mais vivait comme lui à Wellington.
Mais cette fois encore ce n’est pas suffisant ! Quelques années plus tard, il décide soudain de quitter son pays d’adoption et s’embarque sur un cargo en partance pour l’Angleterre. Sa mère et ses frères, pensant son errance enfin terminée, l’accueillent à son retour, mais il choisit d’habiter et de travailler à Londres. Il veut prendre un nouveau départ mais, hésitant et déprimé, il s’interroge sur ce qu’il a accompli jusqu’ici, sur le but de son existence et sur le sens de toute chose.
Londres lui est familière et il y connaît du monde, mais c’est avec Leonard et Enid Evans qu’il nouera les liens d’amitié les plus forts. Il rencontre Léonard Evans en achetant une voiture et leur relation prend rapidement une tournure affectueuse. Leurs liens se resserrent et ils passent beaucoup de temps ensemble.
Plusieurs mois après son arrivée à Londres, il tombe gravement malade. Il souffre d’une toux douloureuse, probablement signe de tuberculose, et semble également atteint de dépression. Il perd du poids, ses yeux mornes et tristes s’enfoncent dans ses joues creuses et chaque jour est, pour lui, une bataille plus grise et plus sinistre que le jour précédent.
Désespéré, il consulte un guérisseur qui lui conseille de jeûner pendant 35 jours, de ne boire qu’un peu d’eau et de prier Dieu pour qu’il lui accorde de « renaître ». Wilson arrête alors toutes ses activités courantes, suit ces instructions à la lettre, se plonge dans le silence, la prière et la méditation pour trouver la foi et une réponse à sa quête. Enfin, il se sent prêt… Prêt à affronter à nouveau le monde ! Certes, il est physiquement affaibli, mais la tristesse profonde qui l’écrasait a disparu et mentalement il se sent plus fort qu’il ne l’a jamais été depuis des années. Il n’ose encore croire qu’il est sorti de sa dépression, s’octroie deux mois de repos et part pour la Forêt Noire afin de récupérer.
Là, chaque jour il se sent mieux, plus serein et plus en paix. Son traitement a réussi, il est heureux, oui, la vie lui semble même agréable. Et peu à peu, il se persuade que si la foi l’a tant aidé, elle peut aussi aider les autres. Peut-être se souvient-il également de la force tranquille et de la simplicité des yogis indiens qu’il avait rencontrés pendant son voyage maritime en rentrant de Nouvelle-Zélande…
Quoi qu’il en soit, Maurice Wilson est alors convaincu que, dans notre monde où règnent la misère et la souffrance, tout peut changer si les hommes ont suffisamment de foi. Reste la difficulté de convaincre des millions de sceptiques que c’est là, la bonne réponse.
Pendant son voyage de convalescence en Allemagne, il aura brusquement l’intuition de ce qu’allait désormais être le sens de sa vie. Dans un café à Fribourg, il lit par hasard un article en lambeaux et taché de confiture sur l’expédition à l’Everest de 1924 et la disparition de Mallory et d’Irvine. À titre personnel, il ne ressent pas l’appel des sommets, mais cet article est comme un déclencheur. La foi peut bouger des montagnes, elle peut donc aider les hommes à les gravir – plus particulièrement, elle peut aider un homme à gravir une montagne. Et si un homme peut réussir là où toute une expédition a si notoirement échoué, alors, quelle meilleure preuve du pouvoir absolu de la foi pourrait-on donner au monde ?
Et c’est ainsi que Maurice Wilson allait finalement donner sa vie pour montrer au monde comment vivre. Mais comme beaucoup de personnes résolues, sa détermination et sa concentration étaient si complètes qu’il refusait de voir la démesure de l’entreprise ; il ne pouvait supporter d’être vaincu, ni par les forces de la nature, ni par sa méconnaissance de l’alpinisme. Il se laissa ainsi dévorer entièrement par ce qui n’était au départ que sa manière de démontrer sa foi, qu’un moyen donc pour arriver à son but. S’il avait été différent, il est vrai qu’il n’aurait sans doute jamais atteint le Tibet. Mais qu’il ait été fou, courageux, naïvement stupide ou les trois à la fois, sa motivation initiale était généreuse. Bien sûr, son caractère complexe s’expliquait aussi par le désir de gloire, l’ambition et l’ego : être le premier à « apporter la lumière au monde » ! Élément intéressant pour comprendre cet homme : son ambition suprême, son projet après l’Everest, était de construire un engin volant qui le conduirait dans l’espace, au-delà de l’atmosphère terrestre…
Lorsque Maurice Wilson quitta Londres pour le Tibet, il confia tous ses papiers à Léonard et Enid Evans, dont il fit également ses exécuteurs testamentaires. Le journal que l’on trouva sur lui est un petit carnet relié qu’il avait acheté à Darjeeling, et dont environ la moitié des pages était griffonée au crayon d’une écriture penchée. Après la page de garde, on trouve ces mots notés de sa main : « Pensées fugitives », et aussi le chiffre 3, suivi de quelques mots illisibles. Avait-il déjà rempli deux autres carnets depuis le début de son voyage ? Peut-être l’un sur son périple en avion et le deuxième sur ses aventures en Inde ? Les avait-il envoyés à Léonard et Enid à Londres, avec peut-être aussi son livret de vol ? Des parties de son journal laissent penser qu’il écrivait à ses amis, surtout à Enid qui lui était particulièrement chère.
Ce carnet fut racheté par L. E. Frank et donné à l’Alpine Club en 1965. Il fait partie des archives du club à Londres. C’est un document fascinant, mais frustrant. Il contient un certain nombre de descriptions détaillées. Par exemple, Maurice Wilson enregistre presque obsessionnellement ce qu’il mange (certes, de nombreux trekkeurs ou grimpeurs en Himalaya ont fait de même). Mais il y a très peu de remarques sur le pays qu’il traverse ou sur ce qu’il voit et encore moins sur ce qu’il pense. Tout, même son texte, est focalisé sur l’atteinte du sommet. Ceux d’entre nous qui veulent avoir une idée plus large et plus pittoresque de ce qu’ont pu être sa marche au Tibet et ses tentatives sur la montagne, devront consulter les récits des membres des premières expéditions sur l’Everest. Fort heureusement, ces derniers ont décrit avec force détails et couleurs leurs aventures personnelles et leurs livres sont précieux.
J’ai trouvé la lecture du texte de Maurice Wilson émouvante et passionnante. Au début je fus surprise de voir qu’il l’avait écrit au crayon – mais je découvris alors que les stylos-billes n’avaient été commercialisés qu’en 1945, et l’encre d’un stylo aurait pu faire des tâches à basse altitude et geler plus haut sur la montagne. Une partie du carnet est illisible, pas surprenant tant d’années plus tard et sachant surtout qu’il a été exposé aux éléments pendant plus d’un an, avant la découverte du corps de Wilson par les membres de l’expédition de 1935. Avec une loupe je pus, avec peine, décrypter son écriture fine et serrée – et il me semblait alors que sa voix traversait les années, me racontait son histoire, me faisait parfois partager ses pensées et parfois non. Par moment, il me semblait que mon attention diminuait, car ses mots… il ne les avait pas écrits pour moi ! Sachant ce qui l’attendait, je frissonnais en lisant le texte de ses derniers jours, une voix en moi-même lui disait d’arrêter et de redescendre – mais c’était trop tard, tout ce que je pouvais faire était de continuer à lire jusqu’à voir son histoire arriver à sa fin.
Mais j’anticipe. Pour l’instant nous sommes en 1932, et c’est le début de l’aventure de Maurice Wilson sur l’Everest qui nous occupe.
1. 3e supplément à la London Gazette du vendredi 13 septembre 1918 (date de l’article : lundi 16 septembre 1918).
MONTAGNE, MYTHES ET MYSTÈRE
Vers les lieux à l’état sauvage, vers les parois du glacier de Chomolungma, j’allais, dans l’ardent désir de solitude.
Milarepa1
Il y a quelque chose de spécial avec l’Everest – Chomolungma pour les Tibétains, la déesse mère – le Toit du Monde. L’Everest représente quelque chose, même pour ceux qui n’aiment pas les montagnes. Et pour ceux d’entre nous qui, pour de nombreuses raisons, les aiment, l’Everest exerce comme une attirance et une fascination, même si d’autres sommets peuvent être plus près de nos cœurs.
De nos jours, ce sommet nous est très familier, grâce aux journaux, aux livres, aux films et pour quelques privilégiés, grâce à leur propre expérience. Cela va de soi bien sûr, pendant des milliers d’années il est resté inconnu, passant juste pour l’un des sommets d’un groupe de hautes montagnes.
La chaîne de l’Himalaya est vaste, sa longueur égale à peu près la moitié de la largeur de l’Atlantique, elle comporte plus de cent sommets de plus de 7 300 m et vingt au-dessus de 8 000 m. Elle traverse toute l’Asie, séparant pays, populations, climats et modes de vie. Au sud des montagnes, le paysage est luxuriant, il y a des forêts, des fermes et des champs cultivés, enrichis par les pluies de la mousson et la chaleur constante. Au nord, le climat est sec, aride, avec des températures extrêmes allant de la chaleur étouffante au froid paralysant ; il n’y a pratiquement aucun arbre, la végétation est rare et peu de champs sont cultivés ; la population nomade y déplace ses troupeaux dans les zones les plus tempérées à la recherche de pâturages. Cette chaîne est une barrière naturelle, décourageant les envahisseurs sur chaque versant. De grandes rivières y prennent leur source et irriguent les civilisations d’une grande partie de l’Asie – le Yangtsé, l’Irrawaddy, le Gange, l’Indus et le Brahmapoutre. Pour ce don de vie, même ceux qui sont trop éloignés pour apercevoir les montagnes, vénè-rent les hauteurs himalayennes : c’est la source de la mère Ganga, ce sont les sommets sacrés du Meru, du Machapuchare et du Kailas, berceau du dieu Shiva. Dans la tradition, seuls le pèlerin, l’ascète ou le sâdhu2 cherchent à s’y rendre.
Le XIXe siècle a vu l’expansion vers l’est de plusieurs nations européennes à la recherche de terre ou pour faire du commerce. Deux pays se protégèrent par eux-mêmes, ajoutant aux défenses naturelles de leurs montagnes et de leur climat inhospitalier, la fermeture de leurs frontières. Le royaume du Népal refusa l’accès aux Européens de 1815 à 1945, et le Tibet, sous le règne des Dalaï-lamas, presque aussi longtemps. C’est pourtant à cette époque que seront évaluées pour la première fois l’étendue de la chaîne himalayenne et l’altitude de ses sommets. Dès 1784, sir William Jones avait indiqué que ces sommets étaient plus éloignés de l’Inde qu’on ne le croyait et devaient donc être plus hauts que les sommets des Andes (qui passaient alors pour les plus hauts du monde). Mais son opinion, comme beaucoup d’autres, avait été rejetée avec mépris par la communauté scientifique officielle.
Dans leur recherche de pouvoir et de profit, les Européens du XIXe siècle développèrent les sciences et les explorations. Partout dans le monde des hommes observaient, enregistraient, mesuraient, se documentaient et collectaient des plantes, des animaux, des rochers, des oiseaux… Entre 1817 et 1820, John Hodgson et William Webb firent des relevés topographiques du nord de l’Inde, allant dans les montagnes à l’ouest du Népal, identifiant et mesurant la Nanda Devi (7 817 m) et la revendiquant comme plus haute que tous les sommets des Andes.
Elle resta le plus haut sommet identifié pendant plus de 30 ans, tandis que, morceau par morceau, la grande mission du relevé topographique de l’Inde arrivait à ses fins : une immense entreprise, couvrant tout le continent, alors même que l’influence britannique se renforçait et s’étendait. Elle avait débuté sous la direction de William Lambton qui s’intéressait à l’étude des formes du relief pour calculer la courbure de la terre. Il avait effectué des mesures selon un arc allant de Madras dans le sud de l’Inde jusqu’en Himalaya, 2 550 km plus loin, et cet arc sera plus tard étendu pour inclure tout le Cachemire. Son théodolite pesait plus d’une demi-tonne et il fallait douze hommes pour le porter. Après la mort de Lambton en 1823, George Everest prit en charge la mission. Les mesures de la partie sud de l’arc, planifiées par Lambton, étaient pratiquement terminées mais le défi que posaient les montagnes restait entier.
George Everest sera le cartographe en chef de l’Inde jusqu’en 1843, où il transmit sa fonction à Andrew Waugh. Lorsque la mission de cartographie arriva à la frontière nord de l’Inde, elle employa des indigènes connus sous le nom de pandits3, pour pénétrer les zones lointaines et parfois interdites, y effectuer des mesures et collecter des informations. Les pandits se déguisaient souvent en pèlerins ou en sâdhus pour éviter les soupçons, utilisaient des colliers à prières pour calculer les distances et cachaient leurs enregistrements à l’intérieur de moulins à prières, tenus à la main.
Andrew Waugh calcula que le Kangchenjunga était plus haut que la Nanda Devi, mais il garda cette information pour lui. D’autres mesures en 1847 et 1849 semblaient indiquer qu’un autre sommet, au-delà du Kangchenjunga, serait encore plus haut. Waugh demanda alors à son équipe de calculer et de recalculer les mesures prises et fit confiance au mathématicien bengali de génie, Radhanath Sickdhar, pour établir en toute certitude l’altitude de ce sommet : en 1856, le pic XV avec ses 8 848 m, enregistrés par la mission, fut déclaré la montagne la plus haute du monde.
Restait la question du nom. La tradition de la mission était de reprendre les noms donnés par les populations locales, lorsqu’ils existaient, mais Waugh insista pour que l’on donne à la montagne le nom de son prédécesseur. Le débat fit rage. Plusieurs noms locaux s’avéraient possibles, Chomolungma et Tchoumou-Langma utilisés au Tibet, Devadhunga et Chingopamari usuels au Népal. Malgré tout, Waugh tint bon et le pic XV fut officiellement appelé mont Everest.
De nos jours, la montagne est connue sous plusieurs noms : Everest et Chomolungma, mais aussi Sagarmatha, nom sanskrit signifiant la « tête du ciel », donné par le gouvernement népalais lorsque l’on eut démontré qu’elle était la plus haute du monde. Plus récemment, les Chinois ont imposé leur langue en de nombreux lieux au Tibet et ils utilisent le terme de Qomolangma.
Quant à la signification précise de Chomolungma, elle fait encore débat : l’interprétation la plus courante est la déesse Mère du monde, mais il en est d’autres comme la Terre des oiseaux femelles, ou Dame vache, ou le Pic au-dessus de la vallée ou encore Dame Langma, Langma étant une abréviation de Miyolangsangma, la déesse qui vit sur la montagne.
Pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, on considéra comme suffisant que la plus haute montagne du monde soit identifiée, mesurée et dénommée. En 1860, l’une des principales préoccupations de l’Empire britannique était de protéger l’Inde des menaces venant de la frontière nord, à savoir de la Russie tsariste et de la Chine impériale. Ce conflit larvé s’appelait « le Grand Jeu ». Pour en savoir plus sur les montagnes, sur leurs cols enneigés et les accès qu’ils donnaient, les pandits pri-rent le risque de s’enfoncer encore plus loin au Tibet et en Asie centrale. Travail de longue haleine, pénible et dangereux ! Pendant bien des années ces hommes récoltèrent et transmirent des informations précieuses pour les cartographes et les politiciens. Aux missions secrètes de l’armée, participait l’intrépide et ambitieux Francis Younghusband : il écumait le nord du Karakorum, espionnait au nom de la science ! Et l’histoire retiendra que Younghusband et l’un de ses collègues militaires, Charles Bruce, avaient entre eux envisagé l’éventualité d’une ascension de l’Everest… Or, à cette époque, on commençait tout juste à considérer l’alpinisme comme un sport et de nombreux sommets en Europe étaient encore vierges. Cette conversation eut-elle réellement lieu ? Quoiqu’il en soit, ces deux hommes allaient jouer un grand rôle dans l’histoire de l’Everest.
En 1903 : l’Empire britannique s’inquiète toujours de l’influence russe. Une délégation britannique est mandatée au Tibet pour des négociations politiques et commerciales avec Sa Sainteté le treizième Lama, ses lamas ministres et ses dzongpens4. Francis Younghusband, alors colonel, est chargé d’escorter militairement cette mission. À la frontière, les Tibétains leur refusent l’entrée. Mais la délégation n’en a cure, elle poursuit son chemin, l’escorte devient une armée, qui soumet par la force les Tibétains mal équipés et peu expérimentés. Younghusband sera vivement critiqué. Mais plus tard, dans les termes d’un traité, il imposera une clause permettant aux Britanniques l’accès aux sommets de l’Himalaya central par le Tibet. Et c’est ainsi que furent déterminés et la nationalité des premières expéditions à l’Everest et la voie pour y accéder, car le Népal restait toujours interdit aux étrangers.
Après la Première Guerre mondiale, la Royal Geographical Society et l’Alpine Club à Londres s’unissent pour créer le Comité pour le mont Everest sous la direction de Younghusband. En 1920, l’ouverture des négociations avec le Dalaï-lama pour une expédition d’exploration dans la région de l’Everest a de multiples objectifs : trouver un chemin d’accès à l’Everest, étudier la géologie et la faune, dessiner une carte détaillée et rechercher une voie pour gravir la montagne. On ne savait pas, alors, si l’on pouvait survivre à de telles altitudes. Une expédition italienne montée jusqu’ à 7 315 m dans le Karakorum pensait improbable la survie au-dessus de cette altitude. De plus, personne ne connaissait les difficultés techniques, concernant l’accès à l’Everest ou son ascension. Ainsi, lorsque l’expédition de 1920 quitta l’Angleterre sous la conduite de Charles Howard-Bury, ses membres et ses sponsors n’avaient pas la moindre idée de ce qu’ils allaient y trouver.
Par ailleurs, ils n’envisageaient pas vraiment combien leurs méthodes pour explorer, cataloguer, conquérir la nature s’opposaient diamétralement aux fondements culturels des peuples de l’Himalaya. En 1921, la plupart des Tibétains menaient la vie dure de fermiers et d’éleveurs, ils étaient de fervents bouddhistes et tout ce qui leur restait en biens ou en énergie était consacré à leur foi, dans l’aide aux monastères, dans les pèlerinages et dans leurs efforts pour accéder à la sagesse.
Partant de ce point de vue, l’escalade d’une montagne, simplement « parce qu’elle est là » (selon la fameuse formule de Mallory) n’est pas utile. Les Tibétains considèrent les montagnes comme des lieux sacrés où, sur les plus hautes, vivent des dieux et des déesses. Gravir leurs pentes peut déranger ces divinités. Les pèlerins tournent toujours autour du pied du mont Kailas, sans doute le plus sacré de leurs sommets, et se prosternent de tout leur long à chaque pas pour gagner en mérite. S’il leur est nécessaire de gravir un col pendant un voyage, ils respectent la coutume en faisant brûler du genièvre, en construisant des cairns comme offrandes de paix et en laissant flotter au vent des drapeaux de prières avec des vœux pour que tous trouvent le chemin de l’éveil.





























