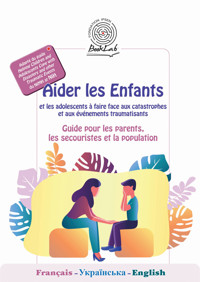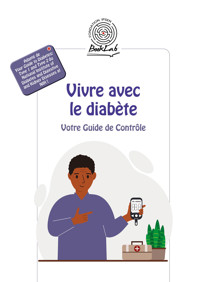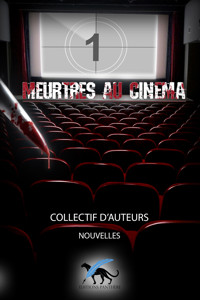3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Découvrez un nouveau numéro en version numérique de la revue littéraire belge Marginales
Pourquoi "revue", pourquoi "rêvée" ? La Wallonie exista longtemps par ses revues, qui lui donnèrent, en fin de compte, son nom. Elle fut longtemps l'emblème d'un quotidien, dont le titre battait comme un étendard, et qui ensuite a cessé de paraître, la privant de cette affirmation journalière, de cette désignation récurrente de la "prière du matin de l'homme moderne", pour reprendre l'expression de Mallarmé. La Wallonie, aussi, se définit longtemps comme un rêve. Paul Caso, chroniqueur inlassable d'un art wallon, et dont l'amitié m'éclaira sur la question, aimait à rappeler que lorsque Louis Delattre publie en 1929
Le pays wallon, il place en exergue à son livre une phrase de Taine, qui dit : "Là, vivent des gens pleins d'étranges rêves". La Wallonie, une usine à rêves plutôt qu'à penser des choses tristes ? C'est l'une des prémisses de ce rassemblement de textes, inattendu peut-être, anachronique aux yeux de certains, et dont l'idée s'est irrésistiblement imposée pourtant.
La Wallonie, on le verra, n'a pas vraiment le moral. À une époque où on demande à tout un chacun d'être performant, confiant dans son avenir, de s'affirmer conquérant, de s'autoproclamer triomphant, elle n'épouse pas l'humeur du temps. Elle est trop blessée, trop lucide aussi pour cela. Elle a su très tôt, peut-être pour y avoir trop cru, que les lendemains ne chantaient pas nécessairement. Elle a anticipé en quelque sorte l'effondrement des idéologies, et développé son esprit critique et sa propension à la dérision plutôt que ses réserves d'enthousiasme. Elle était dans les cordes, subissait les revers économiques qui mirent à mal sa prospérité passée, et puisa dans cette épreuve la confirmation que, décidément, rien n'est acquis à l'homme. Il y a un fond de scepticisme wallon qui est la rançon de la clairvoyance, et du refus d'être dupe.
Des poèmes et nouvelles inspirés par la thématique de la Wallonie avec des écrivains comme Claude Javeau, Emmanuèle Sandron ou encore Daniel Simon.
À PROPOS DE LA REVUE
Marginales est une revue belge fondée en 1945 par Albert Ayguesparse, un grand de la littérature belge, poète du réalisme social, romancier (citons notamment
Simon-la-Bonté paru en 1965 chez Calmann-Lévy), écrivain engagé entre les deux guerres (proche notamment de Charles Plisnier), fondateur du Front de littérature de gauche (1934-1935). Comment douter, avec un tel fondateur, que
Marginales se soit dès l’origine affirmé comme la voix de la littérature belge dans le concert social, la parole d’un esprit collectif qui est le fondement de toute revue littéraire, et particulièrement celle-ci, ce qui l’a conduite à s’ouvrir à des courants très divers et à donner aux auteurs belges la tribune qui leur manquait.
Marginales, c’est d’abord 229 numéros jusqu’à son arrêt en 1991. C’est ensuite sept ans d’interruption et puis la renaissance en 1998 avec le n°230, sorti en pleine affaire Dutroux, dont l’évasion manquée avait bouleversé la Belgique et fourni son premier thème à la revue nouvelle formule.
Marginales reprit ainsi son chemin par une publication régulière de 4 numéros par an.
LES AUTEURS
Jacques De Decker, Yves Wellens, Gaston Compère, Roger Foulon, Richard Miller, Jean Louvet, René Hénoumont, Claude Godet, Daniel Simon, Michel Torrekens, Antoine Tshitungu Kongolo, Emmanuèle Sandron, Éric Brogniet, Françoise Lison-Leroy, Claude Javeau, Françoise Houdart, Liliane Schraûwen, Luc Dellisse, William Cliff, Jean-Pierre Dopagne, Monique Thomassettie, Anne-Marie La Fère, Marc Quaghebeur, Nicolas Ancion, Thomas Owen, Véronique Bergen, Charles Bertin, Gérard Adam et André Schmitz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
ÉditorialPar Jacques De Decker
Pourquoi « revue », pourquoi « rêvée » ? La Wallonie exista longtemps par ses revues, qui lui donnèrent, en fin de compte, son nom. Elle fut longtemps l’emblème d’un quotidien, dont le titre battait comme un étendard, et qui ensuite a cessé de paraître, la privant de cette affirmation journalière, de cette désignation récurrente de la « prière du matin de l’homme moderne », pour reprendre l’expression de Mallarmé. La Wallonie, aussi, se définit longtemps comme un rêve. Paul Caso, chroniqueur inlassable d’un art wallon, et dont l’amitié m’éclaira sur la question, aimait à rappeler que lorsque Louis Delattre publie en 1929 Le pays wallon, il place en exergue à son livre une phrase de Taine, qui dit : « Là, vivent des gens pleins d’étranges rêves ». La Wallonie, une usine à rêves plutôt qu’à penser des choses tristes ? C’est l’une des prémisses de ce rassemblement de textes, inattendu peut-être, anachronique aux yeux de certains, et dont l’idée s’est irrésistiblement imposée pourtant.
La Wallonie, on le verra, n’a pas vraiment le moral. À une époque où on demande à tout un chacun d’être performant, confiant dans son avenir, de s’affirmer conquérant, de s’autoproclamer triomphant, elle n’épouse pas l’humeur du temps. Elle est trop blessée, trop lucide aussi pour cela. Elle a su très tôt, peut-être pour y avoir trop cru, que les lendemains ne chantaient pas nécessairement. Elle a anticipé en quelque sorte l’effondrement des idéologies, et développé son esprit critique et sa propension à la dérision plutôt que ses réserves d’enthousiasme. Elle était dans les cordes, subissait les revers économiques qui mirent à mal sa prospérité passée, et puisa dans cette épreuve la confirmation que, décidément, rien n’est acquis à l’homme. Il y a un fond de scepticisme wallon qui est la rançon de la clairvoyance, et du refus d’être dupe.
Et pourtant, a-t-on envie de dire, la Wallonie existe, et peut-être plus que jamais. Cette région qui a ses propres usages du français, qui n’est pas française pour autant, même si elle le fut épisodiquement, non seulement parce qu’elle contribue à constituer la Belgique, mais parce qu’elle appartint à d’autres ensembles au fil de son histoire, est une contrée spécifique et fort originale dans le paysage européen. Située à un endroit éminemment stratégique, à l’approche de l’embouchure de grands fleuves, aux frontières des nations majeures du continent, au croisement de ses cultures principales, elle est plus que jamais mise en demeure de se définir et de s’affirmer.
Depuis que le mouvement flamand s’est consolidé, elle ne peut plus se bercer de l’idée d’une dilution dans la vaste francophonie belge. Elle ne peut davantage ignorer le problème bruxellois, et sa nécessaire solidarité avec une grande ville, l’une des plus importantes du monde actuel, qu’elle a contribué à peupler et à édifier, et où le français occupe une position dominante. Cette relation-là, pour complexe qu’elle doit, est un des atouts majeurs de son devenir. Mais on comprend qu’elle la considère avec méfiance, avec crainte parfois. Un Wallon, on l’a dit, ne ferme jamais les yeux sur rien. Et comme il ne croit pas à la providence, il ne met son destin dans les mains de personne.
Depuis quelque temps, le cinéma est son moyen d’affirmation le plus populaire. Et avec un évident succès. On sait un peu partout, désormais, que la Wallonie est un pays où les convoyeurs attendent, où l’on peut trébucher sur une promesse, où la force de la jeunesse peut, comme dans le cas de Rosetta, balancer entre la rage et le désespoir. Une autre face de la Wallonie est en train de faire le trou du monde. Jadis, c’était l’espièglerie de Pirlouit, la fantaisie de Fantasio, l’amitié de Blondin et Cirage, la première bande dessinée foncièrement antiraciste, née de l’imagination du grand Jijé. Plus loin encore, c’était la grisaille sans issue de Simenon. La Wallonie a ses humeurs et son humour, qui nourrissent sa créativité, au demeurant inépuisable.
La tentation était grande de demander aux écrivains ce que le pays d’où la plupart d’entre eux sont issus leur inspirait. Ce numéro n’est rien d’autre que ce coup de sonde, proposé à la veille de l’été, époque où les uns se mettent aux abonnés absents, où d’autres s’évadent, où d’autres encore ne veulent plus se laisser distraire de leurs grands projets. C’est dire que ces textes ne saturent nullement la question, qu’ils traduisent plutôt, par bribes, un état mental. Celui d’une Wallonie qui existe, sur le plan institutionnel, plus que jamais, en attendant, qui sait, de pousser plus loin encore son autonomie. Autonomie dont Jean-Marie Klinkenberg supposait, il y a vingt ans, qu’elle « pourrait donner un visage nouveau à la pratique littéraire dans nos provinces ». À voir le statut de notre littérature dans l’orbite francophone et ailleurs, elle ne s’est, de fait, jamais mieux portée. La transformation politique y a-t-elle contribué ? Certes. Mais l’on verra que ce progrès n’a pas pour autant cloué le bec à la critique, ni à la satire. Doit-on s’attendre à ce que la Wallonie, qui est attelée à un évident redressement, ne cesse pas pour autant de se fustiger elle-même ? Il faut non seulement s’y attendre, mais le souhaiter. C’est sa manière, pour elle qui se situe aux marches de tant d’empires, voire d’impérialismes, d’être irréductiblement marginale.
à Hugo, qui comprendra pourquoi
Entre épouvantails
Yves Wellens
No som fier de no Wallonie,
Eul monde étieu admir’ sé éefan,
Au promieu ran bri’ eus’ n’ industrie
È dée lés’ arts on l’ême étou.
Bieu que p’ti, no péï dépass’
Pa sé savan, dé pu grand’ nâssion,
È no volon branmée dé libérteu
Via pouquou no som fier d’étt’ walon !
Éeter walon, toudi no fratérnison ;
Dée l’maleur, on’ ême s’édeu ;
On fée eul bieu san jamée qu’on l’digîche,
Faisan tout’pou l’teni mucheu.
Eul chariteu visitan eul masur’
S’ipr’ee au nuit’aveue enn’ mass’deprécaussion ;
On doun’peu, meu ch’eu d’bon queur ;
Via pouquou no som fier d’ètt’ walon !
P’ti péï, ch’eu pou eut’ grandeur d’âme
Qu’ no t’êmon, san branmée l’dir.
No n’ œil eus’ voil dé qu’on é di du mau
È no queur eu prêt’ a s’ésquèteu.
Eun’ craingneu jamée lé co d’l’aut’,
Lé bra d’vos éefan vo défédron
I n’ fau gnieu braveu no rage :
V’la pouquou no som fier d’ètt’ walon ! 1
La tenue du concours fut longtemps menacée par les fortes réticences de nombreux responsables politiques régionaux et par leurs tentatives réitérées d’en atténuer les effets les plus voyants. Mais il put néanmoins se dérouler selon les règles édictées à l’origine. Simplement, il fut tacitement convenu que les projets sélectionnés ne seraient exposés que très peu de temps et dans un lieu retiré, sans pouvoir faire l’objet d’aucune commande publique.
Il faut se souvenir que l’un des principaux griefs formulés à son encontre voulait que le thème choisi (« Objet de passé et d’avenir en Wallonie ») recelait en lui une contradiction insurmontable. S’ils ne pouvaient ouvertement, alors même qu’ils se ressentaient comme tels, se proclamer les dépositaires d’un héritage déséquilibré par les erreurs commises et par les retards accumulés pendant des décennies, ses détracteurs soutenaient cependant qu’il fallait se détacher du passé pour se projeter hardiment dans l’avenir qui, en conséquence, devait seul être considéré. Mais c’était une position peu convaincante. Il était facile de rétorquer que, s’il est certes mortifère de se référer constamment au passé, celui-ci était profondément singulier : tandis que l’avenir risquait bien de mettre la Wallonie sur le même plan que beaucoup d’autres régions en Europe, où la prospérité en apparence revient, mais où l’amnésie progresserait toujours plus vite qu’elle, et dont, surtout, le destin serait, dans tous les sens du terme, commun. D’ailleurs, il était, ajoutait-on, absolument impossible, sauf à remodeler entièrement le paysage, d’ignorer les stigmates qui recouvraient la plus grande partie des décors de son ancienne grandeur - la Wallonie est assurément l’un des territoires les mieux pourvus en cette matière — et qui attestaient aussi bien de son incapacité à enrayer son déclin.
C’est d’ailleurs cette valse-hésitation, cet aller-retour, plus long dans un sens que dans l’autre, entre le passé et l’avenir que les organisateurs du concours escomptaient rendre sous une forme matérielle. Ils durent pourtant modifier leurs intentions en cours de route : au début, il n’était question que de suggérer, à titre purement indicatif, un symbole pouvant se substituer à l’inénarrable et suffisant volatile emblème officiel de la Région. Mais ils pensèrent reculer devant les envois successifs des candidats, tant ils étaient conscients que la remarquable coïncidence qui s’y rencontrait allait décupler l ire des responsables de haut niveau, plus que jamais à l’affût d’une provocation de trop. Car, comme par un fait exprès, la plupart des candidats avaient envoyé le même objet stylisé.
Certes, chacun de ces épouvantails présentait des variations assez nettes : quelques-uns étaient même fagotés dans des matières qui évoquaient ou étaient issues des nouvelles technologies. Mais, en effet, c’était chaque fois le même objet. Pour couper court aux soupçons d’entente ou de mystification qui commençaient à poindre, les créateurs retenus publièrent un texte qui, pour être de circonstance, n’en était pas moins déterminé. Ils y écrivaient notamment que « au-delà de la rhétorique et de l’auto-persuasion, il est clair pour nous que la Wallonie est perçue à l’extérieur comme un épouvantail en raison de son passé, et que, en retour, elle regarde l’avenir mécanique et sans relief qu’on nous vante partout comme un autre épouvantail. Voilà évidemment pourquoi, chacun de notre part et sans concertation, nous avons choisi cette figure. Il ne faut voir là aucune dérision. Un peu plus de lucidité sur les enjeux, peut-être ; moins d’assurances sur les résultats, sans aucun doute ! » Cette déclaration fit quelque bruit ; mais, comme souvent sous ces latitudes, elle ne fut pas réellement discutée…
Il n’empêche : le seul alignement de ces propositions démontrait que le diagnostic induit par la lecture du thème était généralement partagé et découlait d’une inspiration identique. À partir de là, tout s’emballa. Les conditions mêmes de l’exposition attisèrent les convoitises, exactement comme ces cadavres de condamnés livrés au bûcher étaient disputés par des médecins qui, en dépit de l’interdiction de ces pratiques, payaient très cher pour pouvoir emporter et disséquer les corps avant de les restituer tout dépecés et recousus à la hâte. Plusieurs amateurs se déclarèrent donc pour acheter les projets et les maquettes, ou approchèrent les créateurs à titre privé. Nombre de pièces disparurent d’ailleurs rapidement, et aucune n’a reparu jusqu’ici. On dit que, après avoir été volées, elles se retrouvèrent sur les circuits parallèles, où leur valeur marchande n’a cessé de monter.
Le projet récent d’un industriel, prétendant avoir racheté leurs droits de reproduction aux créateurs des épouvantails (ce qu’ils n’ont ni confirmé ni démenti), connaît du reste un engouement spectaculaire. La commisération et le côté dévalué et dépréciatif que peuvent susciter ces mannequins est contrebalancé, selon cet entrepreneur, par la démonstration d’un enviable savoir-faire et le goût de la belle ouvrage et de la finition. Ces objets plastifiés, servant de trousseau, de porte-clés ou de fétiche, sont en tout cas appelés à devenir vite familiers, autant que les coquilles vides qui firent un temps fureur dans la Capitale, après que l’État fédéral eut été délesté de ses dernières prérogatives, sans mourir pour autant.
1 Supplique imaginaire de Philippe Caroyez, à l’adresse des autorités de sa ville natale, pour l’adoption officielle d’une traduction en picard d’Ath de l’hymne wallon (tel que repris dans le Décret du 23 juillet 1998).
Noteu bieu : euch’ n’eu foc in’ essai, gnieu for orthodoxe. I faudroi d’mandeu au ‘Mon Evrard, a Lariguette… ou bieu co au deu échènn’. Qu’ i pardonîche, eul mayeur étou, eum’ éfrontrie.
Fils du cheval faé
Gaston Compère
Pour Emmanuèle SandronElle devinera pourquoi
Et crins et cris
Bayard à la renverse dans la nue électrique
et les cinq fils du duc Aymon que dispersent
l’ouragan gris le feu du Rhin
à coups de triques à coups de trucs
(la littérature purule dans la chanson)
et de traques infinies – crins cris –
infinies et la Meuse et la Muse
ne peuvent rien contre la rage
contre les crins contre les cris
contre l’orage de la vie
*
Viens-t’en petit Français
Plis déplis replis sur la frontière
du côté de Bouillon une dernière fois
plis de frais plis de biais
le mieux qui puisse se faire et se défaire
les deux Ardennes tête-bêche
Viens on te fera naître à Beauraing
(tête à l’envers ? tête à l’endroit ?)
Viens comme tes frères avec un d
(Renard Alard Guichard Richard)
Thurard ton nom sera Thurard
(tête à l’endroit ? tête à l’envers ?)
À pleines mains les crins – ceux de la queue
À pleine gueule les cris – ceux du jeu fou
Tu es le nègre à l’œil bleu blanc à l’œil blanc bleu
dont la cervelle étroite aime les cris l’écrou
– les crins et les crincrins du luxe pouilleux et
la luxure des chevauchées
en plein ciel d’août sur le ventre des forêts
*
Où cours-tu jeune Thurard ?
À Beauraing
prier la Vierge rare pour l’Ardenne
celle du dessous celle du dessus
hin hin hin
Où cours-tu Renard ?
À Beauraing
sous l’acacia d’argent et de tissu profus
Alard ? Guichard ? Richard ?
Tous à Beauraing à contre-vents
où se tremper les pieds dans la mare aux catarrhes
où se matelasser des omelettes au lard
où se curer le nez et les pieds en fanfare
Bayard où précipites-tu ton train Bayard ?
Nulle part
Nulle part et partout vieillard désassemblé
partout où la source a libre le vagin
loin loin de la mer ensablée
grande avaleuse de chibres floconneux
loin
Mais où encore ? mais où ? où ?
Loin de Beauraing
la Famenne est sage comme une crêpe de sarrasin
et raplateuplate la Famenne comme une femme anglaise
*** Mais partout mais partout mais partout
partout où se dérange le paysage
où se proposent le saut de l’ange
et le bond du séraphin
Où l’on se perd on se retrouve
J’ai cinq pattes cinq pattes rouges
Une par province vive la joie !
cinq j’ai cinq pattes qui toupillent
pattes de course et de tournoi
patte de chasse pattes de guerre
oriflammes olifants
cinq cris et crinière et amour vache
Liège Namur et les deux H
Hainaut Demibrabant
et Luxembourg enfin province hémiardennaise
points d’avoine et point d’orgue
de la neige et du soleil
Oh morgue noire
de ses forêts butoirs
à crins et à cris dans la fournaise
de l’Histoire
*
Je vais je vas je vons
Je pétarade et me voilà
malade presque en plein nuage
Je tombe et zon !
je vais je vas je vons
je trottine je crottine
des pains entiers pour les oiseaux niais
les petits qui battent la breloque coquine
et le coq cinq fois coq
le coq aux barbillons couillesques
atteint d’apoplecticité
ni coq amer ni coquemar le cauchemar
des pète-sec
le coq
qui dans son rêve rengorgé
lève comme il fut dit (ou presque)
très haut lève un pilon hardi
Et me revoici en quête
libre fumant monté de brumes violettes
et de mes cinq héros – violacés
le N par fluide ardent tracé sur les deux testichoses
les L de Pégase le virtuose aux crins de l’échine
le W dans les cris conjugués de la gorge et de l’abîme
le W comme deux racines