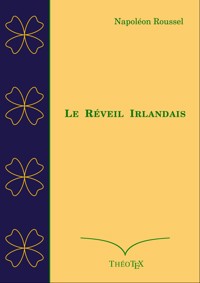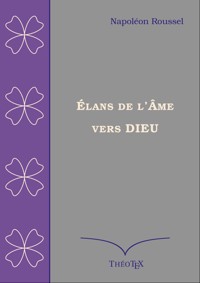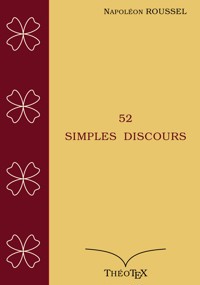
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
52 sermons de Napoléon Roussel écrits pour tous les dimanches de l'année. Destinés à des églises qui n'avaient pas de pasteur, ils se lisent encore avec grand profit spirituel aujourd'hui. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1855.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322474936
Auteur Napoléon Roussel. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Ce n'est pas au lecteur solitaire et muet que nous adressons cet avis ; mais au lecteur, à haute voix, présidant un culte de famille ou d'église.
Bien lire à haute voix n'est pas chose facile ; plus difficile encore est-il de bien lire un discours où l'esprit, le cœur et la conscience des auditeurs doivent être à la fois réveillés. Qu'on m'enseigne les mathématiques avec une voix criarde ou sonore, n'importe ; pourvu qu'on soit clair, cela suffit ; mais qu'on me lise un discours religieux avec hâte, et l'effet en est perdu.
Ce n'est pas seulement l'articulation distincte et mesurée des mots que réclame une telle lecture, c'est encore l'intelligence du sujet ; je dirai plus : c'est une communauté de sentiment avec l'auteur qu'on lit. Les mêmes paroles prononcées sur deux tons différents ont quelquefois deux sens opposés. Des paroles chrétiennes peuvent même devenir inintelligibles en passant par une bouche incrédule. Cette assertion paraîtrait peut-être étrange aux gens du monde, mais elle sera comprise des hommes de foi.
Sans aller si loin, voyez comme le gros du public attache de l'importance à la manière, au ton avec lesquels un sermon est prononcé en chaire. Comme le déclamateur est vite reconnu, malgré sa belle voix et son geste gracieux ; et comme dès lors l'édification de l'auditoire est compromise, pour ne pas dire complètement empêchée. D'autre part, qu'un homme simple, mais profondément convaincu, vienne vous parler du cœur, avec une voix faible ; comme au contraire vous tendez l'oreille, buvez ses paroles, et finalement, recevez du bien dans votre âme !
Trois conditions sont donc requises pour que la lecture d'un discours chrétien produise les effets désirés :
Pour atteindre ce triple résultat, nous conseillons un moyen unique, c'est que le lecteur, avant de lire un de ces discours devant son public, le lise d'abord pour lui-même en particulier. Par cette préparation de la veille, il en saisira mieux le sens et le sentiment, et dès lors il pourra mieux les transmettre à ses auditeurs du lendemain.
Si nous ne donnons pas un second conseil, c'est qu'il est sous-entendu. Le lecteur, comme le prédicateur, éprouvera sans doute le besoin de se préparer à l'accomplissement de sa tâche par le recueillement et la prière ; il sentira de même qu'il y aurait un contraste pénible entre un train de vie habituellement léger et l'heure sérieuse d'une lecture chrétienne ; il comprendra qu'il remplit à sa manière un sacerdoce, et que le salut d'âmes immortelles est intéressé à sa simple lecture. S'il en est ainsi, ce lecteur sera le premier auditeur de ces discours, comme il en recevra le plus de bien.
Une année vient de finir. – Une nouvelle année commence.
Sous laquelle de ces deux formes s'est présentée ces jours derniers à votre esprit ce passage du 31 décembre au premier janvier ? Si je connaissais votre âge, je pourrais faire votre réponse. Jeune, et dès lors chargé d'espérances et de projets, vous dites : « Une nouvelle année commence. » Vieilli, et dès lors oppressé de regrets et de craintes, vous murmurez : « Une année vient de finir. »
Cette tristesse attachée à la fuite du temps ne tient donc pas à la tournure de tel esprit ; elle naît chez tous avec l'âge ; elle arrivera pour les jeunes gens d'aujourd'hui comme elle est venue pour les hommes mûrs, jeunes gens d'autrefois. Ces joies et ces tristesses sont deux expériences à faire avec les années : ceux qui parcourent maintenant la seconde ont jadis traversé la première ; ceux qui traversent encore la première parcourront la seconde, si du moins, hélas ! ils vieillissent à leur tour ! Aujourd'hui heureux d'un nouveau pas fait dans la vie, plus tard ils en gémiront ; après avoir souri d'espérance, ils pleureront de déception ; et même, pour eux comme pour d'autres, à la suite des jouissances s'attacheront les dégoûts. Ne nous y trompons donc pas : quelles que soient notre jeunesse et nos pensées joyeuses dans ce moment, un jour vient où le timbre qui sonne une nouvelle année nous fera pleurer ou gémir.
Ce fait est général ; il ressort de notre nature ; il a été voulu par notre Créateur. Nous aurions donc tort de résister aux impressions tristes et sérieuses qui chaque année reviendront plus tristes et plus sérieuses. Les fuir ne serait pas en arracher les amères racines, mais en perdre les doux fruits. Cherchons plutôt les sources de cette tristesse ; peut-être en les découvrant parviendrons-nous à les tarir.
Le jeune homme, la jeune fille sont joyeux à la pensée d'une année ajoutée à leur âge, parce qu'ils espèrent beaucoup de cette vie. Ils marchent vers le jour où ils comptent dire à ce monde, comme l'Enfant prodigue à son Père : « Donne-moi la part des biens qui doit me revenir ; ma part de fortune, ma part de liberté, ma part d'influence, ma part de plaisir. » L'enfance leur semble une prison, et ils s'estiment heureux de voir s'avancer leur temps de réclusion !
D'où vient donc que ce jeune homme, cette jeune fille, vingt ans plus tard, s'attristent à la pensée qu'ils ont un an de plus ? C'est évidemment que ces vingt ans de vie ne leur ont pas tenu ce qu'ils avaient promis. A leurs premiers mécomptes, ces jeunes gens ont cru que la réalisation de leurs espérances n'était que retardée ; ensuite ils se sont dit qu'elle n'avait fait que changer de nature ; plus tard, ils ont reconnu qu'il fallait en attendre moins de bonheur ; et enfin ils en sont venus à confesser qu'ils avaient été complètement trompés dans leur attente. Aussi, vieillis d'âge et d'expérience, sont-ils aujourd'hui sans illusion et presque sans espoir pour l'avenir. Telle est la première cause de notre tristesse au commencement d'une nouvelle année.
Mais n'allons pas plus loin sans adresser quelques mots à ceux qui, tout en convenant de cette vérité pour nous, jeunes gens de jadis, ne veulent pas se l'appliquer à eux, jeunes gens d'aujourd'hui ; à ceux qui pensent que leurs pères ont été moins habiles qu'ils ne le seront eux-mêmes pour trouver le bonheur, illusion que nous comprenons d'autant mieux que nous aussi nous l'avons partagée.
Jeunes amis, vous croyez que la vie tiendra pour vous les promesses qu'elle n'a pas tenues pour nous ; mais voyez : nous aussi l'avions cru comme vous, et maintenant cette vie expérimentée par nous met à nu notre erreur. Quand nos pères nous disaient ce que nous vous disons, nous ne voulions pas les croire, comme ils nous assuraient aussi n'avoir pas voulu croire leurs pères leur tenant le même langage ; en sorte que, remontant de génération en génération, nous mettons en présence de vos espérances uniques une longue chaîne de déceptions. Croyez-vous donc encore découvrir autre chose que ce qu'ont trouvé tous les âges depuis Salomon, s'écriant : « Tout n'est que vanité ; » depuis Jacob, disant : « Nos jours ont été courts et mauvais ? » Oh ! mes amis, confiez-vous à l'expérience des siècles : vos espérances ne sont pas des nouveautés ; nous les avons eues ; elles nous ont trompés, elles vous tromperont. Nous avons sur vous l'avantage d'avoir traversé votre âge, et vous n'avez pas traversé le nôtre. Croyez-nous : la vie est une menteuse qui abuse de votre crédulité ; et plus tard, vous aussi serez tristes au commencement d'une nouvelle année.
Sans doute la déception est pénible ; mais elle ne suffit pas à nous expliquer la tristesse profonde de l'homme mûr avançant encore en âge ; car, après tout, si nos mécomptes étaient notre unique cause de larmes, nous pourrions nous consoler et accepter joyeusement une vie donnant moins, mais enfin donnant quelque chose. Pourquoi donc sommes-nous plus tristes que cette déception ne semble le justifier ? C'est qu'à la suite des déceptions de la vie vient inévitablement la pensée de la mort. La vie est peu de chose, cette découverte est pénible à faire ; mais bientôt cette vie ne sera rien : il faudra mourir ! et voilà ce qui assombrit encore des pensées déjà sombres. Celui qui reconnaît chaque année que l'attente de l'année précédente était vaine peut encore se persuader que celle de l'année suivante ne le sera pas, et ainsi d'année en année conserver ses vieilles illusions en les rafraîchissant. Mais quant à l'approche de la mort, il ne saurait en être ainsi. Le plus obstiné est bien obligé en vieillissant de reconnaître que sa fin est chaque jour plus probable, chaque jour plus prochaine, et que, quelque habile, quelque robuste qu'il soit, il y faudra venir. Cette pensée devient pour lui toujours plus présente, plus vive, plus vraie, ou du moins d'une plus éclatante vérité.
« J'avance vers la mort. » Comment cette pensée n'attristerait-elle pas la vie ? Sur le petit nombre d'années qu'il me reste, une vient d'être retranchée ; encore quelques renouvellements semblables, et puis moi, moi qui parle, moi qui écoute, moi, moi, non pas un autre, mais moi je mourrai ! On m'enveloppera d'un drap mortuaire, on déposera mon corps dans une bière, et mon corps et ma bière seront portés au cimetière voisin. » Voilà non pas du probable, mais du certain. Et tout cela s'approche, tout cela n'est qu'à deux pas. Oh ! comment ne pas s'effrayer à de telles réflexions, et comment fuir de telles réflexions quand une nouvelle année commence ?
Mais est-ce bien là tout ? Aucune autre cause de tristesse ne vient-elle se mêler aux premières ? Hélas ! nous le voudrions croire, mais nous ne le pouvons pas. Il y a sur le lit de mort de ces terreurs, de ces larmes, de ces regrets, disons-le, de ces remords que l'attente du néant ne peut pas expliquer. Sans aller épier le lit d'un moribond, je découvre dans la vie des hommes en santé de ces traits qui décèlent un esprit occupé d'autres craintes. Et si vous me parliez du calme de tel incrédule ou même de ses mépris et de ses attaques contre toute foi religieuse, je trouverais là même de nouveaux indices que cet homme redoute un sort pire que la mort. Voyez quelle antipathie il manifeste au seul nom de Dieu ! quelle vivacité quand on lui parle de jugement ! quelle moquerie haineuse quand on l'entretient d'un avenir ! Pourquoi se soulever si violemment contre ce qui, selon lui, n'existe pas ? Pourquoi maudire un Dieu qu'il nie ? Pourquoi blasphémer une religion qu'à son avis il faut conserver, sinon pour lui, du moins pour les autres ? Ah ! c'est qu'au fond de cet homme est une conscience plus forte que sa volonté, lui criant qu'il existe un maître dans le ciel et du péché dans son cœur.
Oui, pour l'incrédule comme pour le croyant, voilà la dernière et la plus puissante des causes qui l'attristent en avançant dans la vie. Il a fait le mal ; il ne veut pas se l'avouer, et ce mal accompli, semblable à la flamme qu'on repousse sur un point, se fait jour sur un autre ; ou si, comme la flamme encore, on lui ferme toute issue, ce mal consume cet homme à l'intérieur. Il y a incendie dans sa maison, bien que les portes et les fenêtres soient fermées. Ne soyez donc pas étonnés s'il souffre ; attendez-vous bien plutôt à voir avec ses années s'accroître ses souffrances.
En effet le péché s'accumule dans sa vie, et chaque jour ses souvenirs plus nombreux deviennent plus poignants. Ajoutez, à ce nombre toujours croissant, la lucidité de vue que donne l'approche de la mort ; cette conscience qui reprend d'autant plus de ressort que les passions affaiblies par l'âge pèsent moins sur elle ; et vous comprendrez alors que l'homme réfléchi s'inquiète en faisant un compte toujours plus long de ses jours et de ses péchés.
L'illusion détruite, la mort prochaine, le souvenir du péché, voilà donc la triple source d'où jaillit notre tristesse au renouvellement de chaque année. Si notre corps se plaint d'une maladie unique, comment notre âme ne gémirait-elle pas sous trois souffrances morales ? Ah ! sans doute, en voilà plus qu'il n'en faut pour nous expliquer ce que ces jours derniers quelques-uns de nous ont senti, et ce que plus tard, jeunes gens, vous devez sentir à votre tour.
C'est ainsi que le jour de la vie va se décolorant de teinte en teinte jusqu'aux ombres de la nuit. Et que les plus sages d'entre nous ne s'imaginent pas pouvoir, eux mieux que d'autres, échapper aux tristesses de la déception, aux terreurs de la mort et aux angoisses du péché. Non, et s'ils y parvenaient, ce ne serait que pour être plus malheureux, en trompant ainsi des plans de miséricorde à leur égard. Dieu a fait notre cœur tel que tout s'y assombrit à mesure que le flambeau de notre vie va faiblissant. Il a voulu ces tristesses, ces terreurs, ces angoisses, et, si nous réussissions à nous y soustraire, ce Dieu nous ramènerait encore au même but par notre santé faiblissant avec l'âge, nos sens s'émoussant de jour en jour, nos dégoûts croissant, cris d'avertissements jetés dans notre vie pour nous faire songer à la mort, au jugement, à l'éternité. Si notre existence eût toujours été pleine d'espérances, de santé, de désirs ; si la probabilité de notre mort n'eût pas été chaque jour croissante, il est certain que nous fussions toujours restés loin des idées sérieuses et par conséquent de salut. C'est précisément l'incertitude de notre vie et la certitude de notre mort qui, comme deux aiguillons dans nos flancs, nous poussent vraiment aux idées religieuses, et sans elles nous nous endormirions volontiers ici-bas pour rêver aux ombres passagères de cette vie.
Pour nous en mieux persuader, aidons-nous d'une supposition. Admettons que notre vie terrestre, coule toujours à pleins bords ; que ni souffrance, ni vieillesse ne viennent nous avertir de son terme ; supposons ensuite que notre existence puisse se prolonger ici-bas cinquante siècles aussi probablement que cinquante années ; en un mot supposons que rien ne nous fasse pressentir la mort, et que notre vie puisse être durable comme un soleil ou passagère comme une vapeur ; quelles croyez-vous que seraient alors nos pensées habituelles ? Nous comparerions-nous à ceux qui ne vivraient que quelques jours, ou à ceux qui vivraient quelques siècles ? Nous promettrions-nous l'existence prolongée, ou celle sans lendemain ? Et dans cette vie où rien ne viendrait pâlir nos espérances affaiblir notre santé, détromper nos illusions, aiguillonner notre conscience, nous arracherions-nous bien aisément au tourbillon de nos affaires du moment pour nous occuper d'une vie à venir, ne commençant peut-être qu'au bout d'une longue chaîne de siècles ?
Ah ! vos consciences ont déjà répondu : Non, non. Dans une telle existence nous vivrions de la vie du jeune homme qui se croit si loin de la mort et de la souffrance qu'il se plaît à les affronter ! Nous vivrions de cette vie insouciante, molle, pécheresse, qui nous éloignerait toujours plus de Dieu. Aussi ce Dieu n'a-t-il pas voulu nous donner une telle existence, longue et prospère ici-bas. Aussi ce Dieu a-t-il accumulé dangers, déceptions, incertitude, douleurs et mort dans les étroites limites de quelques années, et, s'il l'a voulu, c'est qu'il était bon pour nous qu'il en fût ainsi. Comment, dans une existence qui faiblit dès le lendemain du jour où l'on y entre ; comment, au milieu de biens qui se rouillent du jour même où on les amasse, dans une vie où toute joie trompe, toute espérance ment, toute action laisse un regret et si souvent un remords, enfin comment, dans une vie qui ne varie pas entre la durée d'un soleil et la durée d'une vapeur, mais bien entre un quart et un demi-siècle ; comment, dis-je, dans une vie tellement restreinte, l'homme pourrait-il ne pas songer à la mort et se dérober à la pensée de l'éternité ? Non, c'est impossible ! Et c'est précisément dans cette impossibilité que Dieu a voulu nous enserrer pour nous contraindre à réfléchir.
L'incrédule dit en souriant que les vieillards deviennent religieux parce qu'ils ont peur de la mort. Eh bien, oui, cela est vrai, très vrai ; mais qu'est-ce que cela prouve, sinon que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la crainte de la mort pour le contraindre à devenir religieux ? N'est-ce pas précisément parce que cela arrive que cela devait arriver ? Dès lors ne devient-il pas évident que Dieu l'avait ainsi préparé, ainsi voulu ! Le vieillard, en suivant cette marche, échappe-t-il donc à sa nature ? Non ; et plus vous me montrez d'exemples d'hommes devenus croyants sous les désenchantements de la vie et les craintes de la mort, mieux j'en conclus que ce résultat n'était pas imprévu de son Créateur.
Ainsi ne vous bercez pas d'une illusion de plus : inévitablement la vie pâlira pour vous comme elle a pâli pour d'autres : elle est faite pour cela ; vous ne pouvez pas échapper à des lois que Dieu lui-même a posées. Et si vous le pouviez à force de dureté de cœur et d'aveuglement d'esprit, alors malheur, malheur à vous ! car vous auriez échappé aux derniers efforts de la bonté de votre Créateur pour vous amener à votre véritable destinée !
Ne vous débattez donc plus sous les étreintes de la nécessité ; pour vous, la vie deviendra pauvre ; pour vous, chaque fin d'année deviendra triste ; et la pauvreté de votre vie, la tristesse de vos fins d'année croîtront toujours, comme toujours aussi vos jours s'abrégeront.
Et maintenant, de ces maux inévitables indiquerons-nous le remède ? Ne l'avez-vous pas déjà deviné ? Qui nous consolera de nos illusions sur la terre, si ce n'est l'assurance du bonheur dans les cieux ? qui nous rassurera à l'approche de la mort et nous la fera presque désirer, si ce n'est la certitude d'une vie au-delà de la tombe, d'une vie sans souffrance et d'une vie sans mort ? Mais pardessus tout, qui calmera les angoisses de notre conscience, qui nous déchargera de ce poids de péchés, si ce n'est la Bonne Nouvelle que nous avons un Sauveur qui nous arrache à la condamnation, et un Dieu qui nous a aimés jusqu'à nous donner, malgré nos fautes, une éternelle béatitude qui n'était due qu'à la sainteté ?
Oui, une réception complète de l'évangile, voilà ce qui changerait la triste perspective de notre vie. Mais, hélas ! voilà ce que nous sommes loin d'avoir réalisé. Nous espérons en partie ; nous croyons en partie, nous nous sanctifions modérément ; nous prenons le remède sur le bord des lèvres. Ne soyons donc pas étonnés de n'être pas encore guéris. Quand nous avons bu à la coupe de la foi, nous en avons été rafraîchis ; quand, au contraire, nous avons éloigné la céleste boisson de notre bouche, nous avons été plus souffrants, et toujours nos joies et nos peines ont été dans la juste mesure du remède que nous avons accepté.
Ne nous plaignons donc plus de nos maux ; il dépend de nous d'en être soulagés. Approchons-nous de Dieu ; tenons-nous fermes aux promesses de l'Évangile, et les années, en s'accumulant sur notre tête, loin de nous effrayer, nous trouveront plus calmes ; car chaque pas vers la mort de la terre nous rapprochera de la vie des cieux.
Avant la venue de Jésus sur la terre, les prophéties qui l'annonçaient étaient lues, non seulement dans le texte au sein de la nation juive, mais encore dans des traductions au milieu de peuples divers. Aussi, même d'après le témoignage d'auteurs païens de l'antiquité, tout l'Orient était-il alors dans une attente anxieuse d'un être extraordinaire. On comprend donc très bien que des sages, pleins de leurs études du saint Volume, aient été, encore plus que le vulgaire, attentifs aux signes des temps, afin de découvrir les lieux et le jour où devait naître ce Messie libérateur, Roi des Juifs et Fils de Dieu.
Aussi trouvons-nous tout naturel que quelques-uns de ces mages, partis d'Orient, viennent en Judée chercher et adorer Celui que l'étoile miraculeuse leur désignera. Faire un voyage et même un long voyage pour contempler le Sauveur du monde, est-ce donc trop ? Déposer devant lui des présents d'or et d'encens, est-ce prodigalité ? Se prosterner devant sa face et adorer en silence le Fils du Créateur des cieux et de la terre, qui lui-même va créer bientôt un monde moral, est-ce une exagération ? Non, sans doute. Il n'y a que simple harmonie entre la naissance d'un Sauveur et l'adoration des sauvés. Aussi la lecture de cette histoire n'a-t-elle rien qui nous surprenne. Nous trouvons tout simple, tout naturel, que les mages soient partis du fond de l'Orient, venus jusqu'en Judée ; qu'ils aient répandu leurs trésors et leurs âmes devant le Seigneur. Mais si nous ne sommes pas étonnés de la conduite des mages, est-ce bien parce qu'elle est toute simple, toute naturelle, toute en harmonie avec l'objet important qui la dirige ? Oui, probablement. Toutefois, pour répondre avec encore plus de certitude, examinons un fait analogue, mais plus récent.
On nous apprend qu'un certain nombre de jeunes missionnaires chrétiens sont partis pour aller en Afrique annoncer aux indigènes qu'un Sauveur leur est né, et qu'il est mort pour eux. On nous apprend de plus qu'après avoir écouté ces missionnaires, ces indigènes, plein de joie, se sont convertis à l'Évangile. Toutes ces nouvelles n'ont rien qui nous étonne. Je ne voudrais pas dire que nous y soyons indifférents ; mais enfin depuis longtemps on nous en répète de semblables sans beaucoup nous surprendre. N'est-ce pas aussi parce que nous trouvons tout simple que ces jeunes missionnaires, sauvés par Jésus-Christ, aillent, par reconnaissance, faire connaître leur Sauveur à ceux qui l'ignorent ? N'est-ce pas parce qu'il nous paraît tout naturel que la Bonne Nouvelle du salut réjouisse des idolâtres gémissant sous le poids de leur longue dépravation ? En un mot, notre calme ne vient-il pas de ce que nous trouvons que missionnaires et indigènes ont fait ce qu'ils devaient faire ? Oui, probablement. Maintenant comparons ces faits si simples, si naturels, les mages d'Orient et des missionnaires d'Afrique, à d'autres faits non moins connus de nous et peut-être moins rares.
Chaque jour les chaires de nos églises, les livres de nos maisons, les journaux de nos docteurs, les bulletins de nos sociétés, chaque jour ces mille voix chrétiennes nous entretiennent de l'amour immense de Jésus pour nous. Toutes nous répètent à l'envie que Christ est mort pour effacer nos péchés, que Dieu nous offre les dons de son Esprit, que le ciel nous est assuré, et que nous, qui sommes là, nous plongés dans la misère, la souffrance, les tentations et le péché, nous, nous-mêmes, dans quelques années, nous serons portés près de Dieu pour y vivre heureux durant une éternité. Certes, si jamais nouvelle grande, douce, réjouissante, nous fut annoncée, c'est bien celle-là. Si jamais pensée fut capable d'émouvoir le cœur et de renouveler la vie, c'est bien cette pensée ; et une existence toute d'adoration pour Dieu, toute de charité pour nos frères, ne serait qu'une suite bien naturelle, bien simple, de ces dons magnifiques. Comment se fait-il donc qu'il n'en soit pas ainsi ? Que dis-je ? comment se fait-il qu'il arrive exactement le contraire ? Comment se fait-il que ces nouvelles si bonnes nous laissent si froids ? Comment se fait-il que ces promesses si grandes nous laissent sans émotion ? Enfin comment un avenir si brillant laisse-t-il notre présent tellement pâle qu'il soit impossible aux hommes qui se croisent avec nous dans ce monde de soupçonner en nous de futurs habitants des cieux ?
Serait-ce que nous nions les faits évangéliques ? Non, car ce serait être incrédule, et nous professons d'être croyants.
Si nous ne nions pas les faits évangéliques, contestons-nous leur importance, et disons-nous que ce n'est pas la peine d'être si constamment touchés d'un pardon absolu, et si fort réjouis par le don d'un ciel et d'un Dieu ? Non ; car, lorsqu'on nous oblige à répondre individuellement, nous avouons que rien de comparable ne nous a jamais été présenté ; nous convenons, avec l'apôtre, que le monde entier n'est rien « en comparaison du poids éternel d'une gloire infiniment excellente. »
Non, nous ne nions pas les faits ; non, nous ne contestons pas leur importance ; et toutefois ces faits magnifiques, ces faits qui nous sauvent, ces faits qui nous ouvrent le ciel, mis devant nos yeux, ces faits nous laissent indifférents ! Oui, Jésus est mort pour moi ; oui, je suis un être immortel ; oui, je vais partir bientôt pour les cieux ; je sais tout cela. Vous me le répétez, mais c'est inutile. Je devrais m'en réjouir, je le sais bien, et cependant je reste froid ; comme rassasié de cette nourriture spirituelle, j'en ai perdu le goût ; mon palais en est blasé, et si vous insistez pour me l'offrir encore, vous soulèverez mes dégoûts !
Je le demande : est-ce là une conduite toute simple, des sentiments tout naturels ? Y a-t-il conséquence, y a-t-il harmonie entre ces grandes vérités évangéliques et la mesquine conduite, les mesquins sentiments qu'elles obtiennent de nous ? Non, sans doute, non ; et si maintenant nous nous reportons à la conduite des mages venant du fond de l'Orient pour adorer Jésus, ou bien aux sentiments pieux de sauvages convertis, peut-être ne les trouverons-nous plus aussi simples, plus aussi ordinaires ; car, à coup sûr, nous, aujourd'hui sauvés par le même Jésus, nous ne serions pas pour lui prêts à faire le voyage d'Orient, pas plus qu'à partir pour l'Afrique.
D'où vient cette différence entre la conduite de ces mages, les sentiments de ces sauvages, d'un côté, et notre propre conduite, nos propres sentiments, de l'autre ? Je pourrais, mes frères, vous rapprochant de ces hommes, m'efforcer de vous faire rougir par une comparaison qui ne tournerait pas à votre avantage. Mais non, je ne veux rien exagérer. Prédicateur du moment, je ne tirerai pas avantage de ma position pour vous accuser, vous mes auditeurs, moi votre frère dans le péché. Non, vous n'êtes pas pires que ces hommes de jadis. Je pense, au contraire, que ces mages et ces idolâtres, à votre place, eussent exactement agi comme vous ; comme vous ils eussent été froids en face de l'ardent amour du Sauveur. Je vais plus loin, et je crois que vous, mis à la place de ces mages et de ces idolâtres, vous eussiez fait tout aussi bien qu'eux, vous fussiez partis d'Orient ; vous eussiez donné votre or, converti votre vie, et répandu votre âme en actions de grâces. Ne nous y trompons pas : l'homme est le même, dans tous les temps et dans tous les lieux ; ce n'est donc pas dans la différence qu'il y a entre vous et ces hommes, vos semblables, qu'il faut chercher l'explication de vos conduites différentes ; non, il faut la chercher dans la différence de vos positions. Expliquons-nous.
D'abord il est si vrai que, mis à la place des mages et des idolâtres convertis, vous eussiez fait comme eux, que vous pouvez trouver dans votre propre passé des sentiments et des actes semblables aux leurs. Oui, vous avez une fois tressailli à la pensée saisissante qu'un Dieu était mort pour vous ; oui, vous avez senti dans votre cœur la présence et les joies du Saint-Esprit ; oui, enfin, vous avez jadis eu du zèle, de l'activité, de l'amour pour vos frères, et peut-être pourriez-vous citer telle époque de votre vie où vous eussiez donné votre sang par amour du Sauveur.
Comment se fait-il donc qu'il n'en soit plus ainsi ? Hélas ! je l'ai fait pressentir en rappelant votre conduite chrétienne : ce sont là vos sentiments et vos actes de jadis ; oui, de jadis : ce mot dit tout. Quand, pour la première fois, vous avez compris l'amour de Dieu et cru qu'il vous avait sauvé, votre cœur en a été transporté. Mais, chose étrange ! à mesure que vous vous êtes éloignés de ce moment de révolution, vous vous êtes refroidis ; plus longtemps on vous a répété que Dieu vous aimait, moins vous avez été sensibles à son amour ; plus longuement on a déroulé devant vous la liste de ses bienfaits, moins vous vous êtes sentis reconnaissants. Quand on vous en reparlait, vous vous disiez en vous-mêmes que vous saviez tout cela, qu'il n'y avait là rien de nouveau, rien de saisissant. Les paroles d'amour frappaient votre âme comme les sons d'une cloche, un long jour de fête, frappent notre oreille et finissent par n'en plus être entendus. Pour dire tout en un mot qui rendra bien notre pensée, vous vous êtes habitués à être pardonnés, habitués à être sauvés, habitués à l'héritage du Ciel, habitués à la possession de tous les biens évangéliques ; et ainsi, riches depuis longtemps, vous n'avez plus senti les joies de la richesse que Dieu vous avait donnée dans votre pauvreté.
L'habitude, l'habitude, voilà le grand ennemi de la spiritualité de notre vie ; voilà ce qui endort l'esprit, voilà ce qui engourdit l'âme et laisse le corps, comme un somnambule, tenir une conduite sans valeur parce qu'elle est privée de sentiment. Oui, nous nous lassons de penser, de sentir, d'aimer, hélas ! Tout ce qui est esprit devient fatigant pour nous, et nous mettons à la place l'acte matériel machinalement accompli par l'habitude ; et ainsi nous arrivons à agir bien sans plaisir, à contempler la vérité sans joie, à nous voir sauvés sans étonnement.
Ce n'est pas tout : non seulement l'habitude nous porte par paresse d'esprit à isoler l'acte du sentiment, mais encore elle nous conduit à jouir des privilèges les plus grands, des faveurs les plus inattendues, comme si ces faveurs et ces privilèges nous étaient dus, comme s'ils étaient nos biens propres, comme si nous les avions acquis par nos forces ou nos mérites ; en sorte que nous acceptons, par exemple, le ciel en don et nous disposons à y pénétrer sans reconnaissance. Que Jésus soit mort pour nous, qui ne sait cela ? Combien de fois ne nous l'a-t-on pas dit ? N'est-ce pas avec cette vérité que nos nourrices ont bercé notre enfance ? cette vérité que nos maîtres nous ont fait réciter dans notre jeunesse ? dont nos pasteurs nous ont saturés pendant notre instruction religieuse ? Enfin, n'est-ce pas cette vérité qu'on nous répète en chaire sans cesse et sans se fatiguer ? C'est la religion de notre enfance, de nos parents, de notre pays. Nous en avons toujours entendu parler ; c'est notre propriété ; comment donc en serions-nous surpris, émerveillés ?
Oh ! tristes effets de l'habitude ! coupable mollesse de notre cœur, indigne paresse de notre esprit, que ne pouvons-nous les détruire comme nous pouvons les signaler ! Eh quoi ! les grandes vérités évangéliques, pour être déjà connues de nous, ont-elles donc perdu de valeur ? L'or s'évapore-t-il en vieillissant ? Ne sommes-nous pas tout aussi sauvés aujourd'hui que le jour où nous l'avons appris pour la première fois ? Le ciel, pour nous avoir été donné jadis et ainsi pour être plus près de nous, en est-il moins précieux ? Si la main de Dieu se retirait de nous aujourd'hui, serions-nous plus capables de nous soutenir au-dessus de l'abîme des enfers que nous ne l'avons été jadis de nous en éloigner ? Pour nous avoir aimé longtemps, Jésus est-il moins digne de notre amour ? Parce que son héritage est plus près de nous échoir, l'apprécierons-nous moins ? Faudrait-il enfin, pour nous rendre à notre premier amour, que Dieu nous retirât quelques-uns de ses bienfaits ? Eh bien, oublions notre passé, effaçons de notre âme les tristes plis de l'habitude, redevenons des êtres neufs qui n'auraient jamais entendu parler de Christ, et qui pour la première fois apprendraient, comme les mages, au milieu d'un monde plongé dans le péché, qu'un être extraordinaire vient de naître. Regardons : une étoile se lève et marche ; l'Esprit-Saint nous dit de la suivre ; nous arrivons près d'une crèche, et sur un peu de paille nous trouvons gisant le Fils de Dieu ! Ce Sauveur se lève, grandit, instruit le monde ; et quand ce monde méchant ne veut plus l'entendre, ce Sauveur tend les bras, présente son côté, appelle le fer, donne son sang, et, sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le sachent, il ouvre à ses ennemis une voie de salut. Son œuvre accomplie, il monte au ciel ; là il prie encore son Père pour les générations à venir, et, au fur et à mesure que nous, hommes, passons sur cette terre, ce Sauveur dans les cieux intercède pour nous, en sorte qu'à cet instant même pour moi, moi-même qui prononce ces paroles, pour vous, pour vous-mêmes qui les écoutez, Jésus vit, aime et prie dans le ciel. Faut-il inventer de nouveaux mots pour prévenir l'effet de l'habitude sur ces choses anciennes, mais toujours vraies, toujours vivantes, toujours actuelles ? ou bien faut-il inventer des choses nouvelles, mais fausses, pour éveiller votre attention et remuer votre âme ? Ah ! luttez, luttez plutôt vous-mêmes contre cette apathie qui engourdit comme le sommeil, gagne en s'avançant comme la paralysie, s'étend de membre en membre comme la gangrène, et se propage jusqu'à ce que mort s'ensuive. Réveillez-vous, secouez l'habitude, et, pour y réussir, priez plus souvent votre Dieu, non plus avec ces prières d'habitude elles-mêmes, faites à heure fixe et dans des mots récités ; mais avec ces prières comme vous en adressez aux hommes dans vos moments d'angoisses, ces prières senties, brûlantes, qui forcent la grâce à descendre des cieux. Ensuite méditez, au lieu de la parcourir, la sainte Parole que par habitude encore vous lisez avec tant de nonchalance. Lisez-la comme vous liriez une lettre venue de Dieu, ou seulement, hélas ! comme vous lisez la lettre d'un simple homme impatiemment attendue. Enfin, descendez plus souvent dans votre conscience ; creusez-la plus profondément, sans paresse, sans pitié ; creusez votre conscience comme le médecin creuse de son fer la plaie qu'il veut guérir, au lieu de la bander comme le malade en détournant les yeux ; et peut-être alors apprécierez-vous mieux et plus constamment le prix d'un Sauveur pour lequel des sages n'ont pas cru trop faire en venant du fond de l'Orient pour l'adorer et déposer à ses pieds leurs dons les plus précieux.
Comme ces scènes orientales saisissent et charment l'imagination ! Quelle simplicité de mœurs, quelle tranquillité dans la nature au milieu de ces immenses solitudes de Mamré, quelle douce paix dans l'âme du patriarche assis à la porte de sa tente, et promenant ses regards au loin dans la plaine pour y chercher un voyageur à secourir ! Un vaste silence règne au désert. Hommes et troupeaux se reposent ; le soleil dardant ses rayons scintillants sur le sable semble seul vivre à cette heure du jour. Cependant trois étrangers courbés sous la fatigue passent à quelque distance sans paraître vouloir s'arrêter. Abraham, qui veille sur l'occasion pour faire le bien, comme d'autres veillent sur leur proie pour faire le mal, Abraham les aperçoit, se lève, court à leur rencontre, les arrête, et les supplie… de quoi ? de venir recevoir l'hospitalité dans sa tente. C'est à genoux qu'il les presse ; et, sans les connaître, il les nomme ses seigneurs, lui qui, ailleurs, traite d'égal à égal avec des rois. Il leur offre à la fois, dans son empressement, le repos sous un arbre, la nourriture dans sa tente, et jusqu'à l'humble office de laver leurs pieds. Les voyageurs ont à peine accepté qu'Abraham retourne vers sa tente en toute hâte, pour servir, lui vieillard, de jeunes hommes, et charger des soins du repas, non les mains de ses serviteurs, mais celles de Sara, sa femme bien-aimée. En contemplant une vie si simple, si douce, si calme, on se surprend à regretter de n'avoir pas vécu dans ces temps antiques ; on forme presque le souhait de les voir revenir pour échapper à l'existence factice et mensongère de nos jours.
Mais, quelle que soit la douceur de ces scènes orientales, ce n'est cependant pas elles que nous contemplerons aujourd'hui. Nous voulons seulement en détacher une figure, celle d'Abraham ; et même, de cette figure, ne signaler qu'un trait, son hospitalité. Reprenons donc notre récit pour l'étudier à ce point de vue.
Au temps d'Abraham, et surtout dans les plaines de Mamré, les facilités d'abriter et de nourrir le voyageur dans des maisons communes, et à ses frais, ne se trouvaient pas comme de nos jours et parmi nous. L'hospitalité des individus était donc plus nécessaire ; aussi était-elle générale. Nous ne voulons donc pas présenter comme extraordinaire qu'Abraham ait convié dans sa tente trois voyageurs ; non, il n'aurait fait en cela qu'acquitter la dette de l'humanité, rendue plus sacrée encore par les circonstances et l'époque. Mais ce que nous voulons signaler, c'est la manière touchante dont le patriarche accomplit ce devoir.
Ce devoir, ai-je dit ; mais, à contempler l'empressement d'Abraham, ne croirait-on pas plutôt que l'hospitalité soit pour lui un privilège, une joie, un bonheur ? Voyez comme il cherche des yeux qui il pourra découvrir ; comme il court à la rencontre de ceux qui ne lui demandent rien ; comme il les presse, les prie de se laisser servir. Et puis comme il se hâte, appelle sa femme, ses serviteurs, les occupe tous, et s'emploie lui-même à préparer repos et nourriture pour des hommes qu'il ne connaît même pas ! Sans doute, ces hommes sont des anges ; mais Abraham l'ignore, sans cela sa conduite n'aurait rien de bien étonnant. Maintenant reprenons l'un après l'autre les détails de l'hospitalité du patriarche, et comparons-la à celle de nos temps, disons mieux, comparons-la à la nôtre propre. Et ce n'est pas au hasard que j'ai pris ce sujet : la saison rigoureuse où nous entrons ne rend, hélas ! que trop nécessaire un redoublement de zèle dans l'exercice de notre bienfaisance.
D'abord Abraham, assis à la porte de sa tente, cherche des yeux quelqu'un à secourir ; comme le bon Samaritain il ne rencontre pas sur sa route un malheureux ; mais il le cherche et il en trouve trois. Il ne s'en tient pas strictement au précepte chrétien de ne pas se détourner de l'emprunteur, mais il court à sa rencontre.
Quant à nous, en quoi sommes-nous les plus ingénieux, à chercher ou à fuir les infortunés ? Que leur adressons-nous de préférence : des exhortations à venir vers nous ou des excuses pour nous dispenser d'aller vers eux ? Est-ce nous qui les prions de recevoir, ou bien eux qui nous supplient de leur donner ? Enfin, si nous les réduisons à nous prier, est-ce pour leur imposer ensuite la confusion d'un bienfait ou la honte d'un refus ?
Je le dirai : la bienfaisance est trop rare chez les chrétiens. J'irai plus loin et j'ajoute que, peut-être parce que les gens du monde, sous prétexte de secourir les corps qui souffrent, négligent les âmes qui se perdent, certains chrétiens, pour s'occuper des âmes qui se perdent, oublient peut-être les corps qui souffrent. Sans doute ils prétendent rétablir ainsi l'équilibre dans l'ensemble en portant leurs offrandes dans le bassin que les incrédules laissent vide ; mais ils devraient comprendre que c'est ici l'œuvre de la Providence et que pour eux ils ont plutôt à mettre cet équilibre entre leurs propres œuvres, et, sans faire moins pour l'évangélisation, à faire plus pour la bienfaisance. Donner aux pauvres, c'est plus que soulager leurs besoins temporels, c'est aussi leur montrer les fruits de la foi, et par cette prédication vivante les appeler à la vérité qui sauve pour l'éternité. Oui, ayons le courage, moi de le répéter, vous de l'entendre : notre préoccupation pour les âmes de nos frères nous fait quelquefois perdre de vue les besoins de leurs corps. Loin d'aller au-devant d'eux, loin même de les écouter à leur rencontre, nous nous montrons habiles à les éviter. Nous ne nous asseyons pas comme Abraham sur le devant de notre tente, nous allons nous cacher derrière et faisons dire par Sara que nous n'y sommes pas. Nous envoyons nos serviteurs à l'indigent, non pour laver ses pieds, mais pour l'engager à continuer son chemin. Alors il nous est facile de nous persuader qu'il n'existe pas des infortunés. Non certes, il n'en existe pas pour nous qui fermons les yeux et la main. Mais revenons au patriarche, sa conduite nous réjouira le cœur autant que la nôtre vient de l'attrister.
Que donne Abraham à ces étrangers ? Est-ce une place parmi ses serviteurs et les restes de son repas ? Non. Il veut que Sara prenne de la fleur de farine, et ce qu'il choisit dans son troupeau, c'est une bête bonne et grasse. En un mot, il donne ce qu'il a de mieux.
Quant à nos dons, nous pourrions les caractériser ainsi : nous donnons ce qui nous coûte le moins, et surtout ce qui, donné par nous, ne nous prive de rien. Ce n'est pas que je veuille ici pousser personne jusqu'à la limite de la charité chrétienne, qui sait, comme la veuve de Jérusalem, pour donner, prendre sur son nécessaire. Mais ce que je voudrais au moins (et j'ai honte de le dire), c'est que nous sachions nous priver de quelque chose pour soulager l'infortune ; non du pain et du vêtement, mais du luxe et du plaisir ; je voudrais que, avant de faire une dépense qui flattera notre palais ou notre vanité, nous sachions nous dire : Tel homme a froid, telle famille a faim.
« Je ne puis pas donner. » Voilà notre excuse la plus ordinaire. Mais si le nécessiteux importun osait nous dire ce qu'il pense, savez-vous ce qu'il répondrait ? Il répondrait, avec notre conscience mal à l'aise : « Vous mentez ! vous avez fait hier une folle dépense ; vous avez donné, le premier de ce mois, des futilités à qui n'avait besoin de rien ; vous avez sur votre personne un ornement à la place même où je manque d'habit, et, dans vos maisons, des mets délicats sur la table où je n'ai pas de pain. Gardez tout cela ; mais, à l'avenir du moins, soyez plus sobre, ayez moins de luxe, privez-vous du superflu qui pourrait encore vous séduire, et, quand un autre indigent viendra comme moi vous tendre la main, ne lui dites plus : Je ne puis pas vous donner. »
Un autre trait de l'hospitalité d'Abraham qui me frappe, c'est qu'il agit lui-même ; c'est lui qui prie les voyageurs, lui qui les conduit à sa tente, lui qui donne les ordres et à sa femme et à ses serviteurs ; lui, enfin, qui sert le repas et leur tient compagnie.
Et ce n'est pas ici la moindre partie du bienfait, quoique ce soit celle que nous négligions le plus volontiers. Si nous consentons à secourir le nécessiteux, c'est de loin, avec un peu d'argent, par l'intermédiaire d'une société, sous la forme d'une vente, peut-être d'une loterie. Certes je ne veux blâmer aucun de ces ingénieux moyens de faire du bien, je veux même m'abstenir de juger le dernier ; mais ce que je désire faire remarquer, c'est que, de nos dons, la partie que nous retranchons presque toujours, c'est nous-mêmes ; nous donnerons de l'argent, mais pas notre temps ; nous sacrifierons un vêtement, mais pas notre peine. Nous enverrons s'il le faut vers le malade, mais nous n'irons pas. Insensés qui perdons ainsi le fruit le plus doux du bienfait que nous semons ! Ne comprenez-vous pas que c'est pour nous, nous-mêmes, autant que pour les malheureux, que Dieu nous appelle à leur secours ? Ne comprenez-vous pas que c'est précisément de les voir, de les toucher, de leur parler, qui fera du bien à notre âme, et que nos rapports personnels, avec eux sont le moyen préparé de Dieu pour nous obtenir, en échange de nos biens terrestres accordés aux pauvres, les biens spirituels que le pauvre nous renvoie en émouvant notre cœur, nous poussant à la prière, nous portant à l'humilité par la vue de notre misérable nature ? Oui, celui qui visite les malheureux reçoit plus qu'il ne donne. Aussi les exemples de la Bible ne sont-ils pas des souscriptions, mais l'hospitalité. Avant de donner de l'argent au maître d'hôtel pour soigner le blessé, le Samaritain place le blessé sur sa monture et l'accompagne, allant à pieds ; de même qu'Abraham tue lui-même le jeune veau, prend lui-même le beurre et le lait, porte le tout encore devant ses hôtes, et, pour dernier trait, reste là, debout, derrière eux, pour les servir. Le patriarche n'aurait-il pas pu se décharger de ces soins minutieux et humbles sur ses domestiques ? Sans doute ; mais il ne l'a pas voulu afin d'honorer ceux que nous faisons rougir et pour goûter la joie pure que nous méprisons, la vue d'une souffrance soulagée.
Oui, honorer d'un mot d'amitié, accompagner d'une parole d'encouragement l'aumône qu'on accorde, c'est plus que la doubler ; c'est rendre la force morale, le courage au malheureux. Ah ! si nous pouvions savoir tout ce qui se passe dans le cœur de l'indigent silencieux qui souffre et demande, qui souffre et que personne ne plaint ni ne regarde ; si nous pouvions y découvrir cette amertume, ce découragement, cette aigreur contre le sort, ce dépit contre les hommes, toutes ces passions mauvaises que l'adversité justifie à ses yeux, et qu'un mot de douceur, d'autant plus précieux qu'il est plus rare, peut apaiser et changer en bénédiction, certes alors nous ne verserions pas dans ce cœur ulcéré la flamme de nos mépris et de nos reproches, mais plutôt le baume de nos consolations. Une bonne parole nous coûterait si peu ! et elle ferait tant de bien que si nous en mesurions toute la portée, nous ne la refuserions pas ; et, comme Abraham, en apportant « une bouchée de pain » nous chercherions à « fortifier le cœur. » Courage donc, surmontons notre répugnance ; ou plutôt rompons avec le préjugé du monde qui veut qu'on tienne l'indigent à distance. Cet indigent est un homme comme nous ; c'est aujourd'hui notre frère ici-bas, et nous pouvons le retrouver demain notre supérieur dans les cieux.
Un dernier trait de l'hospitalité d'Abraham mérite d'être observé : il dit aux trois voyageurs que, lorsqu'ils auront pris du repos et fortifié leur cœur, ils continueront leur route ; or, à cette époque et dans de telles contrées, continuer sa route, c'était se séparer pour ne plus se revoir. Abraham accorde donc l'hospitalité à des hommes qui passent et qu'il ne reverra pas, qui ne lui sont rien et dont il n'attend rien ; en un mot, c'est l'hospitalité la plus vaste et la plus désintéressée, l'hospitalité du Samaritain, qui n'avait jamais vu le voyageur et qui pour toujours allait s'en éloigner.
Telle n'est pas notre propre hospitalité, telle n'est pas notre bienfaisance. Je ne veux pas dire, bien que cela soit vrai, que, contrairement au précepte de Jésus-Christ, nous invitions « ceux qui peuvent nous rendre la pareille ; » non, je ne veux parler que des secours que nous accordons sans espoir de retour. A qui les accordons-nous, ces secours ? C'est à ceux qui peuvent nous montrer, par le nom de leur église, de leur patrie, de leur profession, qu'ils ont, à notre sympathie, un droit que leur infortune seule ne leur donne pas. Nous ne nous informons pas si cet homme a de grands besoins, mais d'où il est, ce qu'il fait, ce qu'il croit ; et, si nous voulions étudier notre cœur dans un tel moment, peut-être verrions-nous que nous cherchons moins un motif pour lui donner qu'un prétexte pour lui refuser. Nous voudrions bien qu'il fût de notre église, de notre ville, de notre profession, mais nous sommes encore plus aises qu'il n'en soit pas ; car ainsi nous le renvoyons à vide et nous nous croyons justifiés. Singulière charité qu'on pourrait appeler égoïsme, alors qu'elle se répand, aussi bien alors qu'elle tarit !
Comme tout cela ressemble peu à la charité de Christ ! comme tout cela sent peu l'Évangile ! combien même c'est loin d'un Abraham encore sous la loi ! Mais allons jusqu'au bout de notre tâche et jetons un regard sur la dernière circonstance de sa patriarcale hospitalité.
Nous l'avons déjà dit : Abraham pense n'avoir reçu que de simples voyageurs, et cependant il se trouve que ces trois hommes sont des anges. Ah ! si nous pouvions nous trouver nous-mêmes dans une semblable position, certes nous mettrions à faire ce que fit Abraham tout autant d'empressement. Oui sans doute…, si nous savions d'avance ce qu'il ne savait pas ! et voilà précisément ce qui nous condamne encore. Nous voudrions être certains d'avoir pour hôte un prince, un roi, un ange, un Dieu, avant de nous montrer magnanimes dans notre hospitalité. Eh bien, s'il nous faut de tels aiguillons, ne nous pressent-ils pas de toutes parts ? Les pauvres, les prisonniers, les malades ne sont-ils pas les frères du Fils d'un Dieu ? et ce que nous faisons pour eux n'est-il pas fait pour lui ? Jésus lui-même ne nous a-t-il pas déclaré que ces membres qui souffrent sur un lit de douleur sont ses propres membres ? que ce corps accroupi au fond d'une prison est son propre corps ? que ces indigents qui crient la faim, le froid, la nudité, c'est lui, lui-même qui demande sous une forme humaine du pain, un vêtement, un abri ? Qu'attendons-nous donc encore ? Faudra-t-il qu'ajoutant un miracle à sa parole Jésus manifeste sa gloire de Fils de Dieu sous ces haillons de l'homme et nous contraigne au lieu de nous exhorter à la charité ? Non ; car si nous attendions ce miracle, nous ne le verrions que trop tard ! Non, nous n'attendrons pas le jour où Jésus, assis sur son trône, dirait à d'autres : « Venez, les bénis de mon Père ; » et à nous : « Allez, maudits, vers Satan et ses anges ! » Non, dès cette heure nous prendrons au sérieux un devoir que nous n'avons jusqu'ici que trop négligé. Nous chercherons le pauvre, soulagerons ses misères, sécherons ses larmes, relèverons son courage et prierons avec lui. A genoux tous deux sur le même sol, devant le même Dieu, nous sentirons mieux notre fraternité, nous puiserons là nous-mêmes des sentiments que nous ne trouverions nulle autre part, et nous comprendrons, en sortant du réduit de l'indigence, la vérité de cette parole : « Mieux vaut visiter la maison de deuil que la maison de festin. »