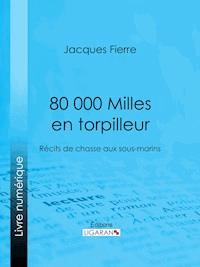
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Mon ami, je viens d'embarquer sur le Knoutt, aujourd'hui à midi, et j'ai bien chaud. J'ai vidé mes malles dans de minuscules armoires ; j'ai fait des visites officielles en gants blancs, avec un sabre qui me battait les mollets, et j'ai encore le courage de vous écrire, au lieu de me coucher joyeusement."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335016444
©Ligaran 2015
Mon ami, je viens d’embarquer sur le Knoutt, aujourd’hui à midi, et j’ai bien chaud. J’ai vidé mes malles dans de minuscules armoires ; j’ai fait des visites officielles en gants blancs, avec un sabre qui me battait les mollets, et j’ai encore le courage de vous écrire, au lieu de me coucher joyeusement.
Mais je veux que vous sachiez que mon bonheur est total : c’est un évènement assez rare et qui ne laisse pas de me rendre nerveux. J’ai eu dans ma vie quelques grandes joies semblables, en particulier, lorsque je franchis pour la dernière fois la coupée du Borda et me trouvai midship. Mon bonheur était plus modeste lorsque je vous vis et me promenai avec vous, sur les bords bleus du golfe Ligurien.
Au reste, soyez juge de ma situation actuelle. Après dix mois d’une campagne splendide sur la Jeanne d’Arc, je suis revenu à Brest, un peu fatigué et la tête lourde de souvenirs.
C’était il y a cinq jours.
Or, une grande manchette s’étalait dans les journaux : L’Autriche a déclaré La guerre à la Serbie, et, comme commentaires : « Devant cet évènement, la France prend d’énergiques mesures pour garantir l’intégrité de son territoire – et de ses colonies. »
Je vous avoue que je ne compris pas très bien, dès l’abord, la liaison des idées.
Mais des mouvements étranges se dessinaient en rade de Brest.
Tandis que nos examinateurs qui pendant un jour nous tinrent sur la sellette, étaient poliment remerciés, et s’en allaient accompagnés de nos sourires satisfaits, par le vapeur même qui les avait amenés, on voyait du fond de l’horizon, arriver de vieux bateaux oubliés depuis de longs mois à Landévenec, en décomposition.
Les remorqueurs sillonnaient la rade-abri ; les ouvriers de la Direction du port s’agitaient ; la fumée envahissait l’atmosphère : les signaux couraient sans cesse le long des drisses pour la plus grande joie des timoniers ; on embarquait partout du charbon, de l’huile, du pétrole, mais la Jeanne-d’Arc débarquait la moitié de ses aspirants.
À terre un mot volait sur les bouches et agaçait les oreilles : « Mobilisation. »
Les journaux connurent l’âge d’or, et les Brestois, plus que jamais, encombrèrent leur rue du Siam.
Quant à moi, je conservais le calme le plus parfait, et expédiais mon tabac de contrebande par petits paquets.
Seulement je craignais que la prise de Belgrade par les Autrichiens (c’était la dernière heure) ne retardât mon congé ; j’avais raison.
La dernière fois que je mis le pied sur le sol armoricain, j’ai entendu parler de guerre. J’eus alors un mouvement d’épaules, et on me regarda de travers.
Enfin, hier, 31 juillet, nous avons quitté Brest, et ce matin, après une nuit de rêves enchanteurs, je me suis réveillé à Cherboug.
Je ne vous raconterai pas, mon ami, les aventures qui m’advinrent, sous un soleil écrasant, pour arriver jusqu’à ce Knoutt qui termine en hâte, dans l’arsenal, quelques réparations.
Enfin je suis maintenant à peu près installé. J’ai ma chambre et ma sonnette. J’ai mis un peu d’ordre dans mes affaires et fait un tour par la ville : on ne parle que de la guerre.
Moi je suis certain qu’avant huit jours je goûterai, au sein de ma famille, le charme du repos et des affections pures.
J’aurai, en tout cas, connu la joie de l’embarquement sur un torpilleur d’escadre, et la fièvre de la mobilisation mort-née.
Cependant je sens le sommeil me gagner, et ma bougie est aux trois quarts fondue.
Je continuerai de vous écrire, comme vous me le demandez, sans rien exiger en retour.
Adieu, Giuseppe, je vous serre la main, et vous souhaite le bonsoir.
Giuseppe, la guerre est finie, et c’est profondément triste.
Autour de nous, l’horizon s’éploie net et vide, et nous savons bien d’ailleurs qu’elles sont amies les fumées qui, parfois, très loin, montent doucement dans le ciel pâle.
La flotte allemande n’est pas sortie le « Grand Jour », maintenant il est trop tard : Giuseppe, je ne me battrai pas !
Et pourtant quelles heures nous avons vécues !
Le 2 août toute la ville était en révolution sous le soleil joyeux ; l’arsenal bruissait comme une ruche gigantesque et à bord du Knoutt, pour hâter les réparations, nous étions là, le commandant, le second et moi, anxieux à l’idée que peut-être nous ne serions pas prêts.
La nuit tomba, lente et tiède…
Des ombres dans les bassins glissèrent, ponctuées de lumières vertes, de lumières rouges, de lumières blanches. On entendait dans le silence des mots bizarres :
« Tribord avant cent ampères. Bâbord arrière deux cents… »
Et c’était comme une farandole mystérieuse qui avec d’infinies précautions sortait de l’arsenal.
Ils s’en allaient, un par un, les sous-marins… vers quelle destinée ?
Les torpilleurs suivaient et au moment où nous larguions à notre tour les amarres, une dépêche arriva par la T.S.F.
Elle venait de Paris, elle était adressée à l’amiral, aux commandants :
Hostilités commencées ; attaquez tous bâtiments allemands que vous rencontrerez !
La guerre !
Ah ! moi qui jusqu’au dernier moment n’y voulus point croire, de tenir entre mes doigts ce papier plein de tant de choses, je tremblais de joie et quand nous eûmes pris la file derrière tous les bateaux qui sortaient, quand nous fûmes dans la rade, quand la brise salée de l’Océan nous fouetta le visage, je fus envahi d’une jouissance infiniment douce.
La nuit était pleine d’étoiles ; la mer était toute calme. Partout, partout, des ombres autour de nous passaient. Des croiseurs, des remorqueurs, des torpilleurs, et puis les choses toutes basses sur l’eau et bourdonnantes, qu’étaient les sous-marins.
Et les digues furent franchies, et l’escadre tout entière se forma pour aller au combat.
L’amiral R… avait donné ses ordres par T.S.F. La Jeanne d’Arc partit en éclaireur. Les torpilleurs en flanc. Le gros de l’armée suivait.
En cas de rencontre, la Jeanne-d’Arc venait reprendre sa place dans la ligne ; les torpilleurs se replieraient, prêts à combattre !
Et je sentis le Knoutt, de l’arrière à l’étrave, frémir de ses machines lancées à pleine vitesse.
Ainsi nous allions à Calais, plus loin peut-être, arrêter l’escadre allemande.
Ah ! quelle folie triomphale ! Quelques croiseurs pour arrêter toute la flotte de l’Empire !
Quant à nous, il faudrait nous approcher à 400 mètres au moins pour lancer nos torpilles, et tandis que nous bondissions vers l’Est, faisant sur la mer un long sillage blanchâtre, la jumelle aux yeux, je scrutais l’horizon.
Et je faisais mille rêves impossibles, et j’évoquais mille combats fantastiques, le cœur battant plus fort, quand les yeux las, je croyais dans l’ombre apercevoir quelque chose.
Ah ! Giuseppe, depuis trois ans ne vivre que pour le combat, n’entendre parler que du combat, n’avoir comme raison d’être que le combat et puis, là, d’un coup, se dire qu’on y est, pour de vrai, qu’on va foncer, comme un fou splendide, qu’on va s’approcher tout près, tout près, aveuglé par les projecteurs, assourdi par le canon, ruisselant d’embruns, et puis qu’on va lancer ses torpilles, et puis qu’on fuira à tout vitesse, sous une grêle d’obus et que pendant ce temps il y aura une grande gerbe d’eau qui escaladera le ciel et qu’une ombre, une ombre qui glissait, aura des mouvements étranges, et puis se dressera, dans un fracas de soutes qui explosent et puis s’enfoncera doucement, doucement, et qu’après il n’y aura plus rien, rien, plus rien sur la mer, parce que notre torpille aura touché !
Ah ! nous allions la connaître cette ivresse. Déjà, je la sentais s’emparer de moi, m’énerver, et les mains crispées sur mes jumelles je fouillais l’horizon…
Et ce fut l’aube.
Le commandant me dit :
– Si je disparais, c’est le second qui prend le commandement ; après lui, c’est vous.
Nous avons ri tous les deux.
On a hissé, en tête du mât, le pavillon français.
On distingue maintenant les torpilleurs les plus proches.
L’horizon devient clair, clair… et puis le soleil commence de monter au-dessus de la mer toujours calme.
Quel beau jour de victoire !
Et tout autour, devant, derrière, les fumées s’allongent, s’allongent vers l’Est, comme d’immenses chenilles… à toute vitesse, l’escadre du Nord se rue au combat…
Hélas ! notre rêve s’écroula brusquement.
« Ordre aux torpilleurs de croiser sur une ligne sensiblement Nord-Sud. »
Que la T.S.F. soit maudite !
Personne n’allait plus loin ! Les Allemands ne sortaient pas, par peur de l’Angleterre.
Ce que fut ma désillusion, mon amertume, vous ne sauriez le croire, Giuseppe.
L’équipage qui était parti aussi avec une si belle insouciance, ne comprenant pas cet arrêt – n’ayant pas eu connaissance des dépêches, – nous regardait avec des yeux douloureux.
Pourquoi, pourquoi ne continuait-on pas ?
Et moi, demeuré sur le pont, le regard machinalement fixé sur les tubes lance-torpilles, je me disais que c’était bien facile, en vérité, de faire partir le coup : il suffisait de tirer un peu fort – oh ! très peu ! – sur cette poignée d’acier…
Alors, puisque les Allemands ne veulent pas se battre, nous montons la garde, et tous les bateaux sont arrêtés, et toutes les marchandises saisies. Peut-être seront-ils las d’être bloqués et essaieront-ils de forcer le passage ? Je me raccroche à cette idée, mais sans grand enthousiasme.
Ma désespérance ne dura pas longtemps. Je fus distrait par mon quart qui m’absorba quatre heures de suite, et puis par toutes les dépêches de T.S.F. qu’il fallait déchiffrer, et puis par la fatigue.
Nous sommes rentrés à Cherbourg faire du charbon, de l’huile, des vivres, en pleine nuit, pour repartir à l’aube.
Maintenant, derrière l’escadrille qui salit de sa fumée un grand morceau du ciel, les croiseurs anglais se profilent sur l’horizon.
Nous allons vers le Nord, et puis vers le Sud, et encore vers le Nord. Aucun bateau ne passera, c’est sûr. Mais comme je suis impatient !
Vous rappelez-vous la promenade que vous eûtes la joie de faire avec moi dans les sentiers fleuris de la montagne qui domine Recco ?
Je vous ai dit que la guerre était ma seule raison d’être et mon vaste désir, et vous avez eu un étonnement. Je ne me doutais pas qu’elle était si proche et que je devais sitôt goûter les plaisirs du guerrier, surtout je ne les croyais pas tels qu’ils sont.
J’ai le calme dans mes nerfs et dans mon cerveau.
Je suis heureux d’être à la mer et malgré moi je scrute l’horizon pour voir surgir le Moltke ou le Bismarck… Ah ! je voudrais tant me battre. Mais j’ai bien peur que la guerre, que notre guerre à nous, soit finie…
Écrivez-moi, mon ami, et me dites que vous accompagnez le Knoutt de vos pensées et de vos vœux. Les miens ne vous quittent point.
Mon cher ami, j’ai reçu votre lettre qui n’avait aucun intérêt, mais vous n’avez pas reçu les miennes, et j’en suis désolé.
Je continue néanmoins à vous conter mes aventures. D’abord, je vous apprends que le Gœben et le Breslau sont pris ; que la Panther est coulée ; que Guillaume II a été tué ; que les Anglais ont anéanti la flotte allemande près d’Aberdeen, et que nous avons pris Mulhouse.
Tout ceci circule sous le manteau, mais on ne tardera pas à le rendre officiel : je vous en donne la primeur.
Il y a deux nuits la mer était plate et le ciel constellé. Les torpilleurs se suivaient à la queue leu leu, sans feux comme des ombres.
J’étais de quart, et sur la passerelle j’écarquillais les yeux pour percer l’obscurité, et tâcher d’apercevoir mon matelot d’avant (on appelle ainsi le bateau qui vous précède) afin de n’aller pas donner du nez sur lui.
Tout à coup une lumière parut, bien faible et bien lointaine : un bateau.
Notre guide nous signala : « Allez reconnaître bâtiment dans le Nord-Est. »
Nous nous sommes précipités sur la lumière. Et peu à peu nous avons distingué un feu rouge et puis d’autres lumières, les sabords éclairés, sans doute, et une grande masse émergea, plus noire que la nuit : un paquebot.
On entendait le halètement formidable de ses machines.
Nous avions peine à le rattraper. Et c’était étrange en vérité, cette chasse dans la nuit d’un immense bateau par un tout petit, tout petit, qui, passant dans le remous du grand, tanguait subitement, et roulait, et forçait de toute sa vitesse, et ne voulait pas lâcher prise.
Nous avons fait le signal : stoppez, en braquant sur lui notre projecteur : il a continué sa route. Alors nous avons tiré un coup de canon à blanc qui résonna sur la mer comme un tonnerre : premier avertissement.
Prudent, il s’arrêta ; le Knoutt vint se ranger tout près de lui.
Nous avons mis la baleinière à la mer ; je suis monté dedans, revolver au côté.
J’accostai au flanc démesuré du paquebot ; on lança un faux-bras, on déroula une échelle de corde, et je grimpai comme un chat.
Sur le pont, il y avait une foule sale et à l’odeur forte ; elle se divisa en deux et me fit d’elle-même un passage jusqu’à une échelle.
Je suis monté. J’ai trouvé une foule moins sale et sans odeur ; elle me fit encore un passage : je suis monté de nouveau.
Alors quelques personnes m’accueillirent, en habit, en toilette de soirée, le commandant, les officiers de quart.
Moi, j’avais une grande capote en caoutchouc, et une serviette éponge autour du cou.
Je sentais des centaines d’yeux braqués sur moi et j’étais très fier.
Personne ne parlait français. J’ai fait des prodiges d’anglais pour avoir les renseignements nécessaires.
J’ai vu les papiers du bord, le journal, le permis.
C’était un hollandais qui venait de Batavia et allait à Amsterdam. Tout était en règle : j’ai signé.
Le commandant m’offrit un cigare et voulut me l’allumer lui-même.
J’ai toujours aimé les Hollandais.
Avant de descendre de la passerelle, je me suis tourné vers l’état-major et j’ai dit :
– C’est bien ; vous pouvez poursuivre votre route.
Et tandis que la baleinière me ramenait sur le Knoutt, le paquebot, lentement, se remit en marche, parce que je le lui avais permis.
Et maintenant, nous nous reposons en rade de Cherbourg. Les nuits à la mer sans sommeil, la nourriture bizarre et peu fraîche, le mouvement continuel, fatiguent, et l’attente, l’attente de quelque chose qui doit venir et que nous ne savons pas, nous énerve.
Pardonnez-moi ma brièveté et mon désordre : je me sens infiniment las.
Voulez-vous la dernière gazette ?
Tout à l’heure, le vieux Borda, ce ponton démâté, branlant et grotesque, amené de Brest pour la démolition, a cassé sa chaîne et est parti à la dérive.
Il est tombé en travers de deux torpilleurs.
Sa colère de vieille femme hargneuse a été promptement calmée par deux remorqueurs. Jusqu’à sa mort cette laide carcasse aura été mauvaise – et c’est la seule distraction du jour.
Adieu, mon ami, ne m’oubliez pas : ce serait très ingrat.
Ami, si j’occupais une profession libérale, j’aurais le droit de vote depuis plusieurs jours. Cela signifie qu’il y a vingt et un ans, un enfant blond et rose a vu le jour, lequel enfant, après de nombreux vagissements, est devenu jeune homme, puis aspirant de marine.
C’est alors qu’il eut l’idée tordue de devenir votre ami, et la chance d’embarquer sur le Knoutt pour faire la guerre…
Il n’est rien de plus triste que de vieillir.
Déjà, mes cheveux blanchissent et tombent, et je sens les premières atteintes du rhumatisme.
Depuis ma dernière lettre, cher, j’ai visité bien des bateaux et accepté bien des cigares – on a démenti les renseignements que je vous donnais sous toute réserve, – et pais c’est, ma foi, tout.
Il me faut faire un effort assez considérable d’imagination pour croire qu’on est en lutte.
Cependant l’Autriche a déclaré la guerre au Japon et je me demande avec angoisse où ils vont se battre.
Je ne serais pas étonné d’apprendre que le Venezuela, en conséquence de cela, mobilise !
Nous savons peu de chose de nos armées. Les bulletins disent : « Situation sans changement : on se replie. »
Les Cosaques galopent à travers la Pologne, Bruxelles est entre les mains teutonnes, la Serbie repousse l’envahisseur, le ministère se modifie.
On raconte, en ville, les choses les plus extravagantes ; des réservistes parcourent les rues, et les cabaretiers gagnent de quoi s’assurer une honnête vieillesse.
La rade de Cherbourg est peuplée de torpilleurs et de croiseurs ; on dévore les journaux, on déchiffre les dépêches… et on ne sait rien.
Le général Joffre est un rude jouteur pourtant, et les Prussiens entrent chez nous. Je me demande si quelqu’un comprend la moindre chose à la salade européenne.
Oh ! mon ami, je donnerais la prunelle de vos yeux pour lancer mes torpilles.
Dites-moi tout ce que vous savez et exposez-moi vos idées sur la situation actuelle : je sais que vous ne manquez pas d’esprit.
En reconnaissance de quoi voici les renseignements que vous me demandez et que je m’étonne de ne vous avoir pas donnés.
Le Knoutt, lorsqu’il fut lancé, il y a une dizaine d’années, était un contre-torpilleur et avait deux mâts.
Maintenant il n’en a plus qu’un et s’appelle torpilleur d’escadre.
C’est un joli bateau, élancé, aux cheminées courtes, à l’avant effilé, et qui peut marcher encore 25 nœuds, c’est-à-dire plus de 46 kilomètres à l’heure.
À son âge on ne peut guère demander mieux.
Il est armé de 6 canons de 47 millimètres, et d’un canon de 65 : tout l’espoir du bord.
Il possède, en outre, 2 tubes lance-torpilles, et 4 torpilles. Il y en a 2 dans lesdits tubes, et 2 dans des « valises », en réserve. Lorsque les premières sont lancées, on met les autres à leur place. C’est une opération assez longue et qu’il est prudent de ne point faire sous le feu de l’ennemi.
Ces torpilles, hélas ! sont préhistoriques, et ne vont guère plus loin que 400 mètres. Il est à peu près certain que le jour où nous les lancerons, nous ne reviendrons pas, ce qui n’a point d’ailleurs très grande importance.
Je ne crois pas qu’il vous intéresse de savoir que nous possédons deux machines à triple expansion, et que nous chauffons au charbon.
Il y a 70 hommes dont 60 matelots qui sont logés à l’avant, très mal, et qui couchent dans des hamacs placés sur 3 rangs, et collés les uns aux autres.
Mais ce sont des hommes solides, durs à la peine, braves enfants, et ne rêvant que plaies et bosses.
Il y a 7 ou 8 sous-officiers, 1 midship (votre serviteur), 1 enseigne à deux galons plus ou moins vieux, et le commandant.
Et tout ce monde vit un peu à l’étroit dans cette petite carcasse, mais avec bonne humeur.
Ce n’est pas toujours aisé, et, quand il fait mauvais, les lames jouent avec nous comme avec des fétus.
Nous roulons et nous tanguons au moindre clapotis. Il faut tout accrocher, tout attacher, tout fermer, et puis on se cramponne quelque part et on reste là.
On entend des bruits extraordinaires : vaisselle qui se casse, hélice qui sort de l’eau et s’affole, lames qui balaient le pont, objets divers qui, d’un bord à l’autre, rebondissent et se poursuivent, eau qui coule – il y a toujours de l’eau qui coule – et puis chutes, cris, rires, jurons. C’est un enfer.
Pour aller depuis l’arrière jusqu’à la passerelle, par mauvais temps, c’est tout un voyage au long cours. Dès que le bateau est droit, on se précipite, mais cela dure une seconde ; vite on s’accroche, et on reste ainsi, agrippé, attendant que la lame soit passée, et que le torpilleur se redresse.
Au moment où il repasse par la position normale, en hâte on fait un nouveau bond, les yeux fixés sur la chose qu’on va « crocher » : canon, rambard ou n’importe quoi, et on l’étreint et on la presse contre soi, et rien ne la fera lâcher.
Et puis on recommence sept ou huit fois des bonds semblables, et on finit par arriver.
La nuit, c’est d’une complication inouïe.
On se lance les bras tendus, on attrape la première chose heurtée, et on a la surprise bizarre d’étreindre le cou d’un matelot qui veille près de son canon.
Alors on roule par terre tous les deux, l’un riant et l’autre jurant.
Il ne faut pas songer, dès que la mer est un peu creuse, à mettre le couvert. Seulement il existe une « table à roulis ». C’est une planche percée de petits trous qui sert de nappe. On pose une assiette et on l’entoure de petits bouts de bois – des cabillots – plantés dans les trous. Cela empêche l’assiette de glisser, mais non le contenu de partir au premier roulis un peu violent, ni les verres de déborder.
On ne peut d’ailleurs pas toujours faire la cuisine. J’en suis personnellement désolé, car jamais je n’ai ressenti les affreuses douleurs du mal de mer. C’est fort heureux, direz-vous – et vous aurez raison. Plusieurs hommes, malades au début, ne le sont plus maintenant. C’est un peu affaire d’entraînement.
Sur la passerelle, par gros temps, on est copieusement arrosé. Les embruns balaient le pont d’un bout à l’autre, et on s’aperçoit alors que les « cirés » ne sont jamais étanches.
Ah ! j’oubliais de vous dire que nous possédons 16 fusils Lebel modèle 1886, modifié 1893, comme dit la théorie, et 8 revolvers.
La compagnie de débarquement que nous pouvons ainsi former est donc fort imposante.
Telles sont, mon ami, les précisions qui vous permettront de me mieux suivre par la pensée.
Vous voyez que je suis dans de bonnes conditions pour guerroyer. J’attends… avec un peu de désillusion.
Affectueusement vôtre.
J’étais dans ma couchette, l’autre jour, mon ami, quand un timonier me réveilla par ces mots :
– Lieutenant, on reçoit l’ordre de pousser les feux et d’appareiller le plus promptement possible.
J’ai poussé un « hurrah ! », ne doutant pas que nous partions pour Kiel, et rejetant mes draps, j’ai levé les jambes en l’air, en signe de réjouissance.
Le ciel était bleu – la mer aussi – et nous avons appareillé sous le soleil, suivis par le Fouet. Tout à coup la brume est tombée, une brume si épaisse que de l’avant on ne voyait pas l’arrière. Nous étions entourés de gris, et le sifflet, à intervalles plus ou moins réguliers poussait un sifflement assez enroué.
Cela dura tout le matin et toute l’après-midi ; la Manche était comme un lac ; le Knoutt virait un peu, mais sans roulis ; il glissait à 16 nœuds dans le gris humide et ouaté. Derrière, on ne voyait ni le sillage ni le Fouet.
Et brusquement, à quatre heures, la brume s’est levée, comme un rideau d’opéra. Le ciel apparut tout bleu, et droit devant, on devinait le cap Griz-Nez, au loin.
Le Fouet, à deux cents mètres, impeccablement, suivait toujours.
Nous sommes entrés dans le Détroit. La blanche Albion étincelait ; l’horizon était vierge d’Allemands ; torpilleurs et sous-marins – français et anglais – faisaient des rondes, sentinelles noires, au ras de l’eau, attendant l’ennemi.
Le commandant de la ligne de surveillance nous a crié, par porte-voix, d’aller à Calais.
Nous y fûmes amarrés à la nuit.
Mon instinct de vieux voyageur m’a poussé par la ville. Je n’ai guère vu que des ombres couleur de muraille, et des becs de gaz anémiques. Mais, le lendemain matin, je suis retourné dans cette valeureuse cité.
Elle ne me déplaît point.
Il y a de vieilles rues et des neuves, comme à peu près partout. On y vend du tabac bon marché. La guerre ne semble pas affoler les populations, et j’ai croisé beaucoup de soldats.
Je suis resté en admiration devant le monument des Bourgeois de Calais qui, pieds nus et en chemise, avec la corde au cou, portèrent les clefs de la ville aux ancêtres de nos alliés.
Cela m’a fait songer à Marie Tudor, qui avait le nom de Calais gravé dans le cœur, du moins elle le disait, car je ne crois pas qu’on ait jamais vérifié…
La ville est pleine de charmantes petites filles.
J’ai été sur la plage, hérissée de cabines dont les ombres sont propices, et j’ai vu les jeunes gens se baigner dans la mer.
Vraiment, mon ami, on ne se douterait pas que l’ennemi est à nos portes : on rit, on chante, et on semble s’amuser fort.
Mais, lorsqu’après avoir été croiser deux nuits et un jour dans le Détroit – sans rien voir – nous sommes revenus ici, de bien mauvaises nouvelles nous attendaient.
Les Allemands avancent, avancent… On les signale à Cambrai, à Saint-Quentin, et nous, nous reculons. Ils sont en France, ils sont chez nous, ils encombrent nos routes…
On dit que les Russes débarquent à Ostende, après avoir traversé toute l’Angleterre ; qu’il y a, aux environs de Lille, des troupes qui n’ont pas encore vu le feu ; que la mer est semée de mines ; que l’escadre du Midi bombarde Cattaro, mille choses qu’on répète partout.
C’est triste… Et nous ? Nous retournons à Cherbourg où nous serons demain matin. Mais quand donc se lèvera-t-il, le jour du combat ? Moi qui étais parti avec tant d’espoir !
Avant que le vaguemestre s’en aille, je termine ma lettre, ami.
Je ne comprends rien, rien du tout.
Les dépêches anglaises, que nous recevons par T.S.F., sont d’une sincérité affolante. Nous avions cru, l’autre jour, qu’elles avaient dit Cambrai pour Courtrai. Hélas ! il n’y a pas d’erreur !
Les Allemands vont droit sur Paris, et on les laisse avancer. Le Gouvernement est à Bordeaux.
Joffre recule, recule… Veut-il donc que les ennemis fassent le tour de France ? ou bien veut-il les laisser entrer chez nous pendant qu’il va chez eux, par l’Alsace ?
Mais alors il faudra se battre pour que chacun revienne chez soi ; on dit que la grande bataille va commencer ! C’est la centième fois qu’elle commence, la grande bataille ! et les nouvelles officielles se succèdent, exaspérantes : « Situation inchangée ! »
Nous sommes à peu près entre Paris et l’Alsace, et on recule encore… Enfin, il y a la Corse !…
Je vous signale un fait authentique :
Un sous-marin anglais a capturé un aéroplane ! C’est assez cocasse. Ces appareils n’ont jamais été construits pour se rencontrer ni se battre en champ clos. Mais avec cette guerre nous aurons, je crois, d’autres étonnements.
Rien n’est désespéré, quoique les nouvelles soient mauvaises.
La Victoire va venir nous donner son baiser, et puis, mon ami, n’oubliez pas qu’il reste une chose que les Allemands n’ont pas prise encore, et qui se mettra en travers le jour où ça n’ira plus : le Knoutt.
Bien à vous.
Il y a de bien jolies lames, Giuseppe, mais je vous assure que ce n’est pas drôle du tout.
Le Knoutt est animé d’un mouvement, dit de casserole, inconnu dans toutes les cinématiques, et nous sommes couverts d’eau.
J’ai demandé au commandant si nous pouvions faire le tour complet ; il m’a dit qu’il n’y avait rien à craindre tant que le bout de la vergue ne toucherait pas l’eau.
En attendant, c’est fort désagréable.
Je ne peux m’étendre, car le roulis me jette à bas de ma couchette ; j’écris avec peine, car tout le torpilleur tremble, et dès que je mets le nez dehors je suis arrosé copieusement.
Les lames nous couvrent et nous masquent la vue du Fouet qui, à deux cents mètres, danse une gigue endiablée.
Non, ce n’est pas drôle du tout.
Et puis si les Allemands venaient, nous ne pourrions lancer nos torpilles, ni fuir, ils nous couleraient sans vergogne.
Mais les Allemands sont loin.
Avant-hier, comme nous venions d’observer un tir d’accord qui n’eut pas lieu, nous avons reçu la dépêche que la tour Eiffel envoyait à l’univers entier : L’ennemi bat en retraite à notre aile gauche et au centre
Je me prends à sourire, maintenant, en songeant à la joie que nous eûmes. Dans la nuit, les dépêches anglaises ont confirmé.





























