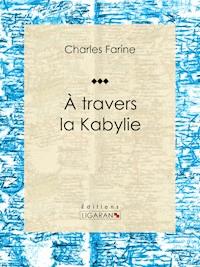
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "L'Afrique, asservie depuis des siècles, tombée dans une profonde décadence, a eu, dans les temps passés, ses jours de gloire et de splendeur. Bien avant qu'on s'occupât de l'Occident, elle avait soutenu sur son sol ou porté sur le sol étranger des guerres acharnées, avec des péripéties diverses de fortune, de victoires ou de défaites ; c'est ainsi que, conquérante, elle a fourni leurs habitants à l'Espagne et à la Gaule méridionale."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335040265
©Ligaran 2015
À madame Isabel R…
Ma chère fille.
En te dédiant ces pages, je ne veux que restituer les emprunts faits aux lettres que je t’écrivais pendant le cours de mon voyage en Kabylie. Et puis ton nom inscrit au frontispice de ce livre, sera, pour lui, comme l’image de la Madone que le pêcheur attache au mat de sa barque avant de se confier à la mer.
Alger, octobre 1805.
CH.F.
L’Afrique, asservie depuis des siècles, tombée dans une profonde décadence, a eu, dans les temps passés, ses jours de gloire et de splendeur. Bien avant qu’on s’occupât de l’Occident, elle avait soutenu sur son sol ou porté sur le sol étranger des guerres acharnées, avec des péripéties diverses de fortune, de victoires ou de défaites ; c’est ainsi que, conquérante, elle a fourni leurs habitants à l’Espagne et à la Gaule méridionale. Elle a donné le jour à de grands génies, Moïse, Hannibal, Origène, saint Augustin, qui ont tracé dans l’histoire leur sillon lumineux.
Son ciel toujours pur, ses rivages caressés par les flots d’une belle mer, ses vastes oasis au milieu de déserts sans limites, ses mœurs patriarcales qui résistent à la civilisation apportée par la conquête, ont inspiré le peintre et le poète. Cependant tous ces souvenirs ne semblent subsister que pour donner la mesure de son abaissement, et cette partie du globe est encore la moins connue, la moins explorée.
Les peuples anciens qui y jetèrent des armées, qui y fondèrent des colonies, ne connurent que le littoral, côtoyé par leurs vaisseaux, ou habité par leurs émigrants. Seuls, les Romains s’avancèrent dans l’intérieur, et l’on retrouve leurs traces éparses sur le sol, depuis les portes du désert jusque dans les vallées qui avoisinent la Kabylie ; mais ils ne franchirent jamais ces pics réputés inaccessibles ; ils ne soumirent jamais ces peuplades qui, aujourd’hui encore, se vantent de leur indépendance ; ils ne cherchèrent pas à pénétrer dans ces déserts mystérieux de l’Afrique intérieure ; leurs pieds ne foulèrent ni les cimes neigeuses de l’Atlas, ni les sables brûlants du Sahara ; leurs tentes ne s’abritèrent jamais sous les palmiers des oasis inconnues, et c’est seulement, depuis un demi-siècle, que de hardis explorateur sont osé franchir ces mers de sable pour atteindre les pays lointains desquels on disait, pour ne pas avouer son ignorance, que toute vie y était tarie par un implacable soleil.
Notre ambition n’est pas d’aller rechercher les sources du Niger, ou explorer les plages de la Gambie, ni de demander leurs secrets aux rois de Boudou ou de Bambara : non ; nous allons, avec un ami, faire une promenade en Kabylie, pays soumis d’hier, peu connu encore et qui mérite la sérieuse attention du moraliste et du philosophe. Nous ne sommes pas les premiers à décrire cette contrée singulière, aux pentes ardues, que couronnent des neiges éternelles, aux vallées profondes et fertiles que cultive un peuple original qui n’a de l’arabe ni le nom, ni les mœurs, ni le caractère ; d’autres, avant nous, ont ouvert la voie, mais ils ont laissé une large part au touriste qui voyage, une plume et un crayon à la main, croquant un site par-ci, saisissant un détail de mœurs par-là. Et, sans autre but que de voir de près ce pays et ce peuple aussi sauvages l’un que l’autre, nous voyagerons à petites journées, racontant le plus simplement possible ce que nous verrons d’intéressant ; nous décrirons, en passant, quelques-uns de ces paysages rendus célèbres par de chères victoires, et les luttes acharnées dont ils ont été les témoins, et, sans faire d’incursion dans la politique algérienne, nous dirons naïvement au lecteur nos impressions.
Autrefois, quand il publiait un livre, l’auteur, dans une longue préface, faisait connaître son but, ses opinions, ses tendances ; il demandait, avec politesse, l’indulgence de ses nombreux lecteurs, car on croit toujours qu’on sera beaucoup lu ; aujourd’hui, nous avons changé tout cela, comme dit Sganarelle ; prosateurs ou poètes ne croient plus utiles ces salamaleks au lecteur indifférent qui feuillette le volume par désœuvrement ; on entre de suite en matière, botté et éperonné, comme Louis XIV au parlement ; ces façons cavalières sont plus commodes ; elles épargnent, à l’auteur, une main de papier barbouillée d’encre ; au lecteur, qui vous en sait gré, cent pages de cette sotte chose qui a nom préface ou introduction.
Suivons donc la mode ; il est si facile de ne pas écrire une préface et d’entrer de prime saut dans son sujet.
Le 10 juin 1864, mon ami M… et moi nous quittions Alger que les Espagnols appellent Argel, corruption du nom arabe djezaïr, les îles. Quatre îlots en effet, reliés entre eux pas une chaîne de récifs, et qui servent à former le port actuel, ont donné leur nom à la ville. Ce n’est qu’au quinzième siècle que les Algériens commencèrent les travaux sur l’ancien port d’Icosium, et construisirent, sur le principal îlot de l’ouest, une tour de vigie et de défense. Les Espagnols s’emparèrent de cette tour, bâtirent à sa place une forteresse, dite le Peñon, hérissée d’artillerie, et y maintinrent une garnison. Ils dominaient ainsi la ville et le port ; mais deux fils d’un pauvre raïs de Mételin, appelés par les habitants d’Alger, chassèrent les Espagnols, s’emparèrent du gouvernement et établirent la piraterie. C’étaient Baba-Aroudji et Khaïr-ed-Din, plus connus sous le nom de Barberousse et de Cherredin.
Telle est l’origine de cette puissance maritime qui, pendant trois siècles, sillonna impunément la Méditerranée de la proue de ses chebeks, portant la terreur sur les côtes d’Espagne, de Provence et d’Italie, pillant les navires de commerce, incendiant les villages, enlevant les belles filles pour peupler les harems barbaresques, puis fuyant à tire d’ailes, chargée de butin. À voir cette ville blanche, assise entre de vertes collines, on ne saurait croire qu’elle fût le repaire de ces bandits, et la complice de tous les crimes commis dans son sein : chrétiens forcés de choisir entre le Koran ou le martyre, et pendus par les reins aux crochets de fer de la porte Bab-Azoun ; Arabes rebelles décapités par le yatagan, à la porte Bab-el-Oued ; femmes attachées dans un sac de cuir avec un chat et un serpent et noyées dans les flots de cette mer qui caressait de son écume les pieds des mosquées.
Il est impossible de contempler Alger, avec ses maisons aux murs étincelants de blancheur, sans songer au contraste qui existe entre son aspect riant, pittoresque, et sa sanglante et mystérieuse histoire ; mais les choses de ce monde offrent sans cesse ces désaccords étranges qui donnent plus de poésie et aussi plus d’énergie à la vérité historique.
Ces réflexions me venaient à l’esprit sur le Titan qui nous emportait, fendant de son taille-mer les flots d’un bleu profond et laissant derrière lui un long sillage d’écume blanche et un panache de fumée noire.
À mesure que nous nous éloignions, le spectacle devenait admirable ; nous passions à travers toute une escadrille de bateaux pêcheurs, aux longues voiles latines, qui, doucement balancés semblaient des mouettes endormies sur la vague. L’aspect d’Alger devenait éblouissant ; les détails s’effaçaient peu à peu et se fondaient dans une masse d’un ton chaud et doré. Bientôt l’œil avait peine à reconnaître une ville dans cette agglomération de maisons sans fenêtres, aux toits en terrasse. Ce vaste triangle, dont la base descend jusqu’à la mer et dont le sommet est couronné par les pittoresques constructions de la Casbah, ressemblait à une immense carrière de marbre blanc ouverte dans les flancs des collines au vert sombre de la Bouzareah et de Mustapha. S’abaissant graduellement, ces montagnes s’avancent dans la mer, comme les cornes d’un immense croissant, à l’ouest jusqu’au promontoire de Sidi-Ferruch, à l’est jusqu’au cap Matifou. Au-dessus de ce cap, se détachent les sommets de l’Atlas qui confondent leurs contours noyés de vapeur avec le fond azuré du ciel.
C’est sur ces pics que nous serons dans quinze jours, en passant par Bone, Philippeville et Constantine.
Quatre heures après notre départ d’Alger, nous étions en vue de Dellys, petite ville, de pauvre apparence, et dont la conquête a coûté à la France de douloureux sacrifices. C’est là en effet que, pour la première fois, nos soldats se sont trouvés en face des Kabyles ; cette guerre pour eux fut toute nouvelle. Au lieu de ces nuées de cavaliers fondant sur nos bataillons ou tournoyant autour de nos carrés, les Français cherchèrent les Kabyles renfermés dans les maisons ; chaque maison devint une forteresse dont il fallut faire le siège ; chaque jardin défendu par des palissades, à l’abri desquelles l’ennemi tirait sûrement et à loisir, dut être enlevé à la baïonnette. Les femmes, dit-on, se battirent avec un sauvage acharnement.
Nous continuons notre route à travers cette mer qui ressemble à un lac suisse, et bientôt, à trois milles devant nous, s’élève un cône isolé, abrupt, dont le sommet offre la forme d’une pyramide. Ses flancs sont couverts de fortifications, ou neuves ou ruinées. C’est le Gouraya, énorme masse de granit qui dresse sa crête dentelée au-dessus de la ville de Bougie, étendue à ses pieds sur une plage étroite et rocheuse. Nous approchons, et le cône semble grandir encore et nous menacer. La ville apparaît bientôt blanche et coquette, abritée derrière cette muraille de sept cent cinquante mètres de hauteur, aux flancs de laquelle elle grimpe, entourée de verts coteaux.
Nous entrons dans la rade que la nature a créée, d’une étendue et d’une sûreté exceptionnelles et qui est destinée à devenir un des ports les plus vastes et les plus commerçants de l’Algérie, lorsque la route de Sétif par le Chabet-el-Acra aura mis en communication les fertiles vallées de l’Oued-bou-Selam et de l’Oued-Sahel avec le littoral. Notre séjour devant Bougie ne sera que d’une heure ; aussi le commandant ne permet pas de descendre ; mais, de la dunette de l’arrière, nous voyons très bien la ville qui, partagée en deux par le ravin de Sidi-Touati, s’offre aux regards d’une façon toute pittoresque. Cette étroite coupure, souvent à sec, déverse dans la mer les eaux pluviales et facilement torrentueuses du mont Gouraya. À sa droite s’élève le quartier de Bridja dont la pointe s’étend dans la mer et forme le mouillage ; à gauche, le quartier de Moussa, sur les derniers contreforts du rocher, ayant pour le défendre la Casbah, comme Bridja est protégé par les feux du fort Abd-el-Kader.
Tous ces travaux ont été refaits depuis 1854, époque de l’occupation de Bougie. Cette ville a toujours été, à raison de sa situation, l’objet des convoitises de tous les conquérants de l’Afrique. Les Romains y avaient établi une colonie militaire, Salvæ Colonia ; et une inscription, découverte il y a quelques années, fixe les doutes au sujet du nom qu’elle portait. Boga, Choba, Rusucurrum avaient tour à tour été placées à Bougie ; mais on est certain aujourd’hui que la ville portait le nom de Salvæ. Un vieux mur d’enceinte d’un développement médiocre, quelques ruines témoignent du peu d’importance de cette cité. Il en est de même de tous les vestiges romains épars en Kabylie ; ils prouvent tous une occupation incomplète.
Au cinquième siècle, Bougie est envahie par les Vandales ; et Genséric, appelé par le comte Thibaut pour le soutenir dans sa querelle avec Rome, s’y établit jusqu’à la prise de Carthage. Au septième siècle, l’invasion arabe, partie de l’Yémen, le Koran d’une main, le sabre de l’autre, ravage l’Afrique et la conquiert depuis l’Égypte jusqu’au grand Océan qui baigne les côtes du Maroc. En 708, Bougie est prise d’assaut par Moussa-ben-Nocéir qui fait massacrer tous ses habitants. Les ténèbres de l’histoire la couvrent de leur voile jusqu’au quatorzième siècle qu’elle est détachée de l’empire berbère par Igremor-Solthan, qui la donne à son fils Abd-el-Aziz. Pendant deux siècles, elle est le siège d’un petit royaume indépendant. La piraterie la fait puissante ; le commerce la fait riche ; mais au commencement du seizième siècle, la décadence commence et, sous le règne d’Abd-el-Hamet, elle est emportée de vive force par l’armée de Pierre de Navarre qui, peu de jours avant, était sorti avec sa flotte de l’un des ports des Baléares pour l’assiéger. En 1512 et 1514, elle résiste à deux assauts de Baba-Aroudji et Khair-ed-Din, hardi capitaine d’aventure, devenu, par son audace, par la terreur qu’il inspira, par le prestige de ses succès, pacha d’Alger. Mais, en 1545, quarante-deux ans plus tard, elle est attaquée par Salah-Raïs, successeur de Baba-Aroudji, dont vingt-deux galères bloquent le port. Une armée nombreuse de Turcs et de Kabyles assiège les remparts. Bougie, dont les forts Moussa et Abd-el-Kader sont démantelés, dont les défenseurs ne sont plus assez nombreux pour la garder, est forcée de se rendre après une lutte de vingt-deux jours. Le gouverneur, André de Peralta, au lieu de s’ensevelir sous les ruines, signe une honteuse capitulation qui ne garantit pas même à la garnison les honneurs de la guerre. Il obtient la vie sauve pour lui et quelques-uns de ses familiers ; tout le reste est passé au tranchant du cimeterre. Peralta, reconduit en Espagne, va porter une justification impossible de sa lâche conduite aux pieds de Charles-Quint qui le fait juger et condamner comme traître à la patrie, et sa tête tombe sur la place de Valladolid.
Bougie se dépeuple sous le gouvernement turc ; le commerce s’anéantit par suite de l’état d’hostilité continuelle avec les tribus kabyles, et cette ville en ruines n’est bientôt plus que le refuge d’audacieux bandits qui attire souvent, l’attention des peuples de l’Occident. C’est dans ce triste état de délabrement que les Français la retrouvent lorsque l’escadre, partie de Toulon, le 22 septembre 1835, sous le commandement du capitaine de vaisseau Parceval, entra dans la rade avec le corps expéditionnaire chargé de s’en emparer.
Bougie, défendue par les habitants et les Kabyles, descendus à l’appel des Bougiotes et attirés par l’espoir de la victoire et du pillage de la flotte, fut prise après de sanglants assauts ; nous ne dirons pas cette guerre de rues, de maisons qui dura trois jours, pendant lesquels de féroces représailles eurent lieu de part et d’autre. En parcourant la grande Kabylie, nous décrirons un de ces combats acharnés de la campagne de 1857, et qui fera connaître le degré d’énergie, de courage aveugle, de férocité implacable de ce peuple kabyle. Je veux toutefois raconter un épisode de cette possession de Bougie et de ses environs : l’assassinat de M. le commandant Salomon de Mussis, en 1856. J’inscris ici ce souvenir, parce qu’il m’a été raconté sur place par Bel Kassem, l’un des témoins de ce lâche attentat.
Les négociations entamées avec les tribus qui avoisinent Bougie, les Messaoud et les Beni-Mimoun, fréquemment interrompues par des meurtres de nos compatriotes et des coups de main des Kabyles, venaient d’être rompues tout à fait par le colonel Larochette, lorsqu’il fut rappelé à Alger, et le commandement provisoire fut donné à M. le chef de bataillon Salomon de Mussis. Saad-Oulid-ou-Rabah, plus connu sous le nom de cheikh Saad, qui avait organisé la défense de Bougie en 1854, et qui nous avait si longtemps combattus, venait de mourir, et Mohamed-ou-Amzian, son frère, lui succédait dans sa dignité de cheikh et dans son pouvoir. Ce nouveau chef nous déclara franchement la guerre. « Je vous préviens, écrivait-il à M. Larochette que mon intention est de vous combattre ; ne comptez plus sur la paix, car, je vous le déclare, c’est désormais une guerre à mort. » Et tout en rompant avec nous, il ne cessait de solliciter des cadeaux en envoyant les siens. « Je vous envoie un petit sanglier, disait-il en post-scriptum de cette même lettre, afin que vous remettiez en échange, au porteur de ce message, un moulin à café et du tabac à priser. Envoyez-moi en cadeau du calicot et quelques pains de sucre. » Ce trait de mœurs peint bien la race kabyle. Son présent lut refusé.
Quelques jours plus tard, Amzian écrivait encore : « Toutes les tribus musulmanes sont réunies pour faire la guerre ; le paradis est le prix du sabre, et nous vous combattrons avec une grande joie. Les Kabyles se rasent la tête, parce qu’ils n’ont pas peur de la mort, et ils ont le crâne extrêmement dur ; ainsi tenez-vous pour avertis, car avant peu nous vous attaquerons, in cha allah, s’il plaît à Dieu. Écrit par ordre de Mohamed-ou-Amzian. Dieu donne la gloire aux musulmans et extermine les Français ! » Cette fois, il ne demandait pas de cadeaux.
L’attaque eut lieu, en effet, quelques jours plus tard, et un grand nombre de tribus vinrent faire le coup de feu contre nous. Mais elle échoua devant le courage de nos troupes et, disons-le, contre les murailles qui les protégeaient ; car la garnison était trop peu nombreuse pour tenir contre une armée dix fois plus forte qu’elle et animée d’un courage féroce. Aussi le cheikh adressa-t-il une nouvelle lettre au gouverneur de Bougie, lettre qui fut trouvée aux avant-postes, attachée à une lance fichée en terre.
« Si vous êtes Français, vous viendrez dans la plaine vous mesurer avec nous. Vous ne devez pas nous tirer des coups de canon et de fusil derrière vos remparts ; si vous êtes des gens de cœur, vous quitterez vos murs et marcherez contre nous ; sinon vous êtes tous des juifs. »
M. Salomon de Mussis voulant à son tour jouer un rôle politique, et espérant amener les Kabyles à signer un traité de paix, essaya de renouer les négociations. Dans ce but il tenta un rapprochement entre lui et Mohamed-ou-Amzian. Après de nombreux pourparlers, pendant lesquels les Kabyles avaient renouvelé leurs attaques contre nos blockhaus du mont Gouraya, une trêve fut conclue ; foute hostilité aurait dû cesser dès ce moment de part et d’autre ; cependant des escarmouches avaient lieu, et nos avant-postes étaient menacés. Ce fut dans un de ces engagements qu’un Kabyle qui s’avançait sans armes vers la ville fut tué d’un coup de feu par une sentinelle. Il fut reconnu par un jeune Bougiote pour un marabout, ami d’Amzian qui lui avait donné l’anaya. En apprenant la mort de celui qui était placé sous sa protection, Amzian, dans le premier moment de la colère, fulmine des menaces contre les meurtriers. Mais bientôt il comprend que la dissimulation l’amènera plus sûrement au but qu’il se propose, et il envoie demander des explications au commandant de Bougie. Celui-ci, ignorant l’importance que les Kabyles attachent à cette vieille coutume de l’anaya, irrité d’ailleurs des attaques incessantes dont la garnison est l’objet, renvoie avec dureté le messager de Mohamed. La paix, dès lors, n’est plus possible. Les Kabyles demandent satisfaction du meurtre du marabout, du mépris de l’anaya ; et Amzian qui veut se faire pardonner ses relations avec les chrétiens, jure de venger la mort de son ami. Pour suivre son dessein, il cache sa haine sous des semblants de courtoisie et prépare un guet-apens dans lequel M. de Mussis, désireux de la paix, va tomber infailliblement. En effet, une entrevue est demandée par Amzian qui, arrêté au bord de la Summam, entouré de quelques cavaliers seulement, semble attendre la réponse. M. de Mussis, malade, hésite à descendre dans la plaine. Le cavalier qui a apporté le message lui souffle perfidement que les Fénaias et les Mézaias, deux tribus puissantes, ont relevé le mezrag des mains d’Amzian, et que la guerre déclarée avec le cheikh Mohamed doit le rassurer sur ses dispositions. Enfin, M. de Mussis, qu’une fatalité étrange semble entraîner à sa perte, écrit à Amzian : « Si tu veux faire la paix avec moi, viens ce soir, à six heures, à la Maison-Crénelée, nous parlerons de nos affaires et tout s’arrangera à l’amiable ; mais il faut de la franchise et point de détours. »
Le cavalier part, porteur de cette lettre, et Amzian qui tient enfin sa vengeance, envoie prévenir les chefs des Fénaias qui le gourmandaient de son inaction, que la journée ne s’écoulera pas que le meurtre d’Abd-er-Rhaman, son ami, ne soit puni. Ceux-ci se hâtent de se rendre auprès de lui.
Le soir venu, M. de Mussis descend à la Maison-Crénelée, accompagné du kaïd Médani, de l’interprète Taponi, de l’Arabe Bel-Kassem et du sous-intendant militaire Fournier qui veut traiter avec notre futur allié de l’approvisionnement de la ville. Amzian n’est pas au rendez-vous et refuse d’avancer jusqu’à la Maison-Crénelée. De nouveaux pourparlers ont lieu entre les cavaliers de l’escorte d’Amzian et les kodjas du commandant. Le kaïd Médani se porte en avant et reconnaît parmi les cavaliers avec lesquels il parlemente des chefs de la tribu des Fénaias. Il rejoint M. de Mussis et lui conseille de ne pas avancer : « Il y a des figures inconnues et qui ne présagent rien de bon. » De son côté, Amzian répond à l’interprète Taponi qu’il craint une embuscade, qu’il voit luire des baïonnettes dans les broussailles, et il réclame le choix d’un nouvel emplacement pour l’entrevue.
On s’accorde enfin : le lieu de la réunion est fixé au bord de la mer, près de la tour du rivage. Le commandant n’a auprès de lui que Médani, Bel-Kassem, le capitaine Blangini dont la compagnie est placée à quelques cents mètres, et le sous-intendant Fournier. Deux soldats, porteurs des cadeaux destinés à Amzian, sont aussi là, sans armes. Le cheikh s’avance, suivi de quelques cavaliers, laissant en arrière, mais à peu de distance, le reste de la troupe qui l’a accompagné. Il vient à M. de Mussis, et après les salamaleks d’usage, il lui dit que cette entrevue met le comble à ses vœux. Le commandant lui remet un burnous rouge et une pièce d’étoffe. Des pains de sucre et du calicot sont distribués aux cavaliers d’Amzian, restés à l’écart. Le café, préliminaire habituel de toute entrevue, est servi et la conférence commence, bien que, d’un tacite accord, tout le monde soit resté à cheval. Les protestations d’amitié, les poignées de mains sont prodiguées. Cependant les cavaliers d’Amzian se rapprochent et manœuvrent de manière à séparer M. de Mussis de son escorte. Parmi eux, un jeune homme, à figure grave, porteur d’un tromblon, sourit au commandant qui s’approche de lui et lui donne cinq francs. À ce moment de Mussis s’aperçoit qu’il est isolé des siens, et ses regards inquiets dénotent sa préoccupation. Amzian le remarque, et craignant que la conférence ne se rompe, il fait un signal. Le jeune homme se penche sur l’arçon de sa selle, arme son tromblon et l’appuyant dans les reins du commandant, il presse la détente et fait feu. M. de Mussis tombe en avant, et trois coups de fusil, tirés à bout portant, le renversent de son cheval, la colonne vertébrale brisée ; la mort a dû être instantanée, et il n’a ni la force ni le temps d’appeler à son-secours. L’interprète Taponi se précipite en avant, et reçoit plusieurs balles mortelles ; le kaïd Médani, qui était descendu de cheval, est blessé deux fois. M. Blangini échappe aux projectiles, mais il est renversé d’un coup de crosse de fusil ; cependant il ne perd ni son sang-froid, ni son courage ; jeté sous les pieds des chevaux, il appelle aux armes les soldats de sa compagnie qui accourent et le sauvent lui, le kaïd, M. Fournier et les soldats qui ont servi le café, d’une mort certaine. M. Blangini, remis sur pied, disperse ses soldats en tirailleurs et dirige le combat ; mais Amzian n’a voulu que se venger par l’assassinat et non combattre loyalement. Il fuit, suivi de ses cavaliers, et quelques coups de canon tirés de la Maison-Crénelée donnent des ailes à ses chevaux, en accélérant leur fuite. Ils entraînent avec eux les montures du malheureux commandant et de Taponi ; et le lendemain, Amzian, tout glorieux de son exploit de la veille, se promenait dans les tribus sur le cheval de M. de Mussis.
Mais les Kabyles eux-mêmes réprouvèrent ce meurtre qu’ils qualifièrent de félonie, et, dans une tribu, les habitants jetèrent à la face d’Amzian cette grave injure, d’assassin, qui reçoit des présents d’une main et donne la mort de l’autre. Le mépris fit justice de la traîtrise de ce misérable qui disparut du pays. On ne sait ce qu’il est devenu.
Le Titan lève l’ancre et continue sa route ; en quelques heures nous sommes devant Djigelly, l’Igigeli des Romains. On trouve encore dans la ville les traces de leur séjour, entre autres, le pavé en mosaïque d’un temple.
La ville est petite, bâtie en pointe sur un promontoire. Le pays qui l’entoure, et que nous apercevons en longeant la côte, est cultivé et paraît fertile. Les hauteurs sont boisées : Djigelly se compose de quelques maisons que surmontent l’hôpital et la caserne, reconnaissables à leurs dimensions. Quelques maisons arabes, d’apparence misérable, sont groupées autour de la mosquée dont le minaret élancé se détache sur le flanc du rocher. Quatre blockhaus, reliés entre eux par une muraille, forment toute la défense de la place. Le vent d’ouest soufflait avec violence, et l’état de la mer ne permettait pas un long séjour dans cette rade peu abritée et qu’il serait facile de rendre sûre en exécutant le plan de Duquesne ; ce plan consistait à relier entre eux les îlots du port par des maçonneries, en les prolongeant par un môle.
Djigelly fut pris en 1664 par la petite armée du duc de Beaufort : on ne trouva, dit la relation véritable, dans la ville abandonnée que dix canons en fer, et des maisons si laides et si misérables qu’on pouvait à peine croire qu’elles eussent été habitées par des êtres humains.
Un autre passage de ce manuscrit, dont je citerai quelques lignes, prouve que ce peuple n’a pas changé et qu’il est encore aujourd’hui ce qu’il était alors :
Plusieurs étaient nus comme la main, d’autres avaient une houppelande blanche qui les couvrait depuis le haut de la tête jusqu’à la moitié des jambes ; quelques-uns avaient de longs fusils et des sabres, la plupart n’avaient que des zagaies d’un bois fort lourd : les cavaliers, habillés comme les fantassins, ont un morceau d’étoffe au bas de leurs jambes pour tenir leurs éperons longs d’un demi-pied. Leurs selles sont pareilles à des bâts, leurs brides ne sont que de méchants filets ; tous les chevaux que nous avons vus sont petits et efflanqués ; néanmoins ces gens-là les poussent du haut d’une montagne en bas à toute bride. La cavalerie n’osait point s’approcher de nous à cause du canon, mais quand quelqu’un des leurs était tué, ils aimaient mieux s’exposer beaucoup que de l’abandonner.
Djigelly a été presque entièrement détruit, il y a peu d’années, par un tremblement de terre. La ville se relève de ses ruines, mais il y a encore des quartiers abandonnés et dont les maisons n’ont pas été réédifiées.
Le lendemain, vers midi, nous arrivions en vue de Stora, le Tretum des anciens, après avoir doublé le cap Bougarone ; de belles montagnes, couvertes de bois toujours verts, abritent un petit village de pêcheurs maltais, coquettement assis sur le rivage et les premiers échelons de la colline. Stora, autrefois habité par les Romains, n’a conservé d’eux que de belles citernes presque intactes. Une route coupée dans le flanc de la montagne et ombragée d’arbres d’essences diverses, caroubiers, pins, chêne-liège, conduit à Philippeville, qui se dresse au bord de la mer à quatre kilomètres. Mais le peu de fond de la rade ne permet pas aux vaisseaux d’approcher du port qui se creuse en ce moment, et les voyageurs sont obligés de débarquer à Stora.
Philippeville est une ville nouvelle, fondée en 1839 sur les ruines de la colonie romaine de Russicada ; elle est donc toute française et les Arabes peu nombreux qui se sont groupés autour de nous ne forment pas le vingtième de la population.
Les Romains avaient habilement choisi ce lieu pour servir de port à leur puissante Cyrla, Constantine d’aujourd’hui, et l’on retrouve encore les restes grandioses de leur établissement. D’antiques et immenses citernes ont été découvertes sur la montagne, et devaient largement approvisionner d’eau Russicada ; des statues mutilées, des chapiteaux très ornés, des fûts gigantesques de colonnes marquent la place de grands monuments. Sur l’un des fûts de marbre, nous avons retrouvé le dessin primitif de quelque enfant romain, qui y avait gravé au ciseau la silhouette d’un aquarius, porteur de ses seaux.
Des fouilles, faites récemment dans une colline, pour agrandir le collège, ont amené la découverte de ruines importantes ; en creusant un tertre, on a mis à ciel ouvert les loges et les gradins d’un théâtre ; l’amphithéâtre est presque entier, et le proscenium commence à sortir des déblais.
J’ai dit que Philippeville, qui s’élève sur les ruines de la colonie romaine est une cité toute neuve ; elle a de beaux établissements, un hôpital, une caserne très bien situés et en bel air, une église d’aspect monumental, une large rue à arcades ; en un mot, tous les éléments de ce qu’on appelle une jolie ville, et cependant ces paysages africains, baignés de lumière, cette végétation luxuriante font un étrange effet autour de ces maisons européennes et de ces rues tirées au cordeau ; on se prend à regretter les maisons mauresques crépies de blanc, avec leurs portes basses, leurs fenêtres grillées, leur air mystérieux qui s’harmonisent si bien avec la nature qui les entoure.
Toutefois la situation est bien choisie, et Philippeville, qui compte à peine vingt années d’existence, a pris un rapide développement.
Un coup de canon tiré du Titan vint nous avertir, M. M… et moi, pendant que nous visitions la ville, qu’il nous restait à peine une heure pour rejoindre le bord. Nous nous embarquâmes sur une yole maltaise, à la proue élevée, qui rappelle les gondoles vénitiennes, et bientôt le navire, mettant le cap sur Bone, où nous nous rendions, gagnait la pleine mer. Les passagers étaient nombreux : magistrats allant aux assises, officiers rejoignant leurs corps échelonnés sur la frontière de Tunisie, où l’insurrection faisait des progrès, kaïds rentrant dans leurs tribus ; quelques dames formaient une société gaie, animée, favorisés que nous étions par le beau temps. Mais, au coucher du soleil, une large bande de pourpre étendue à l’horizon annonçait que la nuit serait orageuse. Les vieux loups de mer hochaient la tête à la vue de ce pronostic trop certain. En effet, la nuit venue, le vent soufflait avec violence, soulevant la mer et inondant de lames le pont de notre bateau ; il y eut un moment de confusion, et chacun chercha un abri dans le carré des officiers ou les cabines ; il y eut aussi beaucoup de mal de mer. Quelques heures de malaise sont bien vite passées, et le lendemain nous entrions dans la belle rade de Bone. Je dis belle, car elle est vaste, mais elle est dangereuse, semée de rochers à fleur d’eau, que cache l’onde perfide. Nous disions adieu aux officiers du Titan, dont les prévenances et la gaieté avaient abrégé la traversée, et nous entrions dans la petite rade.
À l’entrée du port, d’énormes roches offrent un spectacle singulier : elles accusent la forme d’un lion gigantesque accroupi, dont le flot caresse les pattes de sa frange argentée ; il regarde la haute mer et, sentinelle avancée, semble défendre la ville. Puis tout à coup il s’efface, et on ne voit à la place qu’il occupait que trois blocs schisteux espacés entre eux. Le vaisseau a marché et la vision s’est évanouie ; on voit bien les rochers qui représentaient cette grande figure, mais c’est vainement qu’on cherche à en recomposer l’ensemble, il n’en reste rien. Du môle j’en prenais un croquis exact le lendemain.
À notre droite s’élève Bone, Beled-el-Huneb, la ville des jujubiers, comme la nomment les Arabes ; un mur crénelé l’entoure, et comme, depuis l’occupation française, la ville a augmenté de population, elle a fait brèche à travers l’ancienne muraille, qui, en quelques endroits, se trouve dans l’intérieur entamée par les maisons. Bone, qui était misérable, s’est, grâce à nous, enrichie et relevée de ses ruines. On a élargi les rues, en y construisant des maisons à l’européenne. De beaux squares garnis d’arbres se sont élevés, et la place d’armes est d’un aspect fort gracieux avec sa fontaine entourée de palmiers, de bananiers et de lauriers-roses. Les maisons de cette place sont à arcades, et sur l’un des côtés se dresse une mosquée élégante, avec une coupole et un minaret où nichent des cigognes. La ville, blanche, coquette, indique l’aisance de ses habitants, français ou indigènes ; les israélites surtout sont riches, et la rue Saint-Augustin, je crois, appartient tout entière à une seule famille. Les marchands arabes sont, en général, fort bien vêtus : veste, gilet, culotte, d’une couleur uniforme et claire, sont rehaussés de broderies de soie ; une large ceinture d’un ton éclatant, un turban blanc ou bleu, complètent un costume aussi brillant que pittoresque.
La plupart des marchands sont Juifs ou M’zabites. Ces derniers, émigrés du M’zab, ont conservé le costume arabe pur : le haïk, la gandoura ou la culotte à vastes plis, les jambes nues et le turban roulé en cordelettes. Les Juifs portent toujours le turban noir qui leur était imposé du temps des Turcs.
Quelques rues étroites, bordées de maisons mauresques, renferment tout le commerce indigène. Les artisans, cordonniers, tailleurs, bijoutiers, forgerons, sont accroupis dans de petites boutiques sans fenêtres, et travaillent sur le seuil.
Les marchands d’étoffes, d’objets de sellerie ou de quincaillerie, presque tous M’zabites, ont des magasins un peu plus vastes, où sont empilées pêle-mêle les marchandises les plus disparates. Les M’zabites, Berbères d’origine comme les Kabyles, habitent dans le Sahara quelques villages, dont le principal se nomme Gardiao, et dont l’ensemble forme l’oasis des Beni-M’zab. Une partie de la population s’expatrie et va s’établir dans toutes les villes de l’Algérie, pour s’y livrer au commerce. Dans chaque ville, ils se réunissent, se groupent dans un quartier, pour se protéger mutuellement, se constituent en corporation, avec un chef, dit amin, nommé par eux. À Alger, autrefois, ils avaient le monopole de certaines industries, telles que bouchers, meuniers, baigneurs, comme les émigrants de Biskra, appelés Biskris, sont portefaix ou conducteurs d’ânes. Ce sont les Auvergnats de l’Afrique ; chaque année, quelques-uns d’entre eux retournent au pays, qu’ils n’abandonnent jamais sans esprit de retour, pour y placer les économies faites dans le commerce avec le chrétien.
Les M’zabites passent parmi leurs coreligionnaires pour être austères, laborieux, loyaux en affaires ; ils suivent une religion un peu différente de celle des Arabes, car ils n’admettent pas la tradition, la Somma, et ne croient qu’au Koran. Les Arabes les appellent les Krouaredj, les sortants, parce qu’ils se sont placés en dehors de l’islamisme.
J’ai visité la place où se fait le commerce des denrées un jour démarché : c’est chose curieuse de voir de loin cette masse de turbans blancs, de capuchons noirs ou jaunâtres, de chachias rouges, s’agiter, rouler dans un pêle-mêle indescriptible, et, au milieu, ces fellahs venus de la campagne, fièrement drapés dans leur burnous sale et en guenilles, debout ou accroupis devant une paire de maigres poulets ou quelques bottes d’oignons, attendant le chaland dans le plus complet silence. Quel contraste avec les marchés d’Alger, où Maltais, Espagnols, Français même, appellent, sollicitent la pratique en criant à tue-tête, chacun dans leur idiome ou leur patois national. C’est un vacarme, un charivari de cris, d’interjections, de sons inconnus dans la gamme harmonique dont Wagner lui-même, serait impuissant à noter le formidable tutti. L’Arabe, au contraire, est grave, sérieux, renfermé en lui-même, quoiqu’il n’en pense pas plus pour cela ; mais il ne perd jamais sa dignité, il l’exagère même devant le roumi, comme il appelle l’Européen : deux Arabes se rencontrent-ils après une absence plus ou moins longue, ils s’abordent froidement, s’embrassent mutuellement l’épaule, se touchent la main, qu’ils portent ensuite à leurs lèvres en se disant « selam alek, » salut sur toi ; puis ils se font mille souhaits de bienvenue pour eux, s’interrogent sur la santé de tous leurs parents, excepté de leurs femmes ; ce serait une injure de paraître s’en occuper ; puis ils se quittent gravement, en baisant leurs mains qui se sont rencontrées. On oublie alors les haillons qui les couvrent, pour admirer leur grand air, leurs gestes amples et dignes, lorsqu’ils rejettent en arrière leur burnous troué.





























