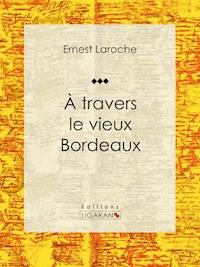
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il y aura tantôt trente-cinq ans qu'un chercheur infatigable, doublé d'un profond érudit, Alfred Delvau, publia un livre fort intéressant : l'Histoire anecdotique des Cafés et Cabarets de Paris. Tel était, je crois, le titre de cet ouvrage introuvable à l'heure actuelle, et dans lequel l'aimable boulevardier monographiait d'une plume humoristique et bien gauloise, ..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335049916
©Ligaran 2015
À MESSIEURS
OBISSIER SAINT-MARTIN
SÉNATEUR
A. SURCHAMP
DÉPUTÉ
G. CHASTENET
DÉPUTÉ
J’offre ce livre en témoignage de vive amitié.
MON CHER AMI,
Je viens de terminer la lecture de votre ouvrage ; je l’ai lu tout d’une haleine, tant il m’a captivé. Un soleil de printemps m’attirait au dehors, mais ayant l’habitude de prendre mon plaisir où je le trouve, j’ai sacrifié le Bois de Boulogne au Pavé des Chartrons.
Votre livre n’est pas seulement un livre pour Bordeaux, c’est un livre pour la France entière, et il serait à désirer que chaque ville trouvât un historien de votre valeur, ayant le dévouement de la recherche, la fidélité de l’impression et la sincérité du récit.
Que de fois les ruines ont été relevées sur cette rive de la Garonne que Bordeaux a traversée pour fonder une colonie en face des Quinconces ! Que de combats, que de sièges, de pillages et d’incendies ont écrasé, ensanglanté, ruiné, détruit la vaillante cité, toujours renaissante, qui est devenue la grande et magnifique ville qu’on voit s’étaler aujourd’hui, dans un paysage plein de contrastes, au bord d’un des plus beaux fleuves de l’Europe ! En remuant la terre, on y trouve les ossements des Visigoths, des Francs, des Sarrasins, des Anglais qui, tour à tour, ont occupé Bordeaux. Dunois l’assiège au nom du roi ; Talbot s’y établit ; Charles VII l’en déloge ; le connétable de Montmorency y pénètre à coups de canon et s’y montre plus terrible, plus cruel, plus impitoyable que ne le fut le duc d’Albe à Gand.
Des temples, des théâtres, des arènes, de tous les monuments par lesquels chaque conquérant avait voulu marquer sa prise de possession, il reste à peine quelques vestiges. Assez cependant pour prêter à la rêverie. Enfant, je contemplais avec regret le peu qui reste du Palais-Gallien, je reconstruisais les arènes par la pensée ; puis j’allais, comme en pèlerinage, au caveau de Saint-Michel où un saisissement me prenait, chaque fois que le gardien, ou sa fille (jeune alors !), disait au visiteur en élevant un bout de chandelle à la flamme tremblotante qui mettait de grandes ombres sur les momies : « Vous marchez sur dix-huit pieds de poussière de morts ! »
Et dans le Bordeaux vivant, on allait de Lormont, aux auberges joyeuses, à Monrepos, cet Orezza de poche ; à Pessac, où commençaient les forêts de pins ; d’autres fois, Blanquefort nous tentait, et aussi les ruines du château de Duras avec ses vieilles tours démantelées, ouvertes comme par un éventreur, et les souterrains où l’on pénétrait en rampant pour y voir de gros boulets de pierre, oubliés là depuis des siècles !
Tous ces souvenirs sont encore vivants, pleins de couleur et parfois de sourires…
Vous avez remué tout cela en moi, mon cher Confrère, et je vous en remercie. Grâce à vous, la cité, quatre et cinq fois ressuscitée, m’est apparue à ses différents âges ; puis, j’ai revu notre Bordeaux actuel, sa clarté, sa joie, son soleil ; j’ai respiré de nouveau les grappes de ses acacias ; et, comme en un mirage, ses foires bariolées ont reparu avec l’animation des bazars d’Orient et le brouhaha du Midi ; et les fanfares, les bruits discordants, les éclats de rire des grisettes dans les émanations des gaufres sortant du moule et le doux parfum des gimblettes !
Sensations exquises, retour vers un passé – peuplé de fantômes adorés – qui sonne pour le Bordelais vieilli, avec le regret des jeunes années, le signal mélancolique du retour !
AURÉLIEN SCHOLL.
Il y aura tantôt trente-cinq ans qu’un chercheur infatigable, doublé d’un profond érudit, Alfred Delvau, publia un livre fort intéressant : l’Histoire anecdotique des Cafés et Cabarets de Paris. Tel était, je crois, le titre de cet ouvrage introuvable à l’heure actuelle, et dans lequel l’aimable boulevardier monographiait d’une plume humoristique et bien gauloise, dans des chapitres alertes qui avaient parfois une saveur toute rabelaisienne, la Plupart des popines historiques, des cabarets et parlottes littéraires, des guinguettes galantes, des tavernes de bohèmes et de gueux, et des cafés à la mode de la capitale du monde civilisé – depuis la Laiterie du Paradoxe jusqu’au Lapin blanc, en passant Par la Brasserie des Martyrs, Momus, l’Assommoir et les tapis francs d’Eugène Süe.
L’exploration ainsi comprise est des plus utiles : elle permet d’étudier, dans l’estaminet, période à période, l’histoire de la civilisation parisienne ; on y salue des noms illustres, on y rencontre des physionomies aimées entre toutes.
Le cabaret – ou, si vous le préférez, le café – tient une place importante dans la vie des gens. De même que la Grèce et Rome avaient les xénies et les popines, que l’Allemagne a les kellers, l’Angleterre les public-houses, l’Espagne les ventas, l’Italie les osterias et la Chine les cong-quans, la France a les cafés en grande quantité. C’est un fait acquis, acceptons-le tel quel et essayons d’en tirer, ainsi que l’a fait d’une façon si heureuse Alfred Delvau, le détail curieux.
Que voulez-vous, après tout ? On l’a dit depuis longtemps : « Le « chez soi », qui est la caractéristique du tempérament anglais, est inconnu dans nos grandes villes. Vivre chez soi, penser chez soi, aimer et souffrir chez soi, nous trouvons cela ennuyeux, incommode ; ce sont des pratiques, des habitudes d’un autre temps. Il nous faut la publicité, le grand jour, le monde pour nous témoigner en bien ou en mal, pour satisfaire tous les besoins de notre vanité ou de notre esprit. Nous aimons à nous donner en spectacle, à avoir un public, une galerie facile ; la pose nous tue. Ce n’est pas d’aujourd’hui, ni d’hier, ni d’avant-hier que nous nous conduisons ainsi – et cela durera probablement longtemps encore. »
Faut-il s’en réjouir, s’en attrister ? Ma foi, ni l’un ni l’autre. Agissons donc à notre guise et laissons travailler et lutter les sociétés de tempérance : il paraît qu’elles obtiennent des résultats !…
Il y a longtemps, belle lurette, que les cafés et les cabarets sont devenus les salons de la démocratie, de tout le monde, comme l’a dit M. Hippolyte Castille. Et si vous voulez des noms, je puis vous en fournir et non pas des moins illustres.
Socrate, le sage, allait volontiers dans les tavernes d’Athènes et s’attardait au milieu des oisifs et des portefaix du Pirée ; Denys le Jeune, dans les cabarets de Corinthe, et Virgile, le doux Virgile, dans les popines syriennes, de même qu’Ovide, en compagnie de Properce et de Tibulle, chez le cabaretier Coranus.
Puis, plus près de nous, est-ce que Shakespeare le génial ne fréquentait pas assidûment – trop assidûment – la Taverne du Cygne, à Londres ; Luther, l’Ourse noire, à Orlemonde ; Rabelais, notre Rabelais, la Cave peinte, à Chinon ; Cromwell, le Lion rouge ; Gœthe, l’Auerbach keller, à Leipzig ; François Villon, le pâle bohème, la Pomme de pin ; Ronsard, le Sabot ; Racine, le Mouton blanc, où il composa ses Plaideurs ; Voltaire, le Café Procope ; l’abbé Prévost, le petit cabaret de la Huchette, où il commit Manon ; Vadé, Collé et Panard, ces chansonniers que l’on veut, avec raison, remettre en honneur aujourd’hui, le Tambour royal, chez Ramponneau, à la Courtille, – d’où tant de gens sont descendus ?
Et plus près, plus près de nous encore, ceux que nos pères ont connus, aimés – admirés : Véron, Alexandre Dumas le père, Méry, Roger de Beauvoir, Théophile Gautier, n’étaient-ils pas les familiers de cet aimable et minuscule cabaret de la mère Saguet, où s’est dépensé tant d’esprit – et du bon, – où se sont tant de fois attablés, au temps de la prime jeunesse, Adolphe Thiers et Crémieux, Victor Hugo et David d’Angers, Tony Johannot et le pauvre Armand Carrel ?
Ont-ils eu raison ceux-là de fréquenter au cabaret ? Cela ne me regarde pas, ni vous non plus, du reste. Un modeste, un conteur n’est pas forcément un moraliste. La recherche du « pourquoi », du « comment » des choses et des faits – psychologie spéciale et aride – ne le tente pas. Il constate l’incontestable et passe, furetant toujours, dans sa course sans merci ni trêve après le renseignement, l’indication, le document, l’inédit ; – et c’est déjà un titre à la considération distinguée de ses contemporains !
Bordeaux est certainement exploitable – explorable, si vous voulez – à ce point de vue. Il y aurait beaucoup à glaner de-ci et de-là, à l’aventure, en flânant, pour les Bordelais qui se connaissent si peu d’une façon intime, dans l’histoire des « buvants » de tous ordres, étranges souvent, intéressants toujours, qui ont inondé – c’est une figure – notre belle cité gasconne. Que d’enseignements on peut tirer de ces promenades, de ces hantises fréquentes ! Et bien que notre ville offre non point à l’observation, mais à l’étude et aux investigations, un champ moins vaste que Paris, on doit essayer quelques incursions dans le domaine du passé. Il y a à faire comme une ébauche de l’histoire curieuse de Bordeaux – types et lieux – découverte en buvant un bock, en dégustant le petit bleu, en savourant une tasse de crème, la pipe ou le cigare aux lèvres, suivant le cas, et crayonnée au hasard de la plume et des impressions multiples.
À ceux qui se voilent la face devant le nombre – tous les jours plus grand, c’est à reconnaître – des maisons où le plaisir énervant se tarife, où, au milieu de la chanson claire des pintes et des brocs, les jeunes de notre génération vont, sous le prétexte d’oublier des chagrins qu’ils se créent, et de rêver aux illusions envolées pour un jour avec la dernière amourette, s’emplir la tête de fumées lourdes, se fausser le jugement et dissiper le meilleur de leur jeunesse ; à ceux-là je citerai aujourd’hui – comme palliatif, s’il en est – quelques-unes des guinguettes et des salles publiques installées dans notre ville pendant le premier quart du siècle.
Alors florissaient les Champs-Élysées, la Charmille, Vincennes, Plaisance, Sacouty, au canton de la Rode (rue Croix-de-Seguey), le Bon Grenier, chez Tartillette, rue Paulin, près la rue Bel-Air (rue Naujac) ; le Petit-Bosquet, l’Île-d’Amour, à l’entrée de la rue Pont-Long (d’Arès) ; l’Hôtel Femelle, rue de Condé, près des Quinconces, où l’on achevait la démolition du Château-Trompette dont je parlerai longuement plus loin ; les cabarets de Flageolet et de Rochefort, ce dernier au Grand-Marché (il existe encore) ; Blanchereau, le Champ d’asile et le Barricot, chemin d’Arès ; le Montferrand, rue Laroche, à côté de la source de Figueyreau où les marchands d’eau, ces types oubliés, allaient s’approvisionner ; les Petit et Grand Versailles, deux concurrents, chemin du Tondu, et non loin du cours d’Albret ; le Trianon, à côté de la vieille église de Sainte-Croix, le plus bel antique peut-être de Bordeaux ; le bal équivoque du Sabot ou de la Galoche, rue de la Chartreuse, et tous les cabarets sans désignation, avec leurs enseignes de fer-blanc peinturluré grinçant au vent et leurs charmilles fleuries, où, dans un doux nonchaloir, allaient s’oublier les grisettes, les vraies, les seules – les Bordelaises – en robe à taille courte, tabliers à corsage et à bretelles, bas à jour, souliers découverts à attaches, et la tête coquettement encadrée dans le mouchoir de madras ou la coiffe blanche, les jours de grandes fêtes.
La mode était alors aux visites à Maconnais, un bastringue situé rue du Palais-Gallien, tout au coin de la rue Turenne, près de la poudrière, à deux pas des ruines romaines qui occupaient l’emplacement où ont été tracées depuis les rues Sansas et du Colisée et une partie de la rue Émile-Fourcand.
On se rendait souvent chez les Frères Arnaud, qui sont devenus le Moulin-Rouge sans changer de réputation. Les oisifs aimaient s’attabler volontiers, pendant les longues soirées de janvier, en devisant autour des poêles rougis, à la lueur vacillante des chandelles, au Café des Aveugles, rue Planturable (Émile-Fourcand), près le Colisée ; au Chien-Canard ( ?) et à la Table ronde, le premier rue Voltaire, le second rue Huguerie, au coin de la rue de la Taupe (Lafaurie-de-Monbadon), et au Petit-Matelot, guinguette qu’il ne fallait pas confondre avec les restaurants du même nom, situés, l’un à mi-chemin de Cenon, l’autre près de l’étrange maison des Quakers, ces fantasques gris, bâtie au milieu d’une des anciennes sablières de la rue de Marseille.
On dansait ferme à cette époque ; la danse était même la seule distraction, et les avant-deux, les valses, les sauteuses, les pastourelles allaient leur train. Il fallait voir, c’était merveille ! Quand je dis la seule distraction, je me trompe. Il y en avait une autre qui consistait à mettre en chansons – et quelles chansons, bon Dieu ! – les faits les plus communs, les plus ordinaires, les riens, les bagatelles. Les ouvriers qui fréquentaient les bals raillaient amèrement les « calicots », vers qui allaient évidemment toutes les préférences des demoiselles. Les calicots répliquaient vertement, et la lutte tournait à l’aigre en un clin-d’œil. Bien souvent c’étaient les pauvres grisettes qui souffraient de cette lutte poétique ( !) ; à preuve la chanson suivante qui courait les faubourgs de Bordeaux en 1818 et que je vous livre telle que je l’ai découverte récemment avec la notation de l’air, un air de danse, bien entendu :
(Textuel.)
Je passe des vers et non point des meilleurs.
Et c’était tous les jours ainsi, à propos de botte – ou de jambe, pour mieux dire. Rien n’arrêtait la haute inspiration, rien ne tarissait la verve des poètes-amateurs dont pas un seul, hélas ! n’est allé à la postérité. Ils traduisaient de leur mieux leur sentiment en strophes plus ou moins correctes, en se souciant, on l’a vu, des règles de la prosodie comme d’une guitare ; et si maintenant tout finit par des banquets, tout alors, ainsi que je l’ai dit plus haut, finissait par des chansons.
Et, somme toute, c’est encore, certes, la meilleure façon de comprendre la vie.
Puis, quand le printemps montrait le bout de son petit nez rose derrière les grands arbres des allées de Tourny, dans le rire ensoleillé des premiers beaux jours, quand c’étaient les Pâques fleuries, – et le bon soleil alors était précoce ! – les grisettes prenaient vite les robes et les brassières d’indienne à ramages, les mouchoirs aux couleurs tendres, et s’en allaient, dans la grâce éclatante de leurs vingt ans, courir les sentiers, belles et désirables, au bras des « prétendus » énamourés. Puis, en rentrant, ne sentant pas la fatigue, tellement on était heureux d’aimer et d’en vivre, on hâtait le pas, à travers les rues tortueuses, – éclairées, comme vous savez, par de rares lanternes suspendues à des cordes tendues de droite à gauche des voies étroites, et que le vent se chargeait d’éteindre au début de la soirée, – pour aller achever la journée chez Bojolay qui tenait à ce moment le Théâtre de la Gaîté, sur les allées de Tourny, à côté d’un café qui, ensuite, a beaucoup perdu de son importance première, le Café Kern, soit au Théâtre de Gillotin, sur la place des Quinconces.
Gillotin avait édifié sa scène à peu près à la place qu’ont occupée tour à tour le théâtre du Gymnase et les bureaux du journal le Nouvelliste. Il était entouré, comme son concurrent la Gaîté, seulement de quelques masures et petites « échoppes » dont l’aspect offrait un contraste saisissant avec l’aspect de la maison Gobineau qui déjà se dressait, imposante, sur les magnifiques allées d’arbres de Tourny.
Le 12 avril 1801, un petit spectacle pour le genre des variétés avait été établi sur les allées de Tourny, dans une baraque décorée du nom de Salle de la Gaîté. Elle fut brûlée le 12 mars 1802. Le directeur fit rebâtir son ancienne salle qui fut baptisée Théâtre de la Gaîté, ainsi que je le dis plus haut, et y réalisa des recettes assez rondelettes, jusqu’au jour où l’on réduisit à deux le nombre des théâtres permanents à Bordeaux : l’un pour le grand spectacle, l’autre pour le genre des variétés.
Le même directeur avait également fait construire, route de Saint-Médard, les Folies-Bojolay dont je reparlerai.
Le soir, aussi, les maris qui échappaient par hasard aux exigences de leur moitié, ou qui trompaient leur aimable surveillance, se réunissaient au café de l’État-Major, à la « Rotonde des Français » (aujourd’hui brasserie du Coq d’Or), narguant au passage les petites… dames qui débouchaient de la rue du Canon (de la Vieille-Tour), pour faire leur promenade quotidienne. L’usage, en ce qui concerne ces dames, ne s’est, pardieu ! pas encore perdu !…
Au café de l’État-Major, puisque j’ai parlé de lui, se réunissaient aussi des journalistes, Couderc ou J. Arago, appartenant soit au Mémorial, soit au Kaléidoscope, l’ennemi acharné de M. de Villèle ; des acteurs, Desforges, Buet, Fournier, un comique ; des musiciens, Duchaumont fils et Duchaumont père, violon-solo au Grand-Théâtre et chef de la famille Amourous, si connue et si justement estimée.
On y a vu, tour à tour, le grand Talma et Pauline Rossignol, une danseuse-étoile, qui demeurait au Puits-de-Fer, au coin de la rue de la Taupe et du cours de Tourny (où se trouve actuellement le café de l’Époque), et qui faisait, surtout dans l’Amour au Village, les délices des lorgnettes abonnées aux fauteuils de la salle Louis. Ligier s’y arrêtait parfois, en descendant de sa propriété de la rue Ségalier ; de même que Déruisseaux, un comédien médiocre, mais un garçon de cœur, qui se tua, un soir, en plein théâtre, pour échapper aux sifflets et aux quolibets des spectateurs – un peu moins Bordelais que de nos jours, je veux dire un peu moins… indulgents.
Hélas ! ce passé s’efface peu à peu, chaque jour davantage, avec l’image des Mimis et des Babets qui, belles d’insouciance, de gaîté et de jeunesse, couraient les bois de Pessac et de Talence, dans un froufrou de pompadour et de percaline neuve, et attachaient leur petit cœur tout entier au fil d’une amourette, à l’âge où ce cœur entrait en efflorescence comme les bosquets au mois d’avril.
On a oublié les chansons des grisettes, et c’est à peine si on peut saisir, au fond de la brume triste des années, un souvenir de cette époque pleine d’une poésie intime, alors qu’on va s’asseoir, au printemps, sous les treilles bourgeonnantes, dans la campagne aimée de nos aïeux.
Nous nous rappelons, par les récits de nos grands-pères, les luttes politiques auxquelles donnèrent lieu, dans notre ville, la chute de Napoléon Ier et l’avènement de Louis XVIII. Les [ fidèles de l’empereur et les fanatiques du royalisme se livraient bataille sur tous les terrains. Je ne veux parler aujourd’hui que des rixes des rues et des combats à coups de chansons.
Donc, à la fin de l’an 1815, les querelles étaient fréquentes dans les rues, et des rixes s’ensuivaient entre gens du peuple, royalistes et bonapartistes. Et les coups pleuvaient dru ! Les belliqueux partisans de Louis ou de Buonaparte n’auraient certainement pas apporté plus de rage et d’acharnement dans la lutte contre les Anglais.
Les royalistes, qui se sentaient les plus forts, ne cessaient de narguer leurs adversaires, de les molester en prose, en vers – et contre tous ! Quelque vieil émigré, sans doute, avait commis le couplet suivant qui se chantait – avec accompagnement de coups de trique au besoin – sous les fenêtres des bonapartistes :
Les dames de la halle – du grand marché des Fossés surtout – étaient intraitables et espéraient en imposer à leurs contemporains par l’étalage de sentiments royalistes et de costumes qui traduisaient fidèlement ces sentiments : robes blanches, tabliers de soie verte et souliers de prunelle à attaches vertes.
Les hommes portaient la cocarde blanche à leur chapeau, et s’en seraient voulu s’ils n’avaient arboré le dimanche le drapeau blanc officiel à gros nœuds verts, tout en haut de leur échoppe aux murs crépis.
On promenait à ce moment le buste en plâtre de Louis XVIII par les principales rues de la ville, et le cortège passait au milieu des ovations enthousiastes sur une jonchée de feuillage et de fleurs. Les dames de la halle – qui avaient formé une vaste association et marchaient précédées d’une bannière que l’on a vue longtemps suspendue aux voûtes de l’église Saint-André – étaient au premier rang des spectateurs, houspillant au passage, malmenant dans leur pittoresque idiome gascon, couvrant de quolibets d’autres femmes connues pour bonapartistes, que l’on gratifiait de l’agréable qualificatif de « terroristes » et qui répondaient en menaçant du poing, en montrant bec et ongles… je n’ose pas dire : et le reste, et cependant !…
Et c’étaient des fêtes, des manifestations sans fin, des chants d’allégresse, des vivats, des bruits de pétards dans l’air, comme une débauche de joie dans toutes les classes ; car ce mouvement eut ceci de particulier – je parle pour Bordeaux – qu’il engloba tout le monde, grands et petits, riches et gueux. On apprenait des chansons dans le genre de celle-ci, par exemple, que l’on débitait à tout propos et surtout hors de propos :
I
II
III
Et notez bien que le mouvement, loin de s’arrêter au bout de quelque temps, s’accentua plus fortement encore chez les dames de la halle. On n’a pas oublié qu’en 1820, lors de la naissance du duc de Bordeaux, ces dames envoyèrent à Paris une délégation de recardeyres artisanes qui offrirent au royal nourrisson un superbe berceau, œuvre du vannier Chevrier, demeurant allée des Noyers. L’une des députées, une bonne femme pleine de santé robuste, Mme Anniche ***, vivait encore il y a quelques années. Elle était, comme bien on pense, plus qu’octogénaire. Elle habitait non loin du cours du Jardin-Public, où je l’ai connue, entourée de la vénération de ses descendants.
Dans toutes les réjouissances publiques, les harengères de Paris qui, les premières, s’intitulèrent les Dames de la Halle, avaient coutume de députer vers le roi quelques-unes d’entre elles pour lui porter les félicitations… du peuple de la capitale, simplement ! Les marchandes de Bordeaux les imitèrent dans la circonstance que je viens de rappeler. Mais, afin de donner plus de magnificence à leur offrande, elles résolurent d’y associer les principaux habitants de la ville, en recueillant des souscriptions volontaires.
Le berceau, béni par l’archevêque, fut remis à la duchesse de Berry le 16 décembre 1820 par trois députées présentées à la cour par leur compatriote, M. de Sèze, pair de France. À cette occasion, une médaille commémorative fut frappée qui portait à son revers l’inscription suivante :
« La maï daou noubet Henric Dioudounat, a tous de Bourdéous qu’an baillat é as brabes Bourdeléses qu’an pourtat lou brés oun drom lou hillet daou Biarnés duc de Bourdéous. »
Mais les bonapartistes tenaient bon : ils avaient confiance, ces gens-là. Ils croyaient à la possibilité, à l’imminence du retour de leur monarque bien-aimé. Ils répondaient aux attaques de leurs ennemis, aux vexations dont on les accablait, par des coups d’épée s’ils étaient gens de marque ou militaires, par des coups de poing s’ils étaient roturiers. Une querelle commençait, soit dans un café, soit aux Folies-Bojolay, route de Saint-Médard (vis-à-vis les Deux-Ormeaux), qui finissait souvent d’une façon tragique dans une rencontre dans la rue Coupe-Gorge, derrière la Chartreuse, à deux pas de Vincennes.
Ils essayaient bien de conspirer un peu entre-temps, mais en pure perte, et piteusement ils échouaient.
Et, comme une suprême raillerie, pleine de dédain et de mépris, une chanson dont la tentative de restauration impérialiste faisait tous les frais, courait les rues, poursuivant comme un remords, ou plutôt un cauchemar, les partisans du Corse à la redingote grise. La voici, textuelle :
I
II
III
Pour éviter les collisions dans la rue, sur les places, et les scandales qui pouvaient en résulter, les postes avaient été doublés renforcés, d’autres créés. Il y en avait un au coin de la rue Poudensan et de la Croix-de-Seguey – mis là pour défendre la demeure d’une irascible charcutière bonapartiste ; un autre à la place Dauphine, veuve alors de la statue du roi de Rome, qui l’ornait quelque temps auparavant (la place Dauphine était alors occupée par les véhicules des charretiers qui y attendaient les clients) ; d’autres encore aux allées Damour, sur les quais, à Saint-Michel.
La ville tout entière était en effervescence, les bonapartistes logeant un peu partout, bien entendu. À ma connaissance, des rixes se produisirent assez fréquemment rue Saint-Christoly, rue des Treilles (de Grassi), rue Tronqueyre (Rodrigues-Pereire), rue des Lauriers (Mériadeck ou du Château-d’Eau), rue Neuve (de Fleurus), au pont de la Mothe (angle de la rue Dauphine et du cours d’Albret), place du Marché-aux-Veaux, allée des Noyers (rue David-Johnston), rue des Mothes, près de la Porte Basse (fossés des Tanneurs, anciennement rue Boule-du-Pétal), rue du Poisson-Salé (rue Sainte-Catherine, depuis environ la rue des Ayres, où se trouvait la fontaine du Poisson-Salé, jusqu’au cours des Fossés), rue Bouhaut (continuation de la rue Sainte-Catherine jusqu’à la place Saint-Julien). La rue Bouhaut était presque exclusivement occupée par des marchands israélites.
Les « terroristes » impénitents, avec une ténacité digne d’un meilleur sort, allaient toujours, ne se laissant ni réduire ni abattre. Eux aussi avaient leur chanson, quelque chose comme leur choral de Luther, où perçaient, dans les allusions poétiques, leurs secrètes espérances, leurs inébranlables résolutions, leurs fermes aspirations.
Qu’on en juge :
I
II
Quel lyrisme, quelle fidélité, quelle espérance, quelle ténacité dans la conviction !
Hélas ! tout cela était très beau, j’en conviens sans peine, mais Roland ne revint pas !
J’ai dû dans le chapitre précédent sacrifier beaucoup aux citations de texte et laisser dans l’ombre des faits susceptibles d’intéresser le lecteur, dans cette étude anecdotique de la Restauration et des Cent-Jours – une époque si peu connue.
Le populaire, certes, n’était pas seul en proie à cette fièvre de la passion politique que j’ai montrée. Pendant que les dames de la halle et quelques acabayres manifestaient hautement leur entière sympathie pour le régime nouveau, M. Henri-Joseph Laîné, accusé par les bonapartistes d’être un factieux vendu à l’Angleterre, et qui, par son attitude, précipita le mouvement qui ouvrit, le 12 mars 1814, les portes de Bordeaux au duc d’Angoulême, écrivait ses énergiques protestations contre « l’usurpateur ». Enfin, comme je l’ai dit, tous ceux, gentilshommes ou bourgeois, nobles ou soudards, qui voulaient s’en donner la peine, trouvaient mainte occasion, sans se déranger, d’en découdre proprement.
Il était écrit que cette glorieuse et sinistre épopée césarienne, qui avait déjà coûté tant de sang à la France, devait s’achever dans le sang, au milieu de la lutte sauvage des partis. Les cœurs battaient encore dans les poitrines la charge des jours de combats ; les têtes étaient chaudes encore, et dam !…
Pour un rien, un mot, une futilité souvent, on armait une dispute, histoire d’aller ferrailler sur le pré pour ne pas s’engourdir les muscles. Cette habitude brutale du duel s’ancrait chaque jour davantage dans les mœurs, et deux braves gens parfois risquaient leur vie et compromettaient leur avenir sur la rouge ou la noire d’un combat singulier, parce que c’était d’usage, bien vu et de bon ton.
Bordeaux eut, à cette triste époque de décadence politique, cette plaie sociale : les bretteurs de profession. Gobineau, propriétaire de la maison qui porte son nom ; le jeune Gaston Clairat, le comte de Larillère, qui habita une petite maison de la rue Saint-Étienne, construite tout à côté du cimetière de Saint-Seurin, sur l’emplacement qu’occupe actuellement celle portant le numéro 12 ; le marquis de Lignano, demeurant dans le cul-de-sac Saint-Pierre, près la rue des Argentiers ; Lucien Claveau, un Chartronnais, dont les duels ont été déjà racontés, et cent autres encore.
Je parlerai donc seulement des duellistes honnêtes – bonapartistes ou royalistes – qui se battaient avec acharnement, mais aussi avec loyauté et courage, pour leurs opinions, et qui, d’abord, étaient sincères. Mais, avant d’aller plus loin, il convient ici d’ouvrir une parenthèse.
J’ai à m’expliquer sur deux points. Le premier a trait à la classification des Bordelais en deux partis : les royalistes ou légitimistes, et les bonapartistes. Étaient dénommés bonapartistes non pas seulement les partisans de Napoléon, mais même tous les gens qui n’étaient pas royalistes – voire même les républicains purs, ou plutôt les « libéraux ».
La confusion pourrait se produire à ce sujet. Aux yeux des blancs, tous leurs adversaires politiques étaient des fauteurs de désordre : lisez bonapartistes. Et pourtant, parmi ces prétendus factieux, je pourrais citer des hommes honorables et intègres qui, sous la monarchie de Juillet, furent les libéraux de l’opposition, ce groupe d’où sortirent, d’où surgirent les fermes républicains militants de 1848.
Le second point concerne les duellistes. Abstraction faite des spadassins de profession, il y avait à Bordeaux une nombreuse catégorie d’hommes imbus d’idées belliqueuses, qui, sur les bancs du lycée, avaient appris, au lieu du grec, l’art de ferrailler et de se battre ; dont l’instruction, l’éducation première aussi avaient été toutes militaires ; et qui considéraient comme un devoir naturel de répondre par l’envoi de témoins à une intempestive et bête provocation.
S’ils étaient royalistes, ils obéissaient, dans leur façon de faire, aux mêmes sentiments de haine politique qui guidaient les dames de la halle allant de grand matin donner des charivaris sous les fenêtres de leurs adversaires, ou encore fouettant en plein marché, en 1815, une femme, Mme Lhoste, accusée de bonapartisme. Somme toute, des honnêtes gens que l’idée et la passion politiques entraînaient souvent et aveuglaient.
Je ne veux pas m’occuper, à cette place, des spadassins de métier qui, au sortir de leurs clubs de la rue Notre-Dame-aux-Chartrons ou de la rue du Mû – (une des petites rues montueuses existant encore dans le quartier Saint-Paul et qui conduisaient au marché aux Veaux (Vieux-Marché), près du Μû (l’Abattoir) – se postaient aux abords du Grand-Théâtre pour, de leur autorité privée, en défendre l’accès aux spectateurs paisibles.
Les duellistes sérieux – ceux qui se rencontraient et croisaient le fer pour une cause – se réunissaient dans deux endroits. Le Café Helvétius, à l’angle de la place de la Comédie et du cours de l’Intendance, abritait les officiers et quelques soldats de la garde nationale royale que l’on venait d’instituer. Par dérision, on les appelait les « culs-blancs », à cause de leurs brassards blancs et de leurs longues redingotes blanches dont les pans leur battaient les mollets. C’étaient, pour la plupart, des gens de condition moyenne.
Le Café Helvétius se transporta ensuite sur le cours du Chapeau-Rouge, en face du Grand-Théâtre. Il est devenu depuis le Café de l’Opéra.
Le Café de la Préfecture, qui subsiste encore, était le lieu des rendez-vous quotidiens des bonapartistes. Il arrivait souvent qu’une quinzaine de demandes de cartels étaient envoyées dans un seul jour d’un café à l’autre. C’était, sur une feuille de papier, une liste en regard des noms de laquelle les habitués du café où elle était adressée étaient tenus, de par les usages en vigueur, de mettre leurs noms.
Il me revient à l’esprit une anecdote que je ne puis résister à l’envie de vous livrer. Je la tiens d’une personne très estimée à Bordeaux et dont le père, un homme très chatouilleux et qui eut plus de trente duels, vivait encore il y a quelques années.
Un soir, M. H… – qui fut plus tard, sous la monarchie de Juillet, je crois, chef d’un des services de la mairie – se trouvait au Grand-Théâtre. Il avait pris place au fond de la salle (il y avait alors – déjà – une porte tout en haut du parterre, sous la loge municipale). À ce moment, Garat, neveu du conventionnel et acteur adoré du public, chantait une cantate en l’honneur de Louis XVIII, dont le buste, sur la demande des spectateurs, venait d’être placé sur la scène avec grande cérémonie.
M. H…, qui était de petite taille, écarta du coude, à plusieurs reprises, pour mieux voir le spectacle, ses voisins, debout, comme lui, dans le couloir. L’un d’eux, un officier de cuirassiers, impatienté de ce manège et peut-être aussi un peu bousculé, toisa dédaigneusement M. H… de toute sa hauteur, et, d’un ton ironique, l’appela gamin.
Le gamin – un homme de vingt-cinq ans, s’il vous plaît, bondit sous l’affront. Il appela l’ouvreuse :
– Un tabouret, tout de suite !
L’ouvreuse s’exécuta avec un empressement intéressé. M. H… grimpa sur le siège, et, blanc de colère, il appliqua par deux fois sa main frémissante sur le visage de l’officier, en lui criant :
– Je suis assez grand, maintenant ?
On sortit sur-le-champ, comme bien vous pensez, pour se battre tout à côté, sous une lanterne, contre les remparts du Château-Trompette.
À la deuxième passe, l’officier était percé de part en part.
Les duels avaient lieu, ainsi que je l’ai dit, sur le Pré-aux-Clercs bordelais, dans la rue Coupe-Gorge, puis sur les terrains vagues du Tondu, du chemin des Cossus, ou encore du côté de Vincennes, à deux pas du mur où les généraux César et Constantin Faucher, les deux jumeaux de La Réole, ces martyrs de l’exaltation populaire, et que leur ami M. Ravez lui-même ne voulut pas défendre, devaient être fusillés le 27 septembre 1815. L’exécution eut lieu sur le Pré-de-Pourpre, lieu ordinaire des exécutions militaires, à deux pas du « Porge des protestants », où a été construite depuis l’usine à gaz.
Une fois les affaires terminées, les combattants qui en réchappaient allaient avec leurs témoins soit chez Olivier, aux Orangers ou au Bois de Boulogne, un charmant établissement situé à mi-chemin de Pessac, un peu avant la Médoquine ; soit chez Thuronne, une marchande de comestibles du marché, très renommée pour ses produits de primeur, et qui tenait à Caudéran, un peu après la propriété où a été ouverte depuis la rue Saint-Amand, une auberge devenue en peu de temps le rendez-vous obligé des viveurs de l’époque. Et la journée s’achevait gaiement en amusettes.
Les manifestations de la rue et des cafés ou cabarets se reproduisaient souvent à Bordeaux, au théâtre, avec cette circonstance, peu à l’honneur des trouble-fête, qu’elles visaient des acteurs à qui il était interdit de répondre.
La grande tragédienne Mars (de son vrai nom Anne Boutet) aimait beaucoup Napoléon – non pas pour des motifs politiques, je le crois du moins. Léon Gozlan dit, dans ses Châteaux de France, qu’on lui a montré, à Rambouillet, un petit kiosque, isolé au milieu d’un lac, où Napoléon la reçut mystérieusement. Cela me suffit.
Un soir, Mars parut sur la scène – on était alors en pleine Restauration – avec une robe constellée d’abeilles et de violettes. Le tumulte fut à son comble. On voulut la forcer à crier : « Vive le roi ! » Elle s’y refusa d’abord ; puis, se ravisant, elle s’avança vers le public :
– Vous me demandez de crier : Vive le roi ?
Après une pause :
– Eh bien ! je l’ai dit.
L’acteur Fleury, l’ami de Mars, qui eut souvent l’honneur de jouer chez Voltaire, à Ferney, fut aussi, en 1815, soupçonné, avec moins de raison peut-être, de bonapartisme, et, à Paris, il essuya, dit M. Louis Loire dans ses Notices biographiques, à deux reprises, des marques d’hostilité des spectateurs royalistes. À Bordeaux, où Fleury donna avec Mlle Patrat une représentation, le fait se reproduisit. On jouait du Molière. L’acteur, s’avançant, respectueux mais digne, sur le devant de la scène, dit aux spectateurs :
– Messieurs, je représente ici Tartufe ; ayez, je vous prie, la bonté de permettre que je m’acquitte de mon devoir. Si demain quelqu’un désire me parler en particulier, je demeure rue Traversière, n° 23.
Nul ne bougea et la représentation s’acheva au milieu des bravos.
LES Anglais, entrant à Bordeaux en 1814, se logèrent un peu partout où ils purent, dans la ville : les officiers au centre, les soldats dans les faubourgs. Bordeaux comptait à ce moment à peu près cent mille habitants qui leur accordèrent une hospitalité forcée, et intéressée par cela même.
Les étrangers s’installèrent donc aussi commodément que possible, qui dans les hôtels ou « maisons bourgeoises », qui dans les échoppes. Ils traitèrent bientôt Bordeaux en ville conquise. Le séjour, ai-je besoin de le dire ici, était en tous points charmant, comme aujourd’hui ; le climat très doux, les femmes aimables, et le vin – car il y avait alors du vin, disent nos grands-pères ! – et le vin généreux.
La ville avait déjà, à cette époque, son aspect monumental. Certes, on était loin de l’ancienne cité limitée par la ligne des remparts qui allaient de la Porte-Basse à la porte de la Rousselle – le quartier marchand, – de la Rousselle aux fossés du Chapeau-Rouge et de cette enceinte primitive à la Tour-du-Canon (rue de la Vieille-Tour). D’importantes améliorations se poursuivaient. Le palais de l’Ombrière et l’antique maison commune de Saint-Éliège (Saint-Éloi), dont on a conservé une des quatre tours, venaient de disparaître pour faire place bientôt à des constructions édifiées, avec un caractère plus régulier, sur le modèle adopté par l’intendant Louis-Urbain Aubert de Tourny, qui, le premier, fit planter la pioche du démolisseur dans le Bordeaux si pittoresque du Moyen Âge.
Puis les Anglais, il faut le dire, devaient éprouver un certain plaisir à occuper quasi militairement une ville soumise pendant longtemps à la domination de leurs ancêtres. Ils se souvenaient, certes, qu’après la guerre de Cent-Ans, – cette page si troublée de notre histoire locale, – après l’entrée de Dunois victorieux à Bordeaux, les jurats avaient décidé l’édification des forts Tropeyte (Trompette) et du Far (Hâ), pour prévenir le retour offensif des Anglais, retour que l’on considérait comme désormais impossible.
La population, batailleuse déjà et qui ne demandait qu’à en venir aux mains, s’irritait contre les étrangers. La vieille fierté gasconne reprenait le dessus. Et, malgré les recommandations et l’intervention de M. Laîné, préfet provisoire de la Gironde, et du général Clauzel, qui avait été nommé gouverneur militaire de la place, le peuple était pris souvent de brusques colères à l’endroit des envahisseurs dont il réclamait le départ. La haine grondait sourdement dans la foule constamment remuée par de patriotes agitateurs, bonapartistes et libéraux, qui la conseillaient et la guidaient, travaillant sans relâche, sans trêve, sans répit à la libération du sol natal.
Une étincelle pouvait mettre le feu aux poudres et déterminer une explosion superbe de patriotisme révolté. Voici comment elle fut communiquée.
Une Société s’était formée depuis peu à Bordeaux. Ses membres, recrutés dans l’opposition politique, avaient pris pour nom les « Carbonari ». C’était une affiliation à la Société de Paris qui rayonnait sur toute la France, et dont M. de Lafayette devait être quelques années plus tard le président. Le carbonarisme bordelais n’était pas une Société secrète dans l’étroite acception du mot. Il était bien distinct de la formidable Association italienne, bien que fondé sur le modèle des sociétés révolutionnaires de l’Italie et de l’Allemagne.
Aucun serment n’était exigé du « carbonaro », si ce n’est celui de garder le plus profond secret sur l’existence et les actes de la Société. Celle de Bordeaux était composée d’habitants très honorables de la ville – des jeunes gens surtout – qui ne demandaient rien moins que le renversement du pouvoir royal établi sur les ruines de la France appauvrie d’hommes et d’argent. L’énergique vitalité de l’esprit libéral se manifestait dans cette conspiration, qui était comme une continuation de l’état révolutionnaire.
Les « carbonari », traqués parfois par les alguazils de la politique, avaient plusieurs lieux de réunion, tantôt sur un point, tantôt sur un autre. Leur organisation était complète, et chaque réunion de vingt « carbonari » formait une « vente » particulière. Les assemblées partielles ou générales – ces dernières peu fréquentes, on le comprend – avaient lieu chez quelques-uns des membres de la Société, les plus indépendants au point de vue de la situation, soit à la place Saint-Julien, près de l’Hospice des Incurables, bâti, ainsi qu’on a pu s’en rendre compte en 1886 en construisant la nouvelle Faculté de médecine, sur une partie des anciens remparts ; soit dans le quartier Saint-Bruno, dans les vieilles rues Nauté, du Réveil ou des Piques (rues de Belleyme et de la Chartreuse) ; soit encore rue Saint-Christoly, qui est devenue la rue Montméjan, puis la rue Poquelin-Molière ; rue du Grand-Pont-Long, qui avait été la rue Plus-de-Rois, et qui est devenue la rue d’Arès ; rue des Religieuses (rue Thiac) ; rue Marmanière, perdue dans le faubourg des Chartrons, une voie d’un mètre de largeur à peine, et qui était, loin des regards indiscrets de leurs adversaires, fort bien située pour donner asile aux conspirateurs à « jabots » et à redingote à la « propriétaire ».
On m’a montré, il y a déjà quelque temps, la liste d’une section de la Société. J’y ai retrouvé des noms encore très connus, très estimés dans notre ville : négociants, industriels, bourgeois, artisans, maîtres-ouvriers. Cette section, la quatrième, si mes souvenirs me sont fidèles, était surtout composée de Bordelais habitant le centre de la ville et le quartier Saint-Pierre : rue Judaïque-en-Ville (rue de Cheverus) ; place de l’Ancienne-Monnaie (rue Sainte-Catherine, à la hauteur de la rue de la Devise-Saint-Pierre) ; rues des Trois-Canaux et du Fort-Lesparre, qui allaient de la place du Marché-Royal (du Parlement) jusqu’à la rue du Petit-Cancera, et dont on a fait depuis le commencement de la rue du Pas-Saint-Georges ; rue Arnaud-Miqueu ; enfin, quelques rues types du vieux Bordeaux, étroites, tortueuses, désertes, bordées de maisons humides, lézardées : rue Corcelles, des Trois-Chandeliers, de la Coquille, Traversière, qui est devenue la rue Vinet (du nom du savant historien local) ; puis la petite ruelle aujourd’hui rue Millanges (du nom du premier imprimeur bordelais, Simon Millanges).
Le chef ou le sous-chef de la section demeurait sur la place Puy-Paulin, au coin de la rue du Jardin ou de la rue des Carmélites, près du Château Puy-Paulin, plus tard l’Intendance, où fut logé le premier intendant de la généralité de Bordeaux.
Un détail à noter : les « carbonari » portaient comme signe de reconnaissance, dans la rue ou dans les lieux publics, une épingle piquée au revers gauche de leur paletot, d’une façon assez apparente. Certains, les manifestants, faisaient garnir le fond de leur chapeau d’une coiffe tricolore dont la seule vue mettait dans des états de fureur indescriptible les partisans de Louis le Bien-Aimé ! L’un de ces derniers, qui habitait la rue Putoye (Saint-Fort), eut à ce propos trois duels dans une semaine, m’a-t-on affirmé.
Mais revenons aux incidents à la suite desquels les Anglais quittèrent Bordeaux. Ils fréquentaient – je parle des officiers – le café de Tourny, depuis café Bibent, installé au rez-de-chaussée et à l’entresol de la maison Gobineau. Ils y absorbaient force consommations, y menaient joyeuse vie, et, après boire, installés à la fenêtre d’un des salons qui leur étaient réservés, à l’entresol, ils raillaient parfois les promeneurs de Tourny dans des plaisanteries à bout portant.
Un soir, quelques officiers anglais s’amusaient à jeter des gros sous et des liards à la marmaille, en manière de passe-temps. Un groupe de jeunes gens, « des carbonari, » solides gaillards, friands de la lame comme on l’était à cette époque, s’étaient arrêtés sous la fenêtre, en souriant ironiquement de cette distraction de désœuvrés. Mais leur attitude était des plus correctes.
Tout à coup, deux d’entre eux, qui parlaient couramment l’anglais, crurent entendre les officiers employer cette langue pour adresser des insultes aux Français, spectateurs paisibles de cette scène. Ils écoutèrent avec plus d’attention. Plus de doute. C’était bien cela, en effet. Les injures pleuvaient dru, provoquant les rires sans fin des insulaires.
Les Anglais raillaient les jeunes gens dont les cheveux courts étaient coupés « à la Titus », innovation introduite par Talma qui, ayant à jouer Titus dans le Brutus de Voltaire, se fit, un soir, tailler les cheveux sur le modèle d’un buste antique, et abandonna la « queue » si disgracieuse.
Nos compatriotes n’étaient pas d’humeur endurante. D’en bas, on répondit comme il convenait à cette provocation ridicule, insolente. Des propos plus que vifs s’échangèrent de part et d’autre. La foule s’ameuta. Les jeunes gens montèrent dans le café, et, au bout d’une minute, ce fut une bagarre épouvantable. Les verres, les carafes volaient et atteignaient le but : la tête des combattants. Les vitres se brisaient. Un vacarme assourdissant, une lutte sans merci, qui se continua dans l’ombre, – car les lampes furent bientôt éteintes, – plus atroce encore.
Un des assaillants, M. Lanusse, mort aujourd’hui, dont le nom est toujours hautement porté, s’empara, pendant l’action, d’une paire d’épaulettes d’or qu’il renvoya deux jours après, avec sa carte, mais coupées par petits morceaux, à leur propriétaire, officier de l’armée anglaise. L’officier ne broncha pas, si bien que M. Lanusse ne put pas – comme il l’eût désiré – donner réparation de cette offense à qui de droit. Il faut dire, du reste, pour être juste, que l’officier anglais aurait encouru très probablement, en relevant le gant et en ravivant ainsi la querelle, de graves punitions de ses chefs. Mettons que c’est pour cela qu’il ne dit mot.
À la suite de cette scène qui mit dans un état voisin de la stupeur tout le camp britannique, l’autorité avisa et décida de donner aux Anglais, pour résidence et campement, la petite localité de Cachac, près de Blanquefort.
Une fois les « Sans-Culottes », comme on les appelait, – car la troupe comprenait avec les Anglais une quantité d’Écossais, en costume national, bien entendu, – partis, avec leurs femmes et leurs enfants, qui suivaient le convoi, la ville reprit son aspect ordinaire. On se battit bien encore avec fureur, mais dans des duels seulement, et Français contre Français ; je dirai même Bordelais contre Bordelais – ce qui est tout bonnement impardonnable !
J’ai déjà eu l’occasion de donner mon opinion sur les spadassins de profession, les coupe-jarrets qui désolèrent Bordeaux et le dépeuplèrent, pourrais-je dire, si le mot ne semblait pas un peu exagéré.
Les Bordelais ont été de tout temps fumistes… Gascons, si le premier mot vous blesse. En voulez-vous une preuve ?
En 1815, il y avait dans les prés du quartier Saint-Seurin, entre la rue Durand (de La Chassaigne) et la rue Judaïque-Saint-Seurin, une construction isolée, sorte d’archaïque manoir de triste apparence, entourée, du côté de la rue Judaïque, de terre en friche, et avec larges fossés et pont-levis sur la rue Durand. On l’appelait le « Château du Diable ».
Les bonnes grand-mères et les enfants se signaient et passaient bien vite devant la maison maudite, où le soir on entendait, affirmaient-ils, toutes sortes de bruits infernaux, au milieu de grandes lueurs rouges.
Cette idée s’accréditait chaque jour davantage et prenait grande consistance dans l’esprit crédule des bonnes gens. Au fond, c’était, comme bien vous pensez, une magistrale plaisanterie. Elle avait commencé de la façon suivante :
Lors du passage des troupes britanniques à Bordeaux, le propriétaire du « Château du Diable », afin de réaliser quelques bénéfices, avait loué sa maison à une famille anglaise qui l’habita pendant plusieurs mois. Au moment du départ définitif des Anglais de Bordeaux, un mauvais plaisant résolut de punir le propriétaire du château pour avoir donné asile à des ennemis de la France, et se mit en campagne pour discréditer l’antique demeure et empêcher sa location, répandant partout les bruits les moins rassurants, parlant de sabbats pendant les nuits noires, de plaintes qu’on entendait, de gémissements, de ferrailles traînées lourdement sur les larges dalles, que sais-je encore ?
Il fit si bien qu’en peu de temps, tellement on crut à ses sornettes, les voisins les plus proches déménagèrent : ils avaient entendu, eux aussi !… Enfin, un homme courageux, un jardinier, chantre à Saint-Seurin, du nom de Désarnaud, un « incrédule », tenta l’aventure. Il loua le château, fit défricher une partie de la terre… et s’en trouva fort bien, je vous l’assure. Les esprits infernaux avaient fui. On n’a jamais su ni comment ni pourquoi, par exemple !
Le « Château du Diable » est devenu le Refuge des Petites-Sœurs des Pauvres. Il ne donne asile qu’aux misérables gens vieillis et fatigués de tirer… le diable par la queue et non plus aux lutins. Je préfère ça, pour ma part !
C’est le 24 décembre 1816. Un brouillard épais tombe sur la ville ; il est bien près de six heures, et, pressant le pas dans les rues et les ruelles que les lanternes fumeuses sont impuissantes à éclairer, l’ouvrier, le gros négociant, le bourgeois regagnent le toit familial. Une maison toute petite, une sorte d’échoppe en contrebas de la chaussée, tapissée en façade par des ceps de vigne décharnés. La porte est fermée au loquet simplement. Nous pénétrons. Toute la maisonnée, dans la pièce qui sert à la fois de cuisine, de salle à manger et de dortoir, est là, debout, tête nue, attentive et recueillie, autour de l’aïeul vénérable, au « catogan » blanc comme la neige aurorale, qui vient, avec mille précautions, de placer sur deux chaises de paille une grosse, une énorme bûche de « bois de tonneau ». C’est le traditionnel « souc de Nadau » (Noël), ce ressouvenir des sacrifices des ancêtres, ce reste persistant des pratiques païennes.
Le vieillard redresse sa taille cassée ; il trempe l’olivier de Pâques-Fleuries dans l’eau bénite et il s’en fait un aspersoir. Et sa main tremble comme la chandelle de résine qui l’éclaire lorsqu’il bénit le « souc ». À quoi songe-t-il, le bon vieux, dans le grand recueillement de la pièce bien close, au milieu des petits-fils aux blondes têtes curieuses ? À quoi songe-t-il ?
Il trace dans l’air un grand signe de croix, et toute la famille, alors, les enfants les premiers, fait processionnellement neuf fois le tour de la bûche en récitant chaque fois un Pater et un Ave ; le « souc de Nadau » est placé dans le foyer où il pétille bientôt joyeusement, et sa lueur douce emplit la chambre, découpant des silhouettes étranges sur les rideaux à grands carreaux rouges et blancs ou les ciels-de-lit couverts d’étoffes à ramages. Pendant neuf jours il doit brûler, et, la neuvaine terminée, on jettera ses derniers tisons sur l’armoire ou sur le grand buffet pour préserver la maison du feu du ciel durant l’été qui va venir.
La soirée se poursuit. Autour du foyer, les vieux et les bambins – qui font toujours si bon ménage – chantent des cantiques, dont un dédié à Notre-Dame de Talence – sur ce rythme lent qui berce et fait rêver :
Puis on cause ; les bébés se serrent, curieux, près des jupes bouffantes des grand-mères, pour mieux entendre ce que l’on va conter.
Et tandis que les grand-mères, pour la centième fois, racontent la vieille légende de la Nue et de son mari le Soleil, les hommes de l’assistance, assis sur des tabourets dont les pieds branlants frappent à intervalles de coups secs le dallage de briques, entourent aussi la cheminée qui flamboie et dont la chaleur les enveloppe d’un grand engourdissement. Ils devisent de tout un peu, traitant la question politique ou religieuse avec une égale naïveté et une entière bonne foi. Il y a là le gros maître Jean, charretier chez M. Coudert, chemin de Saint-Médard, dont la verve est intarissable. C’est un madré qui en sait long sur les hommes et sur les choses de son temps – ou qui le prétend. – Il n’est pas bigot et se déclare, au contraire, libéral et ennemi de l’autorité, de la domination des moines, comme il dit. Maître Jean est avec des amis ; il leur exprime toute sa pensée bien franchement, sans ambages, et il résume la situation. Il « parle comme un livre », ce diable d’homme-là !
Depuis le 3 mai 1814, depuis le retour de Louis le Désiré, les pratiques religieuses sont plus en honneur que jamais. Ceux qui ne vont pas à confesse par goût doivent s’y rendre par intérêt, par nécessité et pour échapper aux continuelles vexations des « gens de bien ». Les prêtres reparaissent tout-puissants après le long exil qui les a sacrés martyrs, appuyés par la fameuse « Chambre introuvable » dont MM. Corbière, de La Bourdonnaye et de Villèle, qui est si bien arrangé tous les huit jours dans le Kaléidoscope bordelais,





























