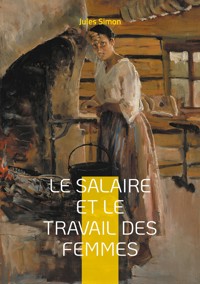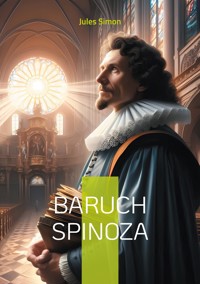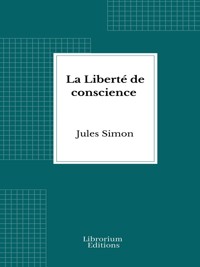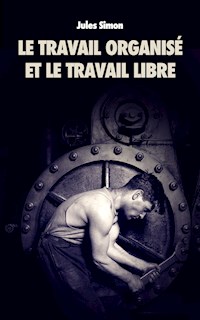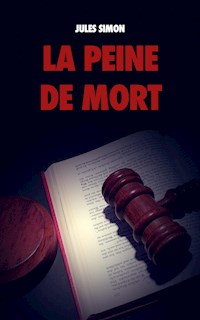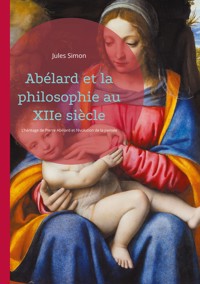
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Abélard et la philosophie au XIIe siècle" de Jules Simon est une analyse détaillée de l'une des figures les plus influentes du Moyen Âge, Pierre Abélard, et de l'impact de sa pensée sur la philosophie du XIIe siècle. Le livre retrace la vie tumultueuse d'Abélard, de ses débuts prometteurs comme théologien et philosophe jusqu'à ses controverses théologiques et ses contributions intellectuelles. Jules Simon met en lumière la manière dont Abélard a marqué son époque par ses idées novatrices, notamment en matière de logique et de théologie. L'ouvrage se divise en plusieurs parties, chacune consacrée à un aspect différent de la vie et de la pensée d'Abélard. Simon commence par une biographie complète, évoquant les études et la carrière d'Abélard, ses relations avec ses contemporains, et ses célèbres démêlés avec l'Église. L'auteur explore ensuite les concepts philosophiques centraux d'Abélard, comme le nominalisme, qui a eu un impact durable sur le développement de la philosophie médiévale. Jules Simon ne se contente pas de relater les faits historiques; il analyse également la portée des idées d'Abélard dans le contexte plus large de la pensée médiévale. Il examine l'influence qu'Abélard a exercée sur ses disciples et ses adversaires, ainsi que sur la tradition intellectuelle européenne. Simon traite aussi de la fameuse relation d'Abélard avec Héloïse, une figure intellectuelle elle-même, et de la manière dont cette histoire personnelle a affecté la réception de son oeuvre. En fin de compte, "Abélard et la philosophie au XIIe siècle" est une étude érudite qui permet de comprendre non seulement la vie et l'oeuvre d'un des plus grands philosophes médiévaux, mais aussi l'évolution de la pensée philosophique et théologique durant cette période charnière de l'histoire intellectuelle européenne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ABELARD
ET
LA PHILOSOPHIE AU DOUZIEME SIECLE.
ABELARD, PAR M. CHARLES DE REMUSAT.[1]
Le nom d’Abélard s’est transmis de siècle en siècle avec la triple consécration du génie, de la passion et du malheur ; mais, quelque illustres que soient ses amours, on ne connaissait, jusqu’à ces dernières années, ni sa doctrine, ni l’influence qu’il a exercée sur la philosophie de son temps. La plupart de ses ouvrages étaient oubliés ou perdus ; il ne restait de lui que sa gloire. Abélard ne ressemble pas à ces docteurs du moyen-âge qui ont régné obscurément dans les écoles, et n’ont laissé après eux que le souvenir de vaines disputes. Abélard a été le héros de son siècle : il l’a occupé tout entier de ses succès et de ses malheurs. Il a fondé la scolastique, la seule philosophie que le moyen-âge pût souffrir. Il a été le précurseur et presque le martyr de la liberté de penser. C’est le Descartes du XIIe siècle.
M. Cousin a publié en 1836 un ouvrage autrefois célèbre d’Abélard, le Sic et Non, dont nous ne connaissions que le titre. À cette édition était jointe une préface qui est un livre[2]. Après avoir, dans ses leçons, victorieusement établi ce principe, que la curiosité humaine, une fois éveillée sur le problème de nos destinées, n’abdique ni ne s’éteint jamais ; après avoir dépouillé la philosophie du moyen-âge de cette rude écorce qui arrête les esprits superficiels, et montré, sous ces formules glacées, sous cet appareil de servitude, les luttes désespérées et contenues, les aspirations ferventes, les inquiétudes promptement dissimulées, tous les élémens de la vie intellectuelle, et ce travail occulte, mais incessant, d’où la liberté devait sortir, M. Cousin n’avait plus, pour achever sa tâche, qu’à prouver la justesse et la solidité de sa doctrine en l’appliquant. Il choisit la philosophie d’Abélard, et cette philosophie résume bien, en effet, le travail intellectuel de la scolastique, puisqu’Abélard a combattu, sans les remplacer, tous les systèmes dont la scolastique a vécu. M. Cousin, sans descendre dans les détails, reprit ces divers systèmes, les définit avec une clarté supérieure, les jugea en les ramenant à leurs principes, et, laissant l’histoire à faire après lui, donna d’avance, sur ces questions capitales, le dernier mot de l’histoire. Jamais les rapports historiques et philosophiques qui unissent le moyen-âge à l’antiquité n’avaient été si profondément compris ; jamais un jour si éclatant n’avait été jeté sur la nature du nominalisme et du réalisme, sur leurs conséquences, sur leur opposition, sur le rôle de cette tentative, impuissante par elle-même, mais féconde par l’esprit libéral dont elle est le produit, et qu’on appelle le conceptualisme. M. Cousin ouvrait ainsi une nouvelle carrière à l’activité de l’esprit philosophique, et ce qui prouve qu’il a réussi, peut-être même en un sens au-delà de ses espérances, c’est que nous voyons aujourd’hui se placer à côté de lui, dans ces arides sentiers de la scolastique, un des esprits les plus brillans et les plus fermes de notre temps, et l’un de ceux, sans contredit, dont on avait moins le droit d’attendre une œuvre si patiente, si laborieuse, et qui, par les difficultés matérielles qu’elle présente comme par l’exactitude scrupuleuse de l’exécution, rappelle l’irréprochable érudition des bénédictins.
L’entreprise de M. de Rémusat est très différente de celle de M. Cousin. M. de Rémusat n’a pas à réhabiliter la philosophie du moyen-âge. C’est Abélard, et lui seul, qu’il veut nous rendre ; mais il veut nous le rendre tout entier, épuiser son sujet, ne rien laisser à faire après lui. Son livre est précisément ce qu’on aurait pu souhaiter qu’il fût pour fixer d’une manière définitive le caractère d’Abélard et sa place dans le développement général de l’esprit humain. M. de Rémusat ne se substitue pas à Abélard. Après avoir raconté en historien et en poète le roman de sa vie, il prend un à un tous ses ouvrages, les analyse fidèlement, sans en altérer la forme, et les juge sans esprit de système, sans prévention, avec une netteté de style et une rectitude d’esprit qui sont en philosophie ses caractères distinctifs. Il est aisé maintenant de montrer que la réputation d’Abélard n’est pas usurpée, M. de Rémusat en a retrouvé les titres ; mais, par une étrange destinée, cet Abélard, à qui ses contemporains ont fait si durement expier son génie, trouve à peine plus de justice, dans la postérité ; à mesure qu’il est plus connu, ce qui devrait augmenter sa gloire semble au contraire la diminuer, et nous aurons plus d’une fois à le défendre, même contre son historien.
Nous ne parlons que du philosophe. Si nous suivions Abélard dans ce drame à la fois touchant et terrible que M. de Rémusat nous déroule avec une émotion si vraie et une chaleur si pénétrante, comment ne pas réserver toutes nos sympathies à celle qui s’est oubliée dans l’amour, qui, maîtresse, a préféré la gloire de son amant à son propre honneur, qui, femme, lui a sacrifié sa liberté et tous ses instincts d’amour et de jeunesse, à l’exception des élans de ce noble cœur, qui ne devait cesser d’aimer qu’en cessant de battre ! Dans la maison du chanoine Fulbert, aux premiers jours de cette passion si pleine de charme et de misère, c’est elle qui a le plus aimé. Après l’affreux et irréparable malheur, c’est elle, en demandant des consolations, c’est elle qui relève et qui console. Abélard l’ensevelit, à vingt ans, dans le cloître ; elle se condamne, victime obéissante, à cette vie pour elle pire que la mort ; elle étouffe la révolte de son cœur, et, sans lutter contre son amour, sans le cacher, sans rien ôter à l’amertume de sa