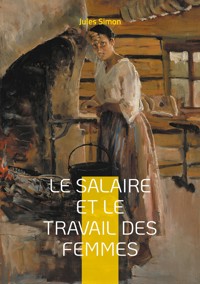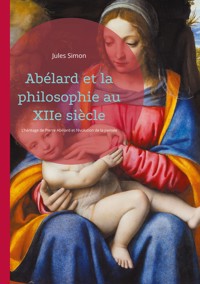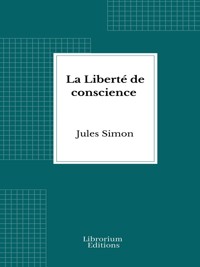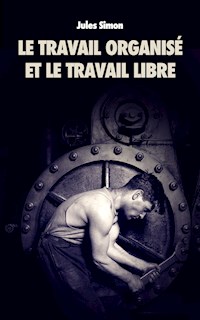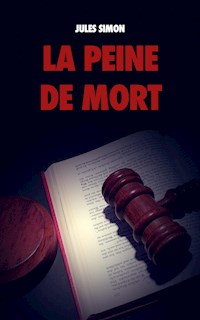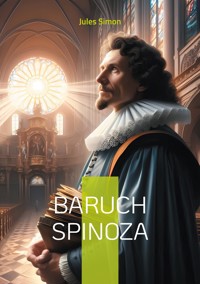
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Monument de la philosophie moderne, "Baruch Spinoza" de Jules Simon est une introduction lumineuse à la pensée du grand philosophe hollandais du XVIIe siècle. Dans cet essai pénétrant, Simon explore les principaux concepts et enjeux de la métaphysique spinoziste, tout en retraçant le parcours intellectuel singulier de celui que Hegel considérait comme le père de la modernité philosophique. Héritier critique de Descartes, Spinoza est présenté comme l'un des trois grands rationalistes du XVIIe siècle, aux côtés de Descartes lui-même et de Leibniz. Mais au-delà de cette filiation, c'est l'originalité et la radicalité de sa pensée que Simon s'attache à mettre en lumière. Au coeur du système spinoziste se trouve l'identification de Dieu et de la Nature, conçus comme une substance unique et infinie dont tous les êtres sont des modes. Une métaphysique moniste et immanentiste, qui rompt avec le dualisme cartésien et le providentialisme chrétien. De cette ontologie découlent des conséquences éthiques et politiques révolutionnaires. En identifiant liberté et nécessité, Spinoza pense l'homme comme partie intégrante d'un univers entièrement déterminé, où le sage est celui qui comprend et accepte l'ordre des choses. Une éthique de la joie et de la connaissance, qui invite à se libérer des passions tristes et des illusions pour atteindre la béatitude. Spinoza apparaît ainsi comme un penseur inclassable et subversif, dont la rigueur géométrique n'a d'égale que l'audace spéculative. Excommunié par la communauté juive d'Amsterdam, soupçonné d'athéisme par ses contemporains, il incarne la figure du philosophe libre et solitaire, tout entier voué à la quête de la vérité. Un modèle d'existence dont Simon souligne la portée universelle. Plus qu'un simple commentaire, "Baruch Spinoza" est une invitation à redécouvrir un penseur dont l'actualité ne cesse de s'imposer. En explorant les arcanes de l'Éthique et du Traité théologico-politique, Simon nous guide avec clarté dans une oeuvre réputée difficile, dont il révèle toute la puissance émancipatrice. Un classique de la littérature philosophique, qui n'a rien perdu de sa force et de son tranchant.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 67
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SPINOZA. [1]
Le monde a-t-il commencé, ou est-il éternel ? A-t-il une cause, ou subsiste-t-il par sa propre force ? Au-delà de ces phénomènes et de leurs lois, la pensée peut-elle saisir un être tout-puissant et infini qui répand partout l’existence et la vie et sème les mondes à travers l’espace ? Il n’est point d’engourdissement si profond des sens et de la matière que de telles questions ne puissent secouer. Sorti de l’éternel et nécessaire enchaînement des causes, ou appelé par la Providence, l’homme, intelligent et libre, se sent dépositaire de sa destinée. Avant d’arriver à ce terme où les générations s’engloutissent, il faut bien, chacun à notre tour, nous mettre en face de ce redoutable peut-être, et toucher à ces questions suprêmes qui contiennent dans leurs profondeurs, avec le secret de notre destinée à venir, la sécurité et la dignité de notre condition présente. Userai-le de ma liberté au hasard ? Non ; comme il n’y a point de hasard dans l’univers, il ne doit pas y en avoir dans la vie. Autour de moi, tout s’enchaîne, tout conspire dans une parfaite et constante harmonie, et moi qui réagis librement sur le monde, moi qui le comprends dans ma pensée, miroir vivant de l’harmonie universelle, je n’apporterais pas ma part dans ce concert ! Je n’aurais pas aussi ma destinée, unie par d’indissolubles liens à la destinée du monde ! Je n’aurais pas une étoile ! Cette force qui. m’est à charge dans le repos, cette lumière qui me conduit, cet inépuisable amour dont je porte en moi le foyer, tout me répond de mon avenir et m’assure d’une immortalité que je dois conquérir par le travail. Je trouverai Dieu par-delà la vie. Quel Dieu ? Cet être abstrait, incompréhensible, impuissant, sans cœur et sans entrailles, qui ne saurait m’aimer ou penser à moi sans se dégrader, Dieu inutile pour lequel le monde n’est rien et qui n’est rien pour le monde ? ou cette éternelle substance qui sans raison ni volonté, par la loi de son être, produit au dedans d’elle-même tout ce monde et ses lois, avec ce flot de la mort et de la vie dans lequel je suis emporté : substance aveugle et nécessaire qui ne peut vivre qu’aux dépens de ma propre vie, et dont la réalité admise fait de moi un pur néant ? Réduire Dieu à l’existence absolue, qui n’est pas l’absolu véritable, mais une abstraction morte, le confondre et l’identifier avec la nature, ou le nier : trois philosophies profondément différentes, qui aboutissent toutes les trois par des chemins opposés à une même conséquence fatale. Les panthéistes ont beau se plaindre et transformer Spinoza en mystique ivre de Dieu : c’est la logique qui leur répond, et qui au bout de leur système leur montre inexorablement la morale des athées.
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les écoles ont commencé à se jeter l’une à l’autre l’accusation de panthéisme. Les éternels ennemis de la philosophie, qui n’ont pas épargné le nom d’athée à Descartes et à Liebnitz, n’ont pas, à l’heure qu’il est, de meilleure machine de guerre que cette accusation de panthéisme qu’ils ont rendue banale. Ce n’est pas qu’ils connaissent à fond la nature de cette triste philosophie dont Spinoza est le héros. Ils ont autre chose à faire que de suivre les Parménide, les Plotin, les Spinoza dans leur longue et pénible route. Il suffit que le panthéisme déshérite l’humanité de ses espérances immortelles : plus il est obscur et inconnu dans son principe, mieux il convient à leur secrète pensée. De ces mystérieux problèmes sur la substance et la création, ils se font un épouvantail pour inspirer aux faibles une crainte salutaire de la liberté de penser et de la raison. On a beau leur crier qu’on a défendu avant eux la cause sacrée de l’immortalité de l’ame et de la responsabilité morale que leur importe d’avoir calomnié, pourvu que la calomnie leur profite, et que le problème soit trop obscur et trop difficile pour que la défense de la philosophie, portée devant le public, ait la chance d’être entendue ? Après tant de protestations inutiles, une chose restait à faire à l’école de Descartes, de Malebranche et de Leibnitz : c’était d’apprendre ses ennemis et au public ce que c’est que cette doctrine panthéiste, objet de tant de démonstrations aventureuses. M. Saisset s’est dévoué à cette tache. Il nous donne aujourd’hui, pour la première fois, les ouvrages de Spinoza traduits en français. Il nous les donne accompagnés d’une introduction étendue où le système de Spinoza est exposé depuis ses principes les plus élevés jusqu’à ses dernières conséquences politiques, religieuses et morales, discuté avec impartialité, mais avec une logique inexorable. Après cette publication, si les diffamateurs persistent à accuser de panthéisme tous les philosophes contemporains, ou si quelques esprits égarés, qui prennent pour de la métaphysique de vagues et incohérentes rêveries, continuent à invoquer sans intelligence le nom de Spinoza, il ne restera plus d’excuse aux uns ni aux autres.
Spinoza, inconnu pendant sa vie, l’est encore plus après sa mort. Cette longue malédiction qui s’attache à sa mémoire a sauvé son nom de l’oubli sans populariser sa doctrine. Rejet par sa nation, traité en ennemi public, maudit par son siècle, il n’a pas trouvé plus de justice dans la postérité, et malgré la pureté et le désintéressement de sa vie, malgré son sincère et puissant amour pour la vérité, malgré son courage, malgré son génie, les fatales conséquences de son système pèsent sur sa renommée, et dans la proscription de La philosophie panthéiste on enveloppe le nom de Spinoza.
Né à Amsterdam, le 24 novembre 1632, d’une famille de juifs portugais, à quinze ans il embarrassait la synagogue par la hardiesse de ses objections et son opiniâtreté à les soutenir. Doué d’une ardeur infatigable, d’un génie vif et pénétrant, soustrait sans effort et comme par le bénéfice de sa nature à l’influence des préjugés, il avait dévoré en un instant les langues et la théologie, et s’était livré tout entier à la philosophie et aux ouvrages de Descartes. Il se sentait là dans son pays, et il se trouvait lui-même en apprenant de son nouveau maître qu’on ne doit jamais rien recevoir pour véritable qui n’ait été auparavant prouvé par de bonnes et solides raisons. Déjà fermentait dans son esprit cette philosophie redoutable, qui changeait la condition de la nature humaine et ne laissait pas de place à la religion de ses pères. Spinoza ne connaissait point les ménagemens ; ce qui lui semblait la vérité, il le disait simplement sans emphase, dans son style concis et puissant, comme s’il eût obéi à une nécessité aussi bien reconnue par les autres que par lui-même. Les rabbins le souffraient au milieu d’eux avec peine ; mais ils sentaient qu’une fois sorti de la synagogue, il ne garderait pas de mesure. Il fallait le contenir ou le perdre. Une pension de mille florins lui fut offerte. Un soir, en sortant de la synagogue, il voit à côté de lui un homme armé d’un poignard ; il s’efface et reçoit le coup dans son habit. A quelque temps de là, l’excommunication fut prononcée. Spinoza quitta les juifs chargé d’anathèmes et menacé jusque dans sa vie. « . A la bonne heure dit-il quand on lui porta la sentence de son excommunication : on ne me force à rien que je n’eusse fait de moi-même, si je n’avais craint le scandale ; mais, puisqu’on le veut de la sorte, j’entre avec joie dans le chemin qui m’est ouvert, avec cette consolation que ma sortie sera plus innocente que ne fut celle des premiers Hébreux hors de l’Égypte, quoique ma subsistance ne soit pas mieux fondée que la leur Je n’emporte rien à personne, et je me puis vanter, quelque injustice qu’on me fasse, qu’on n’a rien à me reprocher. »
Il est faux qu’il ait jamais embrassé le christianisme et reçu le baptême. Après cette rupture violente avec les siens, il n’appartint plus à personne. Aucune religion, aucune