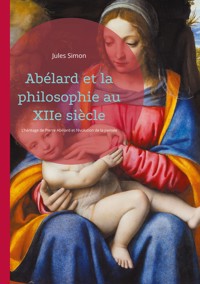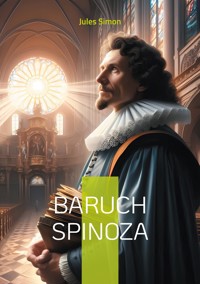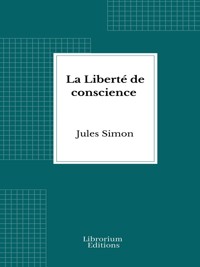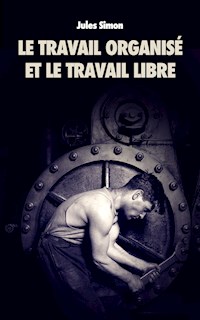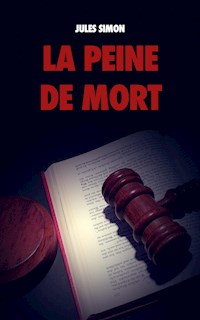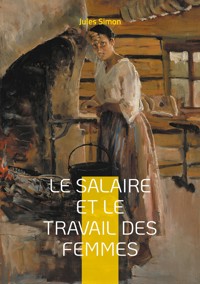
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le Salaire et le Travail des Femmes est une analyse sociale et économique des conditions de travail et de rémunération des femmes au XIXe siècle. Jules Simon y examine les inégalités salariales, les conditions de travail précaires, et la lutte pour l'égalité des sexes dans le monde du travail. L'auteur plaide pour une reconnaissance équitable du travail des femmes, soulignant les injustices auxquelles elles sont confrontées, et appelle à des réformes pour améliorer leur situation dans la société. Ce livre est un document essentiel pour comprendre l'évolution des droits des femmes et les débats entourant leur place dans la société industrielle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Chapitre I. Les Femmes dans les fabriques lyonnaises
I.
II.
III.
JULES SIMON.
Chapitre II. Les Femmes dans les filatures
I
II
III
JULES SIMON.
Chapitre III. Les Femmes dans la petite industrie
I.
II.
III.
JULES SIMON.
Chapitre IV. L'Assistance et les institutions de prévoyance
I
II
III
JULES SIMON.
ETUDES MORALES.
LE SALAIRE
ET
LE TRAVAIL DES FEMMES
LES FEMMES DANS LA FABRIQUE LYONNAISE.
Comme il faut que tout soit attaqué en ce monde, et jusqu’aux choses les plus saintes, la famille elle-même a eu de nos jours ses ennemis. Nous sommes heureusement débarrassés de ces étranges théories, qui, pour réformer la société, commençaient par outrager la nature; mais les transformations rapides de l’industrie, en appelant de plus en plus les femmes dans les ateliers et en les arrachant à leurs devoirs d’épouses et de mères, créent pour la famille un péril d’une espèce toute différente et beaucoup plus grave. Faut-il s’opposer, coûte que coûte, aux progrès du mal? Faut-il le subir comme une nécessité de notre temps et se borner à chercher des palliatifs? C’est un problème d’autant plus difficile à résoudre qu’il intéresse à la fois la morale, la législation et l’industrie.
Les esprits absolus, qui se portent toujours aux extrémités, demandent que les femmes ne soient astreintes à aucun travail mercenaire. Diriger leur maison, plaire à leur mari, élever leurs enfans, voilà, suivant eux, toute la destinée des femmes. Ils ont, pour soutenir leur opinion, des raisons de deux sortes. Les unes, que l’on pourrait appeler des raisons poétiques, roulent sur la faiblesse de la femme, sur ses grâces, sur ses vertus, sur la protection qui lui est due, sur l’autorité que nous nous attribuons à son endroit, et qui doit être compensée et légitimée par nos sacrifices; ces sortes de raisons ne sont pas les moins puissantes pour convaincre les femmes elles-mêmes et cette autre partie de l'humanité qui adopte volontiers la manière de voir des femmes, qui ne connaît encore la vie que par ses rêves et ses espérances. Des raisons d'un ordre plus élevé se tirent des soins de la maternité et de l’importance capitale de l'éducation. Il faut un dévouement de tous les instans pour surveiller le développement de ces jeunes plantes d’abord si frêles, pour former à la science austère de la vie ces âmes si pures et si confiantes, qui reçoivent d’une mère leurs premiers sentimens avec leurs premières idées, et qui en conserveront à jamais la douce et forte empreinte.
Cette théorie, comme beaucoup d’autres, a une apparence admirable; mais elle a plus d'apparence que de réalité. De ce que le principal devoir des femmes est de plaire à leur mari et d’élever leurs enfans, il n’est pas raisonnable, il n’est pas permis de conclure que ce soit là leur seul devoir. Dans les familles riches, cette conclusion est pourtant acceptée comme une vérité inattaquable ; les hommes et les femmes tombent d’accord qu’à l’exception des devoirs de mères de famille, les femmes n’ont rien à faire en ce monde. Et comme pour la plupart d’entre elles cette unique occupation, même consciencieusement remplie, laisse encore vacantes de longues heures, elles se condamnent scrupuleusement au supplice et au malheur de l’oisiveté, atrophiant leur esprit par ce régime contre nature, exaltant et faussant leur sensibilité, tombant par leur faute dans des affectations puériles et dans des langueurs maladives qu’un travail modéré leur épargnerait. Ce préjugé est poussé si loin qu’il y a telle famille bourgeoise dont le chef ne parvient que difficilement par un labeur obstiné à satisfaire les besoins, tandis que sa femme, épouse vertueuse, tendre mère, capable de dévouement et de sacrifice, passe son temps à faire des visites, à jouer du piano, à broder quelque collerette. C’est à Lyon particulièrement que cette oisiveté des femmes de la bourgeoisie est complète : non-seulement les femmes des fabricans n’aident pas leurs maris dans leurs comptes, dans leur correspondance, dans la surveillance de leurs magasins, comme cela se fait avec beaucoup d’avantage dans les autres industries; mais elles demeurent ignorantes du mouvement des affaires au point de ne pas savoir si l’inventaire de l’année les ruine ou les enrichit. C’est bien peu respecter les femmes, c’est en faire bien peu de cas, que de perdre ainsi volontairement ce qu’elles ont d’esprit d’ordre, de bon goût, de rectitude morale, je dirai même de disposition à l’activité, car les femmes, quand nos préjugés ne les gâtent point, aiment le travail, elles sont industrieuses ; ces mollesses et ces langueurs où nous voyons tomber leurs esprits et leurs organes leur viennent de nous et non pas de la nature. Même pour la seule tâche dont elles sont encore en possession, pour la tâche d’élever leurs filles et de commencer l’éducation de leurs fils, croit-on qu’elles y soient propres, quand elles ne donnent point l’exemple d’une activité sagement dirigée, quand leur esprit manque de cette solidité que peuvent seuls donner le contact des affaires et l’habitude des réflexions sérieuses ? Admettons que les femmes soient aussi frivoles qu’on le prétend, ce qui est loin d’être établi : on ne comprendra jamais quel intérêt la société peut avoir à entretenir, à développer cette frivolité, ou pourquoi notre monde affairé et pratique s’efforce de conserver aux femmes le triste privilège d’une vie à peu près inoccupée.
Il faut avouer que, si les femmes riches ne travaillent pas assez, en revanche la plupart des femmes pauvres travaillent trop. C’est pour elles que les soins du ménage sont pénibles et absorbans. Il y a une grande différence entre donner des ordres à une servante ou être soi-même la servante, entre surveiller la nourrice, la gouvernante, l’institutrice, ou suffire, sans aucun secours, à tous les besoins du corps et de l’esprit de son enfant. Les heureux du monde qui se contentent de secourir les pauvres de loin ne se doutent guère de toutes les peines qu’il faut se donner pour la moindre chose quand l’argent manque, de la bienfaisante activité que déploie une mère de famille dans son humble ménage, pour que le mari, en revenant de la fatigue, ne sente pas trop son dénûment, pour que les enfans soient tenus avec propreté, et ne souffrent ni du froid ni de la faim. Souvent, dans un coin de la mansarde, à côté du berceau du nouveau-né, est le grabat de l’aïeul, retombé à la charge des siens après une dure vie de travail. La pauvre femme suffit à tout, levée avant le jour, couchée la dernière. S’il lui reste un moment de répit quand sa besogne de chaque jour est terminée, elle s’arme de son aiguille et confectionne ou raccommode les habits de toute la famille, car elle est la providence des siens en toutes choses, c’est elle qui s’inquiète de leurs maladies, qui prévoit leurs besoins, qui sollicite les fournisseurs, apaise les créanciers, fait d’innocens et impuissans efforts pour cacher l’excès de la misère commune, et trouve encore, au milieu de ses soucis et de ses peines, une caresse, un mot sorti du cœur, pour encourager son mari et pour consoler ses enfans. Plût à Dieu qu’on n’eût pas d’autre tâche à imposer à ces patientes et courageuses esclaves du devoir, qui se chargent avec tant de dévouement et d’abnégation de procurer à ceux qu’elles aiment la santé de l’âme et du corps ! Mais il ne s’agit pas ici de rêver : ce n’est pas pour le superflu que l’ouvrier travaille, c’est pour le nécessaire, et avec le nécessaire il n’y a pas d’accommodement. Il est malheureusement évident que, si la moyenne du salaire d’un bon ouvrier bien occupé est de deux francs par jour, et que la somme nécessaire pour faire vivre très strictement sa famille soit de trois francs, le meilleur conseil que l’on puisse donner à la mère, c’est de prendre un état et de s’efforcer de gagner vingt sous. Cette conclusion est inexorable, et il n’y a pas de théorie, il n’y a pas d’éloquence, il n’y a pas même de sentiment qui puisse tenir contre une démonstration de ce genre.
Il ne reste donc qu’un refuge à ceux qui veulent exempter la femme de tout travail mercenaire : c’est de prétendre qu’en fait le salaire d’un ouvrier suffit pour le nourrir lui et les siens. Il ne faut, hélas ! qu’ouvrir les yeux pour se convaincre du contraire. « En tout genre de travail, dit Turgot, il doit arriver et il arrive en effet que le salaire de l’ouvrier se borne à ce qui est nécessaire pour lui procurer la subsistance. » C’est en vertu de ce principe que les manufacturiers ont substitué peu à peu le travail des femmes à celui des hommes, et l’on sait ce qui serait arrivé, au grand détriment de l’espèce humaine et au grand préjudice de la morale, si le législateur ne s’était empressé de protéger les enfans contre les terribles nécessités de la concurrence. Il n’est donc pas permis d’espérer que le salaire d’un ouvrier soit jamais très supérieur à ses besoins, ou, ce qui est la même chose, que l’ouvrier, par son seul travail, suffise à ses besoins et à ceux de toute une famille. Il ne faut pas oublier non plus que la richesse d’un peuple résulte du rapport qui s’établit entre sa consommation et sa production. Si la France, nourrissant le même nombre d’ouvriers, produisait tout à coup une quantité moindre de travail, il est clair, ses dépenses restant les mêmes et ses bénéfices diminuant, que son industrie subirait une crise. Aussi ne peut-elle ni restreindre pour les hommes la durée du travail, ni se priver du travail des femmes et, dans une certaine mesure, de celui des enfans, à moins que les peuples rivaux ne fassent en même temps le même sacrifice. Toutes ces propositions étant des vérités d’évidence, on peut regarder comme établi que le travail de la femme est nécessaire à l’industrie, et que le salaire de la femme est nécessaire à la famille.
On dit que cette dure nécessité n’a pas été connue de nos pères ; mais nous ne sommes plus au temps où la mère de famille filait le lin et tissait la toile pour les usages domestiques. La véritable économie consiste désormais à travailler fructueusement pour l’industrie, à recevoir d’elle les produits qu’elle livre à bas prix aux consommateurs. Ainsi le même travail, en changeant de nature, produit des résultats plus avantageux, et la tâche des femmes s’est modifiée sans s’accroître.
Il y aurait toutefois quelque exagération à regarder comme un malheur social cette obligation qui leur est imposée de contribuer par leur travail personnel à l’allégement des charges communes. Le travail en lui-même est salutaire pour le corps et pour l’âme, il est pour l’un et pour l’autre la meilleure des disciplines. Loin de dégrader celui qui s’y livre, il le grandit et l’honore. Jamais un homme de cœur ne verra sans quelque respect les nobles stigmates du travail sur les mains de l’ouvrier. La pitié, pour être saine à celui qui l’éprouve et profitable à celui qui en est l’objet, doit être fondée sur des infortunes réelles. C’est l’excès du travail qui est une peine et un malheur, mais non pas le travail. Ce qu’on peut espérer, ce qu’il faut demander avec une ardeur infatigable à Dieu et à la société, c’est que le travail des femmes soit équitablement rétribué, qu’il n’excède pas la mesure de leurs forces, et qu’il ne les enlève pas à leur vocation naturelle, en rendant le foyer désert et l’enfant orphelin.
Le travail, pour les femmes comme pour les hommes, est de trois sortes : le travail isolé, le travail de fabrique, et le travail des manufactures. Le travail isolé est le seul qui convienne aux femmes, le seul qui leur permette d’être épouses et mères; cependant il devient chaque jour plus rare et plus improductif, la manufacture absorbe tout, et la fabrique elle-même, forme intermédiaire entre le travail isolé et la manufacture, est menacée de périr, c’est-à-dire de se transformer. On pense généralement que, si elle se transforme en manufacture, ce sera un grand progrès pour l’industrie, et il sera facile de montrer que, si elle se changeait au contraire en travail isolé, ce serait un grand avantage pour la morale. Nos conclusions ne vont pas plus loin. Il y a une nécessité qui domine toutes les autres, c’est la nécessité d’avoir du pain. Malgré tous les dangers du travail en commun, surtout pour les femmes, il est encore possible de vivre honnêtement dans un atelier, et s’il fallait opter entre l’envahissement des manufactures et la ruine de notre industrie, la sagesse voudrait qu’on préférât les manufactures; mais on n’a pas encore jusqu’ici démontré la nécessité, l’urgence de cette révolution, et puisque la question est pendante, puisque de bons esprits peuvent hésiter sur les résultats matériels du système nouveau qui tend à s’établir, il est bon de plaider par des faits, sans exagération, sans affectation, la cause de la morale.
I.
Nous n’avons pas eu en France de ces magnifiques enquêtes que l’on fait en Angleterre avec tant de dépenses et de fruit ; mais nous possédons un grand nombre de livres[1] où la situation de nos ateliers est décrite avec un soin minutieux, jugée avec une parfaite intelligence des conditions et des besoins de l’industrie. Rien n’est plus attachant que la lecture de quelques-uns de ces ouvrages. Les ateliers qu’ils décrivent, les mœurs qu’ils racontent, les horizons qu’ils ouvrent à la pensée, ont à la fois le charme d’un voyage de découverte et l’autorité d’un livre de morale. Pénétrons à leur suite dans les ateliers de la fabrique lyonnaise, car c’est surtout l’industrie de la soie, dont Lyon est le chef-lieu en France et même en Europe, qui a échappé jusqu’ici, au moins chez nous, au régime de la manufacture.
Les bonnes ouvrières de Lyon aiment leur état ; elles en parlent volontiers, souvent avec esprit, et il est vrai que ces métiers si propres, ces belles étoffes si souples et si brillantes ont quelque chose d’attrayant pour les mains et pour les yeux d’une femme. Quand on entre dans un atelier, c’est toujours la maîtresse qui en fait les honneurs, et qui répond avec un visible plaisir et beaucoup de netteté aux questions des visiteurs. L’une de celles qu’on appelle les camuses disait dernièrement, devant une commission d’enquête, que la soie est le domaine des femmes, et qu’elles y trouvent du travail depuis la feuille de mûrier où l’on élève le ver jusqu’à l’atelier où l’on façonne la robe et le chapeau. Il y a en effet toute une armée d’ouvrières de toute sorte sans cesse occupées sur ce frêle brin de soie. On étonnerait beaucoup la plupart des femmes du monde en leur apprenant combien il a fallu de peine pour faire leur plus simple robe, par combien de mains elle a passé. Nous avons d’abord toute une grande industrie agricole, l’industrie de la production, car la France produit une grande partie de la soie qu’elle met en œuvre, et elle en fournit même à l’Angleterre concurremment avec l’Asie. Il faut surveiller avec une sollicitude de tous les instans, depuis sa naissance jusqu’à sa métamorphose, ce petit ver qui se nourrit de la feuille du mûrier, et qui, à force de filer, se crée cette précieuse enveloppe qu’on appelle le cocon. Quand le cocon est formé et qu’on l’a débarrassé de la bourre, on saisit les fils de soie et on commence à les tirer, en en réunissant au moins trois et quelquefois vingt, suivant la grosseur qu’on veut obtenir. Les brins élémentaires qu’on obtient ainsi par le tirage sont ce que l’on appelle la soie grège. On les emploie sous cette forme à la fabrication des baréges, d’une partie de la rubanerie, de la gaze de soie, etc., et tout le reste de la soie grège est dévidé, tordu et doublé avant d’être mis en œuvre. Ces diverses opérations constituent le moulinage, après lequel la soie, suivant la force de l’assemblage, le degré et la nature de la torsion, se divise en fil de trame et en organsin ou fil de chaîne. C’est à ce moment-là qu’elle est livrée aux chimistes, qui commencent par la décreuser pour lui enlever la gomme qu’elle contient, lui donner de la flexibilité et de l’éclat, et la disposer à recevoir plus facilement la matière colorante. Une fois teinte, les dévideuses s’en emparent, et enroulent la soie des écheveaux sur des bobines, ou la disposent sur des canettes pour former la trame.
Les ourdisseuses sont chargées d’une opération plus délicate, qui consiste à assembler parallèlement entre eux, à une égale longueur et sous la même tension, un certain nombre de fils dont l’ensemble a reçu le nom de chaîne. Quand la chaîne est toute préparée, on l’enlève de l’ourdissoir et on la dispose sur le cylindre ensouple du métier à tisser; c’est ce qu’on appelle le montage. Si l’étoffe qu’on va commencer est toute semblable à celle qu’on vient de finir, on rattache chacun des nouveaux fils à l’extrémité des fils correspondans de l’ancienne chaîne ; cette opération, qui peut se répéter indéfiniment, qui simplifie le travail parce que toutes les pièces qu’on fait successivement ne sont plus pour l’ouvrier qu’une seule et même pièce, est faite par les rattacheuses ou tordeuses. Si au contraire l’étoffe nouvelle a un nombre de fils différent, il est impossible de souder la nouvelle chaîne à la chaîne précédente, et il faut introduire directement tous les fils dans les maillons du métier. Les remetteuses sont chargées de ce travail. Après elles, le métier se trouve prêt, et il ne reste plus qu’à tisser l’étoffe.
Cependant, lorsqu’il ne s’agit pas d’un uni, mais d’un façonné, le tisseur, avant de se mettre à l’œuvre, a besoin du concours d’un nouveau personnel assez nombreux. En effet, il faut d’abord créer les omemens que doit recevoir l’étoffe; c’est l’affaire du dessinateur, un véritable artiste, dont la profession demande beaucoup de goût et d’habileté. Il fait avec des fils de soie ce que le mosaïste fait avec ses cailloux diversement coloriés, ou plutôt, car le mosaïste n’est qu’un reproducteur, le dessinateur ressemble à l’artiste verrier, qui éblouit les yeux par les mille combinaisons de sa merveilleuse joaillerie. Le dessin achevé, il faut le mettre en carte, opération assez analogue à celle d’un architecte qui dessine la coupe de son édifice après en avoir dessiné l’élévation. Mettre un dessin en carte, c’est faire sur un papier quadrillé le plan du tissu que l’on veut produire, en marquant minutieusement la place de chaque fil. Après la mise en carte vient encore le lisage, qui a pour but de distinguer, sur les fils de la chaîne, les points qui doivent être apparens et ceux qui doivent passer à l’envers du tissu. L’ouvrière fait cette opération sur un cadre tendu de fils qui simulent la chaîne, et parmi lesquels elle sépare les fils apparens ou cachés au moyen de ficelles qui à leur tour simulent la trame. On se sert de ce cadre pour préparer des cartons percés de trous que l’on met en contact avec le mécanisme chargé de faire mouvoir les fils de la chaîne sur le métier. Ces cartons une fois posés, le tisseur peut commencer sa besogne. Tout ce travail, qui emploie tant de bras, coûte tant de soins et dure si longtemps, n’est donc, à proprement parler, que la préparation du travail. Enfin, lorsque le tisseur à son tour a fini sa tâche et rendu la pièce fabriquée au négociant qui lui avait confié les fils, celui-ci, dans la plupart des cas, la dépose encore chez l’apprêteur, qui la nettoie, lui donne le brillant, et, s’il y a lieu, certaines apparences particulières, celles par exemple de la moire ou des étoffes gaufrées. L’art des apprêts constitue à lui seul une grande et difficile spécialité.
N’est-ce pas là, comme nous le disions, une véritable armée d’artistes, d’ouvriers, d’industriels de toute sorte? Dans cette armée, on retrouve partout les femmes. D’abord dans la magnanerie, où l’on élève le ver à soie. Le tirage ou filage se fait exclusivement par elles ; elles concourent avec les hommes à la plupart des opérations du moulinage. Les hommes sont en plus grand nombre dans les ateliers de teinture, et les femmes n’y sont employées qu’à des travaux accessoires, tels que le pliage ; mais dans les spécialités qui viennent ensuite, jusqu’au tissage, il n’y a que le dessin et la mise en carte qui soient exclusivement dévolus aux hommes : le lisage se fait indifféremment par des hommes ou par des femmes ; puis viennent les dévideuses et canetières, les ourdisseuses, les tordeuses, les remetteuses. Enfin, pour le tissage proprement dit, c’est-à-dire pour l’industrie en somme la plus importante et qui emploie le personnel le plus nombreux, plus d’un tiers des métiers dans la ville de Lyon (il n’y en a pas moins de soixante-douze mille), et peut-être les deux tiers dans la grande banlieue, sont occupés par des femmes.
On comprend aisément pourquoi la présence des hommes est nécessaire dans les ateliers du moulinage et de la teinture. Cependant, à mesure que les machines du moulinage se perfectionnent, les hommes cèdent la place aux femmes, qui finiront par être elles-mêmes remplacées par les enfans. On croirait au premier abord que l’industrie du dessinateur pour étoffes est faite exprès pour les femmes. C’est un joli travail, sédentaire, peu fatigant, bien rétribué, qui ne demande en apparence que du goût. Et qui sait mieux que les femmes choisir un dessin ou assortir des couleurs? Néanmoins il est constaté par une longue suite d’expériences, toutes infructueuses, qu’elles ne savent pas inventer des combinaisons; leur aptitude est de les bien juger et d’en tirer bon parti. Quand nous voyons des châles, des soieries, des papiers peints, des dentelles, dont l’aspect général nous frappe par l’élégance ou la richesse, sans que nous nous rendions un compte très exact du dessin, nous ne pensons guère que la faculté dominante de l’artiste qui fait les patrons ou modèles est plutôt la création que le goût, et pourtant il en est ainsi : une belle étoffe à dessin riche, touffu, élégant, est tout un petit poème. L’opération de la mie en carte pourrait se faire par des femmes, et se fait généralement par des hommes. À ce petit nombre d’exceptions près, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans tous les ateliers de l’industrie de la soie. En Allemagne, le tissage se fait presque exclusivement par leurs mains. Il ne faut, pour tisser, que de l’adresse, de l’assiduité, de la propreté; les velours seuls exigent de la force.
Ce n’est point assez cependant que d’avoir dénombré les bataillons; il faut à présent entrer dans les rangs, et se rendre compte des conditions d’existence des membres les plus importans de cette armée : commençons par les capitaines.
La première fois qu’on va visiter un fabricant lyonnais, on s’attend à entrer dans d’immenses ateliers, à entendre le bruit d’une machine à vapeur, à voir d’innombrables métiers en mouvement, à être entouré d’un monde d’ouvriers. On trouve un comptoir, quelques magasins silencieux et deux ou trois hommes occupés sur un bureau à des écritures. C’est que le fabricant est un entrepreneur qui achète la soie en écheveaux, la fait tisser hors de chez lui, dans des ateliers dont il n’est ni le propriétaire, ni le directeur, et la revend ensuite au commerce de détail. Son industrie comprend trois parties : acheter la soie, surveiller la fabrication, vendre l’étoffe. Il n’y a peut-être pas de profession qui, par sa nature, soit soumise à des chances plus variables, et demande la réunion d’un plus grand nombre de qualités très rares. Cela tient principalement à deux causes : —l’une, c’est le prix de la matière première, qui vaut littéralement son pesant d’or; l’autre, c’est la nature capricieuse de la mode, qui règne souverainement sur l’industrie de la soie. L’achat est soumis à toutes les chances de l’agriculture, la vente à tous les caprices de la fantaisie. Ainsi, soit que l’on considère l’approvisionnement en matières ou l’approvisionnement en tissus, la valeur de l’inventaire peut varier d’un moment à l’autre dans des proportions énormes. À ces conditions, qui exigent évidemment dans un degré supérieur toutes les qualités d’un commerçant, s’ajoute encore, pour le fabricant de soieries, l’obligation de choisir les nuances et les dessins, et de les faire exécuter avec goût; il faut donc qu’il soit à la fois négociant et artiste. Si l’on songe maintenant à l’influence qu’il exerce, par ses achats sur les magnaneries, par ses commandes sur la population ouvrière, par ses ventes sur le commerce des nouveautés, on comprendra quelle est l’importance exceptionnelle de son rôle dans l’industrie. Avec deux ou trois commis de magasin et autant de commis de ronde qui composent tout son état-major, il a sur la richesse nationale une influence plus réelle, plus personnelle que des directeurs d’usines qui emploient douze cents ouvriers, et construisent des chemins de fer de plusieurs kilomètres pour le service exclusif de leurs établissemens.
L’auxiliaire immédiat du fabricant lyonnais est un simple artisan. Quand le fabricant a acheté la soie, quand il l’a fait mouliner et teindre, il appelle un ouvrier auquel il confie la quantité de matière nécessaire pour faire une pièce. L’ouvrier emporte cette soie chez lui, avec les dessins et les cartons quand il y a lieu; il la fait disposer sur son métier par une ourdisseuse et une remetteuse, et quand la pièce d’étoffe est achevée et qu’il la rapporte au patron, celui-ci lui paie sa fabrication par mètre courant. L’ouvrier, dans ces conditions, est donc un entrepreneur; il ne dépend de son patron que comme tout fabricant dépend de celui qui lui donne de l’ouvrage.
S’il n’y avait d’autre élément dans la fabrique lyonnaise que le négociant qui fait la commande et l’ouvrier qui l’exécute, l’industrie du tissage appartiendrait à ce que nous avons appelé le travail isolé; mais il est bien rare que l’ouvrier qui possède un métier n’en possède qu’un seul : en général, il en a au moins deux et au plus six. Une chambre où cinq ou six métiers sont occupés par autant d’ouvriers est un atelier; ce n’est plus le travail isolé, ce n’est pas non plus la manufacture, c’est ce que l’on appelle proprement la fabrique.
La plupart des ateliers sont situés dans des rues étroites, malpropres, à l’aspect désolé. On monte un vieil escalier médiocrement entretenu, et l’on se trouve dans une pièce assez vaste, bien éclairée, munie d’un petit poêle en fonte, et très souvent voisine d’une espèce de petit salon où la maîtresse de la maison vous reçoit. Les métiers sont disposés à côté l’un de l’autre, de manière à profiter le plus possible de la lumière. Dans certains ateliers, il n’y a pas d’autre homme que le maître, ou d’autre femme que la maîtresse: quelquefois les deux sexes sont mêlés. Ces chefs d’ateliers forment une classe très intéressante et très curieuse, qu’on ne retrouve pas ailleurs, car ils sont très décidément des ouvriers, et ne cherchent pas, comme la plupart des maîtres dans les autres corps d’état, à s’affilier à la bourgeoisie. Qu’ils soient fils de maîtres ou qu’ils soient arrivés à s’établir après avoir longtemps travaillé comme compagnons, ils font leur journée dans l’atelier comme tous les autres : leur travail est rétribué par le fabricant de la même façon, au même prix; ils dirigent leurs apprentis, mais ils ne se mêlent pas du travail des compagnons; ils n’ont sur eux d’autre autorité que celle d’un propriétaire sur son locataire. Ils portent le même costume, et les dimanches se réunissent dans les mêmes lieux de plaisir. S’ils ont l’esprit plus ouvert, ce n’est pas que leur éducation soit différente; c’est que le sentiment et le souci de la propriété donnent toujours quelque force au jugement et une certaine régularité à la conduite. Ils se connaissent entre eux, s’apprécient, tiennent à l’estime de leurs voisins, et entrent volontiers dans des associations de secours mutuels, non-seulement par de louables vues d’épargne, mais pour se procurer une force de résistance contre les patrons. La preuve de ce dernier fait, c’est qu’il existe à Lyon plus de cent soixante sociétés de secours mutuels, et que, quand on a essayé de les réunir en une société générale, très peu de chefs d’ateliers s’y sont prêtés, tant ils craignent de ne pas rester maîtres d’eux-mêmes. Les sources de leurs bénéfices sont de trois sortes : ils ont d’abord le produit de leur journée de travail comme tous les autres ouvriers; puis ils prélèvent pour location du métier la moitié du salaire gagné par les compagnons : on calcule qu’en tenant compte du loyer, du chauffage et de l’éclairage, cette moitié se trouve réduite à un quart; enfin chaque apprenti leur paie, pour frais d’apprentissage, une somme assez élevée ou leur abandonne pendant plusieurs années le produit de sa main-d’œuvre. Un chef d’atelier propriétaire de six métiers en bon état, qui a de nombreuses commandes, des compagnons laborieux et capables, avec un apprenti, est certainement dans l’aisance. Il travaille treize heures par jour, mais c’est la condition de tous les ouvriers, et au moins il travaille chez lui, près de sa femme et de ses enfans, sans être gêné par un surveillant ou par un contre-maître, et en tirant de son industrie un salaire relativement très élevé. A ne considérer que ces traits généraux de sa situation, il est certainement permis de le compter parmi les ouvriers les plus favorisés. Une population ouvrière dont un tiers environ est composé de chefs d’ateliers présente d’importantes garanties d’ordre et de moralité, et la perspective de devenir chefs d’ateliers à leur tour est pour les compagnons un encouragement à la bonne conduite et à l’économie.
La situation du simple compagnon est de tout point différente de celle du maître. D’abord il est réduit à son propre salaire, et il en perd chaque jour la moitié, disons le quart, pour plus d’exactitude, puisqu’il perdrait toujours l’autre quart en frais généraux. Ensuite il travaille hors de chez lui, ce qui implique une certaine dépendance; il n’a ni famille ni intérieur. Il rentre dans un garni après treize heures de travail; s’il ne gagne pas assez pour partager l’ordinaire du maître, il se nourrit mal dans un cabaret. Une vie sans foyer est presque fatalement une vie de désordre, car l’économie n’est conseillée au célibataire que par la raison, tandis que c’est le cœur qui la conseille au père de famille. Dans un temps qui n’est pas encore très éloigné de nous, le compagnon s’attachait à la famille du maître, et trouvait dans ces rapports un adoucissement à sa solitude; mais peu à peu un abîme s’est creusé entre ces deux ouvriers, dont l’un n’a que ses bras, tandis que l’autre a un établissement et un capital. Les compagnons sont devenus nomades, courant d’atelier en atelier, faisant leur tâche à côté du maître pendant tout le jour, sans le prendre pour confident, sans lui donner et sans lui demander de l’affection, de jour en jour moins honnêtes, moins réfléchis et moins à l’abri d’une vieillesse malheureuse.
L’apprentissage se fait dans de mauvaises conditions. Il est d’usage que l’apprenti abandonne au maître le produit de son travail pendant quatre années, contrat onéreux qui met l’enfant à la charge du père de famille dans un âge où il a déjà toute sa vigueur. Il en résulte que le métier de tisseur ne peut être appris par la partie la plus pauvre de la population, et que les ouvriers aisés, épuisés par les sacrifices que ces quatre années leur imposent, ne peuvent plus songer à exonérer leurs enfans du service militaire. On a peine à se rendre compte d’une exigence aussi disproportionnée, car le métier de tisseur s’apprend en six mois. Les pères de famille rachètent, quand ils le peuvent, une portion de ces quatre années d’esclavage par une somme qui s’élève quelquefois à 500 francs. Voilà en gros quelle est la situation du maître, du compagnon et de l’apprenti. Tout ce que nous venons de dire s’applique également aux hommes et aux femmes; mais il y a des différences nécessaires, et qu’il faut maintenant examiner.
II.
Constatons d’abord un fait très important à l’honneur de l’industrie lyonnaise, c’est que l’ouvraison est payée à tant le mètre, sans aucune différence pour les hommes et pour les femmes. Il n’en résulte pas que la moyenne du salaire soit la même pour les deux sexes, car si la moyenne pour un homme s’élève, par exemple, à 2 francs 50 centimes, elle n’atteint pas 1 franc 75 centimes pour une femme. La raison en est toute simple : il faut plus d’adresse et d’agilité que de force pour conduire un métier ordinaire ; mais il faut plus de force que n’en possède ordinairement une femme pour faire mouvoir les métiers qui tissent des pièces de grande largeur,. ou les métiers pour velours et certaines étoffes façonnées. Quelques femmes tissent des velours; on en citait une dernièrement qui, grâce à une vigueur exceptionnelle et en travaillant quatorze heures par jour, gagnait des journées égales à celles du meilleur ouvrier. La pauvre fille avait une jeune sœur aveugle à pourvoir; elle est morte à la peine dans la fleur de l’âge, et sans avoir pu réaliser entièrement la pensée pour laquelle elle donnait sa vie. La charité, si active à Lyon, a sur-le-champ adopté la sœur orpheline. Plusieurs femmes, chargées de famille et trouvant dans leur cœur la source d’un courage inépuisable, compensent ainsi par leur activité ce qui leur manque de force, et arrivent à égaler les journées des hommes en travaillant plus longtemps. Ce sont là de rares exceptions. Il ne faut pas souhaiter qu’elles se multiplient, puisque ces excès de travail sont infailliblement funestes à la santé des ouvrières. Le salaire des femmes reste donc inférieur à celui des hommes ; mais elles reçoivent ce qu’elles ont réellement gagné, le fabricant acquitte ce qu’il croit être le juste prix du service reçu : ce n’est pas de lui que les femmes peuvent se plaindre, mais seulement de la nature, qui leur a refusé des forces égales aux nôtres.
On voit que le principe d’après lequel la rémunération est répartie dans la fabrique lyonnaise est le principe libéral, celui qui dit : à chacun suivant ses œuvres. Si l’on cherchait bien, on reconnaîtrait que ce principe est le fondement du droit de propriété. Aussi quelques écoles socialistes lui ont-elles opposé un principe tout différent, et dont on sait la formule : à chacun suivant ses besoins! Comme le droit de propriété sort du premier de ces deux principes, le droit au travail sort du second. Le premier principe mesure la rétribution sur le service, parce qu’il reconnaît le droit de celui qui paie, et le second mesure la rétribution sur les besoins du travail- leur, parce qu’il ne reconnaît de droits qu’à celui qui est payé. Or, quoique le socialisme soit chassé de nos institutions, de nos lois et de nos usages, il envahit sournoisement le domaine de l’industrie. Ce sont les manufactures qui le ramènent de tous côtés, malgré la guerre théorique que leurs chefs lui ont faite et lui feraient certainement encore. Le socialisme brutal réclamait pour l’ouvrier incapable ou fainéant un salaire qu’il ne gagnait pas : il attentait à la propriété. Les manufacturiers qui paient un service moins qu’il ne vaut, parce que l’ouvrier qui le rend a peu de besoins ou beaucoup de résignation, attentent à la justice. A l’époque du grand développement des manufactures en Angleterre, les bras ayant été brusquement abandonnés pour la vapeur, et l’ouvrier ayant cessé par conséquent d’être lui-même une force pour devenir le guide et le surveillant d’une force mécanique, on remplaça partout les hommes par des femmes, qui rendaient le même service, et qui, dépensant moins, se contentaient d’un moindre salaire. On vit les hommes, inoccupés, inutiles, garder la maison et les enfans, tandis que les femmes vivaient à l’atelier, et, prenant le rôle de l’homme, en prenaient aussi jusqu’à un certain point les habitudes. Bientôt les fabricans cessèrent de mesurer la rétribution sur les besoins, — il n’y a plus de règle en dehors de la règle, — et comme les femmes n’ont ni l’esprit de résistance qui anime les hommes, ni la force nécessaire pour se faire rendre justice, on poussa aux derniers excès la réduction des salaires. Il y eut même des ateliers où l’on rechercha de préférence les femmes qui avaient des enfans à leur charge, parce que, dans leur désir de donner du pain à leur famille, elles ne reculaient devant aucun travail, et acceptaient avec empressement des prolongations de journée qui dévoraient en peu de temps leurs forces et leur vie. Quand les machines devinrent de plus en plus puissantes et la surveillance de plus en plus facile, l’ardeur du gain, aiguillonnée par la concurrence, remplaça la femme par l’enfant, détruisant ainsi les adultes par le chômage et les enfans par la fatigue. De tels résultats méritent d’être pesés par les partisans du droit au travail; on peut dire que c’est leur arme qui se retourne contre eux. C’est pour avoir voulu entamer le capital au nom du besoin qu’ils voient le capital rejeter les hommes, épuiser et rançonner les femmes et les enfans. C’est donc un grand titre d’honneur pour la fabrique lyonnaise d’être constamment restée dans le vrai, et d’avoir toujours payé le service rendu sans acception des personnes.
La maîtresse d’atelier est rémunérée, de même que son mari, au prorata de l’étoffe qu’elle a tissée. Si l’on ne regardait que ces ouvrières privilégiées, on pourrait dire que la fabrique de Lyon a résolu le problème de traiter équitablement les femmes. Une maîtresse d’atelier, n’ayant pas le loyer de son métier à payer peut, sans trop de fatigue, gagner 4 francs dans sa journée. Sur ces 4 francs, il faut défalquer un quart pour les frais, ce qui porte encore la journée à 3 francs, et comme le ménage, outre le salaire du mari et de la femme, opère un prélèvement sur la journée de chaque compagnon, le bénéfice s’élève en moyenne à 5 ou 7 francs pour la femme, à 6 ou 8 pour le mari. Il ne faut pas oublier toutefois que les crises de l’industrie se traduisent immédiatement pour le chef d’atelier en ruine complète, qu’il dépend pour avoir de l’ouvrage de la bonne volonté du fabricant et de ses commis, et que, même en supposant toutes les chances propices, il subit une interruption forcée de travail chaque fois qu’une pièce est finie et qu’il faut en disposer une autre sur le métier. Les fabricans qui favorisent un maître tisseur lui donnent des pièces à longue chaîne, ou dont l’ourdissage se fait avec rapidité, afin de lui épargner des pertes de temps. Malgré ces inconvéniens, on peut dire qu’une ouvrière placée à la tête d’un atelier reçoit pour ses peines un salaire convenable.
Elle exerce d’ailleurs son industrie dans des conditions excellentes. Sauf l’obligation de rendre l’étoffe à des époques déterminées, ce qui même n’a pas toujours lieu, elle est affranchie de toute surveillance. Elle travaille chez elle à côté de son mari, elle peut avoir ses enfans sous la main, et reste maîtresse de partager son temps au mieux de ses intérêts entre les soins du ménage et son travail industriel. Sa santé, sa moralité, son bonheur domestique ne