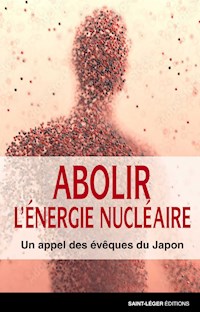
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Léger Editions
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Après avoir cherché à comprendre le partage des responsabilités de la catastrophe de Fukushima et examiné certaines questions éthiques impliquées dans l'utilisation de la technologie nucléaire, la Conférence épiscopale japonaise appelle l'humanité à abolir ce type d'énergie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Abolir l’énergienucléaire
Un appel de l’Église catholique du Japon
La Conférence des évêques catholiques du Japon
Le comité de rédaction pour L’abolition de l’énergie nucléaire
Traduction de l’anglais Amaury Le Bastart de Villeneuve
les unpertinents
Abolir les centrales nucléaires immédiatement
Faire face à la tragédie de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi
À tous ceux qui vivent au Japon,
L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, déclenché par le grand tremblement de terre de l’est du Japon, a contaminé l’océan et la terre par des radiations, a tragiquement perturbé la vie quotidienne d’un très grand nombre de personnes. Aujourd’hui encore, près de cent mille personnes ont été évacuées de la zone voisine de la centrale nucléaire, et de nombreuses personnes sont contraintes de vivre dans la peur et l’anxiété.
En ce qui concerne les avantages et les inconvénients des centrales nucléaires, nous, les évêques japonais, nous sommes exprimés dans notre message « Révérence pour la vie – un message pour le xxie siècle par les évêques catholiques du Japon » comme il suit :
Elle a fourni une source d’énergie totalement nouvelle pour l’humanité, mais comme nous pouvons le voir dans la destruction de vies humaines en un instant à Hiroshima et Nagasaki, au cours de la catastrophe de Tchernobyl et de l’accident de criticité1 mortel de Tokaimura, elle peut aussi transmettre d’énormes problèmes aux générations futures. Pour l’utiliser efficacement, nous devons avoir la sagesse de connaître nos limites et faire preuve de la plus grande prudence. Afin d’éviter la tragédie, nous devons développer des moyens alternatifs sûrs de production d’énergie2.
La « tragédie » évoquée dans ce message fut provoquée par rien de moins que l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Cette catastrophe nucléaire a anéanti le « mythe de la sécurité », qui a été créé parce que les gens ont fait trop confiance à la science et à la technologie sans avoir « la sagesse de connaître nos limites ».
Dans le message « Révérence pour la vie », nous, les évêques japonais, n’avons pas pu aller jusqu’à demander l’abolition immédiate des centrales nucléaires. Cependant, après avoir été confrontés à la catastrophe nucléaire tragique de Fukushima, nous avons regretté et reconsidéré cette attitude. Et maintenant, nous voudrions appeler à l’abolition immédiate de toutes les centrales nucléaires au Japon.
En ce qui concerne la suppression immédiate des centrales nucléaires, certaines personnes s’inquiètent de la pénurie d’énergie. Il existe également divers défis tels que la réduction du dioxyde de carbone. Cependant, le plus important, c’est qu’en tant que membres de la race humaine, nous avons la responsabilité de protéger la vie et la nature en tant que création de Dieu, de transmettre un environnement plus sûr aux générations futures. Afin de protéger la vie, qui est si précieuse, et la belle nature, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur la croissance économique en donnant la priorité à la rentabilité et à l’efficacité, mais décider immédiatement de supprimer les centrales nucléaires.
En raison de la prévision d’une nouvelle catastrophe due à un autre tremblement de terre ou tsunami, les 54 centrales nucléaires du Japon risquent de subir des accidents horribles comme le dernier en date. Par conséquent, afin de prévenir autant que possible les calamités d’origine humaine associées aux catastrophes naturelles, il est essentiel d’éliminer les centrales nucléaires.
Bien que les centrales nucléaires aient fourni jusqu’à présent de l’énergie à la société dans le cadre d’une « utilisation pacifique », elles ont également rejeté une énorme quantité de déchets radioactifs tels que le plutonium. Nous allons déléguer la responsabilité de la garde de ces déchets dangereux aux générations futures pour les siècles à venir. Nous devons considérer cette question comme une question d’éthique.
Jusqu’à présent, les politiques nationales ont encouragé l’énergie nucléaire. En conséquence, l’énergie naturelle a pris du retard en termes de développement et de popularité. Nous demandons instamment que les politiques nationales soient modifiées afin de donner la priorité au développement et à la mise en œuvre de l’énergie naturelle, qui contribuera également à la réduction du dioxyde de carbone. D’autre part, le démantèlement d’une centrale nucléaire demande beaucoup de temps et un travail énorme. Par conséquent, le démantèlement des réacteurs et l’élimination des déchets radioactifs doivent être menés avec une extrême prudence.
En effet, l’électricité est essentielle à notre vie actuelle. Cependant, ce qui est important c’est de modifier nos modes de vie en général en changeant les modes de vie qui dépendent excessivement de l’électricité.
Le Japon possède une culture, une sagesse et une tradition qui ont longtemps coexisté avec la nature. Les religions telles que le shinto et le bouddhisme sont également fondées sur le même esprit. Le christianisme a également un esprit de pauvreté. Par conséquent, les chrétiens ont l’obligation de rendre un témoignage authentique de l’Évangile, en particulier à travers les modes de vie attendus par Dieu : « La simplicité de vie, l’esprit de prière, la charité envers tous, en particulier envers les humbles et les pauvres, l’obéissance et l’humilité, le détachement et l’abnégation3 ». Nous devons choisir à nouveau un style de vie simple et clair basé sur l’esprit de l’Évangile4, dans des cas comme l’économie d’électricité. Nous vivons dans l’espoir que la science et la technologie se développent et progressent sur la base du même esprit. Ces attitudes conduiront sûrement à une vie plus sûre et sans centrales nucléaires.
Depuis Sendai
le 8 novembre 2011
La Conférence des évêques catholiques du Japon
1. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement (SdF) et de la gestion de la qualité, la criticité est définie comme le produit de la probabilité d’occurrence d’un accident par la gravité de ses conséquences : criticité = probabilité × gravité. La criticité d’un mode défaillant est un facteur de l’AMDEC dépendant à la fois de la fréquence ou probabilité d'apparition du défaut, de sa gravité et de la probabilité de sa non-détection.
Dans le domaine de l’ingénierie nucléaire, la criticité est une discipline visant à évaluer et prévenir les risques de réaction en chaîne non désirée dans les installations nucléaires. C’est une sous-discipline de la neutronique. Le risque de criticité est le risque de déclencher une réaction en chaîne de fission incontrôlée.
2. Reverence for Life –A Message for the Twenty-First Century from the Catholic Bishops of Japan (Catholic Bishops’ Conference of Japan, 2001, pp.104-105). Another message on nuclear plants announced by the Catholic Church in Japan is “Petition on the Criticality Accident at the Uranium Conversion Facility, JCO Co. Ltd” (1999).
3. Pope Paul VI, Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi, 76 (1975)
4. Cf. Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine of the Church, 486 (2004).
Avant-propos
Lorsque le Comité éditorial sur l’énergie nucléaire de la Conférence des évêques catholiques du Japon fut créé en septembre 2014, il avait l’intention de publier une traduction anglaise du texte japonais qu’il finirait par produire. Nous voulions informer le monde de la situation, du point de vue et de la responsabilité du Japon, de la portée de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima et de la réponse de l’Église catholique japonaise. La préparation proprement dite devait durer un an à partir du début des travaux à l’automne 2016.
Étant donné que le projet disposait d’un temps et d’un budget limités, il fut décidé que le chapitre de la deuxième partie, « Rayonnement, énergie nucléaire et puissance nucléaire », qui contenait des informations facilement disponibles dans d’autres sources, serait omis de cette traduction.
Néanmoins, pour diverses raisons, le travail a pris plus de temps que prévu par le comité. Je présente mes excuses pour ce retard à tous ceux qui ont participé aux travaux et à ceux qui attendaient leur conclusion. Veuillez noter que la situation décrite dans le chapitre 1, partie 2 des dommages causés par l’accident de la centrale nucléaire a quelque peu changé entre le moment où il a été écrit pour la première fois et la présente version traduite en anglais en 2020.
Lors de sa visite au Japon en novembre 2019, le pape François a rencontré des victimes de l’accident nucléaire de Fukushima, et a ensuite évoqué les dangers de la production d’énergie nucléaire lors d’une conférence de presse en vol sur le chemin du retour à Rome. Nous sommes ravis que l’expérience du pape au Japon ait approfondi sa conscience des dangers de l’énergie nucléaire.
Je suis heureux qu’aujourd’hui nous soyons enfin en mesure d’informer le reste de l’Église et du monde de l’opposition de l’Église catholique du Japon à la production d’énergie nucléaire.
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au révérend William Grimm MM et au révérend Patricia Ormsby qui ont traduit le texte. Le Révérend Masayuki Semoto SJ et le Professeur Mami Yoshikawa de l’Université Sophia ont fourni une révision détaillée de la traduction.
Ce livre est dédié à feu le Révérend Michael Siegel SVD. Mick était la figure centrale dans la préparation de ce texte anglais mais a succombé à un cancer au petit matin du 3 juillet 2019.
Comité éditorial sur l’énergie nucléaire
La Conférence des évêques catholiques du Japon
Ichiro Mitsunobu SJ
Tokyo, Pâques 2020
Introduction
Le 11 mars 2011, à 2 h 46 de l’après-midi, un tremblement de terre de magnitude 9,0 s’est produit au fond de la mer, à 130 kilomètres de la péninsule d’Oshika, dans la préfecture de Miyagi. Le séisme, d’une magnitude de 7 sur l’échelle japonaise, a provoqué un tsunami qui a causé d’énormes dégâts le long de la côte pacifique de la péninsule des régions de Tohoku et de Kanto. Environ une heure après le séisme, un tsunami de 14 à 15 mètres de haut a frappé la centrale nucléaire Daiichi de la Tokyo Electric Power Company à Fukushima, coupant l’électricité dans toutes les unités sauf une. Avec la perte d’électricité, il est devenu impossible de refroidir les réacteurs nucléaires. En conséquence, les cœurs des unités 1, 2 et 3 ont fondu, un accident catastrophique qui a provoqué la fuite de grandes quantités de matières radioactives. Cette catastrophe qui a contaminé la terre et la mer et détruit les moyens de subsistance de nombreuses personnes n’a pas encore été réparée. Plus de 90 000 personnes qui ont dû être évacuées n’ont toujours pas pu retourner chez elles.
En novembre 2011, huit mois après l’accident, la Conférence des évêques catholiques du Japon a publié « Abolir les centrales nucléaires immédiatement : Faire face à la tragédie de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ». Cette déclaration souligne les dangers de la production nucléaire et appelle à l’abolition de l’énergie nucléaire.
L’attitude des évêques catholiques du Japon à l’égard de la production d’énergie nucléaire a déjà été exposée dans leur message de 2001 intitulé « Révérence pour la vie : Un message pour le xxie siècle de la part des évêques catholiques du Japon ». Dans la section 75 de ce message, les évêques ont déclaré :
[Le développement de l’énergie nucléaire] a fourni à l’humanité une source d’énergie totalement nouvelle, mais comme nous pouvons le constater avec la destruction de vies humaines en un instant à Hiroshima et Nagasaki, la catastrophe de Tchernobyl et l’accident de criticité mettant en danger la vie des gens à Tokaimura, elle peut également transmettre d’énormes problèmes aux générations futures. Pour l’utiliser efficacement, nous devons avoir la sagesse de connaître nos limites et de faire preuve de la plus grande prudence. Afin d’éviter la tragédie, nous devons développer des moyens alternatifs sûrs pour produire de l’énergie.
Ce paragraphe expose des questions importantes pour aujourd’hui. Ceux d’entre nous qui vivent au Japon savent, de par leur histoire, à quel point la puissance sans précédent de la technologie nucléaire peut être destructrice, et comment elle met en danger même les générations futures. Nous savons qu’il est absolument nécessaire de reconnaître les limites de notre technologie et la nécessité de développer des formes alternatives d’énergie.
La catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi nous confronte durement à cette tragique réalité. Nous savons par expérience que la sagesse et les efforts humains ne sont pas suffisants pour contrôler le pouvoir dangereusement destructeur de l’énergie nucléaire. Cette dernière catastrophe a détruit la vie et les moyens de subsistance de nombreuses personnes.
Cinq années se sont écoulées, mais il n’y a toujours aucune perspective de rétablir ces moyens de subsistance ou de réparer les dommages économiques et sociaux causés par la catastrophe. La cause de la catastrophe n’a toujours pas été pleinement expliquée et divers experts soulignent les problèmes liés aux normes de sécurité récemment élaborées pour la production d’énergie nucléaire. Même si la production d’énergie nucléaire devait être arrêtée, les problèmes persistants d’élimination des déchets nucléaires ne sont toujours pas résolus. Malgré cela, en 2014, le gouvernement japonais a adopté une politique de redémarrage des 48 réacteurs nucléaires arrêtés à la suite du tremblement de terre et du tsunami dont la sécurité est considérée comme « vérifiée ».
Lorsque les évêques ont présenté Révérence pour la vie, ils n’en étaient pas encore au point de demander l’abolition de l’énergie nucléaire. À cette époque, notre conscience des problèmes de la technologie nucléaire, de l’impact dévastateur des accidents nucléaires et de la question plus profonde de savoir si une vie dépendante de l’électricité produite par l’énergie nucléaire est compatible avec la foi chrétienne était encore incertaine. Même après avoir vécu la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en mars 2011, notre compréhension des problèmes était encore insuffisante et nous avons donc accepté la réouverture des centrales nucléaires.
Il est temps pour nous de reconsidérer les leçons de la catastrophe de Fukushima. En cas d’accident grave dans une centrale nucléaire, la vie des gens est bouleversée et les effets environnementaux des radiations se propagent au-delà des frontières et des générations. Même sans accident, l’accumulation de déchets nucléaires nuit à l’environnement. L’énergie de l’atome est si puissante qu’il est difficile pour l’humanité de la contrôler sur une longue période. Face à ce constat, que devons-nous faire ? Comment porter un nouveau regard sur notre propre vie ? Avec qui devons-nous nous unir afin d’ouvrir un nouvel avenir ?
En mai 2015, le pape François a promulgué son encyclique Laudato Si’ – Sur le soin de notre maison commune. S’appuyant sur les dernières recherches sur les questions environnementales, le pape se penche sur diverses crises écologiques telles que le changement climatique, les problèmes d’eau, la perte de biodiversité et la dette écologique, et tire la sonnette d’alarme.
Ce livre, inspiré par Laudato Si’, s’appuie sur notre déclaration de 2011 appelant à la fin de la production d’énergie nucléaire et renouvelle l’avertissement sur son danger. Ce volume a été préparé par un comité d’experts en théologie, philosophie, religion, science et technologie qui s’est réuni en octobre 2014 sous le nom de Comité de l’Église catholique et de l’énergie atomique du Japon.
La première partie du livre se penche sur l’histoire de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, en cherchant à comprendre les responsabilités de l’accident. En outre, elle examine la situation des victimes de la catastrophe et explore les moyens de faire preuve de solidarité à leur égard.
La deuxième partie explique les radiations, l’énergie nucléaire ainsi que la science et la technologie de la production d’énergie nucléaire. Elle examine également certains problèmes éthiques liés à la science et impliqués dans l’utilisation de la technologie nucléaire.
La troisième partie est, en un sens, le cœur de ce livre. Elle présente des façons d’envisager l’utilisation de l’énergie nucléaire à la lumière de l’enseignement social catholique et de l’éthique environnementale contemporaine. L’encyclique Laudato Si’ montre comment la pensée catholique traditionnelle sur l’environnement peut se combiner avec de nouvelles perspectives. Afin de développer une large perspective sur la question de l’énergie nucléaire, nous présenterons des points de vue et des initiatives d’autres églises et religions.
La synthèse finale précisera les exigences que la sortie du nucléaire implique : des mesures concrètes pour « réduire la dépendance à l’électricité », l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, l’effort d’économie d’énergie et la transformation de nos modes de vie. L’appel à un « style de vie simple et clair » dans la déclaration des évêques de 2011 est repris par le pape François dans Laudato Si’ lorsqu’il parle d’une « spiritualité écologique » ou d’une « écologie intégrale ».
Il existe de nombreux points à partir desquels on peut examiner les avantages et les inconvénients de l’énergie atomique : la rentabilité économique, la santé des enfants, la sécurité publique, la responsabilité d’un approvisionnement énergétique fiable et le maintien de la compétitivité internationale de l’industrie nucléaire, entre autres. Cependant, pour l’Église catholique, qui a reçu la consigne de Jésus-Christ, « Aimez-vous les uns les autres » (Jean 13:34), l’examen des avantages et des inconvénients de l’énergie nucléaire doit commencer par la prise en compte de la vie et de la dignité de tous, y compris des générations futures. En d’autres termes, nous sommes convaincus que le point de départ de la réflexion doit être le fait que l’humanité fait partie de la création de Dieu et a la responsabilité de s’unir pour protéger l’environnement que nous partageons avec le reste de la création. C’est pourquoi ce livre fournit à l’Église et à la société civile du matériel pour réfléchir au problème de l’énergie nucléaire d’un point de vue éthique et évangélique.
Nous espérons que cet ouvrage sera une aide à la réflexion et à la discussion sur la manière de construire un style de vie qui exclut d’autres catastrophes nucléaires à l’avenir.
La Conférence des évêques catholiques du Japon
Le 14 juin 2016
Première partie. Du développement du nucléaire à l’accident nucléaire de Fukushima
Questions historiques et sociales
La tâche de ce travail est d’approuver le message de novembre 2011 de la Conférence des évêques catholiques du Japon. Ce message était le suivant : « Nous voudrions examiner le tragique désastre connu sous le nom d’accident nucléaire de Fukushima Daiichi, y réfléchir, et demander que toutes les centrales nucléaires au Japon soient abolies immédiatement. » En d’autres termes, notre tâche consiste à présenter des documents à l’Église et à la société civile pour leur permettre de considérer cette question d’un point de vue éthique, basé sur l’évangile, comme une position (opinion morale) pour accepter l’information et agir en conséquence.
Dans la première partie, nous examinons la relation entre l’atome et les hommes qui dépendent de l’énergie nucléaire ainsi que les problèmes qui en découlent. Ce livre passe donc d’abord en revue l’histoire de l’utilisation de l’énergie nucléaire et examine la responsabilité du Japon en tant que pays où s’est produit l’accident nucléaire de Tokyo Electric Power à Fukushima Daiichi. Il envisage ensuite les moyens de rapprocher les différentes victimes. À Fukushima, en particulier, alors qu’aucun soulagement n’est en vue, les circonstances font qu’il est difficile pour les gens de parler et de partager des opinions sur l’énergie nucléaire, même au sein de l’Église. Nous souhaitons le rétablissement des moyens de subsistance et la restitution à l’amiable pour les personnes qui ont tout perdu à cause de l’accident. Il s’agit notamment de personnes dont les moyens de subsistance étaient assurés par des emplois liés à l’énergie nucléaire, et des personnes dont les relations avec des personnes importantes ont été déchirées par des divergences en réponse à l’accident. Nous prêtons une oreille attentive aux personnes souffrant de dommages et envisageons cours pour protéger leurs droits en tant qu’êtres humains.
Chapitre 1. Histoire de l’utilisation de l’énergie (atomique) nucléaire et de l’exposition aux radiations
La langue japonaise utilise depuis longtemps les termes « kaku » (nucléaire) et « genshiryoku » (littéralement, « énergie atomique ») à des fins différentes. En liant le premier à l’armement, et le second faisant référence à la production d’électricité, la différence entre l’usage militaire et l’usage civil et pacifique fut soulignée. En se différenciant ces mots expriment de la sorte également un jugement de valeur : les armes nucléaires, qui sont des armes de destruction massive, sont mauvaises ; mais l’énergie atomique, qui produit une énergie utile à la société, est bonne. Mais qu’il s’agisse d’armes nucléaires ou d’énergie atomique, l’une ou l’autre implique toujours une technique (technique nucléaire) d’utilisation de l’énergie nucléaire produite par des changements dans les noyaux atomiques (fission nucléaire)5.
L’accident nucléaire de Fukushima Daiichi n’était pas simplement un accident de centrale électrique susceptible de se produire au Japon, où les tremblements de terre et les tsunamis sont fréquents, il s’agissait d’une terrible calamité pour tous ceux qui en étaient venus à utiliser l’énergie nucléaire. Les dommages causés par cet accident, en particulier l’exposition aux radiations et la grave contamination de l’environnement, sont communs aux autres cas de dommages nucléaires subis par l’humanité jusqu’à présent. Comme l’accident nucléaire de Tchernobyl qui s’est produit un quart de siècle auparavant (en 1986), les matières radioactives libérées se sont répandues au-delà des frontières nationales, affectant de larges pans du monde. Ses effets négatifs seront ressentis même par les générations futures.
L’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire au Japon ne peut être séparée de l’histoire tragique de la technologie nucléaire. Cette histoire comprend Hiroshima et Nagasaki et les événements vécus par l’humanité depuis lors6. Le Japon a subi cinq tragédies liées à la technologie nucléaire, à commencer par la première utilisation de l’énergie nucléaire par l’humanité dans le cadre d’une guerre, avec les deux bombes atomiques larguées en 1945. Elles furent suivies d’une exposition à la radioactivité lors des essais de la bombe à hydrogène de l’atoll de Bikini, de l’accident de criticité de Tokaimura JCO, et puis l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi. De toutes les nations du monde, seul le Japon a souffert de toutes les formes d’épreuves causées par la technologie nucléaire – l’exposition aux rayonnements d’une attaque nucléaire, d’essais nucléaires et d’accidents majeurs dans des installations nucléaires (usines de fabrication de combustible nucléaire et centrales nucléaires). En ce sens, il semblerait que le peuple japonais ait une responsabilité plus importante que d’autres dans l’examen des sociétés qui utilisent l’énergie nucléaire et de la manière dont ces sociétés sont organisées, et qu’il s’interroge sur la signification et l’opportunité de cette situation, l’importance et le bien-fondé de cette démarche. Ce chapitre passe en revue l’histoire de l’utilisation de l’énergie nucléaire (ou atomique) et de l’exposition aux radiations.
1. La bombe atomique et l’exposition aux radiations
L’énergie nucléaire déchaînée
Le développement de la technologie pour utiliser l’énergie nucléaire a commencé à la fin des années 1800 avec les progrès de la recherche sur les appareils produisant des rayonnements. Dans les premières années du xxe siècle, différentes formes de rayonnement et de substances radioactives furent découvertes successivement. On a également découvert que les atomes étaient constitués d’un noyau et d’électrons, et que le noyau était composé de protons et de neutrons. Puis, en 1939, dans une expérience consistant à bombarder des noyaux d’uranium avec des neutrons dans l’Allemagne contrôlée par les nazis, la fission atomique fut pour la première fois réalisée.
La scission du noyau d’un atome d’uranium entraîne la production de deux éléments atomiques plus légers avec la libération de deux ou trois neutrons. Ces neutrons entrent en collision avec d’autres noyaux atomiques, provoquant des fissions nucléaires ultérieures dans une réaction en chaîne. Lorsque cela se produit, une énorme quantité d’énergie est libérée instantanément. Les scientifiques du monde entier ont immédiatement su que la découverte de la fission atomique conduirait au développement de la bombe atomique (bombe A). Le physicien juif Léo Szilard, né en Hongrie mais qui s’est réfugié en Amérique, craignait que les nazis ne mettent au point la bombe atomique. En Amérique, il a écrit une lettre au président Roosevelt, à laquelle Einstein a également ajouté sa signature, lui conseillant de lancer un projet de développement d’une bombe A (Yamagiwa et al. [1993] Einstein’s Correspondence, August 2, 1939, pp. 4-5).
La Seconde Guerre mondiale a éclaté en réponse à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne en septembre 1939. En Amérique, le comité de l’Académie nationale des sciences sur la fission nucléaire a publié un rapport en mai 1941 sur la possibilité de produire une bombe atomique. En Grande-Bretagne également, un rapport fut publié en septembre 1941 sur la possibilité de réaliser une bombe A avec de l’uranium, et des travaux ont commencé sur plans pour la développer. Ce rapport a été transmis à l’Amérique, une puissance alliée, en octobre de la même année, et le gouvernement américain a décidé de collaborer avec la Grande-Bretagne pour mettre au point une bombe atomique. Vers la fin de cette année-là, la guerre dans le Pacifique entre le Japon et l’Amérique commença, et en septembre 1942, le gouvernement américain a lancé des plans de développement de la bombe A top secret. Le projet, initialement basé à New York, fut appelé en secret le « projet Manhattan7 ». Environ 120 000 scientifiques et techniciens y furent affectés. En collaboration avec l’industrie, une nouvelle ville fut construite dans le but de rechercher et de produire une bombe A. Environ 2 milliards de dollars ont été dépensés pour ce projet, un chiffre astronomique à l’époque.
Le gouvernement américain craignait initialement que l’Allemagne ne réussisse à développer une bombe A avant l’Amérique. Accélérant le développement pour ne pas prendre de retard, l’Amérique a procédé à deux projets différents en même temps dans le cadre du projet Manhattan. L’un d’entre eux consistait à séparer l’uranium-235 de l’uranium naturel et à fabriquer une bombe A à partir d’uranium-235 enrichi de haute pureté. L’autre était de fabriquer une bombe A à partir de plutonium-239 produit par un réacteur nucléaire. Le coût de production du plutonium-239 était inférieur à celui de l’enrichissement de l’uranium-235. Parce que le plutonium est facile à produire en masse, il est devenu le choix principal pour la production de bombes A après la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre du projet Manhattan, un réacteur nucléaire pour produire du plutonium et une usine de retraitement pour séparer le plutonium de l’uranium furent construits près de la ville de Hanford, dans l’État de Washington. Des installations d’enrichissement de l’uranium ont été construites à Oak Ridge, dans le Tennessee. Le laboratoire de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, fut créé pour concevoir et assembler les bombes A.
Au début du projet Manhattan, l’Allemagne était considérée comme la cible du bombardement atomique. En 1944, cependant, il est devenu clair que l’Allemagne n’avait pas la capacité de développer une bombe A. Sur le front européen, la défaite de l’Allemagne commençait également à devenir certaine. La raison initiale de développer une bombe A, à savoir affronter l’Allemagne, n’existait plus. Cependant, à ce moment-là, tant de personnes avaient été mobilisées et le Congrès avait secrètement alloué une telle somme d’argent pour ce projet colossal qu’il était impossible de l’annuler. Prévoyant la reddition de l’Allemagne avant que la bombe A ne puisse être achevée, le gouvernement américain a décidé à la mi-1944 de faire du Japon la cible des bombardements atomiques à la place. Avec la mort soudaine de Roosevelt le 21 avril 1945, Truman accède à la présidence. Récemment informé du développement secret des bombes A à cette époque, Truman est persuadé par ses proches confidents d’approuver la politique établie d’utiliser les bombes A contre le Japon. Ainsi, le 21 juin, le gouvernement américain décida de larguer les bombes A le plus rapidement possible, sans avertissement, en visant des villes d’une taille permettant de mesurer les effets des bombes atomiques. Les villes visées devaient comporter des bases ou des arsenaux militaires et avoir été peu endommagées par les raids aériens. Hiroshima, Kokura et Niigata devinrent des candidates au bombardement, Nagasaki étant finalement ajoutée à la liste.
En juillet 1945, une bombe de type uranium et deux bombes de type plutonium furent achevées. Un essai d’explosion de l’une des bombes au plutonium fut effectué (16 juillet) et Truman, qui en a été informé à Potsdam, près de Berlin, approuva la stratégie de largage des autres bombes A sur le Japon (25 juillet).
Le bombardement atomique d’Hiroshima et de Nagasaki
Une bombe de type uranium a été larguée sur Hiroshima le 6 août 1945, et trois jours plus tard, le 9 août, une bombe de type plutonium fut larguée sur Nagasaki. Ces bombes A ont été larguées de manière à toucher le centre de ces villes, et elles ont explosé à une altitude calculée au préalable pour provoquer le maximum de dégâts (580 mètres au-dessus du sol à Hiroshima, et 503 mètres au-dessus du sol à Nagasaki). La puissance des explosions résultant de la fission nucléaire d’environ 800 grammes d’uranium et d’environ 1 000 grammes de plutonium étaient équivalentes en termes de rendement TNT à environ 16 000 tonnes et 21 000 tonnes, respectivement (selon les estimations de la Radiation Effects Research Foundation ; RERF, 2013, p. 4). Ces chiffres dépassent de loin la quantité totale d’explosifs utilisés lors des raids aériens qui ont permis de dévaster les parties basses de Tokyo, qui s’élevait à 1 685 tonnes.
Contrairement aux explosifs conventionnels, les bombes A libèrent de grandes quantités de radiations. Il existe deux types de radiations provenant d’un bombardement atomique : le « rayonnement initial » libéré pendant l’explosion et le « rayonnement résiduel », qui est émis après l’explosion8. Contrairement au rayonnement initial, le rayonnement résiduel ne se dissipe pas rapidement. Les substances radioactives propagées par le champignon atomique et les vents qui s’élèvent dans le ciel retombent progressivement sur terre sur une large région. Comme le bombardement atomique s’est produit en été, les substances radioactives flottant dans le ciel sont retombées sur terre au fur et à mesure des pluies. Dans certains cas, cette pluie radioactive s’est mélangée à la suie noire qui avait été transportée en altitude par les terribles incendies allumés par les bombardements. C’est ce qu’on a appelé plus tard sous le nom de « pluie noire », et est devenu le terme commun pour la pluie radioactive. Les substances présentes dans l’atmosphère, le sol et les bâtiments furent transpercés par les rayons neutroniques et sont devenus radioactifs. Tout comme les retombées radioactives, elles sont devenues une source d’exposition aux rayonnements.
L’un des dangers des rayonnements résiduels est qu’ils provoquent des expositions secondaires chez les personnes qui n’ont pas été directement touchées au moment de l’explosion (exposition primaire). Immédiatement après la chute des bombes A, les gens sont entrés dans les villes dévastées pour prendre des nouvelles des membres de leur famille ou porter assistance aux blessés. Le personnel médical travaillait dans les postes de secours et les abris temporaires construits à la hâte dans les villes. La police et les fonctionnaires du gouvernement emportaient les morts et nettoyaient les ruines calcinées. Les gens consommaient de la nourriture et de l’eau contaminés par les retombées radioactives sans s’en rendre compte. Eux et les personnes résidant dans les zones où la pluie noire était tombée recevaient de fortes doses de radiation qui sont connues avec certitude pour être dangereuses pour la santé.
Les souffrances des victimes de la bombe A et leur dissimulation
Après le largage des bombes A sur Hiroshima et Nagasaki, le gouvernement du Japon a déposé une protestation contre l’Amérique (10 août) via la Suisse, un pays neutre, contre les bombardements atomiques comme une violation du droit international. Immédiatement après, cependant, le Japon a accepté les termes de la Déclaration de Potsdam le 14 août et a émis des ordres de cessez-le-feu à ses forces armées le jour suivant, mettant ainsi fin à la guerre.
À votre avis, quelles étaient les véritables raisons du largage des bombes A ? Comme le suggère le fait que deux types de bombes A furent utilisées, à l’uranium et au plutonium, les bombes durent être considérées comme un moyen de vérifier expérimentalement les effets des nouvelles armes. D’autres objectifs de l’Amérique ont pu être impliqués, tels que l’intimidation de l’Union soviétique et l’établissement de sa position de puissance mondiale. L’explication selon laquelle le largage de bombes A a aidé à mettre fin à la guerre plus rapidement et visait à minimiser le nombre de victimes de la guerre (le « mythe de la bombe A ») a été créé après la guerre comme une justification logique de l’attaque nucléaire. Un certain nombre d’études menées par des historiens ont révélé qu’une telle explication n’est pas en stricte conformité avec les faits historiques (Kimura & Kuznick, 2010, pp. 6-10).
L’immense force destructrice d’une explosion nucléaire tue non seulement des citoyens non combattants sans distinction9, mais en dispersant de grandes quantités de substances radioactives sur une vaste région, elle provoque également des lésions dues aux radiations chez les survivants. Les blessures subies par les victimes de la bombe A comprenaient des brûlures dues aux rayons thermiques, des blessures externes dues à l’onde de choc et des dommages dus aux radiations. L’ensemble de ces lésions est connu sous le nom de « maladie de la bombe atomique ». Il s’agissait de dommages cruels que l’humanité n’avait jamais connus auparavant, personne n’avait de méthode pour les traiter. Les médecins ne savent toujours pas comment traiter la période aiguë de la maladie de la bombe atomique en particulier, qui dure jusqu’à quatre mois après l’exposition. Même les personnes qui ne souffrent pas de brûlures ou de traumatismes mortels sont frappées par la perte de cheveux, de vomissements, d’anémie, de leucopénie, de diarrhée et d’autres symptômes terrifiants. Les cas graves meurent l’un après l’autre.
Les radiations des explosions atomiques ont également de graves effets sur les fœtus, qui sont très sensibles aux radiations. Selon une étude, les fœtus des femmes enceintes exposées dans un rayon de 2 kilomètres autour du point zéro et souffrant de lésions aiguës dues aux radiations présentaient des taux de fausses couches ou de mortinatalité environ neuf fois plus élevés que ceux dont les mères se trouvaient à bonne distance. De plus, il est devenu clair par la suite que les taux de décès chez les enfants dont les mères avaient été exposées aux radiations pendant leur gestation étaient plus élevés que ceux des autres et beaucoup d’entre eux souffraient d’un mauvais développement ou d’une faible constitution (Comité éditorial du Journal sur les catastrophes des bombes atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, 2011, pp. 147-150 [en japonais uniquement]).
La souffrance liée à la maladie de la bombe atomique se poursuit tout au long de la vie de la victime. Même après la guérison des blessures aiguës, de nombreuses victimes survivantes de la bombe A ont souffert de problèmes de santé, ou eurent des séquelles de leurs blessures, comme des cicatrices chéloïdes défigurantes, ou eurent l’esprit et le corps tourmentés par la fatigue et la débilité dans ce qui se traduit littéralement du japonais par « maladie persistante de la bombe A ». Sujet à la maladie, les victimes de la bombe A tombèrent dans la pauvreté en raison des frais médicaux et de la perte de leur emploi. Ils s’isolèrent socialement en raison du choc psychologique, de la perte des membres de leur famille et des biens du ménage. En outre, elles subirent des discriminations en raison des préjugés et du manque de considération. On leur refusa le mariage et l’emploi et on leur refusa une assurance-vie. Cela a obligé beaucoup d’entre elles à dissimuler le fait qu’elles furent des victimes de la bombe A. Une personne sur quatre répondants à une enquête sur les victimes 60 ans après l’exposition, menée par la Confédération japonaise des organisations de victimes de la bombe A et de la bombe H ont déclaré qu’elles avaient passé leur vie à cacher le fait qu’elles avaient été exposées (Japan Confederation of A and H-Bomb Sufferers Organizations, 2005, p. 4).
Pire encore, les effets retardés de l’exposition aux rayonnements se produisent dans de nombreux cas. Les cataractes commencent à augmenter à partir de trois ans après l’exposition ; et de cinq à 15 ans après l’exposition, la leucémie. À partir de 10 ans après l’exposition, les cas de cancer de la thyroïde, du sein, du poumon, de l’estomac, du côlon et des d’ovaires, de myélomes multiples et d’autres affections malignes commencèrent à augmenter. Une augmentation des décès par leucémie fut observée non seulement chez les personnes ayant subi une exposition primaire, mais aussi chez celles ayant subi une exposition secondaire et qui sont entrées dans les villes peu après les explosions. Alors que cette réalité devenait évidente, les victimes de la bombe A ont été forcées de vivre dans l’inquiétude des maladies, peut-être mortelles, qui pourraient leur arriver à tout moment dans le futur.
Les dommages psychologiques liés à l’expérience d’un bombardement atomique continuèrent aussi à hanter les victimes de la bombe A. Dans l’enquête menée auprès des victimes 60 ans après l’exposition, environ 40 % des personnes interrogées ont reconnu que les événements de ce jour-là leur avaient laissé des blessures psychologiques. Une victime de la bombe A a déclaré : « Même maintenant, la puanteur du sang, du pus et de la mort de cette époque me reste dans les narines. Si j’essaie de me remémorer la situation de l’époque pour me faire une idée de la scène que j’ai vécue, je n’arrive pas à m’en souvenir. pour dessiner une image de la scène que j’ai vécue, j’ai un rythme cardiaque anormal (arythmie) ou je trouve cela insupportable. » (Japan Confederation of A- and H-Bomb Sufferers Organizations, 2005, pp. 7-8). Certaines réponses à cette enquête font état de la peur de la mort sous forme de flashbacks occasionnels ou de blessures psychologiques aggravant les troubles mentaux. Que les blessures psychologiques subies par les victimes de la bombe A aient été ignorées par la quasi-totalité de la société et qu’aucun soin n’ait été apporté demeurent des problèmes qui ne doivent pas être négligés.
Le gouvernement des États-Unis, pays qui a infligé les bombardements atomiques, et le gouvernement du Japon, qui avait la responsabilité d’aider les victimes de la bombe A, ont continué à adopter une attitude extrêmement froide à l’égard de ces victimes, qui ont dû subir insulte sur insulte. Les scientifiques américains avaient étudié les effets des substances radioactives sur la santé et étaient conscients de leurs effets toxiques avant même les bombardements atomiques. Le danger que les bombes A fassent des victimes gratuitement en dispersant des substances radioactives avait été prévu. Certains pensaient que les produits de fission nucléaire créés par l’explosion seraient transportés en altitude jusqu’à la stratosphère, où ils se disperseraient largement et se dissiperaient suffisamment pour que les radiations résiduelles ne présentent aucun danger. Le fait qu’il s’agissait d’une erreur qui sous-estimait l’impact du rayonnement résiduel a été démontré au lendemain des bombardements atomiques (Hiroko Takahashi, 2012, p. 57-65). Le gouvernement américain a cependant nié que quiconque était exposé à des radiations résiduelles. Le quartier général (GHQ) a soumis tous les rapports sur les bombes A à une censure stricte, s’efforçant d’empêcher que les conditions misérables des sites de bombardement et la misère des victimes de la bombe A ne soient transmises à la société internationale. Pendant ce temps, l’Académie nationale des sciences des États-Unis a mis en place la Commission des victimes de la bombe atomique (ABCC) à Hiroshima et Nagasaki pour recueillir des données sur les effets des radiations de la bombe A sur le corps humain. Les informations recueillies lors de l’examen de nombreuses victimes de la bombe A furent traitées comme des données militaires classifiées sur les dommages causés au corps humain par une attaque nucléaire. Ces données n’ont jamais été utilisées pour traiter les victimes de la bombe A (Kimura & Takahashi, 2016, pp. 198-208). Jusqu’à ce que la loi concernant le Support for Atomic Bomb Victims (Loi sur le traitement médical des victimes de la bombe atomique) fût adoptée en 1957, ces victimes de la bombe A furent laissées à elles-mêmes, sans soutien, pendant 12 ans. Il faut noter que les gouvernements japonais et américain se sont dérobés à leur responsabilité administrative de restaurer la dignité des victimes de la bombe atomique.
Les essais de la bombe à hydrogène de Bikini et les insulaires du Pacifique
Après avoir gagné la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique a décidé de procéder à des essais nucléaires sur les atolls de Bikini et d’Enewetak pour étudier l’utilisation des bombes atomiques et développer de nouvelles armes nucléaires. Ces atolls font désormais partie de la République des îles Marshall, qui a acquis son indépendance en 1986. Les îles Marshall sont situées dans la région micronésienne de l’ouest de l’océan Pacifique, près de l’équateur. Auparavant, elles étaient un territoire sous mandat du Japon, mais après la guerre, elles sont passées sous administration militaire américaine. L’Amérique a transféré tous les habitants sur différentes îles en mars 1946 et a procédé à deux essais de la bombe A sur l’atoll inhabité de Bikini en juillet de la même année.
L’année suivante, les îles Marshall sont devenues un territoire sous tutelle des Nations unies. L’Amérique, qui a obtenu l’autorité administrative sur elles, a effectué un essai nucléaire après l’autre sur l’atoll de Bikini et sur celui d’Enewetak à l’ouest, soit 67 essais au total de 1946 à 1958 (Takemine, 2015, pp. 36-39). La production énergétique totale des armes nucléaires ayant explosé pendant cette période s’élève à 108 mégatonnes équivalent TNT. Cela équivaudrait à égal à 6 750 bombes A de type Hiroshima (16 000 tonnes). L’Angleterre, qui avait pris du retard sur l’Amérique en matière de développement d’armes nucléaires, a effectué, elle-même, 21 essais nucléaires entre 1952 et 1958, et la France 199 essais de 1966 à 1996, principalement dans la région du Pacifique Sud, y compris l’Australie (Maeda, 2005, pp. 41-42). L’un des facteurs qui fit du Pacifique central et méridional une telle « mer nucléaire » fut la course aux armements nucléaires pendant la guerre froide. Lorsque l’Union soviétique a testé avec succès une bombe A en août 1949, l’Amérique a perdu son monopole nucléaire. En réponse, le président Truman a décidé de développer une bombe à hydrogène (bombe H), qui utilise une réaction de fusion nucléaire entre des atomes d’hydrogène (deutérium ou tritium) et est plus puissante. L’Amérique effectua son premier essai de bombe H le 31 octobre 1952 sur l’atoll d’Enewetak.
Du 1er mars au 13 mai 1954, l’Amérique effectua six essais de la nouvelle bombe H, son atout stratégique face à l’Union soviétique. Lors du premier essai, le 31 mars à 6 h 45, heure locale, une bombe H de 15 mégatonnes (nom de code « Bravo ») a explosé sur le site d’essai de l’atoll de Bikini. L’énorme explosion qui s’ensuivit vaporisa une partie du récif corallien en un clin d’œil et produisit beaucoup plus de débris, créant un cratère de 2 kilomètres de diamètre et d’environ 80 mètres de profondeur. Trois îles disparurent. La puissance stupéfiante de cette explosion équivalait à environ 1 000 bombes A de type Hiroshima, et était cinq fois supérieure à celle de la totalité des explosifs utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale (trois mégatonnes).
Voir fig. 1 du cahier central.
Plusieurs heures après l’énorme flash et le souffle explosif, du corail blanc pulvérisé combiné à des substances radioactives a commencé à tomber du ciel dans la mer autour de l’atoll. Un article de journal japonais relatant plus tard les événements de ce jour-là a inventé pour la première fois le terme « shi no hai » (cendres de la mort) pour désigner les retombées radioactives produites par les explosions nucléaires (fission nucléaire et fusion nucléaire) (Yomiuri Shimbun, 16 mars 1954).
Sur l’atoll de Rongelap dans les îles Marshall, à 180 km à l’est du centre de l’explosion, de la poudre blanche est tombée comme de la neige. Quatre-vingt-deux insulaires, dont quatre femmes enceintes, furent exposés, et des symptômes d’irradiation aiguë apparurent sur eux le jour même. Il n’y avait aucun moyen de les traiter sur les îles, qui n’avaient pas d’hôpitaux, ni de les évacuer, les insulaires durent attendre trois jours l’arrivée d’un navire de secours américain, alors qu’ils continuaient à être exposés aux radiations externes des « cendres de la mort ». Ils ont également respiré de l’air et ingéré de l’eau et des aliments contaminés par la radioactivité.
Après avoir été évacués vers les installations militaires américaines de l’atoll de Kwajalein, les habitants de Rongelap vécurent pendant trois ans sur différentes îles. Ils sont retournés à Rongelap en juin 1957, une fois que le gouvernement américain a déclaré que l’île était sûre, mais ils ont souffert d’une succession de maladies et d’autres problèmes, notamment des troubles de la thyroïde, des cancers, des fausses couches, des mortinaissances et des naissances d’enfants difformes. Finalement, les habitants de l’île ont décidé de leur propre chef en 1985 de quitter leurs îles natales.
Voir fig. 2 du cahier central.
Sur l’atoll d’Utirik, à environ 500 kilomètres à l’est du site d’essai, 157 insulaires furent également exposés aux radiations des « cendres de la mort ». Lorsque la République des îles Marshall obtint son indépendance, le gouvernement américain a reconnu les dommages causés par les essais de la bombe H et a tenté de régler le différend politiquement avec une compensation de 15 millions de dollars. Cependant, les dommages n’ont été reconnus que pour les habitants de quatre atolls (Bikini, Enewetak, Rongelap et Utirik). Plus tard, dans des documents officiels des États-Unis publiés après déclassification, il fut révélé que les « cendres de la mort » provenant de la série d’essais de la bombe H avaient été dispersées sur une région si vaste qu’on pouvait considérer qu’elle était d’envergure mondiale. Il fut également noté qu’à commencer par 401 insulaires vivant sur l’atoll d’Ailuk, à environ 525 kilomètres au sud-est du site d’essai, ce sont les habitants de toute la région des îles Marshall qui furent exposés aux radiations (Takemine, 2005 ; voir également Hiroko Takahashi, 2012, pp. 182-188 ; Takemine, 2015, pp. 113-154). Les habitants de l’atoll d’Ailuk ont demandé une enquête en bonne et due forme et une indemnisation au gouvernement américain, mais ce dernier a refusé, soutenant que la question avait déjà été résolue.
Exposition des navires de pêche japonais aux radiations
L’essai de la bombe H « Bravo » (1er mars 1954) a causé d’énormes dommages aux navires de l’océan à proximité. Les eaux autour de la Micronésie sont de bonnes zones de pêche pour le thon, ainsi des nombreux bateaux touchés étaient des navires de pêche en haute mer japonais. Selon des documents internes de l’Agence des pêches datés du 30 novembre 1954 et publiés en 2015, au moins 856 navires furent touchés. Le tableau d’ensemble, cependant, sur ce qui semble être arrivé, consisterait en environ 10 000 membres d’équipage exposés aux radiations, mais reste flou. Aucune enquête de suivi sur la santé des membres d’équipage n’a été réalisée. Néanmoins, une étude fut menée sur les membres d’équipage des bateaux de pêche affectés par les essais de Bikini par un groupe appelé le « Séminaire Hata », formé en 1983 par un professeur de lycée, Masatoshi Yamashita, et des étudiants de plusieurs lycées de la préfecture de Kochi. Ils ont recherché témoignages des personnes concernées qui avaient été relégués dans l’ombre de l’histoire, ont enregistré leurs découvertes et les ont fait connaître (Yamashita, 2012).
Une des catastrophes des essais de la bombe H à Bikini qui fut officiellement reconnue par les gouvernements américain et japonais est l’incident du Daigo Fukuryu-maru, un thonier palangrier japonais. Le bateau opérait à 160 kilomètres à l’est du site d’essai et, selon un membre de l’équipage, Matashichi Oishi, tôt le matin du 1er mars, une poudre blanche est tombée si épaisse sur le pont qu’on y a laissé des empreintes de pieds. Le même jour, l’équipage a été assailli par des vertiges, des maux de tête, des nausées, des diarrhées et d’autres symptômes (Oishi, 1991 ; 2003 ; 2007 ; 2011). Incapable de quitter le bateau contaminé par la radioactivité avant son retour au port de Yaizu le 14 mars, l’équipage a souffert d’une inflammation des yeux, d’une décoloration de la peau avec des cloques de brûlure, de saignements, d’une perte de cheveux et d’autres symptômes liés aux radiations. Si l’on ne tient compte que de leur exposition aux rayonnements externes, on estime que l’équipage a reçu en moyenne 3,24 Sieverts, une forte dose de rayonnement équivalente aux personnes se trouvant à moins d’un kilomètre du point zéro de la bombe A d’Hiroshima.
De plus, en mai de la même année, de fortes concentrations de substances radioactives ont commencé à être détectées dans la pluie tombant sur l’archipel japonais. Bien que les habitants des îles Marshall aient adressé une pétition aux Nations Unies pour que les essais de la bombe H soient arrêtés, l’Amérique a affirmé, comme excuse, la légalité des essais, en utilisant l’article 76 de la Charte des Nations Unies concernant la tutelle internationale « pour contribuer à la paix et à la sécurité internationales ». La poursuite des essais à six reprises jusqu’au 13 mai fut la cause de la pluie radioactive au Japon. La contamination radioactive des fruits et légumes sur les marchés a également été confirmée à la fin du mois de mai.
Les personnalités du gouvernement américain de l’époque tentèrent de calmer la situation, en affirmant que si les retombées radioactives tombaient dans la mer, elles seraient diluées, limitant ainsi les effets des radiations résiduelles (déclaration du 31 mars 1954 de Lewis Strauss, alors président du président de la Commission de l’énergie atomique, dans Miyake, Hiyama & Kusano, 2014, pp. 21-24). Pourtant, alors que le nombre de navires touchés continuait d’augmenter, des thons radioactifs furent pêchés et une pluie radioactive fut observée au Japon, il devint évident que l’impact des essais de la bombe H atteignait une échelle et une portée bien au-delà de ce qui avait été prévu.
Ne pouvant plus se contenter de regarder en spectateur, le gouvernement japonais a envoyé un navire de recherche de l’Agence des pêches, le Shunkotsu Maru, en mer près de l’atoll de Bikini du 15 mai au 7 juillet pour étudier les effets des essais de la bombe H sur les écosystèmes marins. Après avoir étudié les poissons, le plancton, l’eau de mer et l’air au cours d’un voyage d’environ 1 700 kilomètres, les scientifiques embarqués déterminèrent que la contamination radioactive pouvait se trouver dans l’eau de mer et les poissons dans des zones éloignées de 1 000 kilomètres ou plus de l’atoll de Bikini, et que la bioaccumulation des contaminants dans la chaîne alimentaire jouait un rôle dans la contamination des poissons. Les essais de la bombe H ont provoqué le pire cas de contamination radioactive de l’océan de l’histoire. L’enquête a réfuté l’idée selon laquelle les retombées radioactives seraient diluées par l’eau de mer et rendues inoffensives.
Pendant ce temps, l’état de santé des 23 membres de l’équipage du Daigo Fukuryu Maru, qui avaient été hospitalisés, se détériorait régulièrement. Le nombre de cellules de leur moelle osseuse avait diminué de moitié par rapport à celui d’une personne en bonne santé. En mauvaise santé et ayant perdu la capacité de générer leur propre sang, ils ont continué à recevoir des antibiotiques et des transfusions sanguines. Peu à peu, de nombreux membres de l’équipage ont commencé à souffrir de troubles de la fonction hépatique. L’opérateur radio en chef Aikichi Kuboyama, dans un état grave, est mort le 23 septembre d’une défaillance multiple des organes résultant de son exposition aux radiations.
La mort de Kuboyama fit les gros titres des médias. Elle a donné du pouvoir au Mouvement pour l’interdiction des bombes nucléaires qui a alimenté les inquiétudes sur la radioactivité et la colère contre les essais nucléaires, les propageant rapidement parmi les citoyens du Japon. Les gouvernements des États-Unis et du Japon furent poussés à faire quelque chose. Visant un règlement politique de la catastrophe japonais, le gouvernement américain a versé 2 millions de dollars (environ 720 millions de yens au taux de change de l’époque) en compensation au gouvernement japonais le 4 janvier 1955.
Le versement de cette compensation ne signifiait toutefois pas que le gouvernement américain admettait l’illégalité des essais de la bombe H et présentait ses excuses au Japon. L’argent de la compensation que le Japon a reçu n’était qu’une consolation, sans tenir compte de la culpabilité légale de l’Amérique. Sans révéler toute la situation de l’exposition aux radiations des essais de la bombe H, les gouvernements des États-Unis et du Japon ont tenté de négocier un règlement à l’amiable et de balayer le problème sous le tapis. Malgré la persistance de la pollution marine, les tests de radioactivité sur les poissons furent interrompus en décembre 1954. Aucune tentative n’a été faite pour clarifier les degrés d’exposition des équipages des navires touchés autres que le Daigo Fukuryu Maru, ni pour étudier l’impact sur leur santé, ni pour leur verser une quelconque compensation. L’illégalité des multiples essais de bombes H américains qui ont fait tant de victimes n’a jamais été reconnue, et les essais ont continué sur les atolls de Bikini et Enewetak sans que le gouvernement japonais ne proteste le moins du monde contre cette décision.
Les nations détentrices d’armes nucléaires ont effectué au total au moins 2 050 essais nucléaires entre 1945 et 2013. Les personnes victimes de l’exposition aux radiations vivent, comme les habitants des îles Marshall, en marge de la société civilisée centrée sur les superpuissances (Daigo Fukuryu Maru Peace Association, 2014, pp. 96-103). De plus, les essais nucléaires répétés ont dispersé d’énormes quantités de substances radioactives dans tout l’environnement, entraînant une contamination irrémédiable à l’échelle mondiale. Les plus de 2 000 essais nucléaires à ce jour ont libéré une quantité d’iode-131 estimée à environ 3 millions de pétabecquerels (« péta » signifiant un quadrillion, soit un « un » suivi de quinze « zéros »). Ce chiffre est environ 577 fois supérieur à la quantité estimée libérée par la catastrophe de Tchernobyl (environ 5 200 pétabecquerels). (environ 5 200 pétabecquerels). En 1991, l’International Physicians for Prevention de la guerre nucléaire (IPPNW) a annoncé ses conclusions selon lesquelles le nombre final de décès par cancers attribuables aux essais atmosphériques répétés d’armes nucléaires pourrait s’élever à 2,4 millions de personnes dans le monde (IPPNW, 1991, pp. 39-40). Le degré réel de dommages causés à l’humanité par les essais nucléaires n’est cependant pas connu avec certitude.
2. L’histoire de la génération d’énergie nucléaire au Japon
Recherche sur l’énergie nucléaire après 1945
Les recherches menées au Japon pour mettre au point une bombe atomique ont débuté en 1943 et ont progressé dans le secret pendant la guerre d’Asie-Pacifique. Appelées « Projet Ni-Go », elles furent principalement menées par le physicien Yoshio Nishina sous la direction de l’armée impériale japonaise à l’Institut de recherche physique et chimique (aujourd’hui RIKEN). Les recherches du « Projet F-Go » ont commencé en 1944 à l’Université impériale de Kyoto (aujourd’hui Université de Kyoto) sous la direction de la Marine. Toutefois, aucun des deux projets n’a jamais réussi à s’approcher du développement réel d’une arme nucléaire.
Après la fin de la guerre, le GHQ (le Haut commandement) a fait détruire les cyclotrons (équipement essentiel à la recherche), et pendant l’occupation, le Japon s’est vu interdire toute recherche en physique nucléaire atomique. Cependant, lorsque le traité de San Francisco entre en vigueur en avril 1952, un groupe de physiciens et d’experts en physique nucléaire se met en route. Un groupe de physiciens dirigé par Seiji Kaya proposa toutefois de conseiller le gouvernement sur la création d’un organisme d’enquête chargé d’étudier la question de l’énergie nucléaire. Bien que la recherche sur la physique nucléaire ait repris, de nombreux universitaires s’y sont opposés. Au cours de cette période, la guerre de Corée a éclaté (1950 à 1953), et le Japon a commencé à se remilitariser avec la création de la réserve de la police nationale. Les universitaires étaient très inquiets car les relations entre le Japon et les États-Unis se resserraient en matière de sécurité nationale, et si le Japon se lançait dans la recherche sur l’énergie nucléaire, il s’impliquerait dans la stratégie militaire des États-Unis (Yoshioka, 2011a, n° 2, Ch. 3).
Dans les années 1950, l’énergie nucléaire a commencé à être utilisée à d’autres fins que les bombes atomiques. L’Union soviétique a mis en service la première centrale nucléaire au monde en 1954. Ce fut suivi d’un réacteur à double usage militaire et civil (la centrale nucléaire de Calder Hall) qui a commencé à fonctionner en Grande-Bretagne en 1956, produisant du plutonium pour l’armée tout en fournissant de l’électricité. L’Amérique a créé le premier sous-marin à propulsion nucléaire au monde, l’USS Nautilus, en 1954.
Dwight D. Eisenhower, qui a succédé à Truman à la présidence des États-Unis en 1953, a encouragé le développement de la bombe H. Il a également adopté une stratégie de déploiement des armes nucléaires dans les bases militaires américaines du monde entier. Le but de cette stratégie consistait à contenir l’Union Soviétique, et elle fut à l’origine de la stratégie de « dissuasion nucléaire » en matière de sécurité internationale (Ohta, 2014). Au même moment, les milieux industriels américains commencèrent à s’impliquer dans le développement de l’énergie nucléaire, après avoir été devancés par la Grande-Bretagne. Ces milieux commencèrent à demander au gouvernement de cultiver un marché mondial pour cette énergie (Nakagawa, 2011).
« Atomes pour la paix »
Pour éviter que la stratégie nucléaire américaine n’apparaisse comme dangereuse à la communauté internationale dans ces conditions, le président Eisenhower commença à rechercher des utilisations non militaires de l’énergie nucléaire. Il pensait en effet que si les gens croyaient que l’énergie nucléaire apporterait la paix et la prospérité, il serait plus facile de développer et de déployer des armes nucléaires (Yoshimi, 2012). Lors de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1953, Eisenhower a proposé l’idée des « Atomes pour la paix ». C’était la stratégie nationale de l’Amérique pour amener les gens à considérer l’énergie atomique comme une technologie non destructrice.
Peu après la proposition d’« Atomes pour la paix », un budget pour l’énergie nucléaire fut adopté par la session plénière de la Chambre des représentants du Japon le 4 mars 1954. Après cela, le gouvernement japonais commença à mettre en place un système de développement et d’utilisation de l’énergie nucléaire. Les milieux industriels y ont vu l’avènement d’une opportunité commerciale dans ce domaine. À partir de ce moment-là, les mondes politique, ministériel et des affaires ont maintenu une coopération entre eux afin de promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Il faut ajouter que le budget de l’énergie nucléaire fut approuvé par la Chambre des représentants le même mois que l’incident du Daigo Fukuryu Maru (mars 1954). C’est donc à cette époque que le Mouvement pour l’interdiction des bombes nucléaires prit de l’ampleur parmi les citoyens japonais. Une campagne de signatures émergea en opposition aux armes nucléaires. Elle a permis d’obtenir plus de 30 millions de signatures. Pour supprimer ce mouvement croissant, l’Amérique a organisé des expositions « Atomes pour la paix » dans 10 villes japonaises, dont Hiroshima, où les souvenirs du bombardement atomique étaient encore frais. Dans leur tentative d’effacer le souvenir des bombardements atomiques, les Américains ont collaboré avec l’élite dirigeante japonaise pour orienter méticuleusement l’opinion publique (Igawa, 2002).
Parallèlement, l’Amérique d’Eisenhower conçut un plan de déploiement effectif d’armes nucléaires au Japon. Un navire de guerre doté d’armes nucléaires a accosté au Japon en 1953, et des armes nucléaires furent transférées dans une base militaire américaine à Okinawa de la fin 1954 à 1955. À cette époque, le Japon passait sous le parapluie nucléaire des États-Unis. Un nouveau traité de sécurité fut conclu entre le Japon et l’Amérique en 1960, et une campagne s’est développée contre le traité de sécurité entre le Japon et les États-Unis. C’est aussi l’année où la préfecture de Fukushima a déclaré son intention d’attirer des centrales nucléaires sur son territoire. L’implication du Japon dans la stratégie nucléaire américaine a progressé en même temps que sa politique en matière d’énergie nucléaire. Les « atomes pour la paix » et les « atomes à usage militaire » étaient les deux faces de la stratégie nucléaire américaine à l’époque de la guerre froide.
Bagarre entre le pour et le contre l’énergie nucléaire
À cette époque, des voix s’élevèrent pour protester contre l’initiative « Atomes pour la paix ». Masao Tsuzuki, un médecin qui avait mené une enquête sur les dommages causés par les bombardements atomiques et avait été directement confronté à la souffrance des victimes de ces bombardements, s’opposait à la construction de centrales nucléaires. Il a cité des exemples de dommages causés par les radiations résultant de l’énergie nucléaire aux États-Unis et en Europe et a averti : « Lorsque nous envisageons l’utilisation pacifique de l’énergie atomique, nous devons en même temps, ou mieux encore, avant cela, envisager sérieusement la prévention des dommages causés par la radioactivité » (Tsuzuki, 1954, p. 943). Le physicien théoricien Seitaro Nakamura a également déclaré que du point de vue des devoirs moraux des scientifiques, « Actuellement, il n’existe pas de traitement approprié pour les lésions dues aux radiations, notre position ne devrait-elle pas être d’éviter toute radioactivité d’origine humaine ? »… « Jusqu’à ce que nous soyons capables de traiter les déchets radioactifs provenant de la production d’énergie atomique reposant sur la fission nucléaire. Tant que notre capacité à traiter les déchets radioactifs provenant de la production d’énergie atomique reposant sur la fission nucléaire n’aura pas été perfectionnée, il serait erroné d’autoriser cette technologie industrielle dans un pays dont l’espace est aussi limité que celui du Japon » (Nakamura, 1954, p. 124).
Un autre physicien théoricien, Mitsuo Taketani, qui avait autrefois préconisé la construction de réacteurs nucléaires, mais qui avait été témoin du terrible spectacle de l’incident du Daigo Fukuryu Maru, a pris une position ferme contre l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Il a déclaré : « Les diverses parties qui s’agitent en faveur de l’utilisation pacifique ne se contentent pas de camoufler, mais dissimulent leurs motifs par rapport au mouvement contre les armes nucléaires » (Taketani, 1955, p. 99).
Le gouvernement n’a cependant pas pris ces avertissements au sérieux (Jomaru, 2012, pp. 82-92).
L’accord atomique entre le Japon et les États-Unis fut conclu en novembre 1955, et trois lois sur l’énergie atomique furent approuvées en décembre de la même année (loi fondamentale sur l’énergie atomique, loi sur la création de la Commission japonaise de l’énergie atomique, et loi sur la révision partielle de la loi sur la création du Cabinet). L’organisation du développement de l’énergie atomique a donc commencé. L’Institut japonais de recherche sur l’énergie atomique (JAERI10), qui recevrait l’uranium enrichi, conformément à l’accord atomique, et la Nuclear Fuel Corp. qui s’occupait du développement des mines d’uranium et de la technologie de production du combustible nucléaire, furent créés en tant que services publics spéciaux sous la juridiction de l’Agence pour la science et la technologie. En 1956, les milieux industriels créèrent le Japan Atomic Industrial Forum Inc. et la Commission japonaise de l’énergie atomique (JAEC11) fut lancée en tant qu’institution gouvernementale chargée de créer et de promouvoir un plan commercial pour l’énergie atomique au Japon.
Hideki Yukama, qui avait reçu le prix Nobel de physique et qui était en position de représenter le monde universitaire japonais à cette époque, fut l’un des premiers membres de la Commission de l’énergie atomique du Japon. Son opinion tenait que la recherche et le développement (R&D) de l’énergie atomique devait être développée en partant des bases12





























