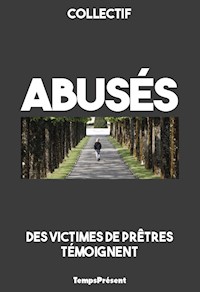
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Temps Présent éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Ce livre rassemble des témoignages de victimes d'abus sexuels commis par des prêtres. L'une de ces victimes est prêtre lui-même, dans le diocèse de Saint-Etienne, Jean-Luc Souveton. Il se bat pour que l'Église catholique se mette beaucoup plus à l'écoute des victimes. Son agresseur, Régis Peyrard, a été condamné en décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. Une autre des victimes de Régis Peyrard, ainsi que la sœur de l'une d'elles, témoignent également dans ce livre. Tous ces témoignages racontent la difficulté à parler, à libérer la parole, à faire accepter leur situation de victime non seulement par l'institution catholique mais aussi par les proches, à commencer par la famille. La préface est signée par Sylvie Barjon, psychologue et présidente de l'Association interprofessionnelle de soins et de prévention des abus sexuels (AISPAS).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Préface
Écoutons la parole des abusés
Par Sylvie BarjonPsychologue clinicienne et criminologuePrésidente de l’Association interprofessionnellede soins et de prévention des abus sexuels (AISPAS)
~
La parole est aux abusés.
Enfin.
Écoutons-les.
La question du silence des victimes d’abus sexuel, du secret dans lequel elles sont prises est au centre de mes interrogations depuis trente ans d’engagement associatif dans la prévention des abus sexuels et d’accompagnement psychologique de victimes en tant que psychologue.
Pourquoi, malgré les messages préventifs, la sensibilisation, les perches tendues, la clairvoyance et la bienveillance des intervenants auprès des enfants, pourquoi certaines victimes parlent et d’autres pas ?
La première interprétation basique qui vient à l’esprit du professionnel aguerri et formé, dans ce type de problématique, est en général : « Je n’ai pas su faire, je n’ai pas trouvé les bons mots, c’est de ma faute. » Or il faut aller chercher au-delà de cette humilité – louable certes, car elle prouve la capacité à s’interroger sur nos pratiques, mais qui ne saurait être une réponse unique. Il faut aller chercher du côté de la victime elle-même, et comprendre ce qu’elle vit. Quelle est la fonction du secret ? Pourquoi l’adage populaire « Parle et tu te sentiras mieux, confie-toi et tu seras libéré » ne fonctionne-t-il pas dans ces cas-là ?
Le secret, imposé par l’agresseur ou que la victime s’impose elle-même, est une protection. C’est un faux ami qui protège : du scandale, des menaces, de la crainte de ne pas être cru, de l’exposition, de la honte, de l’éclatement de la famille parfois. Mais c’est aussi un leurre qui permet à l’agresseur de continuer en toute impunité. Le secret est un piège qui enferme la victime dans cette relation duelle et la rend presque complice de la répétition des abus. Il scelle un accord tacite entre l’abusé et l’abuseur, une sorte de pacte de non-révélation pour garder le statu quo, un pacte de mort psychique pour la victime.
Dès lors, on comprend l’insistance des intervenants auprès des enfants à les faire parler pour les libérer, pour les protéger, pour leur bien, et pour empêcher d’autres passages à l’acte sur d’autres victimes. Mais à soutirer une parole, comme on arrache des aveux à un coupable, sans l’écouter, sans la soutenir, sans la reformuler pour ne pas la déformer, sans prendre le temps de l’accoucher, sans l’accompagner, sans l’étayer, on risque de la faire disparaître à tout jamais ou de la voir se rétracter. Le temps social est pris dans l’urgence à protéger, le temps judiciaire est animé par la recherche de la vérité pour protéger et punir, le temps psychique est d’un autre registre. Il est différent selon les individus, leur histoire, leurs ressources internes, leur maturité, leurs expériences précédentes. Il est respectable en soi.
Il est indispensable de tenir compte de ces différences, et de tenter d’accorder au mieux ces temps pour aider efficacement une victime. Car à trop vite consoler, on étouffe la peine, à trop vite agir, on dépossède la victime de sa parole, on lui confisque la procédure judiciaire. La victime devient objet de protection, objet de soin, objet et jamais sujet, dans une répétition involontaire de ce qu’elle a déjà subi dans l’abus, c’est-à-dire être utilisée comme un objet sexuel.
Alors oui, comprenons que pour un abusé, la parole est un danger.
La victime qui parle brise le pacte inconscient avec son agresseur, elle rompt la pseudo paix protectrice et s’expose à tous les dangers. Des dangers objectifs qui s’appuient souvent sur le discours de l’agresseur : « Si tu parles, je te tue... », « Je dirai que tu étais d’accord... que tu mens... », « Si tu parles, j’irai en prison... », « La honte sera sur ta famille... Tout le monde le saura... ». Il s’expose aussi à des dangers anticipés, par rapport aux conséquences : « Si je parle, on ne me croira pas... », « Je vais faire exploser ma famille », « Je vais être puni... placé », « Mes parents le sauront... La police m’interrogera ». Ces dangers réels ou fantasmés se doublent de dangers internes, psychiques, inconscients, encore plus opérants pour museler la victime.
L’accompagnement des victimes d’abus sexuels nous apprend cette chose, étrange au départ mais tellement vérifiable dans la réalité : malgré l’horreur de l’abus et l’effraction physique et psychique subie, les enfants victimes ne sombrent que rarement dans la folie, ne se suicident pas ou peu, n’ont pas toujours des symptômes criants sous forme de troubles du comportement envahissants. Ils s’adaptent, ils n’ont pas le choix.
C’est un terme effrayant mais ils s’adaptent à l’horreur de la situation, ils l’apprivoisent, apprennent à vivre avec, en mettant en place des mécanismes de défense qui sont les mécanismes de survie que l’on retrouve chez toutes les victimes, dans la durée, d’un trauma sans cesse répété.
Ils procèdent inconsciemment à des remaniements psychiques pour supporter l’insupportable et utilisent le clivage, le déni, le refoulement, le retournement, l’amnésie.
Ils construisent un pseudo-équilibre sur le chaos, ils isolent la partie négative, de non-vie, insensée au sens propre du terme, innommable et indicible, dans un sas étanche, et continuent à vivre dans des espaces protégés (école, famille, vie sociale). C’est alors la pulsion de vie qui est préservée.
Parler, c’est rompre cet équilibre, c’est se mettre à nu, renoncer à ses défenses et cela représente un grand danger d’effondrement psychique. Ils le savent ou le pressentent.
Parler, c’est se confier, donner sa parole à quelqu’un, c’est faire confiance. Ce qui est difficile quand la confiance a déjà été trahie.
Parler, c’est mettre son destin entre les mains de quelqu’un : sacré challenge lorsqu’on a été victime de mains abusives.
Parler, c’est un coup de poker, un saut dans le vide.
Toutes les victimes ne sont pas prêtes, intérieurement, psychiquement, à le faire.
Il faut les préparer, les accompagner, les nourrir.
C’est d’ailleurs un vrai paradoxe que de demander à une victime, à qui on a tout pris, de donner encore : des mots, des faits, des preuves.
Avant de donner, il faut recevoir. Notre rôle est peut-être de donner à ces victimes du temps, de l’écoute, des explications, du sens, de la sécurité, de la réparation afin d’accoucher de cette parole.
Mais le travail ne s’arrête pas au dévoilement.
Parler peut suffire à alerter, à protéger, à déclencher une procédure, mais pas à réparer, à reconstruire.
La parole doit être crue, portée et relayée aux autorités compétentes en terme de protection.
Elle doit être accompagnée dans la procédure.
Elle doit être soutenue et défendue par les adultes protecteurs de l’enfant : les parents, l’institution, la société.
Il est de fait que le désaveu de la mère, quand il s’agit d’un abus incestueux, de l’institution, quand il s’agit d’un professionnel, ou de l’Église, quand il s’agit d’un prêtre, a un effet traumatique surajouté.
Enfin, cette parole doit être travaillée en thérapie pour que les faits se transforment en récit, pour qu’ils soient mis en sens et puissent être analysés avec un tiers, digérés et dépassés par l’abusé. C’est tout le travail de l’élaboration du traumatisme.
Parler est un premier pas, mais le chemin est long et douloureux. C’est en nommant le vécu brut, encrypté en elle comme un poison lentement distillé, que la victime redevient lentement sujet.
Dans le cas des victimes d’abus sexuels dans l’Église, nous assistons a un cumul d’obstacles. Les enfants abusés par un prêtre le sont à des niveaux multiples. Abusés dans leur corps, dans leur psychisme, dans leur confiance, dans leur foi. C’est l’équivalent d’un inceste dans la mesure où le prêtre est le père spirituel. Mais il semble qu’il y a double inceste quand le père biologique confie l’enfant au père spirituel, qui est aussi le sien, et ne peut se désolidariser de lui pour protéger son enfant. Il ne rétablit pas l’ordre des choses, celui de la loi et de l’interdit majeur.
Par ailleurs l’institution religieuse, si elle fonctionne comme tout groupe qui tient à conserver l’homéostasie1 et pratique l’omerta pour la protection de ses membres, semble encore plus fermée dans la mesure où chaque intervenant est pris dans un conflit de loyauté au-delà du corporatisme professionnel ou de la fidélité familiale, dans la spiritualité et l’essence même du sens de la vie.
Enfin, si le bouleversement provoqué par l’inceste est majeur, dans le sens du mélange des rôles, des sexes et des générations, c’est l’ordre familial qui est mis à mal. Dans le cas de l’Église, c’est l’ordre moral, spirituel, l’ordre du monde qui est bouleversé ; les fondamentaux.
Il est d’ailleurs intéressant de noter que les quelques familles qui croient et soutiennent leur enfant, ou les victimes elles-mêmes qui cherchent de l’aide, toutes s’adressent à la hiérarchie de l’Église, c’est-à-dire en interne, inconscientes de ce fonctionnement fusionnel incestueux, et assurés, par leurs croyances intimes, que le salut ne peut venir que de là. Le recours au tiers extérieur n’est pas la réponse spontanée. Pourtant, il n’y a que le tiers extérieur qui puisse avoir une action : il n’a aucun enjeu personnel et en appelle à la loi froidement.
Le chemin est encore long pour sensibiliser, former, ouvrir la parole, l’écoute et l’accompagnement, et sans cesse à renouveler tant nos défenses inconscientes sont fortes pour mettre à distance, en doute, cette réalité qui nous fait violence, celle d’êtres humains comme nous qui devraient de fait être protecteurs des mineurs, et deviennent des abuseurs d’enfants.
Écoutons la parole des abusés.
Au delà de nos connaissances, de nos expertises, de nos pratiques, de nos formations, nous avons beaucoup à apprendre d’eux.
Ils sont les principaux concernés.
Ne parlons pas d’eux, sur eux et pour eux mais avec eux.
Ce livre nous en offre l’occasion rare.
1. Ensemble des mécanismes physiologiques qui permettent de maintenir le milieu interne dans un état d’équilibre (Nde).
L’Église catholique ne sait toujours pas écouter les victimes
Par Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse de Saint-Étienne
~
« Crier son désespoir n’est pas une écriture, il faut chercher les mots qui donnent forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi. Il faut mettre en scène l’expression de son malheur pour en remanier la représentation. Lorsque le spectateur applaudit ou quand le lecteur comprend, il confirme que le malheur a été métamorphosé en œuvre d’art. Le blessé ne réintègre l’univers des gens heureux qu’en créant chez eux un moment commun d’émotion, de joie ou d’intérêt. Écrire dans la solitude, pour ne plus se sentir seul, est un travail imaginaire qui trahit le réel puisqu’il le rend partageable, mais apaise l’auteur en tissant un lien de familiarité avec celui (celle) qui le lira.
Pourtant l’écriture n’est pas une thérapeutique. L’auteur a souffert de son malheur, il ne redeviendra jamais sain, comme avant. Le travail de l’écriture l’aide plutôt à métamorphoser sa souffrance. Avant, j’étais dans la brume comme une âme errante, là ou ailleurs, sans savoir où aller, sans comprendre. Depuis que j’ai écrit, je me suis mis au clair, je ne suis plus seul, j’ai repris une direction, mais je ne suis pas guéri, je ne redeviendrai jamais comme avant puisque la blessure est dans mon corps, dans mon âme et dans mon histoire. Mon malheur charpente ma personnalité. Tout ce que je perçois, les objets, les lieux, les maisons et les raisons, sont référés au malheur passé, mais je n’en souffre plus. Puisque j’ai trouvé un sens, mon monde intime a pris une autre direction. Depuis que j’ai écrit mon malheur, je le vois autrement : “Aux effets de symbolisation et de trace qui sont plus forts dans l’acte d’écrire que dans celui de parler, il faut ajouter les bénéfices secondaires de prise de recul, d’apaisement et de reconnaissance.”
Quand le malheur entre par effraction dans le psychisme, il n’en sort plus. Mais le travail de l’écriture métamorphose la blessure grâce à l’artisanat des mots, des règles de grammaire et de l’intention de faire une phrase à partager. L’objet écrit est observable, extérieur à soi-même, plus facile à comprendre. On maîtrise l’émotion quand elle ne s’empare plus de la conscience. En étant soumis au regard des autres, l’objet écrit prend l’effet d’un médiateur.
Je ne suis plus seul au monde, les autres savent, je leur ai fait savoir. En écrivant j’ai raccommodé mon moi déchiré ; dans la nuit, j’ai écrit des soleils. »
La nuit, j’écrirai des soleilsBoris Cyrulnik
« Le 24 août 2018
Monsieur le procureur de la République,
Je suis prêtre du diocèse de Saint-Étienne, né le 9 novembre 1960 à Toul (54). À l’âge de 15 ans, au mois de juin 1976, j’ai été victime d’un abus sexuel de la part de Régis Peyrard. Cela s’est passé dans le chalet Le Serpolet, propriété de l’association Camp vers les sommets, aux Lanches, hameau de la commune de Peisey-Nancroix.
J’étais seul avec lui. Il m’avait proposé de l’accompagner sur deux jours pour monter du matériel en vue des camps d’été. Mes parents étaient au courant et avaient donné leur accord. Je devais participer à l’un de ces camps d’été.
Régis Peyrard était l’aumônier du groupe de JIC (Jeunesse indépendante chrétienne) auquel j’appartenais. Scolarisé au lycée technique Benoît Fourneyron, il venait régulièrement me chercher en voiture à l’issue des cours pour que je puisse participer aux rencontres de ce groupe.
Une relation de confiance s’était donc nouée. Mes parents l’avaient rencontré et lui faisaient aussi confiance.
À l’heure du coucher, prétextant l’inutilité de faire plusieurs lits pour une seule nuit à passer sur place, je me suis retrouvé dans le même lit que lui. Très rapidement il s’est livré à (...).2
Ce que je me rappelle le plus nettement, c’est qu’à un moment j’ai eu conscience qu’il me fallait jouer mon va-tout pour m’en sortir car j’étais tétanisé. J’ai connu une sorte d’éclair de conscience salvateur que ma vie était en danger si je ne faisais rien. J’ai donc bondi hors du lit, profitant de ce que je n’étais pas du côté du mur, et je me suis enfui dans une autre chambre. Il n’a rien fait pour me retenir ni me poursuivre. Le lendemain il n’a parlé de rien. Moi non plus.
C’est la mort dans l’âme que je fais ce « coming out », ce dévoilement de ce que j’avais réussi à tenir caché jusqu’alors, me sentant, dans les premières années, honteux et coupable de ce qui s’était passé et bien incapable de le partager puis, ensuite, dans le déni de l’impact que cet évènement avait eu sur moi et sur ma vie. Tout était en place pour que je me taise et j’avais réussi « bon an, mal an » à faire avec et à mener une vie heureuse.
Le prochain procès de l’auteur de cet abus, les révélations des comportements scandaleux de membres éminents de l’Église, la maltraitance3 que je viens de subir de la part de mon évêque, qui n’a rien trouvé de mieux que de faire loger Régis Peyrard chez moi les jours de ses auditions par la gendarmerie alors qu’il connaissait mon histoire, réveillent en moi des réactions que je croyais apaisées par le temps et le long travail de psychothérapie. Il m’est devenu impossible de me taire et de ne pas contribuer positivement à l’enquête en cours.
Pour compléter un peu ces lignes, vous trouverez ci-joint des extraits d’un courrier que j’adresserai dans les jours à venir aux responsables de l’Église de Saint-Étienne et de France. Je ne sais pas si leurs contenus peuvent apporter quelque chose dans l’instruction de ce procès. Ils vous permettront au moins de comprendre ce qui m’habite et me met en mouvement après toutes ces années de silence.
Veuillez agréer, Monsieur le procureur de la République, mes sincères salutations. »
•
Le 12 juin 2019, je suis contacté par l’officier de police judiciaire de la brigade des recherches de la gendarmerie de Saint-Étienne qui avait entendu Régis Peyrard et qui m’apprend ce que me confirmera le 27 août 2019 le procureur de la République par un courrier : ma plainte contre Régis Peyrard est classée sans suite, les faits dénoncés étant prescrits.
Voilà, en un coup de téléphone de moins de cinq minutes et moins de trois lignes signées par le procureur de la République, l’affaire est classée. C’est rude, car s’il y a prescription pour la justice, il n’en est pas de même pour la souffrance. J’ai la sensation d’un décalage énorme entre le « Circulez, il n’y a plus rien à faire » de la justice et le besoin qui m’habite d’une parole qui reconnaisse publiquement l’abus. L’affaire est classée comme je l’ai moi-même classée ou cru l’avoir classée pendant quarante ans, sans faire tous les liens entre mes difficultés, mon mal-être, mon besoin d’être écouté et cet événement sur lequel je ne suis jamais revenu... Une affaire classée qui va revenir à la surface, un dossier dormant remis sur le dessus de la pile au moment où je ne m’y attendais pas et de façon brutale.
Avec le recul, je peux dire que ce premier traumatisme de 1976 a laissé des traces dans ma vie et plus particulièrement dans ma capacité à faire confiance, à oser vivre et laisser s’exprimer mes sentiments à l’égard de qui que ce soit dès lors qu’ils sont de l’ordre de l’attrait, de la tendresse ou de l’amour. Mais aussi à accueillir les signes d’attention, d’affection et d’amour. Oui j’ai été bousillé, endommagé gravement dans ma capacité à aimer et à me laisser aimer et je pourrais dresser la longue liste des conséquences concrètes que cela a eu et a encore dans mes relations. C’est l’élan naturel de la vie qui est touché lorsqu’il est difficile, et même parfois impossible, de dire son affection par des paroles ou des gestes tellement est présente la peur que cela soit mal interprété ou qu’un piège se referme. L’affection exprimée et vécue est un piège : c’est la croyance qui s’est insidieusement installée dans ma vie suite à ce premier traumatisme. Mais il en est une autre, née de la même expérience. L’attention que te porte l’autre, les manifestations d’intérêt, les déclarations d’amour cachent une intention secrète : te transformer en objet pour satisfaire au mieux des besoins et au pire des pulsions, te nier comme sujet et « te baiser », au propre comme au figuré.
Et puis il y a la confiance brisée. Il m’a fallu quarante ans pour la rééduquer de multiples manières grâce aux psychothérapeutes, aux groupes et aux sessions dont les cadres sécurisants permettent de réexpérimenter la possibilité de donner et de recevoir sans se faire dévorer, sans se mettre en danger, et invitent à poursuivre dans les relations ordinaires ce qui a été réussi dans un espace protégé. Ils me permettent progressivement de renouer avec l’élan vital qui mène vers l’autre et avec l’acceptation d’être fait pour cette forme de relation réussie qui s’appelle la communion. J’aime beaucoup la manière dont en parle Jean-Paul Mensior, prêtre jésuite, docteur en médecine, psychiatre et psychanalyste4 :
« Toute relation réussie, et donc porteuse de vie, exige la différence, l’altérité, la distance. La communion ce n’est pas la fusion, c’est l’union dans la différence. Et non seulement la communion exige la différence, mais elle l’accroît : toute relation réussie est personnalisante, pour les deux partenaires de la relation. Chacun y devient un peu plus lui-même, dans sa ligne propre. »
Long chemin, donc, de sortir des conséquences de cette histoire où je me suis finalement senti nié comme sujet, traité comme un objet, utilisé pour assouvir le besoin d’une figure d’autorité (il était Père) qui avait su forcer ma confiance. J’avais alors – et j’ai toujours – des parents aimants et de bonnes relations familiales. Je n’étais ni en difficulté ni en rupture. J’étais un adolescent « normal » dans une famille « normale ». Je n’étais pas en recherche d’un substitut pour répondre à des carences parentales. J’étais un baptisé qui s’adressait naturellement à un prêtre pour l’aider dans sa vie spirituelle. Tout a commencé avec lui dans la confiance et dans l’amour... Un amour filial qui devait se sentir puisque j’ai souvenir que ma mère disait que j’étais un peu son fils spirituel. Un amour paternel de son côté ? Je ne sais pas, lui seul pourrait le dire. En tout cas, sa fonction et son titre m’autorisent à le penser. D’autant plus que notre rencontre s’est faite sur fond d’une faim de vie profonde et d’interrogations spirituelles. J’étais un chercheur de Dieu et j’attendais d’être accueilli et accompagné sur le chemin d’une Rencontre. Je m’en suis remis à lui, confiant, pour ce qu’il représentait pour moi : un autre Christ, le représentant de Dieu sur terre... À l’époque, je n’avais ni le langage ni les années d’étude de philosophie et de théologie pour parler correctement du prêtre et de ce qu’il représentait. Il était pour moi de l’ordre de Dieu sur terre.
Plus j’avance et plus je considère que l’expression d’abus sexuel n’est pas totalement adaptée à ce que j’ai vécu et c’est souvent ce qui concerne l’inceste qui me parle le plus. La différence donnée par le docteur Fernande Amblard5 est très éclairante pour moi :
« L’inceste et l’abus sexuel sur un enfant ont des conséquences très proches, avec une gravité supplémentaire pour l’inceste puisque le crime est commis par celui en qui l’enfant a mis son amour et sa confiance : sa mère ou son père, le plus souvent, ou un substitut parental. »
Oui, pour moi, l’abus a été commis par un homme, un prêtre, en qui j’avais mis mon amour et ma confiance. Ça a été très dur pour moi de reconnaître ce lien de confiance et d’amour qui m’unissait à lui. Il m’a été difficile de le nommer. Je n’aime pas en parler. Je vois déjà fondre sur moi les propos qui me renvoient à la responsabilité de ce qui m’est arrivé, au fait que je n’ai pas aimé la bonne personne, au fait que je ne peux m’en prendre qu’à moi ! Voilà ce que je crains que l’on me dise et ce qu’une petite voix en moi répète. Pourtant, je n’étais qu’un enfant. C’est un élément non négligeable de la culpabilité malsaine. La plupart des victimes n’aimaient pas leur bourreau, moi si. C’est peut-être en grande partie ce qui explique la surprise de tant de monde lorsque je m’exprime. Et c’est pourquoi j’aborde peu ce fait ancien et développe davantage l’abus le plus récent, d’un autre ordre, un abus de confiance commis lui aussi par un Père en qui j’avais placé ma confiance, l’évêque de Saint-Étienne, au point de lui révéler l’abus commis par Régis Peyrard, dont je n’avais jamais parlé à personne.
Ce sont bien les témoignages de personnes victimes d’inceste qui me permettent de mieux comprendre mes quarante-deux années de silence, et l’absence d’animosité, de colère, de ressentiment et de révolte à l’égard de Régis Peyrard. Je pourrais reprendre la quasi-totalité des propos ci-dessous entendus6 :
« Les violences au sein de la famille sont particulièrement efficaces. On ne se révolte pas contre ceux qu’on aime. C’est ce qui fait de l’inceste une arme de domination si puissante. Plus l’amour est présent, le respect, le sentiment d’être redevable et dépendant, plus le risque de faire exploser son socle, ses proches, sa famille, plus la révolte semble impossible, la dénonciation ingérable ou pas tout de suite, ou tard, ou au prix de l’exclusion du foyer [...] L’inceste c’est dans la famille. Du coup il y a de l’amour et moi je sais que j’ai eu beaucoup de mal avec ça. C’est que j’avais un amour profond pour mon grand-père [...] et c’est ça qui est terrible, c’est qu’on peut aimer les gens même quand ils font des trucs horribles [...] Cet amour c’est ça qui empêche de se libérer. »
Remplacez « famille » et « foyer » par « Église », « grand-père » par « Père Régis Peyrard »... « inceste » par « relation d’amour et de confiance »... vous comprendrez un peu dans quoi je me suis débattu toutes ces années ! Jusqu’à une nouvelle effraction en mai 2018 que j’aborderai plus loin, conséquence d’une autre confiance mal placée. En écrivant « mal placée », je m’aperçois qu’une fois encore je me situe comme responsable de ce qui m’est arrivé ! Je corrige donc : « Conséquence d’une autre confiance trahie. »
J’aimerais citer un autre passage du podcast de Charlotte Pudlowski qui rend bien compte de la tension intérieure éprouvée, du silence qui s’ensuit et de ce qui est intégré comme normal :
« D’un côté on a envie de rejeter ce père qui se permet... qui s’approprie son enfant... le prend, c’est une chose ; et en même temps on a besoin de ce père, on en a besoin parce que pour grandir... pour, je sais pas... c’est compliqué, c’est très compliqué et c’est pour ça, je pense, que je l’ai toujours exonéré en fait de sa responsabilité pour pouvoir continuer à avoir une relation avec lui, je pense que c’est comme ça que ça se passe, l’enfant est incapable de réagir [...]
Ce que l’on apprend, quand on a été victime d’inceste, c’est que ceux qui sont censés nous aimer le plus de manière inconditionnelle, nous protéger, sont ceux qui nous dominent... que c’est normal de respecter ceux qui nous font du mal, ce sont aussi ceux qui nous aiment... »
De la difficulté de parler
Début juin 2020, après un premier refus une bonne année avant, je me suis engagé à donner mon témoignage pour un livre des éditions Temps Présent, à l’initiative de Luc Chatel qui avait couvert le procès de Régis Peyrard à Saint-Étienne pour Le Monde des Religions. Une longue interview avait permis à Luc de me proposer un texte qu’il me restait à relire et à corriger avant de donner mon accord. Mais quelque chose clochait, qui m’empêchait de clore ce travail. Il y avait bien sûr tout un tas de bonnes raisons extérieures pour me justifier mais là n’étaient pas les véritables raisons. J’étais en fait plongé dans un dilemme : parler ou ne pas parler, écrire ou ne pas écrire, poursuivre ou laisser tomber. Des évènements extérieurs tombaient alors à pic pour le trancher et justifier à bon compte mon abandon. S’en est suivi un échange de mails dont voici le dernier, envoyé par Luc :
« Merci Jean-Luc, je comprends la complexité de ta situation. De notre côté, le livre est déjà enregistré auprès des libraires pour janvier prochain et ton texte a une place très importante dans cet ouvrage, par la singularité et la force de ton témoignage. Si tu veux apporter des modifications, tu peux me les indiquer et je les rédigerai. On peut encore repousser le délai de bouclage jusqu’à fin octobre. Sinon, tel quel, ton texte est très bien (en faisant les corrections de forme, bien sûr). Dis-moi quelle option tu préfères.
Amitiés,
Luc »
Ce qui était sûr pour moi, c’est qu’aucune des options proposées par Luc ne me satisfaisait. Si je devais aller au bout, il fallait vraiment que ce soit mon texte, écrit dans mon style. Mais peut-être fallait-il commencer par explorer cette résistance qui apparaissait. N’y avait-il pas en elle quelque chose d’essentiel à mettre au jour et à exprimer qui pourrait aider le lecteur à comprendre ce qui se passe quand on a été victime ?
Qu’est ce qui me retenait dans mon expression ? Comment se faisait-il que je n’osais pas ou plus raconter simplement les évènements vécus, les plus anciens et surtout les plus récents, avec leurs répercussions dans ma vie ? Pourquoi est-ce que je n’osais pas, au-delà de l’exposition des faits, aller jusqu’à exprimer mon analyse ? Pourquoi le texte n’arrivait-il pas à mûrir en moi et à se déposer tranquillement sur le papier ?
Toutes ces questions en appellent une autre : qui avais-je envie d’épargner ou de protéger en gardant encore le silence ? Plusieurs réponses se présentent :
- Moi ? Certainement. Tout catholique qui évoque publiquement les fautes de l’Église s’expose à deux types de réactions. Soit il sera félicité pour son courage et son souci de transparence, soit il se fera blâmer d’avoir « blessé » l’Église et alimenté les arguments de ses détracteurs. Pour certains, le scandale ne réside pas dans les faits mais dans la perspective qu’ils soient connus. Et malheur à celui par qui le scandale arrive. Haro sur le traître, le faux frère dont la fraternité ne va pas jusqu’à se taire pour préserver le groupe et la bonne image qu’il faut maintenir à tout prix... en tout cas au prix du silence. Je crains d’être voué aux gémonies.
Il y a une autre raison à mon silence. Être prêtre, c’est un engagement fort et radical. Comme l’exprime fort bien Catherine Fino7 : « L’engagement existentiel est tel que dénoncer les faits subis équivaut à se désolidariser d’une appartenance qui a construit l’identité de la personne, alors que celle-ci tente précisément de résister au processus de dissolution identitaire induit pas l’abus. » C’est une tension difficile à vivre car j’aime toujours l’Église. C’est l’amour que j’ai pour elle et la conscience qu’elle est irremplaçable qui, paradoxalement, m’ont longtemps conduit à me taire et me poussent maintenant à m’exprimer. Je dénonce et me désolidarise de comportements que je trouve profondément inhumains avant même de les taxer d’anti-évangéliques, mais en aucun cas je n’ai envie de quitter l’Église ou d’en être exclu. Est-ce que ça peut être entendu et compris ? J’en doute, à tort je l’espère. Je ne remets pas en cause tout ce que j’ai reçu mais, pour reprendre une formule célèbre, je me donne un droit d’inventaire. Je me sens prisonnier dans un conflit de loyauté qui me paralyse. Loyauté envers l’Église qui va jusqu’à pouvoir l’interroger et dénoncer des attitudes et des comportements malsains, et loyauté envers les autres victimes sans accepter pour autant des discours ou des revendications que je ne partage pas. Il me faut trouver un chemin dans cette double appartenance. D’un côté comme de l’autre je peux être suspecté de ne pas jouer pleinement l’appartenance. Je suis prêtre et ex-victime. Ce « et », je le veux inclusif alors qu’il m’est souvent proposé de le remplacer par un « ou ». Je choisis le grand écart même si ce n’est pas confortable. C’est dans cette tension acceptée que se dit et se construit aussi quelque chose de mon identité.
Je sens aussi que certaines personnes trouvent que j’ai un lien ambigu à mon histoire ancienne et à Régis Peyrard. Je ne peux pas le réduire au mal qu’il m’a fait. Il n’a pas été que mauvais pour moi. Il faudrait que ce soit tout blanc ou tout noir. C’est bien plus compliqué !
- Les personnes concernées et impliquées dans ces différents évènements ? Oui, aussi. À commencer par l’agresseur : comment ne pas le réduire à ses actes délictueux ? Comment dire ma vérité en laissant suffisamment d’espace au lecteur pour ne pas l’enfermer dans une seule lecture possible ? Je reste habité par la peur d’être injuste ou d’exagérer mais j’ai de plus en plus conscience de la nécessité de ce travail d’écriture pour raccommoder mon moi déchiré, comme l’exprime si bien Boris Cyrulnik cité en exergue.
- L’Église ? Je ne sais pas.
Je ne pouvais que constater les résistances qui étaient là et qui bloquaient mon expression. Il se joue une fois encore, dans les raisons de cette difficulté à tout mettre noir sur blanc, la sensation que de toute façon c’est inutile, que cela ne sert à rien, que personne ne voudra me croire, qu’il faudra encore lutter pour me faire entendre.
Alors, à quoi bon faire l’effort déchirant d’essayer de mettre en mots l’indicible si, une fois encore, c’est pour ne pas être cru ou pour être suspecté de je ne sais quelles arrière-pensées ? À quoi bon mobiliser ce qui a fait mal et ce qui reste douloureux si je n’ai pas l’espoir d’être vraiment écouté et pas seulement entendu... ? À quoi bon me livrer si c’est pour entendre une fois encore des paroles de relativisation qui piétinent et parfois nient mon vécu ?





























