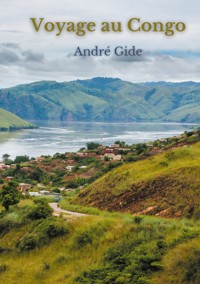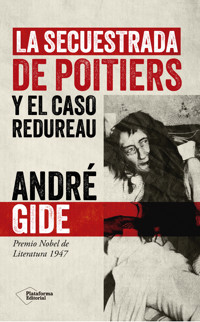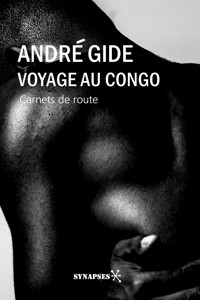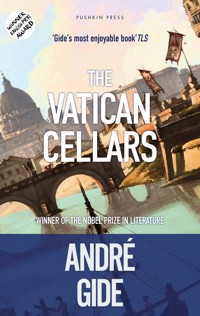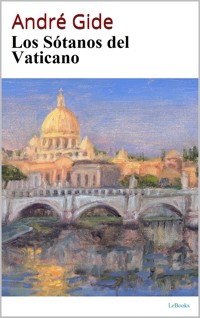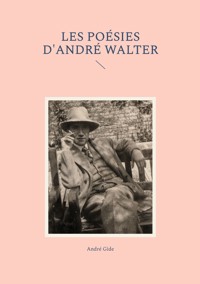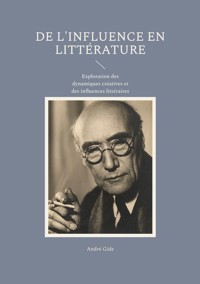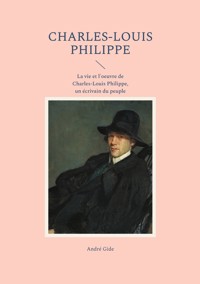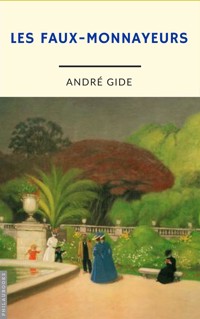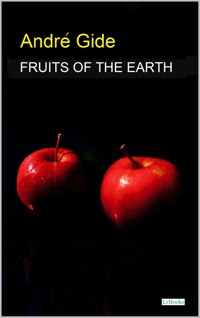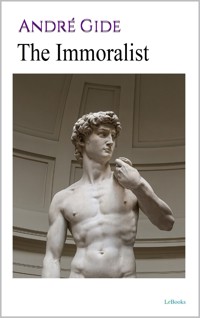0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Je viens de biffer quatre mots : c’est tricher. Tâcherai de ne pas recommencer… Ah ! j’en avertis aussitôt : faudrait voir à ne pas attacher à ce que je consigne à présent trop d’importance ; cela donnerait à Benda trop beau jeu. Si j’ai désir de me contredire, je me contredirai sans scrupule : je ne chercherai pas la « cohérence ». Mais n’affecterai pas l’incohérence non plus. Il y a, par-delà la logique, une sorte de psychologique cachée qui m’importe, ici, davantage. J’ai soin de dire : « ici », car je ne puis supporter l’illogisme que momentanément et par jeu. Certes, rien de moins hilarant qu’un illogisme et je prétends ici m’amuser. Toutefois, sans la rigueur de raisonnement de Descartes, je reconnais que rien de solide ni de durable n’aurait pu être fondé. Mais cette partie serrée se joue sur un tout autre plan ; pour l’instant, ce n’est pas mon affaire. Et peut-être que, à mon âge, il est permis de se laisser aller un peu. Amen. (Ce qui veut dire, je crois : ainsi soit-il !)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
André Gide
Ainsi soit-il
ou
Les jeux sont faits
1952
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782383836735
Ainsi soit-il ouLes jeux sont faits
À ma fille
Catherine Jean Lambert.
Chitré, 24 juillet 1950.
Je ne sais ce que ça donnera : j’ai résolu d’écrire au hasard. Entreprise difficile : la plume (c’est un stylo) reste en retard sur la pensée. Or il importe de ne pas prévoir ce que l’on va dire. Mais il entre toujours une part de comédie là-dedans. On fait effort pour aveugler les phares. N’empêche qu’une sorte de radar intime avertisse…
Je viens de biffer quatre mots : c’est tricher. Tâcherai de ne pas recommencer… Ah ! j’en avertis aussitôt : faudrait voir à ne pas attacher à ce que je consigne à présent trop d’importance ; cela donnerait à Benda trop beau jeu. Si j’ai désir de me contredire, je me contredirai sans scrupule : je ne chercherai pas la « cohérence ». Mais n’affecterai pas l’incohérence non plus. Il y a, par-delà la logique, une sorte de psychologique cachée qui m’importe, ici, davantage. J’ai soin de dire : « ici », car je ne puis supporter l’illogisme que momentanément et par jeu. Certes, rien de moins hilarant qu’un illogisme1 et je prétends ici m’amuser. Toutefois, sans la rigueur de raisonnement de Descartes, je reconnais que rien de solide ni de durable n’aurait pu être fondé. Mais cette partie serrée se joue sur un tout autre plan ; pour l’instant, ce n’est pas mon affaire. Et peut-être que, à mon âge, il est permis de se laisser aller un peu. Amen. (Ce qui veut dire, je crois : ainsi soit-il !)
Je devais avoir à peu près quatorze ans lorsque je fis la connaissance de l’horreur. C’était place Saint-Sulpice ; laquelle, en ce temps, était pavée. À quelques mètres de moi passe un camion. Un gosse, d’une douzaine d’années, a trouvé le moyen de se faire trimbaler à l’œil en se juchant à l’arrière du véhicule, où le cocher ne puisse le voir. Il en a son content de ce voyage, veut descendre, saute, mais reste accroché par la blouse. De sorte que, son élan rompu, le voici qui retombe, brutalement tiré en arrière, donnant du front sur le pavé. Des passants, qui se sont rendu compte de l’accident, crient, gesticulent, tentent d’arrêter le conducteur, qui, lui, ne s’est rendu compte de rien et fouette son cheval au trot. De pavé en pavé le crâne du malheureux petit rebondit. En vain cherche-t-il à le protéger avec ses bras. Mais il a dû perdre connaissance presque aussitôt. Lorsque trente mètres plus loin le camion consent à s’arrêter (car quelqu’un s’est enfin jeté à la tête du cheval) le visage de l’enfant n’est plus qu’une sorte de bouillie sanglante…
(À l’âge que j’avais, je crois que cette horreur m’a fait beaucoup douter du bon Dieu. Par la suite on a beaucoup travaillé au replâtrage en moi de la divinité-providence. Et, de moi-même j’étais, tant bien que mal, parvenu à la restaurer. Au surplus ce n’est pas sur ce plan qu’elle est – ou que je la sens – la plus sujette à caution.)
Depuis ce temps nous avons été soûlés d’horreur à ce point que ce mince « fait divers » risque de faire hausser les épaules. Not worth mentioning, auprès des atrocités de la guerre, de ce grand chavirement de toutes les valeurs qui demeuraient pour nous des raisons de vivre…
J’ai fait connaissance d’un mot qui désigne un état dont je souffre depuis quelques mois ; un très beau mot : anorexie. De an, privatif, et oregomai, désirer. Il signifie : absence d’appétit (« qu’il ne faut point confondre avec dégoût », dit Littré). Ce terme n’est guère employé que par les docteurs ; n’importe : j’en ai besoin. Que je souffre d’anorexie, c’est trop dire : le pire c’est que je n’en souffre presque pas ; mais mon inappétence physique et intellectuelle est devenue telle que parfois je ne sais plus bien ce qui me maintient encore en vie sinon l’habitude de vivre. Il me semble que je n’aurais, pour cesser d’être, qu’à m’abandonner. Dans ce que j’écris ici, qu’on n’aille point voir du désespoir : mais plutôt de la satisfaction.
Je pèse chaque mot que j’écris ; m’en voudrais d’outrer ma pensée. Somme toute, la partie que je jouais, je l’ai gagnée. Mais j’ai cessé de m’y intéresser vraiment depuis que Em. m’a quitté. Depuis, il me semble souvent que je n’ai plus fait que semblant de vivre : elle était ma réalité. Peu importe si je ne me fais pas comprendre. Je ne me comprends pas moi-même tout à fait bien. C’est ainsi que je ne sais trop ce que j’entends par réalité. Pour elle, la réalité c’était un Dieu auquel je ne pouvais pas croire… J’ai cessé de chercher à comprendre quoi que ce soit.
Si ce que je viens d’écrire devait être cause de trébuchement ou de ralentissement de ferveur pour tel jeune homme qui me lirait, je déchirerais ces pages aussitôt. Mais je le prie de considérer mon âge et de s’ingénier à comprendre que ce n’est pas à quatre-vingts ans qu’on doit encore chercher à bondir – à moins que ce ne soit hors de soi. Qu’il cherche ailleurs, ce jeune homme, dans les écrits de ma jeunesse, des invitations à la joie, à cette exaltation naturelle dans laquelle j’ai longtemps vécu ; elles abondent. Mais à présent je ne les pourrais réassumer sans affectation. C’est l’affectation qui me rend insupportables tant d’écrits d’aujourd’hui, et parfois même des meilleurs. L’auteur y prend un ton qui ne lui est pas naturel. C’est là ce que je voudrais éviter. La sincérité doit précéder le choix des mots et le mouvement de la phrase ; elle n’a rien à voir avec le cynisme des aveux. Elle n’a pas de pire et de plus perfide ami que la complaisance. C’est celle-ci qui vient tout fausser. L’on ne saurait être contre soi-même trop sévère ; mais il y faut un long et patient entraînement.
Dans cette anorexie dont je viens de parler, je ne voudrais pas non plus me complaire. Hier, à Cabris où j’étais allé, de Nice, relancer les Herbart, j’ai soudain senti que, somme toute, je pouvais encore me sentir heureux de vivre et l’ai tout aussitôt déclaré à Pierre et à Élisabeth, et à Mme Théo, mon aînée de trois ou quatre ans. Nous étions assis tous quatre sous une treille non point si épaisse qu’on ne pût voir entre les larges feuilles de la vigne des rappels d’un azur profond. Les grappes qui pendaient de-ci, de-là, se gonflaient pour la prochaine vendange. L’air était à la fois chaud et léger. J’arrivais porteur d’heureuses nouvelles ; celle en particulier de la réimpression de mes Faux-monnayeurs dont j’ai cédé les droits à Élisabeth depuis longtemps. Or ce livre a fait partie du choix des douze meilleurs romans élus pour une nouvelle collection qui s’annonce assez importante. Pierre et Élisabeth me disaient leur satisfaction de voir enfin mise à sa place une œuvre que tous (ou presque) s’accordèrent à considérer comme manquée au moment de sa publication. Simplement elle ne répondait pas à ce que les critiques ont décrété que devaient être les lois du genre. Mais ici, comme tant d’autres fois, j’ai gagné en appel le procès que l’on me fit alors. Il en ira de même pour Corydon et pour Saül. Quant aux Caves du Vatican, j’attends avec une joyeuse impatience l’épreuve de la représentation au Français, cet automne. C’est même une des rares curiosités qui me rattachent encore à la vie.
D’un bout à l’autre, rien de plus inattendu que cette aventure : j’avais laissé Heyd réimprimer dans le tome VII (je crois) de mon Théâtre complet (fort surpris de le voir trouver de quoi remplir tant de volumes) une adaptation que j’avais faite de cette « sotie » sur la demande des « Bellettriens » de Lausanne ; puis j’avais cessé d’y penser… jusqu’au jour où (c’était l’été dernier) une chaleureuse lettre de Touchard, le très aimable administrateur actuel du Théâtre-Français, vint me relancer à Juan-les-Pins où je me languissais alors. (Et vraiment je n’en menais pas large.) Jean Meyer, m’apprenait-il, venait de découvrir la pièce, en avait aussitôt donné lecture aux sociétaires du théâtre ; d’où enthousiasme, acceptation à l’unanimité, projet de porter cette farce sur la scène au plus vite, c’est-à-dire : dès l’automne prochain. J’acceptai joyeusement. Touchard et Meyer, principal metteur en scène, vinrent me relancer à Juan-les-Pins. Entente parfaite. Pourtant certains passages restaient à revoir. Je promis de m’en occuper aussitôt. Et, quelques mois plus tard, Jean Meyer (qui se proposait d’assumer le rôle de Protos) vint à Taormina, où nous achevâmes ensemble de tout mettre au point. Il se montra satisfait des quelques scènes que j’avais composées entre-temps, lesquelles devaient donner plus d’importance au rôle de l’héroïne.
Car, si déjà je souffrais de cette anorexie (sur laquelle je me propose de revenir), si je me sens vieux et comme déjà hors d’usage, je ne pense pas que mes facultés intellectuelles aient beaucoup faibli ; de sorte qu’il suffisait de cette occasion pour les remettre en marche. Et maintenant j’attends, à Nice, un appel de Touchard, fort désireux d’assister aux premiers essais, à la prise de contact de chaque acteur avec son rôle, sachant qu’il est trop tard pour intervenir lorsque les plis sont déjà formés.
Je racontais à Jean Meyer ce qui s’était passé pour Perséphone, lorsque, convoqué par Ida Rubinstein dans son charmant hôtel de la place des États-Unis, je me heurtai à l’entente parfaite d’Ida, de Stravinski, de Copeau, tous trois néophytes, et de Barsacq, le metteur en scène, qui naturellement emboîtait le pas.
« Vous comprenez, disait mon ami Copeau, il s’agit de ne pas présenter au public l’action du drame elle-même. Nous devons procéder par allusions.
— Oui, s’écriait alors Stravinski, c’est comme la messe. Et c’est là ce qui me plaît dans votre pièce. L’action même doit être sous-entendue…
— Alors j’ai imaginé, reprenait Copeau, que tout pourrait se passer dans un même lieu, grâce à un récitant qui n’apporterait des faits eux-mêmes que le récit, que le reflet. Tout dans le même lieu : un temple, ou mieux : une cathédrale… »
Je me sentis perdu, car Ida et Stravinski approuvaient à l’envi.
« Mais, cher ami, tentai-je encore d’objecter : j’ai pourtant indiqué fort précisément, pour le premier acte : un rivage au bord de la mer…
— Oui, c’est ce qu’indiquera le récitant.
— C’est merveilleux, disait Ida.
— Et le second acte, qui doit se jouer aux Enfers. Comment, dans votre cathédrale…
— Cher ami, nous avons la crypte », reprit Copeau avec une telle assurance que, le soir même, lâchant la partie, je m’embarquai pour Syracuse où retrouver le décor antique, celui précisément que je souhaitais.
Je crois que Stravinski me pardonna mal de ne pas avoir assisté à la première exécution de sa très belle partition ; mais c’était au-dessus de mes forces. La musique, je crois, fut applaudie ; quant au sujet même du drame, le public n’y comprit rien, il va sans dire, et pour cause. Si jamais l’on s’avise de reprendre ce « ballet » (et la partition de Stravinski mérite que l’on y revienne), je prie le metteur en scène de se conformer strictement aux indications que j’ai données. Si la voix de l’actrice porte un peu plus que ne fit celle de Rubinstein (laquelle, me dit-on, ne passait pas le septième rang de l’orchestre), je crois pouvoir répondre du succès.
L’on s’est montré fort injuste à l’égard d’Ida Rubinstein. La ballerine chez elle a fait tort à la tragédienne et cette immense fortune qu’elle déployait souvent en dépit de tout bon sens. Ceux qui comme moi eurent le bonheur de l’entendre dans le quatrième acte de Phèdre (c’était lors d’une unique représentation dite de « charité » au théâtre Sarah Bernhardt), peuvent témoigner qu’elle y fut incomparable. Je ne pense pas avoir jamais entendu les alexandrins dits aussi bien que par elle. Jamais les vers de Racine ne m’avaient paru plus beaux, plus pantelants, plus riches d’une ressource cachée. Et rien, ni dans le costume ni dans les attitudes, ne venait à l’encontre de cette extraordinaire et quasi surhumaine harmonie… Tout cela sombre dans le passé. Décidément je n’aime pas le théâtre : il y faut trop concéder au public et le factice l’emporte sur l’authentique, l’adulation sur le sincère éloge. L’acteur en vient trop vite à préférer à Racine Sardou et les applaudissements du grand nombre des incultes à ceux du petit nombre des connaisseurs. Arrêtons : j’en aurais trop à dire. Je reviens à l’anorexie.
Je suis peu sensible aux plaisirs de la table ; de moins en moins ; rassasié après douze bouchées ; sans doute un peu difficile pour la qualité du beurre et du pain ; quant à la viande, est-elle filandreuse ou mal cuite, je préfère me passer de dîner. Le meilleur vin, je l’aime autant coupé d’eau ; mieux même ; à la française, selon Montaigne, au grand scandale de mes amis. Quand je suis seul du moins, les restaurants célèbres me font fuir.
Mme Théo m’a raconté qu’un Belge vint à mourir sans héritiers directs, qui devait laisser, pensait-on, une fortune assez rondelette. Cousins et neveux, rassemblés dans l’étude du notaire, attendaient impatiemment la lecture du testament. À la grande surprise de chacun, le notaire déclara que le défunt ne laissait rien ; tout juste de quoi payer les frais d’inhumation une fois les dettes réglées. Alors on s’étonna : à quels feux secrets avait pu fondre cette fortune ? On finit par découvrir dans le tiroir d’un secrétaire la collection des menus fins que l’oncle s’offrait quotidiennement chez les plus réputés traiteurs de Bruxelles. La fortune y avait passé. « Si ce n’est pas honteux ! » s’étaient écriés les cousins frustrés. Puis la séance s’acheva sur un immense éclat de rire.
J’ai dû me rendre à l’évidence : je suis de naturel avare (je dois tenir cela de mes ancêtres normands) et avec cela je me reconnais généreux. Comprenne qui pourra… Et pourtant je crois l’explication assez simple : c’est pour moi-même ; pour mes aises propres que je répugne à la dépense. Du reste, avec l’âge, j’ai quelque peu changé : la fatigue m’y invitant je me traite avec plus d’égards. Au surplus le sentiment de la valeur de l’argent me fait à ce point défaut qu’il m’arrive couramment d’allonger des billets de mille alors que ceux de cent suffisent. Mais c’est d’anorexie que je me proposais de parler.
Cette inappétence est intellectuelle autant que physique. J’ai grand mal à m’intéresser à ce que je lis. Au bout de vingt pages, le nouveau livre me tombe des mains ; et je reviens à Virgile, qui ne m’offre plus précisément de surprise, mais du moins un constant ravissement.
C’est un état très nouveau que je peins, où je me reconnais à peine. Oui, j’avais su préserver en moi (et tout naturellement ; je veux dire : sans artifice) jusqu’aux approches de ma quatre-vingtième année, une sorte de curiosité, d’allégresse presque fringante, que j’ai peinte du mieux que j’ai pu dans mes livres et qui me faisait m’élancer vers tout ce qui me paraissait digne d’amour et d’admiration ; en dépit des déconvenues. L’inhibition que je ressens aujourd’hui ne vient ni du monde extérieur, ni des autres, mais de moi-même. Par sympathie je me suis longtemps maintenu en état de ferveur. Lorsque je voyage, c’est avec un compagnon jeune ; je vis alors par procuration. J’épouse ses étonnements et ses joies… Je crois que je serais encore capable de certaines ; c’est de moi-même que, progressivement, je me désintéresse et me détache. Toutefois je reste encore extrêmement sensible au spectacle de l’adolescence. Au surplus j’ai pris garde de ne laisser point s’endormir mes désirs, écoutant en ceci les conseils de Montaigne qui se montre particulièrement sage en cette matière : il savait, et je sais aussi, que la sagesse n’est pas dans le renoncement, dans l’abstinence, et prend soin de ne pas laisser tarir trop vite cette source secrète, allant même jusqu’à s’encourager vers la volupté, si je l’entends bien… N’empêche que mon anorexie vient aussi, vient surtout, d’un retrait de sève, force est bien de le reconnaître. Même à quatre-vingts ans on n’avoue pas volontiers ces choses-là. Le roi David avait sans doute à peu près mon âge lorsqu’il conviait la toute jeune Abishag à venir réchauffer sa couche. Ce passage, ainsi que nombre d’autres de la Bible, gênerait grandement les commentateurs, si ceux-ci ne savaient y chercher, y trouver, une interprétation mystique – laquelle ne me saute pas aux yeux.