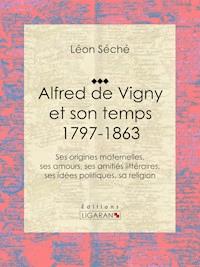
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Alfred de Vigny qui dans son Journal s'est étendu si longtemps sur la généalogie et les parchemins de la famille de son père, n'a rien dit ou presque rien des origines et des titres de noblesse de sa famille maternelle. C'est à peine s'il consacre dix lignes à son aïeul, le vénérable marquis de Baraudin, qui fut chef d'escadre dans la marine de Louis XVI. Encore est-ce uniquement pour nous apprendre que « ce vieux capitaine de dix vaisseaux, que les combats... »"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054927
©Ligaran 2015
à M. HENRY FERRARI
Directeur de la Revue Bleue
Mon cher ami,
Personne ne s’étonnera que je vous dédie ce livre : il est à vous autant qu’à moi, car peut-être serait-il encore au fond de mon encrier si, après avoir publié dans la Revue Bleue les chapitres qui ont trait aux amours d’Alfred de Vigny, vous ne m’aviez engagé à vous en donner quelques autres sur ses amitiés littéraires. À la vérité, j’y pensais depuis longtemps ; je le portais en moi depuis que j’avais cru m’apercevoir que Vigny, comme penseur et comme chrétien, était de la lignée des « Derniers Jansénistes », mais plus j’y réfléchissais, moins je savais par quel bout le prendre.
Tout avait été dit ou à peu près par Sainte-Beuve, Jules Janin, Th. Gautier, et plus récemment par MM. Brunetière, Emile Faguet, Jules Lemaître, sur le poète, le romancier, le philosophe, le dramaturge d’occasion que fût de Vigny. Il eût été oiseux et prétentieux d’y revenir. Restait l’homme privé, en robe de chambre et en pantoufles. Encore avait-il été l’objet d’un commencement d’étude de la part de M. Louis Ratisbonne et de M. Maurice Paléologue. Mais le premier, en publiant le Journal d’un Poète, n’avait fait qu’entrebâiller la porte de la fameuse « tour d’ivoire », et le second ne connaissait, quand son livre parut, ni l’Histoire d’une Âme, ni les lettres de Vigny à sa cousine du Plessis, à Mlle Maunoir, à Bungener et autres, ni les détails circonstanciés de sa fin douloureuse.
La vie de l’auteur des Destinées était donc encore à écrire ou tout au moins à mettre à jour. C’est à ce dernier parti que je m’arrêtai, estimant que l’homme et son œuvre, alors même que, selon l’expression de Vigny, aucun de ses poèmes n’aurait dit toute son âme, forment un tout indivisible, et que pour porter un jugement définitif sur un écrivain qui a mis beaucoup de son sang dans ses livres, il est indispensable de connaître le fonds et le tréfonds de sa vie privée. Et qu’on ne se récrie pas ! je sais tous les inconvénients du genre et qu’on ne doit pas, comme dit Montaigne, « guetter les grands hommes aux petites choses. » Mais il y a des petites choses qui sont de véritables traits de caractère, et c’est pour cela même que j’en ai relevé un certain nombre dans les chapitres où je me suis occupé des rapports de Victor Hugo et de Sainte-Beuve avec Alfred de Vigny. Je ne crois pas, d’ailleurs, avoir excédé mon droit de critique en promenant ma lanterne sourde dans les coins les plus mystérieux de la vie du poète et, si j’ai pénétré jusque dans son alcôve, j’ai fait en sorte de ne dire que ce qu’il fallait dire. Je n’ai point voulu spéculer sur les faiblesses de l’homme, encore moins diminuer le prestige du dieu. Je n’ai agi que dans l’intérêt de la vérité. Pourtant je mentirais en disant que je n’ai éprouvé aucune jouissance à découvrir dans la vie d’Alfred de Vigny ce qu’il avait pris tant de soin de nous cacher. La curiosité et l’indiscrétion ne sont pas des péchés purement féminins ; c’est également, le moindre défaut du critique qui veut être bien averti, et je confesse que de ce chef mon livre n’est pas exempt de reproche, mais on reconnaîtra, j’espère, que je n’ai pas poussé l’indiscrétion jusqu’au scandale et qu’en somme Alfred de Vigny sort à son honneur et à son avantage de l’épreuve analytique à laquelle je l’ai soumis.
Il écrivait un jour à Sainte-Beuve, au début de leurs relations, qu’il avait « créé une critique haute qui lui appartenait en propre et que sa manière de passer de l’homme à l’œuvre et de chercher dans ses entrailles le genre de ses productions, était une source intarissable l’aperçus nouveaux et de vues profondes ». Eh bien ! dans ce livre comme dans ceux qui l’ont précédé, je me suis inspiré de la méthode que Sainte-Beuve a expérimentée avec tant de bonheur dans son Port-Royal et dans ses Lundis. J’ai appliqué à ma critique littéraire les principes mêmes de la critique historique. Je n’ai rien avancé que je ne pusse prouver. Je suis allé, aussi moi, de l’homme à l’œuvre. J’ai commencé par m’enquérir des origines maternelles du poète, et l’on verra que cette enquête n’était pas inutile. J’ai cherché ensuite autour de Vigny les femmes qu’il avait aimées, les hommes qu’il avait fréquentés, les milieux qu’il avait traversés, les livres qu’il avait lus, les influences diverses qu’il avait exercées ou subies, les causes et les effets de ses liaisons et de ses ruptures. Après avoir visité sa ville et sa maison natales, j’ai voulu voir la thébaïde où il s’était renfermé quatre ans durant, après les journées de Juin, et d’où sont sorties les Destinées. Je me suis appliqué à lire dans son âme par-delà le blanc et le noir des pages de sa grande écriture, à démêler dans sa correspondance le sentiment précis, l’idée maîtresse, l’état d’esprit dans lesquels il avait conçu et écrit certains de ses ouvrages. Et j’ai reconstitué ainsi, du commencement à la fin, sa vie morale et intellectuelle, en ayant soin d’éviter l’écueil où. Sainte-Beuve échoua souvent et qui consiste à battre l’homme sur le dos de l’œuvre.
Mais que de fois, pendant que j’écrivais tel ou tel chapitre, ne me suis-je pas dit : « Si Sainte-Beuve avait connu cette lettre et ce document, quel parti il en aurait tiré ! C’est que véritablement il n’y a que lui pour s’entendre à déshabiller les gens et à mettre leur âme à nu ! Quand il eut publié son livre sur Chateaubriand et son groupe littéraire, il mandait à un ami : « J’ai tenu à mesurer exactement l’écrivain et à le maintenir plus grand qu’aucun de notre âge. Quant à l’homme, je lui ai tiré le masque avec quelque plaisir, je l’avoue. » Après cela je suis sûr que, s’il avait connu les lettres de Vigny à Mme Dorval, s’il en avait tenu les originaux dans ses mains, il aurait éprouvé le même plaisir à lui tirer le masque, à lui aussi. Et cependant, lorsqu’on les lira, m’est avis que, loin de se retourner contre lui, ces lettres plaideront plutôt en sa faveur. Ce fut la première impression que j’éprouvai chez M. Bégis, lorsque l’érudit collectionneur me permit d’en prendre copie dans son cabinet. C’est également celle que je me suis efforcé de rendre. Qu’on ne me reproche donc pas d’avoir publié ces lettres ! en conscience, je crois avoir servi plutôt qu’offensé la mémoire du poète, car il n’y a pas d’intrigue amoureuse qui ait donné lieu à plus de racontars désobligeants, et c’est tout juste si, sous le manteau de certaines cheminées littéraires, on n’accusait pas Vigny d’avoir fermé les yeux pour ne pas voir la honte dont, à un certain moment, sa maîtresse infidèle le couvrit au grand jour. Pauvre femme ! Dieu me garde de lui jeter la pierre ! la nature lui avait donné des sens que ne purent jamais dominer le cœur qui était bon, ni l’esprit qui allait parfois aussi haut que son art. Et il doit lui être beaucoup pardonné, non seulement parce qu’elle a beaucoup aimé, mais parce que, si elle fit le malheur de Vigny, elle fit de lui aussi un très grand poète. Qui sait, en effet, s’il eût produit, sans le baiser de cette Melpomène romantique, et Quille pour la peur et Chatterton et les merveilleuses pièces des Destinées ! En tout cas, il est certain qu’il n’eût jamais écrit la Colère de Samson, ce qui prouve une fois de plus que l’homme est inséparable de son œuvre et qu’à vouloir juger l’une sans connaître l’autre on risque de rendre des sentences susceptibles d’appel et de cassation.
Aussi bien, la passion de Vigny pour Dorval, bien qu’elle n’ait été qu’un accident dans sa vie, projette sur toute son existence une lumière qui peut servir de phare à l’historien.
Quand on regarde ce beau visage de marbre, ces beaux yeux d’un bleu tendre et dont la froideur calme semble le reflet d’une âme pure et sereine, on pense involontairement au mot que prononça Dumas le jour où Mme Dorval, pour mettre fin à ses obsessions, lui écrivit : « Aimez-moi comme M. de Vigny. » On se dit qu’avec un tel masque, cet homme ne dut vivre que de la vie des anges. Mais le proverbe est là qui vous conseille de ne pas vous fier à l’eau qui dort. Et le fait est que l’auteur d’Eloa n’eut d’angélique que la figure. Je ne crois pas, quant à moi, qu’il y ait jamais eu au monde un homme plus passionné que lui et dont le cœur ait été battu de plus d’orages !…
Examinons sa vie : on peut la diviser en trois parties inégales. La première s’étend de 1815 à 1830 ; la seconde de 1830 à 1810 ; la troisième de 1840 à 1863, date de sa fin.
La première partie est la phase des élévations et du rêve. Alfred de Vigny a été voué à l’armée par sa mère, mais ce n’est point sa vocation. Il vit à l’écart au régiment ; il préfère à la société des officiers, ses camarades, celle d’un simple soldat de sa compagnie qui, comme lui, cultive les Muses ; il lit la Bible, il lit Milton, lord Byron et Thomas Moore ; le problème de la chute de l’homme le préoccupe, il écrit le mystère d’Eloa, il monte avec Moïse au sommet du Sinaï, et quand il en redescend, il est moins troublé de la vision de Dieu, que désenchanté et lassé, comme lui, du poids du jour. Il se marie et donne presque aussitôt sa démission de capitaine pour recouvrer sa liberté.
La seconde partie est la phase de l’action et de l’amour. Il aborde la scène en même temps qu’il tombe amoureux d’une femme de théâtre. C’est pour elle qu’il traduit Othello, qu’il compose la Maréchale d’Ancre ; c’est par elle que son Chatterton monte aux nues. La magicienne qui lui a pris le cœur lui a révélé du même coup sa vraie vocation et sa vraie nature. Il avait, en effet, au plus haut degré le sens du théâtre, et comme l’a remarqué Auguste Barbier, plus clairvoyant en cela que Sainte-Beuve, « il faut voir surtout en lui un dramatique ; il l’est toujours et partout ; ses moindres pièces sont composées dramatiquement, ses romans, ses contes et ses poèmes sont des drames, drames d’analyse si l’on veut, mais des drames ». Mais s’il avait le don du théâtre, il avait aussi le don de l’amour. « Aimer, inventer, admirer », voilà ma vie, disait-il. Cela prouve qu’il se connaissait. Il a aimé sous toutes les formes et de toutes les manières : avec sa tête, avec son cœur, avec ses sens. Il a aimé sa mère comme une idole, sa femme comme un enfant, sa maîtresse comme un fou, ses amis comme un ami véritable. Et quand il eut perdu par la mort et la trahison sa mère et sa maîtresse, son cœur triste et meurtri se prit d’une immense pitié pour l’homme, son « compagnon de chaîne et de misère », et c’est à le servir, à le relever, à le soulager qu’il se consacra tout entier.
Puis vient la phase de l’ambition, suivie bientôt du renoncement à tout. Lorsque la Révolution de 1848 éclate, l’idée lui prend qu’avec son grand nom il pourrait remplir un grand rôle sur la scène politique. Il se porte à la députation et il échoue piteusement ; il sollicite le poste d’ambassadeur à Londres, et on lui répond qu’il n’est pas républicain. L’Empire arrive : il rêve à ce moment d’entrer au Sénat et puis d’être le précepteur du prince impérial. Mais il n’est pas plus heureux sous l’Empire que sous la République. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas l’étoffe d’un courtisan et qu’ayant conscience de sa valeur, il attend tranquillement qu’on vienne le chercher. Alors, en désespoir de cause, il achève de se replier sur lui-même, il s’enfonce de plus en plus dans la méditation ; la maladie aidant, il devient misanthrope, et le chrétien qu’il n’avait cessé d’être, en dépit des apparences contraires, montre le bout de l’oreille janséniste…
Oui, janséniste ! C’est un point de vue sous lequel personne jusqu’ici ne l’a encore étudié et qui de prime abord peut sembler paradoxal, mais que je tiens pour absolument vrai. On lira le chapitre que j’ai consacré à la religion de Vigny, et ceux qui ont quelque connaissance du sujet me diront si je me suis abusé. Les autres auront peut-être la curiosité de l’approfondir. Je l’espère sans trop y compter, car le sujet est bien aride, et la question de la grâce suffisante et efficace qui mit en l’air tout le XVIIe siècle et conduisit l’Église de France du XVIIIe siècle à deux pas du schisme, est abandonnée depuis longtemps par les amateurs de ces sortes de controverses.
Je prétends donc que Vigny était janséniste, mais je m’empresse d’ajouter qu’il l’était à sa manière. Il avait surtout l’attitude et l’accent, et sa religion de l’honneur, je ne sais pas s’il s’en rendait bien compte, n’était pas autre chose que du jansénisme dévoyé ou simplifié, un jansénisme sans culte et qui n’aurait pour toute chapelle que le for intérieur. C’est même par là qu’il avait attiré mon attention. Son Journal et quelques-unes de ses lettres me fortifièrent dans cette croyance. Quand je sus que l’abbé de Baraudin, qui fut le précepteur de la mère du poète, était imbu de l’esprit janséniste et que Vigny avait au Maine-Giraud, dans sa petite bibliothèque ; l’exemplaire des Lettres de morale et de piété de l’abbé du Guet, qui avait appartenu à son grand-oncle, mes derniers doutes se dissipèrent, et je suis sûr que s’il avait pu lire le manuscrit de ses Pensées, Royer-Collard qui lui fit un accueil si froid, quand il se présenta à l’Académie française, lui aurait ouvert les bras en lui disant que sous son pessimisme outré il avait reconnu l’esprit chrétien de Port-Royal, mais affranchi du joug du dogme. Il est même surprenant que Sainte-Beuve, qui avait lu son Journal, ne se soit pas douté de ses attaches jansénistes. Car le jansénisme des derniers jours frisa singulièrement le « libertinage » où échoua Vigny ; aussi, tout en trouvant que le poète des Destinées a certaines affinités avec Pascal et Racine, n’oserais-je pas dire qu’il eut leur état d’âme. Leur mort seule suffirait à établir entre eux une ligne de démarcation qu’on ne saurait franchir sans tomber dans le paradoxe : Racine et Pascal moururent en catholiques fervents et contrits. Vigny mourut en chrétien résigné, j’allais dire désabusé. Il n’appela pas le prêtre à sa dernière heure, il l’attendit, il le subit presque, et s’il se confessa, ce fut moins pour remplir un devoir que pour témoigner ainsi qu’il mourait dans la religion de sa mère, dans le sein de l’Église catholique, apostolique et romaine. À présent, qui sait si Pascal et Racine n’auraient pas fini comme Vigny, s’ils avaient vécu au XIXe siècle ?…
Je m’arrête sur ce point d’interrogation. Mais avant de terminer cette lettre, je vous demande, mon cher ami, la permission de remercier toutes les personnes qui m’ont aidé dans la composition de ce livre.
Je serais ingrat si je n’adressais pas des remerciements particuliers à M. Archambault qui m’a si obligeamment communiqué les recherches de son père sur la généalogie de la famille maternelle de Vigny ; à M. Bégis qui a mis si gracieusement à ma disposition les lettres du poète à Mme Dorval ; à M. Paul Meurice qui m’a donné la primeur de l’article de Victor Hugo sur Cinq-Mars, à M. Bungener qui m’a envoyé de Genève la belle lettre de Vigny à son père ; à M. Maunoir et M. S. qui m’ont permis de reproduire les traits de Mlle Maunoir, de Mme de Vigny et de Mme Lachaud ; à Mme Camin qui m’a remis toute la correspondance d’Emile Péhant, son père, avec Alfred de Vigny, Ponsard et Victor de Laprade ; à M. de Lovenjoul qui, avec sa complaisance ordinaire, m’a signalé tout ou à peu près tout ce qui avait paru de Vigny ou sur Vigny dans les journaux et les revues depuis plus de soixante-dix ans ; à M. L.-Xavier de Ricard qui m’a documente sur son oncle Guillaume Pauthier ; à M. Ducloud, enfin, et à sa famille qui m’ont fait si aimablement les honneurs du Maine-Giraud au mois de septembre dernier.
Toutes ces personnes ont été pour moi, mon cher ami, de véritables collaborateurs. Il est donc tout naturel que j’inscrive leurs noms au-dessous du vôtre au frontispice de ce livre qui leur devra la meilleure part de son succès.
Léon SÉCHÉ.
Pont-Rousseau
La famille de Baraudin. – Le chef d’escadre de Baraudin et son fils, Louis, fusillé à Quiberon. – Une erreur d’Alfred de Vigny. – Acte mortuaire du marquis de Baraudin. – Les armoiries des Vigny et des Baraudin. – Emmanuel Baraudini. – Pourquoi il fut anobli par François Ier. – Les lieutenants du roi à Loches du XVIe siècle à la Révolution. – Comment le père d’Alfred de Vigny épousa en 1790 une demoiselle de Baraudin. – Leur contrat de mariage et les apports de chacun d’eux. – L’abbé Jaques-Louis de Baraudin, vicaire général de Tours et chanoine-doyen de l’église Saint-Ours a, Loches. – Naissance d’Alfred de Vigny, rue de Gesgon à Loches, le 27 mars 1797. – Situation des Vigny et des Baraudin sous la Révolution. – Arrestation et mise en liberté successives de Léon de Vigny, de sa femme et de son beau-père, le chef d’escadre de Baraudin. – Précieuse intervention dans la circonstance du conventionnel Boucher-Saint-Sauveur. – Lettre inédite de Boucher-Saint-Sauveur à l’agent national de la commune de Loches. – M. et Mme de Vigny perdent leurs trois premiers enfants. – Ils viennent habiter Paris dix-huit mois après la naissance d’Alfred. – Alfred de Vigny et la Touraine. – Sa cousine Alexandrine du Plessis. – Le castel de Dolbeau. – Comment Alfred de Vigny devint Tourangeau. – Une lettre inédite du poète à son cousin de Lestang, – Les parents de Vigny en Touraine. – Le château de Loches, les monuments et l’histoire de cette petite ville. – Comme quoi Vigny n’y alla jamais. – Les gloires littéraires de la Touraine : Rabelais, Descartes, Balzac, Alfred de Vigny. – Tableau, généalogique de la famille de Baraudin dressé par M. Archamhault, ancien notaire de Loches.
Alfred de Vigny qui dans son Journal s’est étendu si longuement sur la généalogie et les parchemins de la famille de son père, n’a rien dit ou presque rien des origines et des titres de noblesse de sa famille maternelle. C’est à peine s’il consacre dix lignes à son aieul, le vénérable marquis de Baraudin, qui fut chef d’escadre dans la marine de Louis XVI. Encore est-ce uniquement pour nous apprendre que « ce vieux capitaine de dix vaisseaux, que les combats, sous M. d’Orvilliers, avaient respecté, fut tué en un jour dans la prison de Loches par une lettre de son fils. Cette lettre, écrit-il, était datée de Quiberon. Le frère de ma mère, cet oncle inconnu de moi dont j’ai un portrait peint par Girodet, était lieutenant de vaisseau, et, blessé au siège d’Auray, en débarquant avec M. de Sombreuil, il demandait à son père sa bénédiction, devant être fusillé le lendemain. Son adieu tua son père un jour après que la balle l’eut tué. »
Certes cet évènement tragique, avec son douloureux contrecoup, avait de quoi frapper l’imagination d’un enfant, et je conçois qu’Alfred de Vigny en ait gardé le triste souvenir ; malheureusement pour la légende qu’il a accréditée, de bonne foi sans doute, mais trop légèrement tout de même, l’évènement n’était vrai qu’à moitié.
S’il est vrai que Louis de Baraudin fut fait prisonnier à Quiberon, jugé et passé par les armes comme la plupart des compagnons de Sombreuil, il est, faux que son père soit mort dans la prison de Loches en apprenant son exécution. Il résulte en effet, des documents ci-dessous, que l’ancien chef d’escadre Didier de Baraudin, qui avait été arrêté comme suspect en 1794, fut mis en liberté par arrêté du comité de sûreté générale en date du 24 frimaire an III et mourut le 29 fructidor an V, au domicile particulier du citoyen Vidal, situé rue des Ponts, à Loches.
Quoi qu’il en soit, Alfred de Vigny, s’il s’en était donné la peine, aurait pu trouver dans l’histoire des de Baraudin des faits de guerre bien autrement glorieux que celui de Quiberon, et dans leur lignée, des ancêtres qui, pour n’avoir point eu leurs portraits peints par des Girodet, n’en commandent pas moins l’admiration et le respect.
Et il faut que le poète de l’Esprit pur ait été laissé par sa mère dans l’ignorance complète des faits et gestes de ces de Baraudin, pour avoir gardé à leur endroit un si profond silence. Car, tout bien pesé, les hommes et les œuvres, les de Baraudin valaient pour le moins autant que les de Vigny.
Si les de Vigny étaient de père en fils écuyers et chevaliers de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, les de Baraudin en avaient autant à leur service. Et la noblesse des premiers ne remontait pas plus haut que celle des seconds.
François de Vigny fut anobli par Charles IX en 1570 « pour les louables et recommandables services faits aux rois, ses prédécesseurs, et à lui-même en plusieurs charges honorables et importantes. »
Emmanuel de Baraudin reçut en 1512 du prince Charles III, duc de Savoie, dont il était secrétaire des lettres d’anoblissement qui furent confirmées par François Ier, roi de France, le 3 mars 1543, peu de temps après qu’il eut obtenu ses lettres de naturalisation, car il était originaire du diocèse d’Yvrée en Piémont et son vrai nom était Baraudini.
Et Alfred de Vigny, qui se croyait personnellement l’obligé des Valois bien plus que des Bourbons, depuis qu’il avait remarqué que tous ses ancêtres, à dater de 1570, avaient vécu paisiblement et sans ambition dans leurs terres d’Emerville, Moncharville et autres lieux, chassant le loup, se mariant et créant des enfants, après avoir poussé leurs services militaires justement au grade de capitaine où ils s’arrêtaient pour se retirer chez eux avec la croix de Saint-Louis, selon la vieille coutume de la noblesse de province, – Alfred de Vigny aurait senti s’accroître sa reconnaissance envers les Valois, s’il, avait su que, depuis 1540 jusqu’aux approches de la Révolution, les de Baraudin avaient occupé le poste de lieutenant du roi au château de Loches, que François Ier avait confié au chef de leur maison.
Sans compter que ce titre de lieutenant du roi n’était pas à dédaigner. Il y a dans les archives de Loches un acte de 1760 où le gouverneur du château qui était un Baraudin est qualifié de vice-roi. Cela ne veut pas dire que ces fonctionnaires royaux étaient les seigneurs et maîtres de la ville. Non ; ils n’y pouvaient même pas exercer, comme les chanoines du chapitre ou comme certains abbés et prieurs des environs, les droits de haute, moyenne ou basse justice, mais ils avaient le pas sur tous les fonctionnaires civils dans les cérémonies publiques, et l’épée qu’ils avaient au côté leur permettait de cumuler de loin en loin le poste recherché de commissaire des guerres, de commissaire provincial de l’artillerie de France, ou le grade de capitaine d’infanterie, de capitaine de dragons ou de capitaine de vaisseau.
J’ai dit que la famille de Baraudin était sortie d’Emmanuel Baraudini, du diocèse d’Yvrée en Piémont.
Dès l’année 1542, cet Emmanuel Baraudin était « eslu pour le Roy à Loches » avec la qualification de noble homme et le titre de seigneur de la Cloutière.
Et sa maison qui, dans la suite, s’allia aux Dalonneau, aux Gaberot, aux Rocher, aux Ménard, aux de Bougainville, aux d’Oyvon, aux Riencourt, fournit quatre lieutenants du Roy pour le château de Loches, savoir :
1° Honorat de Baraudin, écuyer, de 1559 à 1571 ;
2° Honorat de Baraudin, chevalier, seigneur des Bournais, commissaire provincial de l’artillerie de France, en 1709 ;
3° Louis de Baraudin, chevalier, seigneur de Mauvières, le Plessis-Savary, Mantelais et autres lieux, de 1712 à 1750 ;
4° Enfin Louis-Honorat de Baraudin, époux de Marie-Françoise-Charlotte de Bougainville, de 1750 à 1769, date d’une vente de meubles consentie par sa veuve à Jacques-Louis de Baraudin, vicaire général du diocèse de Tours, chanoine doyen de l’église collégiale de Saint-Ours, à Loches, prieur commendataire de Villiers, frère du chef d’escadre Didier de Baraudin, qui fut l’aïeul maternel d’Alfred de Vigny.
Ce Didier de Baraudin, qui fut le personnage le plus marquant de la famille, fit une belle carrière dans la marine. Enseigne de vaisseau en 1754, capitaine en 1784, ayant commandé à cette époque le vaisseau le Réfléchi de 64 canoms, chef d’escadre des armées navales du Roi, avant 1790, il avait épousé une demoiselle Jeanne-Pernelle de Nogerée, de qui il avait eu un fils, celui qui fut passé par les armes à Quiberon, et deux filles : Marie-Elisabeth-Sophie, qui devint chanoinesse de Saint-Antoine de Malte, et Marie-Jeanne-Amélie, qui épousa Léon-Pierre de Vigny.
À ce propos je m’étais demandé par suite de quelles circonstances Léon-Pierre de Vigny, père du poète, qui habitait ordinairement Paris, rue Beaubourg, paroisse de Saint-Nicolas-des Champs, était venu prendre femme à Loches. M. Archambault, notaire en cette ville, dont le fils a bien voulu me communiquer le dossier qu’il avait réuni, à force de patientes recherches, sur la famille de Baraudin, M. Archambault, dis-je, en a donné une raison qui me semble péremptoire.
Quand le père d’Alfred de Vigny sollicita la main de Mlle de Baraudin, il avait perdu ses père et mère, et sa sœur unique s’était alliée à la famille de Thienne dont le nom figure sur les registres de l’état civil de Loches, depuis le commencement du XVIIe siècle. Son contrat de mariage fut fait en présence de Dame Adélaïde-Elisabeth-Pauline de Vigny, épouse de messire Louis-Gaëtan de Thienne, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, sœur du futur époux. C’est évidemment Mme de Thienne, qui attira son frère en Touraine et se chargea de le marier.
La future épouse, Mlle Marie-Jeanne-Amélie de Baraudin, avait, elle aussi, quitté le manoir du Maine-Giraud, sis paroisse de Champagne en Angoumois, où elle habitait avec son père et sa mère, pour aller à Loches achever son éducation sous la tutelle de son oncle, le chanoine doyen de l’église collégiale de Saint-Ours. Et c’est à cette circonstance qu’elle dut de se rencontrer avec Léon-Pierre de Vigny.
Leur contrat de mariage, passé au château de Loches, le 20 avril 1790, en la maison décanale de l’abbé de Baraudin, va nous faire connaître les apports de chacun d’eux. Ces apports étaient des plus modestes. Les époux se mariaient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les biens et les droits de Vigny, consistant en meubles et effets mobiliers, étaient estimés 30 000 livres.
D’immeubles il n’était pas question.
Le marquis de Baraudin constituait à sa fille, une dot de 20 000 livres pour le remploi de laquelle somme il lui cédait, déléguait et transportait sous les garanties de droit :
1° Le lieu et la métairie du Puy, situé paroisse du Liège (Indre-et-Loire) avec ses appartenances et toutes ses dépendances ;
2° Une somme principale de 3 900 livres, du chef de Mlle de Baraudin et à elle due par M. de Clérambault, de la ville de Meslay.
Trois mille livres étaient mises en communauté ; les propres, étaient réservés, faculté était accordée à la future épouse de renoncer à la communauté, et les époux se faisaient donation réciproque.
Le mariage fut célébré deux jours après dans l’église collégiale du château de Loches, et la bénédiction nuptiale donnée par l’abbé de Baraudin. Après quoi, M. et Mme de Vigny s’installèrent rue de Gesgon, sise au bas de la ville, dans une maison, modeste comme leur fortune, et qui est habitée aujourd’hui par M. Enault, notaire
C’est là qu’Alfred de Vigny vint au monde, le 27 mars 1797.
Mais sa naissance avait été précédée d’évènements domestiques que je ne puis passer sous silence.
Dès l’année 1793, trois ans à peine après leur mariage, M. et Mme Léon de Vigny avaient été en butte aux tracasseries du district révolutionnaire de Loches. Mme de Vigny, qui avait eu deux enfants coup sur coup et était à peine relevée de ses dernières couches, avait dû se présenter le 4 juillet de cette année devant le conseil général de la commune siégeant en permanence, afin d’obtenir un certificat de civisme pour son mari « malade et paralysé ». Le certificat lui avait été délivré, mais le Directoire ayant refusé de le viser et approuver, le citoyen de Vigny avait été mis en état d’arrestation, puis relâché au bout de quelque temps. Ils se croyaient par suite à l’abri de toutes recherches, lorsque Mme de Vigny fut arrêtée avec son père à la fin de l’année 1794. Cette fois ce fut au mari à plaider la cause de sa femme et du vieux marquis de Baraudin. Il connaissait Boucher-St-Sauveur, député de Paris, ancien maître particulier des Eaux et Forêts en Touraine. Il s’employa de son mieux auprès de ce conventionnel et fut assez heureux pour obtenir par son canal la mise en liberté de sa femme et de son beau-père.
Deux ans après, Mme de Vigny mettait au monde son quatrième enfant. Comme ils avaient perdu les trois premiers et que, depuis la mort du marquis de Baraudin, plus rien ne les retenait à Loches où il n’y avait aucune sécurité pour eux, ils prirent le berceau de leur petit Alfred et le transportèrent avec eux à Paris.
Et voilà, comment Alfred de Vigny, qui ne vit jamais sa ville natale qu’à travers les récits pleins de larmes et de sang de sa mère, sacrifia dans son cœur la Touraine, sa première nourrice, à la Beauce d’où les de Vigny étaient originaires et où il avait passé, soit au Tronchet, soit à la Briche, une partie de son enfance.
« Paris, a-t-il écrit, fut presque ma patrie, quoique la Beauce fût la véritable pour moi. Mais Paris avec ses boues, ses pluies et sa poussière, Paris avec sa tristesse bruyante et son éternel tourbillon d’évènements, avec ses revues d’empereurs et de rois, ses pompeuses morts, ses pompeux mariages, ses monotones fêtes à lampions et à distributions populaires, avec ses théâtres toujours pleins, même dans les calamités publiques, avec ses ateliers de réputations fabriquées, usées et brisées en si peu de temps, avec ses fatigantes assemblées, ses bals, ses raouts, ses promenades, ses intrigues, Paris, triste chaos, me donna de bonne heure la tristesse qu’il porte lui-même et qui est celle d’une vieille ville, tête d’un corps social. »
Ce n’est que vers la cinquantaine, quand il entra en relations avec sa cousine, la vicomtesse du Plessis, qu’il se sentit attiré vers la Touraine et que, de Beauceron qu’il croyait être, il reconnut qu’il était Tourangeau.
Alexandrine Bléré était fille d’un avocat distingué de Tours qui l’avait mariée au vicomte Hector Lebreton du Plessis dont la mère était une demoiselle de Vigny. C’était une jolie femme, très spirituelle et très mondaine et qui, sans tourner au bas bleu, s’occupait beaucoup d’art et de littérature. Elle ne tarda pas à prendre un véritable ascendant sur le poète, son cousin, qui, non content de lui écrire les lettres exquises que l’on sait, la visita souvent dans son petit castel de Dolbeau. Ce castel, situé dans la commune de Semblançay, non loin du château féodal de ce nom, est bâti sur une éminence. Il n’offre rien de remarquable comme architecture, mais la tourelle qui coupe sa façade par moitié lui donne un faux air de manoir Renaissance, et de la terrasse où il s’élève on découvre une charmante petite vallée traversée par un ruisseau.
La première fois qu’Alfred de Vigny y vint en villégiature, il emporta de son séjour un souvenir si agréable, qu’à peine rentré dans sa terre du Maine-Giraud, il écrivit à sa cousine :
« Angoulême, 20 septembre 1846. Vous m’avez décidé à l’adoption de ma patrie. Ingrat que j’étais de ne pas l’aimer et la mieux connaître ! C’est quoique chose que de rendre un citoyen à l’amour de sa cité. La cité n’y gagne que bien peu : c’est un Tourangeau de plus en Touraine. Mais le citoyen y gagne beaucoup. Il sait les charmes de son pays et y concentre ses affections. Je n’aimerai plus la Beauce, et l’Angoumois m’ennuie déjà, depuis un immense quart d’heure que je l’habite. Dites à Monsieur votre père, je vous prie, que j’adopte sa théorie. On est du pays où l’on est né et où l’on a été remué dans son premier berceau. »
Rien de plus juste, et cependant, après avoir lu ces lignes, je n’ai pu m’empêcher de faire cette réflexion. Si Alfred de Vigny, à cinquante ans, après quelques jours passés à Dolbeau, avait enfin senti son cœur battre d’amour pour la Touraine, que n’aurait-il pas éprouvé à la vue de Loches, « son premier berceau » ? quels cris d’admiration et d’enthousiasme n’aurait-il pas poussés en voyant, de la terrasse du château de Charles VIII et de Louis XII, se dérouler à ses pieds, dans un décor véritablement féerique, l’immense toile ensoleillée au milieu de laquelle coule la lente et claire rivière de l’Indre ?
Je sais bien qu’à Dolbeau il y avait pour embellir le paysage les yeux riants de la cousine, mais à Loches, n’y avait-il pas pour charmer le poète quelque chose de plus doux encore, le souvenir attendri de cette autre jolie femme qui fut sa mère ? Étant donné le culte profond qu’il eut pour elle de son vivant et le long chagrin qu’il ressentit de sa perte, on a peine à s’expliquer que sa chère mémoire n’ait jamais ramené Alfred de Vigny dans sa ville natale qu’avant de mourir il n’ait pas eu la curiosité si naturelle de revoir la petite maison blanche où il avait jeté ses premiers vagissements. Car cet enfant de la Touraine fut avant tout le fils de sa mère. Il avait non seulement son beau visage, ses grands yeux d’un bleu tendre, sa chevelure ondoyante et soyeuse, son teint pâle, sa physionomie pensive, il avait encore sa tournure d’esprit, ses manières distinguées, son âme compatissante et jusqu’à sa tristesse mortelle qu’il croyait tenir de Paris, sa ville d’adoption, et qui lui était venue de la nature d’abord et puis des évènements qui avaient marqué sa naissance.
Après cela, qui sait ? peut-être Alfred de Vigny connaissait-il sa ville natale comme il nous arrive parfois de connaître certaine personne sans l’avoir jamais vue. Le jour où je visitai pour la première fois cette petite cité que son histoire et ses monuments ont rendue si grande, je me demandai sérieusement si quelque fée, ne la lui avait pas montrée en rêve, avec sa ceinture légère de coteaux crayeux, sa façade riante sur la rivière, ses portes fortifiées qui datent du Moyen Âge, sa tour Carrée et sa tour Ronde, son église romane et son château Renaissance, et tout l’horizon qui s’étend devant elle, de Verneuil à la forêt de Beaulieu qui le barre d’une ligne sombre, – lorsqu’il fit l’admirable description de la Touraine par où s’ouvre son roman de Cinq-Mars.
Les vrais poèles, on l’a dit avec raison, reçoivent en naissant le don de seconde vue, et bon sang ne ment point. En se déclarant Tourangeau sur le tard, Alfred de Vigny n’avait pas besoin de renier la Beauce. Lui, Beauceron ! qui l’eût jamais cru ! La Beauce a pu produire des militaires et des laboureurs, des hommes d’épée et de charrue, elle est incapable de produire un poète, un homme d’imagination de l’envergure de Vigny, avec ses plaines immenses qui n’ont d’autre ondulation que celle du vent dans les blés. La Touraine, au contraire, est un merveilleux jardin où la Muse de l’histoire semble avoir attiré tout le chœur d’Apollon. Dans ce jardin de plaisance, bordé de châteaux tels que Blois, Chambord, Azay-le-Rideau, Langeais, Chenonceaux, Loches et Amboise, on a vu, en effet, par je ne sais quel miracle, une Agnès Sorel préparer les voies à la Pucelle d’Orléans ; une duchesse de Bretagne marier l’hermine aux fleurs de lys ; un Rabelais faire sonner son large rire là où cent ans plus tard Descaries devait renouveler la métaphysique en l’inondant de clartés ; un Balzac enfin, promener au bout de sa plume tous les masques de la comédie humaine !… Il manquait à la gloire de la Touraine un poète royal, sachant manier le vers comme Rabelais, Descartes et Balzac ont manié la prose. Alfred de Vigny eut l’insigne honneur de combler cette lacune ; depuis lors la Touraine n’a plus rien à envier aux plus riches provinces de France.
Le Cénacle de la Muse française. – Delphine Gay et le comte d’Artois. – Comment Delphine s’éprit d’Alfred de Vigny, – Mme de Vigny s’oppose à leur mariage. – L’idée de la noblesse chez Alfred de Vigny. – Portrait de Delphine par Lamartine. – « Elle riait trop ! ». – Alfred de Vigny en garnison à Strasbourg et à Bordeaux. – Premières confidences de Sophie Gay à Mme Desbordes-Valmore. – Le Cénacle bordelais d’Edouard Géraud. – La Ruche d’Aquitaine. – Accueil fait par Edouard Géraud à Mme Desbordes-Valmore. – Propos de salon de Marceline. – Alfred de Vigny est introduit dans la société de Géraud par Edouard Delprat. – Les Deux Amitiés par Delphine. – Le poème de Dolorida jugé par Sophie Gay. – Lettres de Sophie à Marceline. – Le Satan d’Alfred de Vigny. – Un mariage manqué. – Elle riait trop. – Dernière poésie d’Alfred de Vigny dédiée à Mme Delphine de Girardin.
Il y a dans la littérature française deux ou trois prénoms d’auteurs qui sont à eux seuls des noms illustres et qui dès qu’on les prononce, évoquent le souvenir et l’image des plus belles Muses des temps anciens.
De ceux-là sont les prénoms de Delphine et de Marceline. Le premier pourrait être synonyme de Thalie et l’autre d’Erato. La Comédie à côté de l’Elégie ; le rire éclatant à côté des lamies !…
Or, dans la vie d’Alfred de Vigny, à l’heure matinale où son âme pensive s’ouvrait à la poésie, Delphine joua le rôle d’amoureuse ingénue, et Marceline le rôle de confidente.
C’est ce roman de la vingtième année du poète que je voudrais conter ici. Quelques pages y suffiront, car si l’intrigue en fut nouée dans le Cénacle de la Muse française, il dura moins que lui encore.
Ce Cénacle, il faut bien le dire, était à l’origine passablement mêlé. Il y avait de tout : des vieux et des jeunes, des amis de la tradition et de la nouveauté, mais, en somme, presque autant de pompiers que d’incendiaires.
Soumet, Guiraud, Baour-Lormian y coudoyaient Victor Hugo, Emile Deschamps et Charles Nodier. Alfred de Vigny s’y rencontrait avec Jules de Rességuier, Pichard, Lefèvre et Ulric Guttinguer.
Et pour éviter le reproche de manquer de femmes, le Cénacle avait ouvert sa porte à double battant à toutes les joueuses de harpe, de guitare et de mandoline, depuis Mmes Tastu, Dufrénoy et Desbordes-Valmore jusqu’à Sophie Gay dont la belle jeune fille, alors dans la fleur de ses grâces naissantes, reçut bientôt tous les hommages.
On ne savait pas encore ce que c’était que le genre classique et le genre romantique. Victor Hugo n’était encore que l’Enfant sublime et, même après le coup de soleil des Méditations, cherchant sa voie dans les ténèbres. Mais entre tous les poètes des deux sexes que l’amour de l’art avait réunis il y avait une émulation cordiale, une admiration mutuelle et de bon aloi qui, du côté des hommes, se doublait d’un véritable charme. Et le charme, je le dis tout de suite, c’était la jeunesse et la beauté triomphante de Delphine. Comment le Cénacle ne l’aurait-il pas subi, quand tous les salons de Paris le subissaient, voire un prince du sang qui, pour les beaux yeux de Delphine, faillit devenir parjure au serment qu’il avait fait, au lit de mort de Mme de Polastron, sa dernière maîtresse, de ne jamais la remplacer dans son cœur.
Delphine ignora toute sa vie le sentiment d’admiration qu’elle avait inspiré au comte d’Artois, mais l’eût-elle connu dans le moment, qu’elle n’en aurait pas été troublée, car elle avait le cœur plein d’une autre image. Elle aimait en ce temps-là un beau militaire, un lieutenant de la garde royale, et je ne surprendrai personne en disant que ce n’était point le costume qui l’avait séduite, mais que son cœur était allé tout droit au poète qui, sous l’épaulette d’or, l’avait émue avec ses vers. Elle s’était même éprise de lui d’autant plus vite que, tout d’abord, il n’avait pas eu l’air d’y prendre garde. Cependant, soit timidité, soit coquetterie, à dater du jour où il s’aperçut qu’elle rougissait devant lui, les apparitions de Vigny au Cénacle devinrent plus, rares. Mais la mère de Delphine, qui se connaissait en amoureux, ayant fréquenté la société la plus débauchée de la Révolution, Sophie n’était pas plus dupe de son manège que de la réserve de sa fille. On a beau s’observer, on se trahit toujours quand on aime. Or Sophie avait remarqué que dans les vers de Delphine la même image revenait sans cesse, et que lorsque la conversation tombait sur M. de Vigny, une petite flamme lui montait subitement à la joue. Ses pressentiments se changèrent en certitude le jour où sa fille refusa nettement tel parti avantageux qu’on lui proposait. Ce jour-là, elle lui prit les deux mains et, la regardant dans le blanc des yeux :
– Alors, tu aimes M. de Vigny ?
– Oui, ma mère.
Et Sophie et Delphine tombèrent dans les bras l’une de l’autre.
Il ne leur restait plus qu’à faire la conquête du bel officier de la garde royale.
À vrai dire, elle était déjà aux trois quarts faite, et si Vigny n’avait écouté que la voix de son admiration, il n’eût pas attendu plus longtemps pour demander la main de Delphine. Mais la voix de l’admiration n’était pas la seule qui lui parlât alors ; il y avait aussi la voix de la raison, et celle-ci était d’autant plus forte qu’elle lui parlait par la bouche de sa mère, – de sa mère qui était veuve et qui n’avait plus que lui au monde.
Elle lui fit comprendre qu’un officier d’avenir mais qui n’avait d’autre fortune que son titre nobiliaire ne pouvait pas décemment épouser une jeune fille sans dot, fût-elle belle comme le jour. Sophie Gay dit que Mme de Vigny était vaine de son titre et qu’elle avait promis son fils à une parente riche. Elle était, je crois, mal renseignée sur ce dernier point, et elle s’abusait certainement sur le premier. On sait le peu de cas qu’Alfred de Vigny faisait de sa noblesse et les admirables vers qu’elle lui a inspirés :
C’est son père qui lui avait donné, tout enfant, l’idée la plus vraie de la noblesse et qui, en lui contant l’anecdote suivante, avait détruit à jamais en lui le faux orgueil de la naissance. Un soir qu’il demandait à son père ce que c’était que la noblesse, le comte de Vigny s’était pris à sourire et, l’ayant assis sur ses genoux, avait prié sa femme de lui donner un volume de Mme de Sévigné. « Voici, lui dit-il, voici la vérité dans une chanson de M. de Cou-langes à Mme de Sévigné, quand on disputait sur l’ancienneté d’une famille. Nous fûmes tous laboureurs, nous avons tous conduit notre charrue. L’un a dételé le matin, l’autre l’après-dînée. Voilà toute la différence. »
Mme de Vigny, quoique plus fière que son mari, était à peu près dans les mêmes sentiments sur cet article, mais elle avait trop souffert de leur manque de fortune pour ne pas savoir le prix de l’argent. Or, sans vouloir tout subordonner à la question d’intérêt dans le mariage de son fils, elle ne lui aurait pas permis de faire un mariage d’amour qui ne fût pas argenté. C’est pour cela sans doute qu’Alfred de Vigny ne déclarait pas sa flamme à la belle Delphine. Je crois, d’ailleurs, que Mme Sophie Gay voyait juste quand elle disait que l’admiration du jeune poète était plus vive que tendre. C’est le sort commun des déesses d’inspirer plus d’admiration que d’amour. Or, si l’on s’en rapporte à la légende, Delphine fut véritablement une déesse de beauté. Lamartine qui, lui aussi, fut un de ses admirateurs, mais qui s’est défendu un jour de l’avoir aimée, nous a tracé d’elle le royal portrait quel voici :
« Son profil légèrement aquilin était semblable à celui des femmes des Abruzzes ; elle les rappelait aussi par l’énergie de sa structure et par la gracieuse cambrure du cou. Le profil se dessinait en lumière sur le bleu du ciel et sur le vert des eaux ; la fierté y luttait dans un admirable équilibre avec la sensibilité ; le front était mâle, la bouche féminine : cette bouche portait, sur ses lèvres très mobiles, l’impression de la mélancolie. Les joues pâlies par l’émotion du spectacle, et un peu déprimées par la précocité de la pensée, avaient la jeunesse, mais non la plénitude du printemps ; c’est le caractère de cette figure, qui attachait le plus le regard en attendrissant l’intérêt pour elle. Plus fraîche, elle aurait été trop éblouissante. La teinte du marbre sied seule aux belles statues vivantes comme aux statues mortes. Il faut sentir l’âme, la passion ou la douleur à travers la peau. L’âme, la passion, la piété, l’enthousiasme sont pâles…
« Le son de sa voix complétait son charme : c’était le timbre de l’inspiration. Son entretien avait la soudaineté, l’émotion, l’accent des poètes, avec la bienséance de la jeune fille ; elle n’avait à mon goût qu’une imperfection, elle riait trop : hélas !… beau défaut de la jeunesse qui ignore la destinée ; à cela près, elle était accomplie. La tête et le port de la tête rappelaient trait pour trait, en femme, celle de l’Apollon du Belvédère en homme : on voyait que sa mère, en la portant dans ses flancs, avait trop regardé les dieux de marbre.
Elle riait trop !… Qui sait ? Vigny, qui était un triste, comme Lamartine, aura peut-être trouvé, lui aussi, que Delphine riait trop. Les vrais poètes, qui sont ceux du cœur, ont toujours eu plus de goût pour les larmes que pour le rire, et l’on sait que l’école de 1820 engendra plutôt la mélancolie que la gaieté. Lamartine disait qu’il y a plus de génie dans une larme que dans toutes les bibliothèques de l’Univers. C’est probablement pour cela que les romances sentimentales de Mme Desbordes-Valmore plaisaient tant aux âmes de sa génération. Quoi qu’il en soit, que ce fût la faute ou non du rire éclatant de Delphine, il est certain que le cœur de Vigny ne fut jamais pris à ses charmes.
Cependant Mme Sophie Gay ne désespérait pas de le marier avec sa fille. Elle avait beau lui répéter, chaque fois qu’elle la voyait songeuse, que M. de Vigny n’était point pour elle, au fond elle croyait à son rêve, et ce qu’elle en disait à Delphine, c’était uniquement pour faire la part du feu et lui épargner, le cas échéant, une déception par trop cruelle.
Une fois pourtant, elle perdit confiance, ce fut quand M. de Vigny fut envoyé en garnison à Strasbourg, car elle savait la force du proverbe : loin des yeux, loin du cœur. Mais quand on lui eut appris que de Strasbourg il venait de passer à Bordeaux, elle vit là un de ces coups du hasard qu’on a raison de nommer providentiels. Mme Desbordes-Valmore n’était-elle pas à Bordeaux depuis quelque temps, et ce brave Emile Deschamps, qui décidément était le trait d’union de toutes les connaissances de Vigny, ne lui avait-il pas parlé d’un sien cousin, Edouard Delprat, qui voyait souvent notre jeune poète et Marceline ? À qui mieux qu’à elle pourrait-elle s’ouvrir du beau rêve qu’elle caressait, dans son orgueil de mère ? Qui pourrait mieux la servir dans cette situation tout particulièrement délicate ? Et la voilà qui prend la plume et qui fait part de son tourment à Mme Desbordes-Valmore.
Elles sont exquises ces lettres de Sophie à Marceline ; je ne regrette qu’une chose, c’est que Sainte-Beuve, qui aurait pu en tirer un si joli parti, s’il l’avait voulu, se soit contenté de les publier sèchement au bas d’une page en les faisant suivre de deux ou trois lignes désobligeantes. La première est datée du mois d’août 1823. Mme Gay y raconte comment sa chère Delphine s’est éprise de M. de Vigny :
« Je vous le dis bien bas, c’est le plus aimable de tous, et, malheureusement, un jeune cœur qui vous aime tendrement et que vous protégez beaucoup s’est aperçu de cette amabilité parfaite. Tant de talent, de grâce et de coquetterie dut enchanter cette âme si pure, et la poésie est venue déifier tout cela. La pauvre enfant était loin de prévoir qu’une rêverie si douce lui coûterait des larmes ; mais cette rêverie s’emparait de sa vie. Je l’ai vu, j’en ai tremblé, et après m’être assurée que ce rêve ne pouvait se réaliser, j’ai hâté le réveil. »
Elle n’ose pas dire qu’elle a pris ce rêve à son compte, mais elle le laisse entendre :
« Comment un homme comme Vigny ne serait-il pas ravi d’animer, de troubler une personne comme Delphine ? »
Elle ne peut y croire et c’est pour cela qu’elle s’adresse à Marceline.
« Voilà une confidence, continue-t-elle, qui prouve tout ce que vous êtes pour moi, chère amie, et je n’ai pas besoin de vous recommander le secret. Mais je dois à ce malentendu de la société un chagrin de tous les jours et que vous seule pouvez bien comprendre. Si vous voyez cet Alfred parlez-lui de nous et regardez-le : il me semble impossible qu’un certain nom ne flatte pas son oreille. Il a de l’amitié pour moi, et je lui en conserve de mon côté, à travers mon ressentiment caché. Je suis sûre que vous le partagerez et que vous ne lui pardonnerez pas de ne point l’adorer. Leurs goûts, leurs talents s’accordaient si bien ! »
Mme Sophie Gay ne savait pas si bien s’adresser en prenant Mme Desbordes-Valmore pour confidente. Non seulement, en effet, elle était femme à la comprendre, mais son talent, la réputation qui l’avait précédée à Bordeaux, lui avaient ouvert toutes les portes de la société bordelaise, à commencer par celles du petit cénacle littéraire qui reconnaissait pour chef Edouard Géraud.
Edouard Géraud avait débuté dans la littérature par des romances qui étaient devenues presque aussi célèbres que celles de Marceline et dont le recueil fut salué à son apparition (1818) par Charles Nodier dans le Journal des Débats.
« À cette date de 1818, dit M. Maurice Albert, éditeur du Journal intime de Géraud, les romances du poète bordelais apportaient quelque chose de très neuf, révélaient des mérites bien personnels et une curieuse originalité. C’est une œuvre de transition. S’ils rappelaient par leur grâce légère et leur audace libertine les poésies de Parny, fort à la mode alors, comme le témoigne l’éloge que précisément à cette époque Lamartine composait pour l’Académie de Mâcon, ces vers offraient aussi un double caractère très nouveau, celui-là même qu’en retrouvera tout à l’heure, avec le génie en plus, chez le poète du Lac et chez Victor Hugo. Ils étaient, les uns très intimes, parfois même mélancoliques, comme les Méditations, les autres, comme les ballades, inspirés par le Moyen Âge, dont E. Géraud fut le premier en France à comprendre l’intérêt poétique, et vers lequel il essayait, deux ans avant la naissance de Victor Hugo, de tourner la curiosité de ses contemporains. »
L’année d’avant, Géraud avait fondé à Bordeaux, pour expliquer publiquement ses idées, car il en avait beaucoup et de très neuve, une revue littéraire dans le genre du Globe et qu’il baptisa la Ruche d’Aquitaine. À cette Ruche ouverte à tous les talents, accoururent une foule d’abeilles de l’Hélicon romantique et même quelques frelons de l’autre bord, car Géraud n’avait point de préférences. Il professait avec politesse et mesure des doctrines que le goût et la raison pouvaient avouer.
« Je n’entends rien, disait-il, absolument rien à la distinction qu’on s’efforce d’établir depuis quelque temps entre l’école classique et l’école romantique. Je ne sais ce que peut signifier ce dernier mot, qui n’est pas français. Mais la fureur de classer les ouvrages et de les proscrire à l’aide de certaines expressions mal comprises et mal définies, ne m’a jamais beaucoup intimidé. Il faudrait laisser aux botanistes cette manie de la classification. Qu’un livre m’intéresse ou m’amuse, voilà le point essentiel, le principium et fans ; peu m’importe après cela de savoir à quelle école on veut qu’il appartienne. Roland furieux, le Petit Jehan de Saintré, Obéron, René ne sont peut-être pas de ces ouvrages qu’on est convenu de nommer classiques ; je ne les regarde pas moins cependant comme des productions charmantes, dont je voudrais bien être l’auteur. C’est dans cet esprit exempt de tout préjugé littéraire que je rédige mes articles de la Ruche, car le fari quæ sentiam fut toujours ma suprême loi. »
Il semble, après cette déclaration qui rappelle un peu celle de Victor Hugo dans la seconde préface des Odes et Ballades, il semble que Mme Desbordes-Valmore aurait dû recevoir à la Ruche un accueil enthousiaste. N’avait-elle pas été la première hirondelle du nouveau printemps littéraire ? Cet accueil ne fut pourtant que sympathique. Ses élégies et ses romances troublèrent l’esthétique de Géraud, qui, comme Baour-Lormian, aimait assez la nouveauté des formes du romantisme, mais qui ne voyait point de salut en dehors du style classique.
« Ces élégies de Marceline Desbordes, écrivait-il dans son Journal à la date du 18 juillet 1823, sont toujours des épanchements, des effusions d’une âme tendre et rêveuse, mais où rien n’est assez arrêté pour satisfaire le bon sens. Il semble qu’elle commence toujours sans s’être bien rendue compte de ce qu’elle veut dire et faire : ses sujets ne sont jamais ni assez déterminés, ni assez encadrés ; et quand elle finit, on n’en voit pas non plus la raison. Les paysagistes se servent d’une expression remarquable : ils disent que c’est un grand talent que de bien choisir sa place, ou de savoir s’asseoir en présence de l’objet qu’on veut peindre. Eh bien, Mme Desbordes, à mon avis, ne sait point s’asseoir. Après avoir parcouru ses élégies, il ne me reste presque rien dans l’imagination ou dans la mémoire ; ses grâces ont quelque chose de si fugitif et de si vaporeux qu’elles ne laissent que bien peu de traces après elles. Comment retenir d’ailleurs ce qu’on a souvent tant de peine à comprendre ? »
Ce n’était pas trop mal vu pour un éclectique. Le bon sens, en effet, n’a pas grand-chose à recueillir dans les élégies de Marceline ; le sujet et l’expression sont toujours plus ou moins vaporeux, mais le mal du siècle, cette tristesse indéfinissable qui devait s’étendre à toute la littérature à partir de René, y jeta un de ses premiers cris. Et c’est ce qui fit leur nouveauté, leur charme et leur succès.
Cependant les réserves que formulait Géraud sur l’œuvre poétique de Marceline ne l’empêchaient pas d’avoir pour elle une admiration, profonde. Cela se sent à la façon méticuleuse dont il note dans son Journal ses moindres faits et gestes et jusqu’à ses propos de salon.
C’est ainsi que j’y relève les anecdotes suivantes :
Mars.
« Mme Desbordes-Valmore nous racontait l’autre jour que Mlle Bourgom, artiste du Théâtre-Français, vivait avec M. Chaptal, célèbre chimiste et un des grands dignitaires de la cour de Bonaparte. Elle en avait même un enfant. Un jour qu’elle entendait plusieurs personnes de sa société s’entretenir de ce qu’elles voulaient demander à l’Empereur, et préparer d’avance leur discours : « Et toi, mon fils, dit-elle à son bambin, comment parleras-tu au grand Napoléon ? Tiens, voici ce que tu auras de mieux à lui dire :
Monsieur, je suis bâtard de votre apothicaire. »
Juillet.
« Mme Desbordes-Valmore écrivait dernièrement à Montano, son amie, une lettre charmante qui finissait par ces mots : farewel nightingale ; et comme Montano ne sait pas un mot d’anglais, Mme Desbordes avait ajouté au-dessous : Écoute-toi et devine. Gergères trouve avec raison beaucoup de finesse et d’esprit dans ce petit rien. »
24 juillet.
« Soirée passée chez Mme Nairac, où se trouvaient Garat, Mme Desbordes-Valmore, son beau-père, Mme Vendure, etc. On y conte des histoires de fantômes, de pressentiments et de rêves étranges, Mme Marceline surtout, qui raconte fort bien. On lui a fait lire mes poésies et ma nouvelle du Gabeur ; elle trouve, dit Mlle Nairac, que cela est désespérant de clarté. Pauline, qui était avec moi, s’amusa ce soir-là, au point d’oublier sa fille jusqu’à onze heures.
M. Garat nous raconta ce mot de Mme de Staël, à propos de sa rivale, Mme de Genlis, qui avait traité Fénelon avec une certaine sévérité, dans-un de ses derniers ouvrages : À la manière dont Mme de Genlis a parlé de Fénelon, je croyais que c’était tout récemment qu’il avait été disgracié. »
Octobre.
« Voici un couplet que Mme Desbordes-Valmore chante très plaisamment sur l’air de Femmes, voulez-vous éprouver… ? Il est, dit-on, de M. de Jouy, lequel a voulu imiter le genre de versification propre aux commis marchands de la bonne ville de Paris :





























