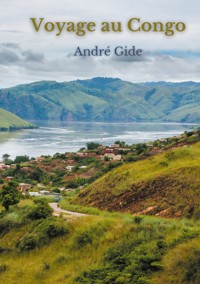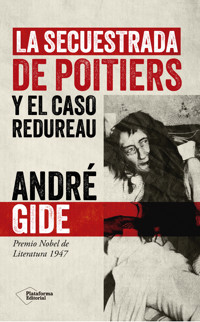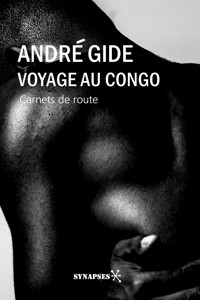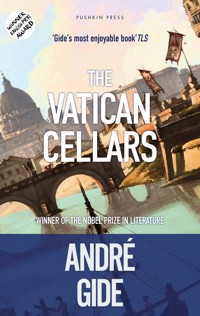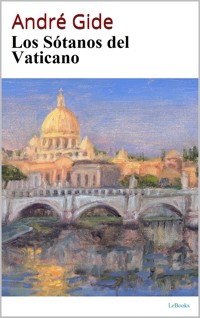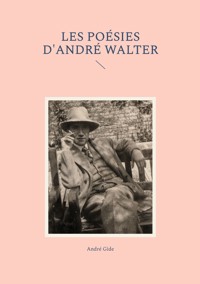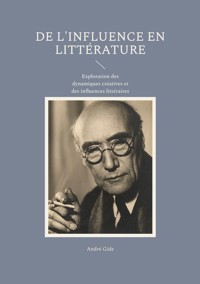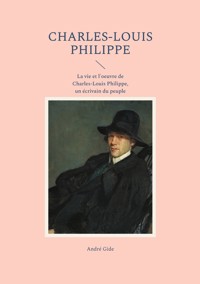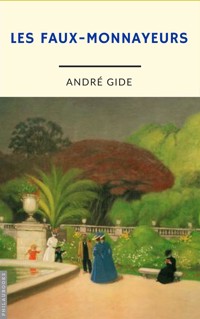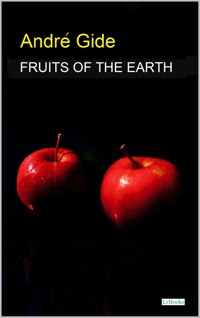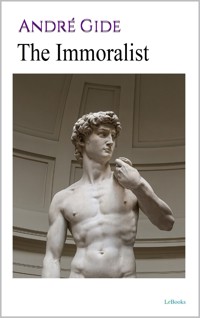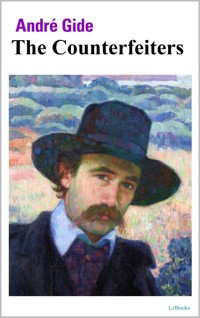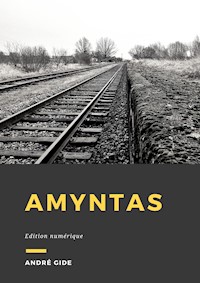
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Amyntas n'est ni une biographie, ni une fiction, mais des notes de voyage où le vécu se mêle à l’imagination. Il s’agit de notes prises de 1896 à 1904, pendant les voyages africains et réunis dans quatre parties à la fois indépendantes et entrelacées : Mopsus, Feuilles de route, De Biskra à Touggourt et Le Renoncement au voyage.
À PROPOS DE L'AUTEUR
André Gide (1869 - 1951) était un auteur français et lauréat du prix Nobel de littérature (en 1947). La carrière de Gide s'étend de ses débuts dans le mouvement symboliste à l'avènement de l'anticolonialisme entre les deux guerres mondiales. Auteur de plus de cinquante livres, au moment de sa mort sa nécrologie dans le New York Times le décrivait comme "le plus grand homme de lettres contemporain de France" et "jugé le plus grand écrivain français de ce siècle par les connaisseurs littéraires".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amyntas
André Gide
– 1906 –
à M. A. G.
Mopsus
AVRIL 1899
Incipe, Mopse, prior…
Virgile.
I
El-Kantara.
… Le rocher qui depuis le matin se prolongeait à notre côté enfin s’ouvre. Voici la porte ; on la franchit.
C’est le soir ; on marchait dans l’ombre ; la plénitude du jour finissant reparaît. – Beau pays désiré, pour quelle extase et quel repos vas-tu répandre ah ! ton étendue, sous la chaude lumière dorée.
On s’arrête ; on attend ; on regarde.
Un monde différent apparaît ; étrange, immobile, impassible, décoloré. – Joyeux ? non ; triste ? non : tranquille.
On s’approche ; comme en une trouble eau tiède, sous l’ombre des palmiers, craintif et pas à pas l’on avance… Un bruit de flûte ; un geste blanc ; une eau doucement chuchotante ; un rire d’enfant près de l’eau – puis, rien ; plus une inquiétude et plus une pensée. Ce n’est même pas du repos : ici jamais rien ne s’agite. Il fait doux. – Qu’ai-je voulu jusqu’à ce jour ? De quoi m’étais-je inquiété ?
II
Le soir vient ; les troupeaux rentrent ; ce qu’on croyait le calme n’était qu’engourdissement et torpeur ; un instant l’oasis étonnée frémit et voudrait vivre ; un souffle infiniment léger touche les palmes ; une fumée bleue monte de chaque maison de terre et vaporise le village qui, les troupeaux rentrés, se dispose au sommeil et s’enfonce dans une nuit douce comme la mort.
III
Que la vie indiscontinue se prolonge. Le vieillard meurt sans bruit et l’enfant grandit sans secousse. Le village reste le même, où nul être désireux de quelque mieux n’apporte la nouveauté de quelque effort.
Village aux rues étroites ; aucun luxe ici n’oblige aucune pauvreté de se connaître. Tout repose et sourit dans sa félicité frugale. – Simple travail des champs, âge d’or ! Puis sur le pas des portes, le soir, occuper à des chants et des contes le loisir de la lente soirée…
IV
Là, entre les lourds piliers sans style de la salle peu éclairée, des femmes dansent, grandes, non point tant belles qu’étranges, et excessivement parées. Elles se meuvent avec lenteur. La volupté qu’elles vendent est grave, forte et secrète comme la mort. Près du café, sur une cour commune pleine de clarté de lune ou de nuit, chacune a sa porte entreclose. Leur lit est bas. On y descend comme dans un tombeau. – Des Arabes songeurs regardent sinuer la danse qu’une musique, constante comme le bruit d’une onde coulante, conduit. – Le cafetier apporte le café dans une très petite tasse où l’on croirait boire l’oubli.
V
De tous les cafés maures, j’ai choisi le plus retiré, le plus sombre. Ce qui m’y attire ? rien ; l’ombre ; une forme souple qui circulait ; un chant ; – et n’être pas vu du dehors ; le sentiment du clandestin.
J’entre sans bruit ; je m’assieds vite, et pour ne rien troubler, je fais semblant de lire ; je verrai…
Mais non ; rien. – Un vieil Arabe dort dans un coin ; un autre chante à voix très basse ; sous le banc un chien ronge un os ; et l’enfant cafetier, près du foyer, remue les cendres pour retrouver un peu de braise où chauffer mon café saumâtre. – Le temps qui coule ici n’a plus d’heures ; mais, tant l’inoccupation de chacun est parfaite, ici devient impossible l’ennui.
VI
Qu’ai-je voulu jusqu’à ce jour ? Pourquoi peinais-je ? – Oh ! je sais maintenant, hors du temps, le jardin où le temps se repose. Pays clos, tranquille, Arcadie !… J’ai trouvé le lieu du repos.
Ici le geste insoucieux cueille chaque instant sans poursuite ; l’instant, inépuisablement se répète ; l’heure redit l’heure et le jour la journée.
Bêlements des troupeaux dans le soir ; chants flottants des pipeaux sous les palmes ; roucoulements sans fin des ramiers ; – ô nature sans but, sans deuil et non changée, – telle tu souriais au plus doux des poètes, telle, à mon œil pieux, tu souriras…
J’ai vu ce soir, pour étancher la soif des plantes, l’eau captée s’épandre, rafraîchir le jardin. Pieds nus dans le canal, un enfant noir dirigeait à son gré l’irrigation bien ménagée. Dans l’argile il ouvrait ou fermait de petites écluses. Chacune, à chaque arbre affectée, au tronc de l’arbre versait l’eau.
J’ai vu dans les creux craquelés cette eau monter, lourde de terre, tiède et qu’un rayon de soleil jaunissait. Puis, à la fin, l’eau débordée, profusante de toutes parts, vint inonder tout un pré d’orges…
Claudite jam rivos, pueri ; sat prata biberunt.
VII
Le soleil trop ardent a presque séché la rivière. Mais ici, sous la voûte que lui fait le feuillage, l’Oued roule et s’approfondit ; plus loin, il remonte au soleil languir sur la grève de sable.
… Ah ! ah ! tremper ses mains dans cette eau blonde ! y boire ! y baigner ses pieds nus ! y plonger tout entier… ah ! bien-être ! Dans l’ombre, là, cette onde est fraîche comme le soir. Un rayon mouvant perce l’entrelacs du feuillage, crève l’ombre, vibre et, comme une flèche, bondit ; il s’enfonce, pénètre aux profondeurs de l’onde, la fait rire, et tout au fond, mais sans insister, touche un peu de sable qui bouge… Ah ! nager !
Je veux m’étendre nu sur la grève ; le sable est chaud, souple, léger. – Ah ! le soleil me cuit, me pénètre ; j’éclate, je fonds, je m’évapore, me subtilise dans l’azur. Ah ! délicieuse brûlure ! – Ah ! ah ! tant de lumière absorbée puisse-t-elle donner un aliment neuf à ma fièvre, plus de richesse à ma ferveur, plus de chaleur à mon baiser !
VIII
Défaisant nos souliers qui s’emplissaient de sable, nous pûmes gravir, en un énorme effort, la dune que nous avions atteinte, et qui nous fermait l’horizon.
Dune mouvante ; nous savions, pour y arriver, quel pays rauque, quels ravins sans eau, quelles ronces sans fleurs. Le sable, que le vent chassait vers nous, nous aveuglait. Quand nous dûmes gravir la dune, il cédait, se supprimait sous nos pas ; le pied entrait, il semblait que nous demeurassions immobiles, ou que la dune entière se reculât. Et, bien qu’elle ne fût pas haute, il nous fallut beaucoup de temps pour la gravir.
De l’autre côté de la dune le pays était plus vaste encore, sinon exactement pareil. Exténués, dans un pli d’ombre nous nous assîmes, et un peu abrités du vent. Tout en haut de la dune, le vent qui soulevait et repoussait le sable en modifiait incessamment la crête.
Autour de nous, sur nous, sur chaque chose, léger comme un silence, on entendait la chute imperceptible du sable. Nous en fûmes bientôt couverts… Nous repartîmes.
IX
La route d’ombre et de mi-jour serpente entre les jardins clos.
Murs d’argile ! je vous louerai, car la profusion des jardins vous déborde ; murs bas ! la branche de l’abricotier n’en a cure ; elle passe outre ; elle s’élance ; elle flotte sur mon sentier. Murs de terre ! au-dessus de vous les palmiers inclinés se balancent ; les palmes ombragent mon sentier. D’un jardin à l’autre, à travers mon sentier, sans crainte de vous, murs croulants ! les ramiers voletants se visitent. – Par une brèche un pampre glisse ; se redresse et sur le fût du palmier bondit ; il s’enroule, l’entoure, le presse ; gagne un abricotier, s’y établit ; s’y balance, s’y replie, s’y divise ; y étend sa ramure élargie. Oh ! dans quel mois brûlant, quel svelte enfant grimpé dans l’arbre, tendra-t-il vers ma main, pour ma soif, une lourde grappe cueillie ?
… Murs d’argile, sans me lasser, espérant qu’enfin vous cédiez, je vous longe.
Une séghia[1]suit le mur d’argile ; elle coule le long du sentier. Le mur emplit le sentier d’ombre. Dans le jardin j’entends sourire et bruire des propos charmants… ô beau jardin !
Soudain l’eau fuit ; perçant le mur, elle entre ; elle s’avance dans le jardin ; au passage un rayon la perce ; – le jardin est plein de soleil.
Murs de terre ! murs détestés ! mon désir incessant vous assiège ; je finirai bien par entrer.
X
Enfoncée dans le mur de terre se dissimule une petite porte de bois.
Nous arriverons devant cette petite porte basse dont un enfant aura la clef ; on se baissera ; on se fera petit pour entrer. Oh ! dirons-nous, – oh ! c’est ici un lieu tranquille. Oh ! nous ne savions pas qu’on pût si bien se reposer, trouver un lieu si calme sur la terre… Apportez-nous des flûtes et du lait – nous nous étendrons sur des nattes ; du vin de palme et des dattes ; nous resterons ici jusqu’au soir. – Un vent léger fuit dans les palmes ; l’ombre hésite ; le soleil rit ; sous les abricotiers géants bleuissent les fossés d’eau jaunâtre ; les figuiers rampent ; mais ce qui nous charme surtout c’est la grâce des lauriers-roses.
Ne bougeons plus ; laissons le temps se refermer comme une onde, comme une onde où l’on jette un caillou ; le trouble que nous avons fait en entrant s’écarte comme la ride de l’onde : laissons se refermer sur ce monde la surface égale du temps.
XI
Nous nous étions levés ce matin-là de très bonne heure, pour, avant la chaleur, avoir pu nous avancer très loin. – Oh ! comme l’oasis interminablement se prolonge ! Jusques à quand marcher, pris entre les murs des jardins ? – Je sais que vers l’extrémité de l’oasis tous ces murs cessent, que le sentier hésite entre les libres troncs des palmiers. – Les palmiers peu à peu s’espacent ; on dirait qu’ils s’attardent, ou qu’ils se sont découragés. – Plus désolément leur fût moins entouré se balance… Quelques rares encore. Entre eux le pays s’ouvre. – L’oasis est finie. Plus rien ne sépare de notre œil l’horizon dégarni. –
Arrêtons-nous ! Le grand désert ici déferle.
– Arrêtons-nous. –
Vois ! sur la rousse mer immobile flotter, semblables à des îles, les immobiles oasis.
Derrière nous, le pan de roc ardent où les souffles du nord s’arrêtent ; parfois un nuage passe, flocon blanc ; il hésite, se défait, s’échevèle, se laisse absorber par l’azur.
Plus loin, au-dessus du mur chaud, derrière nous, la montagne où l’azur ruisselle.
Devant nous, rien ; – le vide nuancé du désert.
XII
Mopsus à Ménaïque.
Si Damon pleure encore Daphnis, si Gallus Lycoris – qu’ils viennent ; je guiderai leurs pas vers l’oubli. – Ici nul aliment à leur peine ; un grand calme sur leur pensée. – Ici, plus voluptueuse et plus inutile est la vie, et moins difficile la mort.
Feuilles de route
MARS-AVRIL 1896
À l’automne d’il y a trois ans, notre arrivée à Tunis fut merveilleuse. C’était encore, bien que déjà très abîmée par les grands boulevards qui la traversent, une ville classique et belle, uniforme harmonieusement, dont les maisons blanchies semblaient s’illuminer au soir, intimement, comme des lampes d’albâtre.
Dès qu’on quittait le port français, on ne voyait plus un seul arbre ; on cherchait l’ombre dans les souks, ces grands marchés voûtés ou couverts d’étoffes et de planches ; il n’y pénétrait plus qu’une lumière réfléchie les emplissant d’une atmosphère spéciale ; ces souks paraissaient, souterraine, une seconde ville dans la ville, – et vastes à peu près comme un tiers de Tunis. – Du haut de la terrasse où P. L. allait peindre, on ne voyait jusqu’à la mer qu’un escalier de blanches terrasses coupées de cours comme des fosses où s’étirait l’ennui des femmes. Au soir, tout le blanc était mauve et le ciel était couleur de rose thé ; au matin, le blanc devenait rose sur un ciel légèrement violet. – Mais après les pluies de l’hiver, les murs végètent ; des mousses vertes les couvrent et le bord des terrasses semble celui d’une corbeille de fleurs.
J’ai regretté la blanche, sérieuse, classique Tunis de l’automne, qui me faisait penser, le soir, errant dans ses rues régulières, à l’Hélène du second Faust, ou à Psyché, « la lampe d’agate à la main », errant dans une allée de sépultures.
On plante des arbres dans les rues larges et sur les places. Tunis en sera plus charmante, mais rien ne la pouvait autant défigurer. Il y a deux ans, la rue Marr, la place des Moutons étaient encore telles qu’on ne s’y savait où transporté, et que l’Orient le plus extrême, l’Afrique la plus secrète n’eussent pas eu, je crois, goût d’étrange plus stupéfiant. Une forme de vie différente et que tout réalise au-dehors, très pleine, antique, classique, établie ; pas de compromis encore entre les civilisations de l’Orient et la nôtre qui paraît laide surtout quand elle veut réparer. – Des plaques de tôle ou des feuilles de zinc remplacent peu à peu les claies de roseau, toitures des souks, et des réverbères répartissent par sursauts la lumière, sur les murs où naguère l’égale clarté des nuits s’épandait, – sur cette grande place des Moutons, sans trottoirs, silencieuse, merveilleuse, où, il y a deux ans, dans la tiédeur des nuits de pleine lune, auprès des troupeaux de chameaux, des Arabes venaient dormir.
– On a fait des trottoirs dans les souks. De l’une des plus belles allées, la base des colonnettes qui soutiennent la voûte est enfouie. Des colonnettes torses, vert et rouge, au chapiteau massif ouvragé. La voûte est blanc de chaux, mais à peine éclairée. Même par les plus splendides journées, ces souks sont toujours demi-sombres.
L’entrée des souks est merveilleuse ; je ne parle point du portique de la mosquée, mais de cette autre entrée, étroite, retirée – abritée par un jujubier qui se penche et fait un préambule d’ombre à la petite allée ténébreuse, tournant court et qu’aussitôt l’on perd de vue. Mais le jujubier, couvert de feuilles à l’automne, n’en a pas encore au printemps. – C’est le souk des selliers qui commence ; l’allée tourne, puis interminablement continue.
Au souk des parfums, Sadouk-Anoun est toujours assis en savetier dans sa boutique, petite comme une niche, au plancher à hauteur d’appui, encombrée de fioles ; mais les parfums qu’il vend sont aujourd’hui falsifiés. J’ai donné à P. V., en rentrant à Paris, les deux derniers flacons authentiques, que j’ai vu Sadouk-Anoun lui-même remplir avec une pipette, d’essence de pomme et, goutte à goutte, d’ambre précieux. Il ne les entoure plus aujourd’hui, demi-pleins d’une marchandise plus commune, si minutieusement de cire vierge et de fil blanc, et ne me les fait plus payer si cher. Il y a trois ans, sa minutie nous amusait ; elle semblait donner du prix aux choses. À chaque enveloppe surajoutée, le parfum devenait plus rare. Enfin, nous l’arrêtâmes ; notre bourse n’y eût pas suffi.
– J’ai vainement aussi cherché ce café sombre, où ne venaient que les grands nègres du Soudan. Certains avaient l’orteil coupé en signe de servitude. Ils portaient, la plupart, piquée sous leur turban, une petite touffe de fleurs blanches, de jasmins odorants ; cette touffe revient contre la joue comme une boucle de cheveux romantique et donne à leur visage l’expression d’une langueur voluptueuse. Ils aiment le parfum des fleurs tellement que parfois, ne les respirant ainsi pas assez fortement à leur gré, ils en entrent des pétales froissés dans leurs narines. – Dans ce café, l’un d’eux chantait, un autre contait des histoires ; et des colombes voletaient et se posaient sur leurs épaules.
Tunis, 7 mars.
Des petits enfants voient cela, rient, se répètent les obscènes mimiques de Caracous[2]. – Difficile gymnastique de l’esprit : qu’il se réforme jusqu’à retrouver cela naturel… Le public d’enfants, rien que d’enfants, la plupart tout petits, qu’en pense-t-il ?
Les Français ne vont pas là ; ils ne savent pas y aller ; ce sont de petites boutiques sans aspect ; on s’y faufile par une porte basse. Les Français vont régulièrement à des paradeurs à côté, qui font grand train et n’attirent que des touristes ; les Arabes savent à quoi s’en tenir et que c’est vraiment peu de chose, ce cheval de carton, qui danse, ce chameau de bois et d’étoffe, qui danse aussi, très drôlement certes, mais d’une manière toute foraine. Il y a là, auprès, une boutique de Caracous traditionnelle, classique, simple, on ne peut plus simple, d’une convention scénique admirable, – où Caracous se cache au milieu de la scène, entre deux gendarmes qui le cherchent, simplement parce qu’il baisse la tête et ne peut plus les voir ; – et les enfants acceptent, comprennent et rient.
Caracous. – Petite salle longue, boutique-échoppe dans la journée, que le soir on défonce ; une petite scène, au rideau de transparente toile, s’établit au fond pour les ombres. Perpendiculaires à la scène, deux bancs le long des murs. Là sont les places de faveur. Le milieu de la salle s’emplit d’enfants très jeunes qui s’assoient à terre et se bousculent. On mange quantité de graines de melon séchées dans du sel, friandise si provocante que ma poche chaque soir s’en vide, qu’au matin pour deux sous j’ai remplie. Il est vrai que j’en donne aux enfants.
L’amusant ici, ce sont ces niches dans le mur, sortes de très incommodes couchettes, de nids d’hirondelles de mer, où l’on ne grimpe qu’à la force des bras et d’où l’on ne descend pas – d’où l’on tombe, – qui ne se louent que pour tout le soir, à de jeunes aficionados. Ici je suis revenu bien des soirs ; c’était presque toujours le même public, aux mêmes places, écoutant les mêmes pièces, et riant aux mêmes endroits – comme moi.
Caracous. –