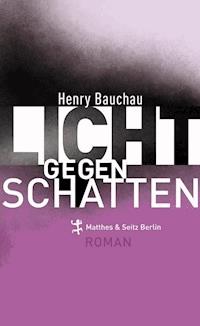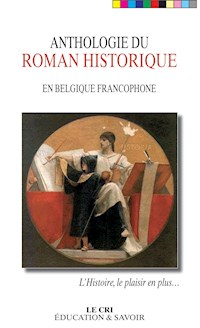
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Cri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Les romans sélectionnés dans cette anthologie ont été écrits par des auteurs belges francophones. Ces romans font référence à des événements ou à des personnages ayant réellement existé, mais qui ne sont pas contemporains de l’auteur. Celui-ci, outre un travail de documentation, a puisé aux sources de son imaginaire pour créer une œuvre de fiction.
L’anthologie s’ouvre sur
La Guerre du feu de
Joseph-Henri Rosny Aîné qui évoque la préhistoire pour se terminer par
Derrière la colline de
Xavier Hanotte qui renvoie à la Première Guerre mondiale. Entre les deux, seize romans et seize auteurs qui proposent au lecteur un cheminement littéraire quasiment continu de l’Antiquité au XIXe siècle. Les dossiers, d’une présentation uniforme pour chacun des romans, ont été rédigés tantôt par des spécialistes de tel ou tel auteur, tantôt par des généralistes de la critique littéraire, mais toujours en tenant compte des paramètres de lisibilité et d’exploitation pédagogique. La présente anthologie se veut donc un outil de travail pour les professeurs et les élèves du secondaire supérieur, mais également un manuel agréable, invitant chacun à des prolongements littéraires, historiques et artistiques.
À PROPOS DES AUTEURS
Les auteurs présentés dans cette anthologie :
Henry Bauchau,
Jean Claude Bologne,
Gaston Compère,
Charles De Coster,
Vincent Engel,
Xavier Hanotte,
Simon Leys,
Diane Meur,
Nadine Monfils,
Patrick Roegiers,
Joseph-Henri Rosny Aîné,
Marie-Êve Sténuit,
Bernard Tirtiaux,
Yvon Toussaint,
Jan Van Dorp,
Robert Vivier,
Francis Walder et Marguerite Yourcenar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANTHOLOGIE DU ROMAN HISTORIQUE
EN BELGIQUE FRANCOPHONE
ROMANS HISTORIQUES
CHEZ LE MÊME ÉDITEUR
Maxime Benoît-Jeannin
Miroir de Marie (Marie de Bourgone), 2003
Chez les Goncourt, 2004
Gaston Compère
Caroline et Monsieur Ingres, 2006
Yves-William Delzenne
Ainsi fut dissipé le charme nostalgique, 2006
Xavier Deutsch
Samuel est revenu, 2001
Catherine d’Oultremont
Le Prince de la Concorde,
la vie lumineuse de Jean Pic de la Mirandole, 2006
Annemarie Selinko
Désirée, 2001
Nicole Verschoore :
Les Parchemins de la tour, 2004
Le Mont Blandin, 2005
La Charrette de Lapsceurs, 2007
LE ROMAN HISTORIQUE
EN BELGIQUE FRANCOPHONE
Anthologie
Conception :
Service de la Promotion des Lettres
Contributions :
Rémi Bertrand (R. B.) • Françoise Châtelain (F. Ch.)
Joseph Duhamel (J. D.) • Laurence Ghigny (L. G.)
Thierry Leroy (Th. L.) • Christian Libens (Ch. L.)
Laurent Moosen (L. M.)
Relecture :Amélie Schmitz
Catalogue sur simple demande.
[email protected] www.lecri.be
(La version originale papier de cet ouvrage a été publiée avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
La version numérique a été réalisée en partenariat avec le CNL
(Centre National du Livre - FR)
ISBN 978-2-8710-6760-3
© Le Cri édition,
Av Leopold Wiener, 18
B-1170 Bruxelles
En couverture : Nikolaos Gysis,Historia Pintura(1892).
Photographies des auteurs : fonds iconographique des Archives et Musée de la Littérature.
Tous droits de reproduction, par quelque procédé que ce soit, d’adaptation ou de traduction, réservés pour tous pays.
« La persistance que Lévy [l’éditeur
deSalammbô] met à demander des
illustrations me fout dans une fureur
impossible à décrire. Ah ! qu’on me
le montre, le coco qui fera le portrait
d’Hannibal, et le dessin d’un fauteuil
carthaginois ! Il me rendra un grand
service. Ce n’était guère la peine
d’employer tant d’art à laisser tout
dans le vague, pour qu’un pignouf
vienne démolir mon rêve par sa
précision inepte. »
Gustave Flaubert
Introduction générale
Les liens entre histoire (récit fictionnel) et Histoire (réalité factuelle) sont souvent complexes comme en témoigne cette citation de Flaubert. Le romancier est avant tout un raconteur d’histoires, susceptible de s’emparer de tous les matériaux disponibles, parmi lesquels les faits et les personnages historiques. L’enjeu consistant à produire un récit original et inédit, contrairement à l’Histoire qui, selon Milan Kundera, a « le mauvais goût de se répéter. » 1
Dans le roman historique, les faits ne sont pas là pour eux-mêmes ; ils nourrissent parfois directement, parfois plus subtilement, une histoire inventée qui, par son style et sa portée se rattache à la littérature. En intégrant des événements, des personnages qui ont existé, dans un ensemble qui ne renvoie pas uniquement à la vérité historique, l’auteur se fait créateur. Il s’agit pour lui de « mentir vrai » (selon la formule célèbre d’Aragon), de créer ce qu’il ne connaît pas, de remplir les blancs avec ses propres références, son imaginaire et par là même d’arriver au vraisemblable, une autre forme de vérité que la vérité historique 2. Comme l’écrit l’essayiste belge Gilles Nélod : « Le roman est toujours un mensonge, un beau mensonge cohérent. Ainsi satisfait-il non point à la vérité, qui peut être considérée comme adéquation au réel, mais à la vraisemblance qui est un autre ordre de vérité. » 3
Les problèmes du roman historique
Le roman historique suscite bien entendu des interrogations. Flirtant parfois avec le mythe, la légende, la biographie, l’anachronisme, il pose essentiellement la question des frontières et des hiérarchies entre les matières, mais aussi de la langue à employer et du style à développer. Les différentes citations qui suivent illustrent ces diverses problématiques :
« Je suis très tenté par le roman historique : je suis à la frontière des deux, mais j’ai un peu peur des douaniers. » (Emmanuel Le Roy Ladurie)
« La fiction ne doit pas être à genoux devant l’histoire, mais elle lui doit au moins un peu de courtoisie. » (Henri Evans)
« Ceux qui réduisent le roman historique dans une catégorie à part oublient que le romancier ne fait jamais qu’interpréter à l’aide des procédés de son temps, un certain nombre de faits passés, de souvenirs conscients ou non, tissus de la même matière que l’Histoire. » (Marguerite Yourcenar)
« […] l’archaïque de la langue dans le roman historique est particulièrement absurde. Ce sont les actes et les sentiments, les conceptions et les pensées d’êtres humains passésqu’on nous communique ici. Ces êtres humains doivent être authentiques à la fois quant au fond et quant à la forme ; la langue est nécessairement celle du narrateur et non celle des personnages. » (Georges Lukacs)
« C’est par le mot ou le détail plaqué pour faire d’époque que le roman historique se disqualifie, [sous réserve que] certains mots périmés peuvent servir, comme un clou, à fixer une date. » (Marguerite Yourcenar)
Petit panorama du roman historique
Le commencement
Au-delà des divergences de définitions du genre, beaucoup s’accordent à dire que le roman historique naît auXIXesiècle, et plus précisément en 1814, avecWaverleyde Walter Scott (1771-1832). À travers les aventures de son héros Edward Waverley, jeune officier plongé dans la révolte jacobite de 1745, Walter Scott peint le caractère des Écossais. Un autre roman de Scott, toujours marqué par l’aspect psychologique de ses personnages, mais tourné cette fois-ci vers l’histoire d’Angleterre,Ivanhoé(qui a pour toile de fond le conflit opposant Saxons et Normands auXIIesiècle),lance la mode du roman historique. Celle-ci sera très vivace auXIXesiècle, le phénomène s’expliquant en partie par la naissance des nationalismes. La littérature, impliquée comme les autres arts dans la construction des identités nationales, recourt alors volontiers à l’Histoire. Mais le roman historique séduira également bon nombre d’auteurs du siècle suivant et de ce début deXXIesiècle. Les raisons de cet intérêt sont multiples, cependant un constat général s’impose : les sujets historiques continuent à fasciner le public.
Les classiques
Les noms et titres suivants sont cités selon la chronologie des époques relatées dans les romans concernés sans tenir compte de leur année de parution ni de l’époque à laquelle appartiennent leurs auteurs. Les auteurs mentionnés ici comptent parmi les noms importants de la littérature européenne et ont marqué de leur empreinte la tradition du roman historique.
Ce petit tour d’horizon, qui s’effectue de l’Antiquité à l’Époque Contemporaine en passant par le Moyen Âge et la Renaissance, débute par la tétralogieJoseph et ses frèresde Thomas Mann où l’auteur évoque les premiers prophètes d’Israël. Gustave Flaubert dans son romanSalammbôprend lui aussi pour cadre l’Antiquité et plus précisément la première guerre punique opposant Rome à Carthage.Quo vadis ?qui valut à l’écrivain polonais Henryk Sienkiewiczle prix Nobel en 1905, relateles persécutions que Néron a fait subir aux premiers chrétiens. Grand saut dans l’Histoire avecNotre Dame de Parisoù Victor Hugo donne à voir la vie sociale duXVesiècle à travers les passions que suscitent la jeune et belle gitane Esmeralda. C’est au Paris duXVIIesiècle que s’intéresse Alexandre Dumas, dansLes Trois mousquetairesoù d’Artagnan, cadet de Gascogne, entouré d’Athos, Portos et Aramis, sauve l’honneur de la reine de France menacé par les ambitions du cardinal de Richelieu. Tandis que l’auteur hongrois Zsigmond Moricz place la Transylvanie duXVIIesiècle au centre de sa trilogie du même nom. Alfred Döblin, l’auteur deBerlin Alexanderplatz,quicompte d’ailleurs parmi lesthéoriciens du roman historique, dresse dansWallensteinune fresque inspirée par la guerre de Trente ans (1618-1648). Le contexte de la Révolution française inspire bon nombre d’auteurs parmi lesquels Anatole France (Les Dieux ont soif)et Honoré de Balzac qui, dansLes Chouans,évoque ce que d’aucuns considèrent comme le premier génocide de l’Histoire, le massacre des Vendéens par les révolutionnaires.
Les succès et les adaptations célèbres au cinéma…
Toujours en tenant compte de la chronologie du contenu des œuvres,il convient de parler d’abord du mythiqueBen Hur (1880) de l’Américain Lewis Wallace qui raconte comment le prince de Judée, contemporain de Jésus, se trouve condamné injustement aux galères dans l’empire romain pour devenir ensuite un athlète adulé dans la course de chars.Les Piliers de la terrede Ken Follet (roman traduit en français en 1990), qui se déroule dans l’Angleterre duXIIesiècle, a pour toile de fond la construction des cathédrales et l’esprit gothique. Impossible de ne pas mentionner iciLe Nom de la rose(traduit en français en 1982 et adapté au cinéma quatre ans plus tard par Jean-Jacques Annaud), où Umberto Ecco construit une intrigue policière, basée sur le mélange des genres, qui se déroule au début duXIVesiècle, dans une abbaye située entre la Provence et la Ligurie, sur fond de philosophie médiévale et de réflexion morale. Robert Merle avec la fresqueFortune de Franceprend pour toile de fond les guerres de religion et les troubles civils des premières décennies duXVIIesiècle, de la mort de François Ierà l’édit de Nantes. DansLe Dernier des Mohicans, James Fenimore Cooperévoque la guerre qui oppose, en 1757, Français et Britanniques en Amérique du nord. Herman Melville reprend la thématique marine deMoby DickdansBilly Bud, gabier de Misainequi conte l’histoire d’un homme enrôlé de force dans la marine royale à la fin duXVIIIesiècle.Léon Tolstoï dansGuerre et Paix,dont on ne compte plus les adaptations à l’écran,décrit la société russe sur fond des campagnes d’Austerlitz et de Moscou qui opposèrent Napoléon Ierà la Russie.LeXXesiècle et ses deux conflits mondiaux sont également une source importante d’inspiration. Exemple récent, Jonathan Littell qui avecLes Bienveillantestraite du massacre des juifs par les nazis 4. Son roman a remporté, outre le prix Goncourt et le Prix de l’Académie française en 2006, un succès commercial immense.
Du côté des auteurs belges
Deux tendances générales se dessinent. D’un côté, les romanciers qui, dès le milieu duXIXesiècle, développent des romans où les éléments historiques leur permettent d’évoquer des réalités humaines, sociales, géographiques, linguistiques et politiques spécifiques à leur pays. Ces romans contribuent à installer une image de la Belgique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. Une démarche utile dans les décennies qui suivent la proclamation de la souveraineté de l’Ėtat belge (1830). Un royaume dont l’identité est à construire vis-à-vis des pays limitrophes comme la France ou la Prusse, deux Ėtats-nations par excellence. L’auteur néerlandophone, Henri Conscience, fondateur du roman historique en Belgique, évoque dansLe Lion des Flandres(1838), la bataille des Ėperons d’or qui s’est déroulée à Courtrai en 1302 où le peuple flamand l’a emporté sur la noblesse française. Charles De Coster dansLa Légende d’Ulenspiegel(1867), considérée comme le premier chef-d’œuvre de la littérature nationale, dresse le portrait d’un peuple belge festif, courageux et solidaire face à l’injustice à laquelle le soumet l’avidité des puissants. Mais les références nationales belges se retrouvent aussi dans la littérature duXXesièclechez les auteurs qui cultivent par exemple une veine nostalgique ou idéologique. Jan Van Dorp dans son roman d’aventureFlamand des vagues(1948), qui a pour cadre leXVIIesiècle, prend pour sujet la vie des marins flamands et illustre leur courage face à la mer ainsi que leur attachement héréditaire à leur terre.
D’un autre côté, des auteurs utilisent la matière historique afin de produire une œuvre littéraire où sont développées des questions ouvertement universelles, comme par exemple, l’exercice du pouvoir. Dans lesMémoires d’Hadrien(1951), Marguerite Yourcenar montre l’empereur romain duiiesièclequi au terme de sa vie écrit à son petit-fils pour lui faire part de sa vision du monde et des hommes. Gaston Compère dansJesoussigné Charles le Téméraire(1985) fait parler le duc de Bourgogne à titre posthume. Ce narrateur particulier jette un regard lucide et sensible sur les relations humaines, l’honneur et l’oubli. Quant à Simon Leys, il se plaît à imaginer dansLa Mort de Napoléon(1986),le destin de l’empereur déchu, en partant de l’idée que celui-ci n’est pas mort à Sainte-Hélène et qu’il devient un homme comme les autres…
Sur la présente anthologie
Le corpus
Les romans sélectionnés ont tous été écrits par des auteurs belges francophones. Ils se réfèrent à un ou des événements, à un ou des personnages ayant réellement existé mais qui ne sont pas contemporains de l’auteur. Le romancier a dû effectuer un travail de recherche, de documentation et/ou puiser à une source qui n’est pas de l’ordre du souvenir direct, mais issue de sa formation, de sa culture générale, de sa personnalité… Dans cette perspective, par exemple, le roman de Pierre Mertens,Les Éblouissements(Prix Médicis 1987), n’intègre pas ce corpus, car Pierre Mertens a été le contemporain, pendant quelques années du moins, de son personnage principal : l’écrivain expressionniste Gottfried Benn.
La liste des romans
— Joseph-Henri Rosny Aîné,La Guerre du feu
— Marguerite Yourcenar,Mémoires d’Hadrien
— Bernard Tirtiaux,Le Passeur de lumière
— Gaston Compère,Je soussigné Charles le Téméraire, duc de Bourgogne
— Yvon Toussaint,Le Manuscrit de la Giudecca
— Charles De Coster,La Légende d’Ulenspiegel
— Francis Walder,Saint-Germain ou la négociation
— Jan Van Dorp,Flamand des vagues
— Nadine Monfils,Les Fleurs brûlées
— Jean Claude Bologne,Le Frère à la bague
— Patrick Roegiers,Le Cousin de Fragonard
— Diane Meur,Les Vivants et les ombres
— Simon Leys,La Mort de Napoléon
— Henry Bauchau,Le Régiment noir
— Robert Vivier,Délivrez-nous du mal
— Vincent Engel,Retour à Montechiarro
— Marie-Ève Sténuit, Les Frères Y
— Xavier Hanotte,Derrière la colline
La méthode
Chacun des 18 romans est présenté selon un schéma et une disposition identiques :
Tout d’abord, une carte d’identité de l’ouvrage avec la mise en exergue d’une édition accessible dans le commerce et peu onéreuse, identifiée par la reproduction de la couverture ; ensuite, sorte de mise en bouche, l’incipit du roman, généralement limité à la première phrase et finalement l’analyse qui se déploie comme suit :
— Le contexte servant de base à la création du roman.
— Le thème et le résumé de la narration.
— Un large extrait situé dans le fil du roman.
— Quelques questions qui permettent une exploitation didactique de l’extrait.
— Une sélection de prolongements possibles (livres, films, visites…)
— Quelques jugements critiques contemporains de la parution du roman ou ultérieurs.
— Une biographie et une bibliographie succinctes de l’auteur accompagnées d’une photo.
L’ordre de succession des ouvrages est établi sur base chronologique, selon l’époque visitée par le roman. L’anthologie s’ouvre donc surLa Guerre du feude Joseph-Henri Rosny Aîné qui renvoie à la préhistoire pour se terminer parDerrière la collinede Xavier Hanotte qui évoque la Première Guerre mondiale. Le souci est de proposer, dans la mesure du possible, différents moments, représentatifs de la chronologie historique, tout en choisissant des textes offrant une grande diversité de styles et susceptibles d’intéresser des lecteurs aux goûts variés.
Les dossiers ont été rédigés tantôt par des spécialistes de tel ou tel auteur, tantôt par des généralistes de la critique littéraire, mais toujours en tenant compte des paramètres de lisibilité et d’exploitation pédagogique.
La présente anthologie s’adresse premièrement, mais pas exclusivement, aux professeurs et élèves du secondaire supérieur. Elle se veut un outil permettant une exploitation concrète, mais également un manuel agréable, invitant à des prolongements littéraires, historiques et artistiques.
J.-H. ROSNY AÎNÉ
La Guerre du feu
Paris, Fasquelle, 1911
Bruxelles, Labor, coll. « Espace Nord », 1998
Paris, Hachette Jeunesse, coll. « Livre de Poche Jeunesse », 2002
Paris, Nathan, coll. « Rouge et Or », 2006
Incipit
« Les Oulhamr fuyaient dans la nuit épouvantable. Fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême : le Feu était mort. »
Contexte
Durant la seconde moitié duXIXesiècle, l’archéologie préhistorique a connu d’importants progrès. Les fouilles ont mis à jour les restes de grands mammifères disparus et peu à peu s’est imposée l’idée qu’une race ancienne d’hommes (« antédiluviens ») a été contemporaine de ces animaux. Les grandes classifications de la préhistoire sont alors établies (paléolithique, néolithique…) et en 1886, à Spy en Belgique, sont découverts des squelettes de l’homme dit de Néanderthal.
Ces découvertes et réflexions s’inscrivent dans le contexte intellectuel nouveau qu’a ouvert la publication en 1859 de l’ouvrage de Darwin,L’Origine des espèces. L’idée d’évolution est appliquée au domaine social (le darwinisme social), et l’on imagine qu’il y a eu des espèces ou des races d’hommes qui ont réussi à s’adapter mieux que d’autres et à évincer les plus faibles ou les plus inaptes.
Indépendamment de ces réflexions sur l’histoire de l’humanité, des romanciers, dans la ligne de Zola et du naturalisme, se sont donné comme objectif d’étudier l’influence du contexte social sur les individus, dans l’idée d’essayer de cerner les fondements de la nature humaine. Les notions de santé, corporelle, mentale et sociale, et de vitalité y sont des critères pour juger des individus et des sociétés. (Voir ci-dessous le jugement de Pierre Masse.)
Des romanciers s’emparent de ces thèmes sociaux et de ces thèmes préhistoriques, riches de possibilités nouvelles, et se lancent dans des spéculations sur l’origine de l’humanité. Parmi ceux-ci, se détache J.-H. Rosny Aîné qui, s’il n’est pas l’inventeur du « genre préhistorique », a cependant imaginé des situations narratives, créé des types de personnage, développé une philosophie et une théorie, de l’évolution de l’humanité aux « âges farouches », bref défini un code, qui marquera durablement le genre et son évolution.
Résumé
Le feu des Oulhamr s’est éteint. La tribu est en danger de mort. Deux petits groupes, dont celui de Naoh, jeune guerrier intelligent et audacieux, sont envoyés dans des directions différentes pour voler leurs cages à feu à une autre tribu. Naoh rencontre différentes formes d’humanoïdes, certains déjà sur le déclin suite à l’affaiblissement de leur force vitale, bien qu’ayant connu des développements remarquables, d’autres se révélant de dangereux concurrents. Il doit également faire appel à toutes ses capacités pour lutter contre les dangers que représentent l’environnement naturel et les grands animaux (tigres, ours géants…).
Thèmes
La nature – L’adaptation au milieu – L’évolution – Les diverses formes de sociétés – Le langage
—
Extrait
Naoh a volé le feu aux Kzamms et, poursuivi par eux, trouve refuge au sein d’un troupeau de mammouths. Humains et mammouths s’apprivoi-sent mutuellement et développent des relations très riches ; le guerrier est fasciné par la remarquable adaptation des pachydermes à leur milieu. Aghoo fait partie de la même horde que Naoh, mais est beaucoup plus fruste et brutal ; Goûn est le vieux chef, sage mais contesté par Aghoo.
Depuis ce soir, le grand mammouth se rapprocha encore des nomades. Il aidait à ramasser la provision de bois, il alimentait le feu avec sagacité et prudence, il rêvait dans la clarté cuivreuse, pourpre ou cramoisie, selon les phases de la flamme. Des notions neuves grossissaient dans son énorme crâne, qui établissaient un lien mental entre lui et les Oulhamr. Il comprenait plusieurs paroles et beaucoup de gestes ; il savait lui-même se faire comprendre : en ce temps, les propos qu’échangeaient les hommes ne dépassaient pas des actions immédiates et très prochaines ; la prévoyance des mammouths et leur connaissance des choses avaient atteint à leur apogée. Ainsi, leur chef réglait quelque temps à l’avance la mise en marche de la peuplade ; lorsqu’on entrait dans des territoires suspects ou énigmatiques, il se faisait précéder d’éclaireurs ; son expérience, guidée par une mémoire tenace, nourrie par la réflexion, avait de la variété et de l’envergure. Avec moins de précision que Naoh, il n’en avait pas moins certaines conceptions sur les eaux, les plantes et les bêtes ; il entrevoyait la succession des périodes mornes et des périodes fertiles de l’année ; il discernait grossièrement le cours du soleil et ne le confondait pas avec celui de la lune. S’il avait parlé la langue des hommes, il n’eût guère paru plus fruste qu’Aghoo et ses frères, il aurait même exprimé certaines choses que le vieux Goûn lui-même ne concevait point.
Car si les hommes, depuis des milliers de siècles, accroissaient et affinaient leur entendement par tout ce qu’avaient palpé et transformé leurs mains, les mammouths développaient, à l’aide de leur trompe ingénieuse, maintes notions qui demeuraient étrangères aux hommes. Mais, réduit à quelques intonations et à quelques signes, le langage des colosses ne pouvait traduire tout ce qu’ils savaient ; les plus subtils restaient murés dans une solitude cérébrale ; aucune réflexion multiple ne pouvait se combiner avec une autre, ou se répandre par ce fleuve de la tradition orale qui, chez les hommes, emportait, rassemblait, variait intarissablement l’expérience, l’invention et les images… Néanmoins, la distance n’était pas encore infranchissable. Si la tradition des mammouths se bornait à l’imitation d’actes et de gestes millénaires, à la transmission de ruses et de tactiques, à une éducation simple sur l’usage des objets ou des devoirs envers la communauté et les individus, ils avaient l’avantage d’un instinct social plus ancien que celui des hommes et d’une longévité qui favorisait l’expérience individuelle. Car l’homme n’était pas construit pour vivre autant de saisons qu’un mammouth, et il était beaucoup plus sujet à périr accidentellement : il ne pouvait pas compter sur une protection très efficace ; la haine de ses semblables le menaçait, non seulement au-dehors, mais au sein de la horde même. Aussi, existait-il moins d’hommes que de mammouths ayant reçu de la vie une leçon à la fois durable et nombreuse.
—
Joseph-Henri Rosny Aîné,La Guerre du feu, Bruxelles, Labor, coll. « Espace Nord », 1998, pp. 163-165
La Guerre du feude Joseph-Henri Rosny Aîné
© Luc Pire, 2007
Pistes de lecture
• Comparez les aptitudes des hommes et des mammouths. Quels sont les atouts des uns et des autres ?
• Cette conception d’une intelligence animale évolutive, entre autres la capacité à domestiquer le feu, est-elle concevable dans la science d’aujourd’hui ?
• Avez-vous lu des livres ou vu des films qui présentent des formes de vie différentes du modèle humain ou animal que nous connaissons ? ComparezLa Guerre du feuà ces livres et films.