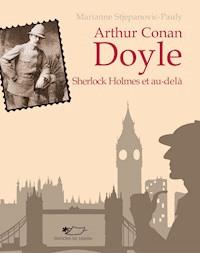Couverture
Copyright
Autres biographies
publiées aux Éditions du Jasmin
1. Van Gogh, la course vers le soleil
José Féron Romano & Lise Martin
2. Jacob et Wilhelm Grimm, il était une fois…
François Mathieu
3. George Sand, le défi d’une femme
Séverine Forlani
4. Frida Kahlo, les ailes froissées
Pierre Clavilier
5. Simone de Beauvoir, une femme engagée
Marianne Stjepanovic-Pauly
Tous droits de reproduction, de traduction
et d’adaptation réservés pour tous pays
© 2008 Éditions du Jasmin
www.editions-du-jasmin.com
Dépôt légal 4e trimestre 2008
ISBN : 978-2-352844-501
Titre
L'auteur
L’auteur
Diplômée en lettres et en linguistique, Marianne Stjepanovic-Pauly est documentaliste pendant une dizaine d’années. Mais à la vie de bureau, elle préfère la compagnie des enfants et des livres. Passionnée par les mots et par la littérature, elle écrit les histoires qu’elle invente pour ses fils, des contes et des nouvelles. Elle trouve aujourd’hui dans la rédaction de biographies la possibilité d’explorer ses domaines de prédilection : la littérature, l’écriture et l’histoire. Marianne Stjepanovic-Pauly a déjà publié aux Éditions du Jasmin une biographie sur Simone de Beauvoir.
Merci à tous mes proches, famille et amis, pour leurs encouragements et pour leur patience tout au long de cette année 2008 qu’ils ont eux aussi vécue aux côtés de Sir Arthur Conan Doyle.
Dédicace
1
Un Irlandais à Edimbourg
« De mon enfance, j’ai peu à dire : elle fut d’une austérité spartiate à la maison, et plus spartiate encore à l’école d’Edimbourg. »
Cheveux en bataille, œil poché et nez en sang, les vêtements en piteux état, un petit garçon court joyeusement les rues. Sa mère, un œil sur ses deux dernières filles, fait travailler l’aînée en préparant le dîner. Elle attend son fils avec impatience et toujours un peu d’inquiétude : certains de ses camarades sont de la graine de maison de correction. Ce garçon, ce n’est pas l’un desBaker Street Irregulars, ces gamins des rues de Londres que Sherlock Holmes emploie comme agents de renseignement. C’est Arthur Conan Doyle, jeune amateur de romans et d’histoire, qui cherche l’aventure dans les rues d’Edimbourg.
Il est grand pour son âge et, dans sa bande, c’est lui qui dirige la bagarre. Dans ces années 1860, toute la ville est le théâtre de guerres en culottes courtes : Irlandais ou Écossais, catholique ou protestant, enfant des quartiers bourgeois ou populaires, habitant de telle rue ou de celle d’à côté, on est toujours l’adversaire de quelqu’un.« Une rivalité féroce […] divisait les petits garçons selon le côté de la rue auquel ils appartenaient. Finalement, deux champions vidèrent la querelle. Je représentais le parti pauvre, qui logeait dans des appartements, et mon adversaire le parti riche, qui occupait les villas, en face. […] Excellent combat, en cinq reprises, où nous ne réussîmes ni l’un ni l’autre à nous assurer l’avantage. »À sa mère qui s’affole en le voyant rentrer couvert de bleus et les poings écorchés, il répond crânement :« Allez donc voir, de l’autre côté de la rue, l’œil d’Eddy Tulloch ! »C’est elle qui lui a enseigné les règles de la chevalerie moderne : se mettre au service des plus faibles et ne pas craindre les plus forts, respecter chacun, et les femmes en particulier, sans distinction sociale. Elle ne peut lui reprocher de faire des exercices pratiques !
Arthur aime ces affrontements et s’y adonne comme à un sport. Il rêve d’Ivanhoé, des Indiens d’Amérique, de défendre la veuve et l’orphelin ; il a déjà lu Alexandre Dumas et Charles Dickens (la bibliothèque du quartier finit par lui refuser plus de deux échanges de livres par jour). Sa mère ajoute à cet enseignement moral, historique et littéraire la fierté familiale, rattachant son fils aux conquérants de l’Angleterre par un arbre généalogique aux ramures complexes. Bouillonnant, plein d’imagination, l’enfant cherche dans la vie réelle le frisson de l’aventure. Le futur écrivain est déjà à l’œuvre :« […] j’écrivis et j’illustrai un petit livre. La rencontre d’un homme et d’un tigre y produisait bientôt le pire amalgame. Je fis remarquer à ma mère […] qu’il est facile de mettre les gens dans des situations embarrassantes, mais plus difficile de les en sortir. »
Prudemment Mary et Charles, ses parents, vont l’envoyer à l’école. Mais pas une école de quartier, dont le malheureux a déjà fait l’expérience : pendant deux ans, il a fréquenté Newington Academy, où la pédagogie consiste essentiellement à faire entrer les connaissances dans la tête des élèves à force de coups et d’humiliations.« […] l’un de ces maîtres d’autrefois me rendit l’existence misérable. Je souffris, de sept à neuf ans, sous le magistère de ce coquin, borgne et marqué de petite vérole, qu’on eût dit échappé d’un roman de Dickens. »
Arthur est donc inscrit à Hodder, cours préparatoire à un collège réputé, Stonyhurst. Son grand-oncle et parrain, Michaël Conan, un journaliste et critique d’art qui vit à Paris, a recommandé les Jésuites pour la qualité de leur enseignement. Il suit de près l’éducation de son filleul, dont il a choisi le prénom en hommage au roi de Bretagne et sur lequel il fonde de grands espoirs littéraires – Arthur et sa sœur aînée Annette portent le nom de Conan, Michaël et sa femme n’ayant pas eu d’enfants. Il conseille cependant à Mary et à Charles de se méfier : les pères jésuites cherchent souvent à faire entrer leurs bons élèves dans leur ordre. Son inquiétude est sans fondement, car Mary veille sur son fils. Bien que croyante, elle accepte difficilement l’intransigeance des prêtres et du dogme, et lui transmet donc un certain scepticisme critique. Dans un roman très autobiographique,Les lettres de Stark Munro, Arthur montre la mère du héros criant en guise d’adieu à son fils qui va prendre le train :« Portez de la flanelle sur la peau, mon cher enfant, et ne croyez jamais aux peines éternelles. » Charles en revanche veut respecter les traditions familiales irlandaises. Il voit bien que sa femme risque d’en détourner Arthur, et tient absolument à ce que son fils étudie dans un établissement catholique rigoureux.
Stonyhurst coûte cher, mais les collèges catholiques sont rares dans ce pays protestant, et celui-ci est prestigieux. Il offre le compromis idéal entre tradition religieuse et bonne éducation, aussi Mary est-elle prête à toutes les économies pour y envoyer son fils. Devant son insistance, l’école accepte de garder Arthur toute l’année, même pendant les congés de Noël et de Pâques. À partir de cette année 1867 et jusqu’à la fin de son adolescence, le jeune garçon ne rentrera chez lui que l’été. Il prend alors l’habitude d’entretenir une correspondance abondante et quotidienne avec sa mère, habitude qu’il gardera toute sa vie.
Si Mary tient tant à éloigner son fils d’Edimbourg, ville au surnom affectueux mais évocateur de « Auld Reekie », la « Vieille Enfumée », ce n’est pas à cause de l’air qu’on y respire, épaissi et noirci par la fumée des cheminées. Ce n’est pas non plus à cause des camarades de bagarre que son fils peut fréquenter, il faut bien que jeunesse se passe. De plus, le côté chevaleresque et audacieux d’Arthur n’est pas pour lui déplaire. Non, ce qui préoccupe la jeune femme, c’est son mari, dont la mélancolie et l’amertume s’accentuent peu à peu. Le charmant jeune homme qui lui faisait la cour quelques années plus tôt a bien changé.
Pourtant, lorsque Charles Altamont Doyle quitte Londres pour Edimbourg en 1849, c’est un garçon plein d’avenir. Il est nommé à un poste administratif d’adjoint aux bâtiments publics, une place importante pour un jeune homme de dix-sept ans. Mais l’ambition fait défaut à ce garçon timide et rêveur, et ses réels talents de peintre et de dessinateur ne seront jamais appréciés à leur juste valeur. Loyal, son fils lui rend hommage dans son autobiographie :« Si je réalise un jour mon dessein d’organiser une exposition Charles Doyle, les critiques découvriront avec surprise combien il était un grand et original artiste, le plus grand, à mon sens, de toute la famille. Son pinceau ne traitait pas seulement les fées et les thèmes légers de la même nature, il s’attaquait également à l’étrange et à l’effroyable. […] Cependant, il étonna le prosaïsme écossais plus qu’il ne conquit son admiration […]. »
L’alcool, qui tient lieu à Charles d’antidépresseur, l’isole peu à peu des siens, dont la situation matérielle incertaine devient plus délicate à chaque naissance. Car son mariage et ses nombreux enfants ne le rendent pas plus combatif, et s’il n’est pas de ces hommes que le vin rend violent, ses crises, durant lesquelles il peut se montrer effrayant, n’en sont pas moins impressionnantes. Il est capable de se montrer attentif à sa famille pendant quelques jours ou quelques semaines, il emmène ses enfants en promenade, leur raconte des histoires, dessine et bavarde affectueusement avec sa femme, puis tout à coup se renferme, fait main basse sur l’argent disponible dans la maison et disparaît. Quand il se montre à nouveau, il est irritable, coléreux. Pour Mary, Arthur et ses sœurs, la situation est difficile, car Charles est imprévisible, et la loi lui laisse néanmoins tout pouvoir dans sa famille. Quoiqu’Arthur ait pu dire ensuite sur les talents et les qualités de son père, et malgré les sentiments réels qui les unissent, il lui en veut de faire subir ces affronts à sa mère. Son combat en faveur du divorce, des années plus tard, doit sans doute beaucoup au souvenir de Mary, liée pour toujours à un homme qui la faisait souffrir.
Charles vit d’autant plus mal son échec professionnel et artistique qu’il est le dernier d’une famille qui brille par ses talents dans les milieux intellectuels et artistiques londoniens. La famille Doyle, d’origine irlandaise, s’est vue déposséder de ses biens au long du siècle précédent à mesure que les lois anglaises donnaient la préférence aux protestants. Ceux que Mary rattache aux grandes familles normandes et aux compagnons de Richard Cœur de Lion ne sont plus propriétaires terriens ni grands seigneurs mais commerçants. Jusqu’à John, le grand-père paternel d’Arthur, venu de Dublin à Londres en 1817 à l’âge de vingt ans, avec pour seules richesses un mortier à médicaments du XVIe siècle aux armes des Doyle, un tableau, authentifié plus tard comme un Van Dyck, et un talent de peintre qui fera la nouvelle fortune de la famille.
Dix ans plus tard, John Doyle est célébré dans tout ce que Londres compte d’écrivains, artistes et journalistes comme l’inventeur du dessin politique moderne, la« caricature polie », comme l’appelle Arthur. Jusque-là, les dessins de presse étaient volontiers outranciers, voire grossiers. John Doyle, sous le pseudonyme de H. B., signe de véritables commentaires de l’actualité : « Mon grand-père était un gentleman qui dessinait pour des gentlemen ; avec lui, la satire résidait dans la malice de la représentation, non dans la déformation des visages ». Il est d’ailleurs apprécié aussi des hommes politiques, dont certains collectionnent ses œuvres. Metternich, le chancelier autrichien, Wellington, le Premier Ministre, sont parmi les plus connus. LeTimes consacre un article de commentaire et d’explication à chacune de ses gravures. À la table de John Doyle sont reçus Sir Walter Scott, Charles Dickens ou Benjamin Disraëli. L’intransigeance de sa foi catholique force paradoxalement le respect de cette société farouchement protestante, la loi accordant les droits civils aux catholiques ne datant que de la fin des années 1820.
Du mariage de John avec Marianna Conan, la sœur de Michaël, qui par ailleurs est aussi le parrain d’Arthur, naissent sept enfants, deux filles et cinq garçons dont l’avant-dernier, Francis, meurt à l’âge de quinze ans. La seconde des filles disparaît également très jeune. Tous montrent dès l’enfance des dons artistiques. James est peintre, généalogiste et auteur d’une histoire de l’Angleterre ; Henry est peintre et critique d’art. Richard, surnommé Dicky, est réputé pour ses dessins à la plume illustrant la vie quotidienne et l’actualité : il sera le dessinateur attitré de la célèbre revue humoristiquePunch, qui utilise encore aujourd’hui comme emblème son Polichinelle au menton et au nez crochus. Charles, bien que doué lui aussi, peine à suivre ses aînés. Orphelin de mère à sept ans, son tempérament mélancolique s’accommode mal de la rigueur paternelle. John Doyle souhaite qu’il s’aguerrisse, et un poste en Écosse lui semble un excellent départ, un exil temporaire avant le retour à Londres pour une brillante carrière.
À Edimbourg, Charles est immédiatement pris en charge par la communauté catholique et logé chez une jeune veuve, Catherine Pack Foley, qui a ouvert une pension après la mort de son mari. C’est une femme généreuse, issue d’une famille protestante irlandaise et convertie au catholicisme par son mariage. Elle élève ses deux filles dans une foi sincère mais peu orthodoxe, et accueille Charles comme un fils – il n’a que dix-sept ans, cinq de plus que sa fille aînée, Mary. Mère moderne, Catherine souhaite que ses filles soient cultivées ; puisqu’Edimbourg ne leur offre pas d’école catholique digne de ce nom, Mary ira en France étudier pendant cinq ans. À son retour, c’est une jeune fille accomplie, elle est jolie, très intelligente et instruite : à la satisfaction générale des deux familles et des intéressés, le mariage est célébré le 31 juillet 1855.
Mary a un caractère volontaire et enthousiaste et des réserves d’énergie qui semblent inépuisables. À la naissance d’Arthur, le 22 mai 1859, elle n’a que vingt et un ans et c’est son troisième enfant – une petite fille est morte l’année précédente, une autre, qui naîtra en 1861, ne vivra que deux ans. Sur les neuf enfants qu’elle mettra au monde, deux mourront en bas âge. Catherine Pack Foley, très malade, meurt en 1862, laissant sa fille assumer seule de grandes responsabilités. Les enfants ont besoin d’être éduqués et nourris, il faut payer les factures et faire rentrer un peu d’argent, c’est-à-dire empêcher Charles de tout dépenser. Il faut aussi faire bonne figure devant les créanciers et les voisins, même si de déménagement en déménagement ceux-ci se font plus modestes. Il faut surtout garder la tête haute devant la famille. Mary fait front : pour elle, les revers de la vie ne sont ni des châtiments ni des épreuves divines, mais des défis à relever. Elle trouve le temps, malgré sa charge de travail, de lire énormément et transmet à tous ses enfants sa passion profonde de la littérature et de l’histoire.
Le terme de passion n’est pas trop fort : pour Mary, histoire, légendes et lettres se mêlent étroitement à la réalité. Ne partage-t-elle pas quelques branches généalogiques avec Sir Walter Scott et un lointain rameau des Plantagenêt* ? Sans compter un général Pack à la tête de la brigade écossaise à Waterloo, ce qui n’empêche pas la famille Doyle tout entière d’être francophile : dansLes lettres de Stark Munro, Arthur évoque l’image de sa mère, surveillant la cuisson du dîner tout en lisantLa Revue des Deux Mondes. Les histoires qu’elle raconte sont si passionnantes qu’elles prennent le pas sur la réalité plus terne de la vie quotidienne :« Du fond de mon enfance, aussi loin que me reporte ma mémoire, je me souviens des récits qu’elle me contait avec une netteté qui rejette dans l’ombre les incidents de ma vie réelle. »(Interview auNew York World, 1907, cité par P. Nordon dansSir A.C. Doyle, l’homme et l’œuvre.)
Le courage et la bonne humeur de Mary, son charme -« Nul […] n’approchait d’elle sans être captivé »- l’amour qu’elle porte à ses enfants et la complicité particulière qu’elle partage avec son fils aîné compensent l’instabilité de Charles. Arthur doit à sa mère la conviction que tout est possible à force de volonté, que les causes perdues méritent un chevalier pour les défendre. Dans sa famille, c’est sa mère qui joue le rôle du chevalier : il n’ignore pas que seules son ingéniosité et sa ténacité leur ont épargné la vraie misère qui fait rage dans les taudis de l’Écosse industrielle. Sans méconnaître le poids des conventions sociales, il sait, par l’exemple de son grand-père, que dans l’Angleterre moderne un homme peut réussir par son propre mérite. Il compte bien en être lui-même une nouvelle preuve.
La devise de Mary, d’Arthur et de tous ses frères et sœurs pourrait êtrenoblesse oblige : non pas la noblesse de la naissance, mais celle de l’honneur, qui consiste à voir dans chaque malheur qui vous frappe une sorte de compétition sportive à transformer en victoire. L’Angleterre victorienne, qui mêle la révolution industrielle et les traditions, l’idéologie du progrès scientifique et le strict maintien de la morale religieuse, est en train de faire du chevalier traditionnel le gentleman moderne. Ce gentleman,sportsmancultivé, forgé dans le moule despublic schools qui perpétuent les traditions, transpose les croisades du chevalier dans les combats du citoyen : Arthur en sera l’incarnation. Le petit garçon qu’il est encore doit donc quitter sa famille pour les classes primaires de Hodder, puis passer ses années d’adolescence au collège de Stonyhurst, où les professeurs affermiront son caractère en même temps que sa culture générale.
« J’avais dix ans lorsqu’on m’expédia à l’école de Hodder, préparatoire à Stonyhurst, qui est le grand collège catholique du Lancashire. Pour un gamin qui n’avait jamais quitté sa famille, c’était tout un voyage. Je l’entrepris dans un sentiment d’abandon qui m’arrachait des larmes amères. »
* En 1154, Henri d’Anjou Plantagenêt est couronné roi d’Angleterre sous le nom d’Henri II. Ses terres de Normandie, d’Anjou et du Maine s’ajoutent au Poitou, à la Gascogne et à la Guyenne apportées par sa femme Aliénor d’Aquitaine. L’ensemble fait du royaume d’Angleterre une grande puissance. Henri II régnera jusqu’en 1181.
2
L’éducation d’un gentleman
« C’était l’habituelle routine des écoles : Euclide, l’algèbre et les classiques, enseignés de manière à vous laisser une durable horreur. […] Je n’en vois qu’une justification possible, à savoir qu’un examen quelconque, si stupide soit-il, fait l’office d’un haltère mental pour le développement du cerveau. Théorie, à mon sens, complètement fausse. »
Hodder reçoit les tout jeunes élèves de huit à dix ou onze ans : beaucoup, comme Arthur, quittent leur famille pour la première fois et s’effraient d’entrer dans un monde inconnu. Le Lancashire, où se trouve Stonyhurst, est aujourd’hui à quatre heures de route d’Edimbourg, ce qui laisse imaginer l’expédition que cela représentait en 1867*. Heureusement, les enfants sont accueillis chaleureusement par un homme qui réconcilie Arthur avec les maîtres d’école :« J’eus la chance d’avoir pour principal l’excellent père Cassidy, homme plus humain que ne le sont en général les Jésuites. Je garde un souvenir chaleureux et de lui et de ses gentilles façons pour les vrais petits polissons dont il avait la charge. ». Le père Francis Cassidy est encore un jeune homme, aussi fervent dans sa vocation religieuse que dans son engagement de pédagogue. Il sait enseigner sans ennuyer, raconte volontiers des histoires et participe aux jeux de ses élèves comme s’ils étaient ses enfants. Arthur apprécie particulièrement sa présence pendant les congés qu’il passe à l’école quand ses camarades rentrent dans leur famille. Grâce à ce professeur exceptionnel, les deux années à Hodder restent dans sa mémoire comme la preuve que l’on peut être heureux à l’école.
Durant cette période, le petit garçon pratique la religion avec ferveur, travaille volontiers : comme tous les enfants, il est docile et enthousiaste quand il se sent aimé et encouragé. Il raconte ses journées, ses jeux et rapporte fidèlement ses résultats scolaires à sa mère dans de très nombreuses lettres. Il demande aussi des nouvelles de ses sœurs, quelquefois de son père, auquel il écrit également, mais plus rarement. Dans ses lettres à Charles, Arthur est plus formel que lorsqu’il écrit à Mary : la connivence entre la mère et le fils ne diminue pas avec la distance, au contraire, alors que sa relation avec son père devient plus lointaine, dans tous les sens du terme.
Aimé à distance par sa famille, entouré d’affection à l’école, Arthur s’épanouit. Il est en bonne santé, toujours plus grand et plus costaud que ses camarades, mais gentil avec les plus petits. Sociable, joyeux et sportif, curieux de tout, il est à l’aise avec tout le monde, mais ne se lie avec personne en particulier, à l’exception de James Ryan, venu d’Écosse comme lui, et qui restera un grand ami. Ses résultats sont bons, ce qui a toujours l’air de le surprendre : dans la compétition, scolaire comme sportive, il ne cherche à surpasser que lui-même, ce qui lui attire évidemment la sympathie des autres élèves. Tout pourrait continuer ainsi dans le meilleur des mondes s’il ne fallait pas quitter ce paradis pour Stonyhurst.
« Quelque cent cinquante ans plus tôt, les Jésuites, devenus légataires de cette grande résidence médiévale, en avaient fait un établissement privé d’instruction […]. Le programme des études n’y datait pas moins que l’édifice, mais il en avait la solidité. »Stonyhurst n’est pas un pensionnat chaleureux : la sévère discipline des pères y est appliquée sans faille, et aucun professeur ne vaut Francis Cassidy. Quant au personnel, infirmières et cuisinières sont aussi glaciales au grand collège qu’elles étaient douces à Hodder : le choc est rude. Arthur se trouve séparé de James Ryan, plus jeune, la règle interdisant la fréquentation d’élèves d’autres classes. La nourriture est frugale et la toilette matinale se fait à cinq heures, à l’eau froide en été, glaciale en hiver. Tout manquement est puni par l’application sur les mains de neuf coups d’une lanière de caoutchouc appelée « tolley ». Cet instrument de torture fait tellement gonfler les doigts que le puni doit ensuite être accompagné d’un camarade : il est incapable ne serait-ce que d’ouvrir une porte. Devant l’inhumanité des relations entre élèves et professeurs, Arthur bouillonne et, comme à Edimbourg, met un point d’honneur à affronter l’ennemi sans trembler :« Si je fus battu comme personne, ce n’est pas que je fusse le moins du monde vicieux, mais c’est que, naturellement sensible à la bonté et à l’affection, qui toujours me faisaient défaut, je m’insurgeais contre la menace, je ressentais un orgueil pervers à montrer que la violence n’aurait pas raison de moi. ».
Malgré la sympathie qu’il inspire à tous ses condisciples – et même, par son naturel et sa franchise, à certains pères - Arthur est très seul à Stonyhurst. Mais fidèle à sa morale personnelle, il fait front : il étudie, profite de la riche bibliothèque, et se défoule dans le sport. Lorsque commence la saison de cricket il devient l’idole de l’école, l’hiver il patine avec acharnement malgré de nombreuses chutes : l’activité intense lui permet de supporter la rigueur de ses enseignants. Au cours de ses années de collège il forge son esprit critique et commence à écrire – sa popularité, en dehors de ses qualités sportives, vient des histoires captivantes qu’il raconte par épisodes en échange de sucreries et de douceurs qu’il ne peut s’offrir. Si son public est subjugué, il paie en nourriture la suite du récit, sinon Arthur reste le ventre vide : il apprend donc à ménager le suspense.
L’imagination débordante d’Arthur, son esprit de contradiction et son humour vont à l’encontre des principes éducatifs de son école, mais vont l’aider à en tirer le meilleur parti. Le directeur de Stonyhurst fait partie des catholiques qui veulent profiter des nouvelles lois pour s’intégrer à la société anglaise, toujours méfiante à leur égard. Pour cela, il encourage vivement le patriotisme de ses élèves, notamment à travers l’étude de l’histoire. Arthur se passionne pour Macaulay, recommandé par son parrain, dont il lit et relitL’histoire de l’Angleterre : à la manière de Michelet en France, Macaulay écrit l’histoire comme un roman. Bien sûr, ce n’est pas un regard catholique sur le passé de l’Angleterre, et certains prêtres désapprouvent ce genre de lecture ; ils préféreraient que les catholiques anglais restent une communauté à part. Pour Arthur, il ne fait aucun doute que les citoyens de son pays ne forment qu’un seul bloc, et que la religion ne doit pas être un obstacle à l’amour de la nation.
Les désaccords au sein de l’Église, le pragmatisme de Mary et l’inconstance de Charles, sa sensibilité personnelle aussi, amènent peu à peu l’adolescent au scepticisme. Il est horrifié d’entendre un prêtre irlandais, venu prêcher au collège, promettre l’enfer et la damnation éternelle à tous les non-catholiques :« De cet instant date la première brèche, qui allait s’étendre et s’approfondir jusqu’aux dimensions d’un gouffre, entre mes guides et moi ». Arthur n’admet pas que Dieu soit aussi sévère, aussi aveugle à la bonté qui peut exister chez tout homme quelle que soit sa religion. Comme il ne sait pas cacher ses sentiments, il ne peut continuer à fréquenter une Église aussi intolérante, qu’il trouve plus proche de la superstition que de la foi. À sa grande surprise, non seulement le recteur du collège, le père Purbrick, ne lui en veut pas, mais il ne lui demande pas non plus de partir : il s’est engagé à former le jeune homme, il le fera jusqu’au bout. Mary est fière de son fils : il n’empêche pas les autres de croire ce qu’ils veulent, mais fait respecter ses propres opinions. Charles en revanche est choqué, toutefois Arthur a peu de considération pour l’opinion de son père et ne s’en désole pas.
Dans sa volonté d’intégrer les jeunes catholiques à la société anglaise, le père Purbrick les encourage fortement à passer l’examen d’entrée à l’université de Londres. À sa propre surprise, Arthur réussit : « […] je sortis de Stonyhurst à seize ans, avec plus d’honneur qu’on eût pu l’augurer de mes notes scolaires. ». Il est encore plus surpris que les Jésuites lui offrent le privilège, le trouvant trop jeune pour entrer à l’université, de passer un an en Autriche, au collège de Feldkirch. Ils savent pourtant qu’Arthur ne sera jamais des leurs : dès le début de sa scolarité, ils avaient proposé de prendre en charge tous les frais de son éducation si sa mère le promettait à la prêtrise, ce que Mary avait bien sûr refusé –« de sorte que l’Église et moi eûmes la chance d’échapper l’un à l’autre ».
Arthur garde de son séjour chez les Jésuites des sentiments contradictoires : en sept ans, l’école l’a mené jusqu’à l’université, mais en utilisant toujours la menace du châtiment plutôt que la promesse d’une récompense, la critique plutôt que l’encouragement. La volonté d’enseigner l’humilité conduit trop souvent les pères à dénigrer les enfants : alors qu’Arthur dirige le journal de l’école,Le Figaro de Stonyhurst, et y publie des poèmes, alors qu’il fait montre d’esprit sportif et de curiosité intellectuelle, la plupart de ses maîtres persistent à voir« mon avenir sous un jour assez sombre. […] [L’un d’eux] m’affirma que je ne ferais rien de bon dans le monde, et il se peut que, de son point de vue, sa prophétie se soit justifiée. » Les Jésuites autrichiens lui semblent plus humains, et si parmi les Anglais le père Cassidy rachète un peu les autres, le respect que lui inspire la congrégation reste entaché par la rigidité de ses principes.
À Feldkirch, Arthur doit perfectionner son allemand et aussi son français, qu’il a appris au collège en lisant Jules Verne – à quatorze ans, il a luVingt mille lieues sous les mers,Cinq semaines en ballonetDe la Terre à la Lune« avec autant de plaisir, écrit-il à sa mère,que des livres en anglais ». Pour être sûre que son fils continue de pratiquer cette langue qu’elle aime tant, Mary lui demande de toujours lui écrire en français. Mais il parle moins allemand qu’anglais, puisqu’il fait partie d’un groupe de vingt étudiants anglais et irlandais qui s’entendent comme les meilleurs amis du monde. Il fait du sport, de grandes randonnées, et, plus surprenant, apprend à jouer du bombardon. C’est un instrument de cuivre qui ressemble à une trompe de chasse, mais si grand – ses camarades de l’orchestre cachent ses draps dans le pavillon – que le musicien doit le passer autour de lui : sa force physique lui permet de devenir rapidement un honnête interprète. Lorsqu’il quitte Feldkirch au cours de l’été 1876, Arthur est bien nourri – les repas autrichiens sont consistants et« la bonne bière y remplaçait les infâmes dilutions » - et réconcilié au moins avec la branche autrichienne de l’institution.
Le long voyage de retour passe par la France, pays des années d’études de sa mère et surtout pays d’adoption de Michaël Conan qui vit à Paris, avenue de Wagram. Durant son année à Feldkirch, Arthur lui a régulièrement envoyé des poèmes et une sorte de journal de bord. Ces textes lui valent l’admiration de son parrain qui s’empresse d’écrire à Mary : il trouve son petit-neveu taillé pour la littérature ou le journalisme. Après un passage à Strasbourg, Arthur arrive par une chaude journée d’août 1876, laisse ses bagages à la gare et, comme il n’a pas un sou en poche, entreprend à pied la traversée de Paris. Il est impatient de rencontrer son grand-oncle qu’il ne connaît que par correspondance mais dont l’influence sur son éducation est certaine.« Ce bon vieil Irlandais volcanique »est ravi de rencontrer enfin son filleul, sentiment partagé :