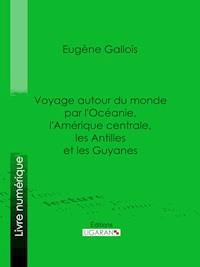Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "L'Asie-Mineure désignée aussi sous le nom d'Anatolie, qui en réalité en est une province, est baignée, au nord par la mer Noire et la mer de Marmara, à l'est et au sud par la Méditerranée. Elle présente du côté de l'Europe une façade très fantaisiste avec une dentelure capricieuse de côtes pittoresques, offrant des baies, parfois très profondes comme celles de Smyrne et de Kos, plus largement ouvertes comme le golfe d'Adalia..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335031218
©Ligaran 2015
Notre intention ne saurait être de faire une monographie détaillée de ce vaste territoire auquel on a donné le nom réduit « Asie Mineure » du plus vaste des continents, l’Asie, dont il fait partie, pas plus que de cette province s’y rattachant et dépendant également de la Turquie asiatique, la Syrie, mais bien de jeter un coup d’œil d’ensemble sur ces terres si pleines de souvenirs et fort intéressantes, nous pourrions ajouter négligées et relativement peu visitées… Nous rappellerons leur histoire, nous passerons une rapide revue des monuments que le passé nous a légués, et nous ne négligerons pas le côté pittoresque, nous permettant encore des considérations diverses, économiques plus particulièrement, tout en cherchant à exposer l’état actuel du pays au point de vue politique et en résumant le rôle joué par les divers gouvernements étrangers. À l’occasion nous ferons un peu de géographie.
Nous nous croyons quelque peu autorisés à faire cette étude d’ensemble par suite de divers voyages accomplis en cette contrée, que nous avons parcourue pendant de longs mois.
En assumant cette tâche, sans la moindre prétention, cela va sans dire, nous ne faisons que poursuivre l’œuvre de vulgarisation à laquelle nous nous sommes voués depuis des années ; et nous ne cherchons d’autre satisfaction que celle pouvant consister en l’accomplissement d’un devoir social…
E.G.
Pour suivre un certain ordre qui nous paraît rationnel nous commencerons par cette suite d’îles qui semblent être comme les avant-gardes de l’Asie-Mineure du côté de l’Europe. Elles sont nombreuses, égrenées au long de ce littoral très découpé, couvrant des baies plus ou moins profondes… D’importance très variable, parfois même simples rochers, elles n’en présentent pas moins d’intérêt ; néanmoins nous ne saurions leur consacrer que quelques pages, cherchant à les dépeindre d’un trait rapide, ébauchant leur silhouette, ne faisant même que les citer pour mémoire dans certains cas, – On voudra bien excuser la sécheresse de cette nomenclature.
Nous débuterons par le Nord rattachant ces îles placées comme à la porte des Dardanelles pour descendre jusqu’à la pointe sud-ouest d’Asie-Mineure, laissant de côté la grande île de Chypre à laquelle des volumes spéciaux ont déjà été consacrés.
Nous transcrirons pour ces îles leur nom le plus courant sans omettre ceux sous lesquels elles ont été désignées à diverses époques.
Après, nous adopterons l’itinéraire suivant pour la revue de cette Asie-Mineure. Ce sera d’abord les rives de la mer de Marmara qui nous retiendront un instant, puis nous descendrons au long de la façade ouest de cette côte qu’on peut qualifier de merveilleuse, nous pénétrerons dans ses admirables baies, nous pousserons même dans l’intérieur du pays, chose facile aujourd’hui, grâce aux chemins de fer ; après quoi nous passerons au Sud pour remonter par la ligne de Bagdad et les chemins de fer d’Anatolie jusqu’aux rives du Bosphore.
En un chapitre additionnel nous traiterons de la Syrie abrégeant un peu ce que l’on pourrait appeler la partie tout à fait touristique sur laquelle on a déjà beaucoup écrit.
[Pages manquantes]
Samothrace (en turc : Semendraki) profile sa haute silhouette à plus de 1500 mètres dans le ciel, aussi l’hiver porte-t-elle une blanche couronne de neige ; mesurant près de 200 kilomètres carrés, elle ne renferme qu’environ 3 000 habitants, ce qui démontre suffisamment que c’est une terre âpre, a l’aspect sévère, n’offrant au reste pas d’abri réel. Elle fut cependant habitée jadis successivement par des Thraces, des Icariens, des Phéniciens et des Hellènes. Au quinzième siècle elle reçut la visite de Mahomet Il et fit partie depuis lors de l’Empire Ottoman.
Imbros ou Imbro est un peu plus vaste que sa voisine (200 kilomètres carrés) mais aussi pauvre et peu cultivée, son aspect n’est au surplus guère plus engageant. Elle groupe quelques milliers d’habitants réunis surtout au chef-lieu : Kastron.
Ténédos ; avec cette île nous atteignons réellement la côte d’Asie-Mineure dont elle n’est séparée que par un exigu détroit, dangereux pour la navigation. Un rocher la précède au Nord, il est dit : l’île aux lapins, ce qui évite tout commentaire. Cette île de plus de dix lieues carrée ? est quelque peu cultivée ; elle produit entre autres des melons réputés, sans parler de son vin. Ses habitants (environ six mille paraît-il) sont surtout des citadins composant la population de la capitale du petit royaume constitué jadis par l’île. On y trouve un petit port de cabotage dominé par une vieille citadelle, cédée aux Génois au quatorzième siècle par un Paléologue, elle fut prise par les Vénitiens et devint enfin turque.
Bozbaba n’est plutôt qu’un rocher de plus de 250 mètres de haut derrière lequel semble se cacher un petit port.
Mytilène ou Mételin (la Lesbos de jadis) a bien fait parler d’elle en diverses circonstances, aussi a-t-elle été l’objet d’études diverses. Comme on a beaucoup écrit sur son compte nous résumerons donc.
Longue de 65 kilomètres, large de plus de 40 kilomètres, elle offre une surface de 1750 kilomètres carrés. Terre haute elle est dominée par des sommets d’un millier de mètres comme le Mont Olympe. Par une bizarrerie de la nature, elle est fortement échancrée en deux endroits et la mer y pénètre profondément dans les deux golfes de Kaloni au Sud et de Hiero au Sud-Est où pourraient s’abriter des flottes entières. De plus, elle possède trois bons ports : Sigri, Lougone, et surtout Olivier. Encore couverte en partie de bois, l’île est abondamment pourvue d’eau. Elle produit des olives, des fruits divers, du coton ; on y fait de l’huile, du vin ; on y fabrique aussi du savon ; de plus le climat est bon, tempéré ; aussi rien d’étonnant à ce que cette île soit bien peuplée, la plus sans doute de l’archipel, puisque certaines estimations lui donnent jusqu’à près de cent mille habitants. Le bétail y est nombreux et le mouton s’y élève bien ainsi que les mulets recherchés en plus d’une occasion par des armées européennes. La capitale est Castro, ville plaisante (environ vingt mille habitants) avec ses maisons aux couleurs tendres, ses mosquées et ses églises, regardant la côte asiatique. Flanquée d’une ancienne enceinte, elle est de plus dominée par une vieille citadelle. Aux environs sont les ruines d’une des villes de l’antiquité, car l’île a été de tout temps florissante, bien qu’elle ait eu à subir des tremblements de terre dont le plus terrible fut peut-être celui qu’elle éprouva au dix-huitième siècle. Patrie de Théophraste, elle donna aussi le jour dans les temps modernes, à deux célèbres pirates surnommés les frères « Barberousse ».
Habitée autrefois par des Pélasges, elle devint colonie éolienne puis athénienne pour faire ensuite partie de l’Empire d’Orient. Avant d’être turque, à partir du quinzième siècle, elle reconnut quelque temps la suprématie génoise. Enfin récemment des tentatives grecques, renouvelées, échouèrent.
Dépassant la profonde échancrure de côte constituant le golfe de Smyrne, on trouve :
Chio ou Khio (du grec khios) île longue d’une cinquantaine de kilomètres, mesurant plus de 800 kilomètres carrés, d’origine volcanique sans doute, montagneuse avec des pointes de 1 200 et 1 300 mètres comme le Mont Saint Élie. Terre très cultivée, produisant oranges, citrons, raisins, figues, grenades, etc., elle nourrit facilement ses soixante-dix titille habitants, qui fabriquent aussi le « mastic » en pâte ou en liqueur. On exploite aussi les marbres, le minerai de fer. En dehors de la capitale, Kastron, placée sur le détroit, une soixantaine de villages au moins émaillent les campagnes.
L’histoire nous apprend que ce furent encore ces mêmes Pélasges qui les premiers se fixèrent sûr l’île suivis par les Carions. Khio se vantait d’avoir vu naître Homère. Alliée d’Athènes elle subit le joug de Lacédémone puis celui de la Macédoine. Dépendant du royaume de Pergame, elle perdit de son antique prospérité. Elle subit dans les siècles suivants des vicissitudes bien diverses ; elle fut prise et reprise par les Gênois, les Grecs, les Latins, puis les Gênois, les Vénitiens, et enfin elle devient turque à partir du dix-septième siècle ; malgré quoi elle tenta encore, mais en vain de secouer le joug au début du dix-neuvième siècle.
Laissant à l’ouest les îlots et rocher de Psara et Antipsara voyons dans le groupe des Sporades, d’abord :
Samos, dont le nom est bien connu, presque populaire commercialement à cause de ses vins sucrés, fabriqués avec des raisins de l’île… ou d’ailleurs, additionnés de distillation de figues paraît-il. Offrant un périmètre d’environ 150 kilomètres, la belle et pittoresque île, avec ses montagnes de 1 200 et même 1 400 mètres plus ou moins couvertes de bois où dominent pins et cyprès, abriterait une cinquantaine de milliers d’individus. Son aspect est généralement verdoyant ; elle produit du reste en dehors de ses vins, des céréales, de l’huile d’olive, des raisins secs même ; on y exploite le marbre ; son sous-sol renferme des gisements pétrolifères, et on y fabrique des cigarettes à bon marché en quantité grâce à sa situation politique, l’île étant une petite principauté presque indépendante, depuis 1832, sur la garantie des trois puissances, anglaise, russe et française, et ne payant qu’une redevance annuelle de quelques milliers de francs au sultan. Un prince grec joue le rôle de souverain, assisté de sénateurs nommés par districts ; il jouit d’une modeste liste civile de trente-cinq mille francs. La religion professée par la majeure partie de la population est du reste la religion grecque orthodoxe.
Le principal centre habité de l’île est Vathy situé au fond d’une baie verdoyante, encadrée de hauteurs et ouvrant au nord. Une petite jetée abrite mal les quais où se distinguent parmi les établissements commerciaux celui des Révérends Pères dont les produits vinicoles sont justement réputés. Au-dessus, l’autre fraction de la ville s’étage dans la verdure. En dehors de ce port qui compte quelques milliers d’habitants il en est d’autres, comme Carlowasi, à l’ouest, Tigani, au sud, sur une pointe, avec un vieux couvent à aspect de forteresse. On trouve aussi des ruines dans l’île plus particulièrement du côté de Chora ou Khora (où aurait été l’antique Samos). Il est là des vestiges d’acropole, des traces de tours, d’un temple élevé à Junon probablement.
Les historiens nous apprennent que l’île fut peuplée par des Ioniens. Elle passa successivement aux mains des Perses, des Lacédémoniens, des Romains, des Turcs, jusqu’au jour où elle conquit son indépendance comme on vient de le voir.
Disons, en passant, qu’elle serait le pays d’origine du grand Pythagore.
Enfin ajoutons qu’un mince détroit la sépare d’une côte accidentée, garnie de montagnes dont certaines dépassent 1200 mètres ; la table rocheuse de l’îlot Chapel rend ce passage délicat.
Nikaria (ancienne Icarie), n’est guère qu’à cinq lieues dans le sud-ouest de Samos ; montagneuse, son point culminant dépasse à peine un millier de mètres. Plutôt inculte elle est boisée sur plus d’un point. Malgré son étendue de près de 270 kilomètres carrés, elle ne renfermerait guère que quelques milliers d’habitants, surtout pêcheurs, jadis pirates. C’est là que la légende ancienne place Icare, le fils de Dédale, qui fut précipité du ciel où il avait voulu s’élever, ses ailes de cire ayant fondu au soleil.
Fourni et ses sœurs forment un peu au-dessus des deux îles précédentes un groupe d’îlettes très peu habitées.
Les îles suivantes vont ensuite s’égrener en véritable chapelet.
Gaïdaro d’abord dresse sa silhouette pittoresque.
Pathmos avec ses dix lieues carrées est plus importante. Assez mamelonnée elle offre des hauteurs de 200 à 300 mètres, plus dénudée qu’elle ne semble l’être, de loin du moins, elle nourrit quelques trois mille habitants surtout marins. Comme la plupart de ces lies elle fut peuplée dans l’origine par des Cariens, puis des Ioniens. Elle renferme des édifices religieux et entre autres un vieux monastère dédié à saint Jean qui y aurait composé l’Apocalypse ? En tous cas, il renferme, paraît-il, de vieux manuscrits, au dire d’un voyageur français.
Arki désigne un groupe de rochers.
Lipsos, de modeste importance avec ses 1 500 hectares de surface, possède une petite anse bien abritée.
Leros beaucoup plus vaste avec ses 5 000 hectares découpe capricieusement ses côtes offrant de jolis golfes et même un bon port. Ses quelques milliers d’habitants vivent surtout de pêche mais recueillent aussi un miel réputé.
Kalymnos est bien plus importante puisqu’elle compte plus de 100 kilomètres carrés ; ses côtes, également très découpées, ménagent de petits ports ; celui de la ville portant le nom de l’île semble le meilleur. Ses campagnes permettant un peu de culture, sa population s’est, accrue (on peut l’évaluer à quelques milliers d’individus), dont beaucoup s’adonnent à la pêche des éponges. Ainsi que ses voisines cette île est rattachée depuis le seizième siècle à l’Empire Ottoman.
Kappari avec un groupe de rochers aux formes bizarres rend la navigation fort délicate en ce coin des côtes d’Asie-Mineure, assez médiocrement éclairées au reste.
Levitha avec ses 1 500 hectares environ, Kinaros et quelques îlots rocheux, se dressent sur le côté. Ils ne sont habités que par des pêcheurs de corail et d’éponge, auxquels se joignent des femmes.
Kos est une grande île longue, vaste de près de 290 kilomètres carrés, toute proche du continent. Accidentée elle dresse quelques-unes de ses montagnes à un millier de mètres, mais elle est assez peu commode d’accès quoique possédant un petit port en sa capitale. On estime à une dizaine de milliers ses habitants. Elle renfermerait aussi des sources thermales, et enfin elle produirait des vins jadis réputés.
Astropalia plus au large, est constituée par deux terres jointes par un isthme. Bien que manquant d’eau elle est habitée cependant par d’assez nombreux pêcheurs.
Nisyros qui n’a pas dix lieues carrées offre un volcan actif d’environ 700 mètres de hauteur, lequel n’effraye pas, paraît-il, deux à trois mille individus groupés à ses pieds.
Tilos est une île plus importante avec ses 100 kilomètres carrés ; aussi nourrit-elle quelques milliers de personnes. Elle fut occupée jadis comme plusieurs de ses voisines par les chevaliers de Rhodes.
Symi, île assez bizarrement découpée et représentant encore environ 70 kilomètres carrés, est nichée près de terre, dans le golfe du même nom. Plutôt montagneuse elle offre des terrains de culture cependant ; on évaluerait sa population à près de dix mille habitants. On pratique là aussi la pêche, et le commerce des éponges.
Charki avec des îlots et quelques rochers dépendent de :
Rhodes, la seconde île de la côte asiatique méditerranéenne avec ses 1 500 kilomètres carrés ; variée d’aspect, elle offre un massif montagneux avec des sommets de 1 200 à 1 300 mètres, une pointe atteindrait même près de 1 800 mètres d’après certaines cartes. Jouissant d’un climat tempéré, elle a été renommée de tout temps pour les produits de son sol, riche en cultures, donnant en abondance : oranges, citrons, cédrats, etc… Ses forêts, il est vrai, ont disparu en bonne partie. Elle a cependant été troublée à diverses époques par des tremblements de terre, dont un encore, dans le courant du siècle dernier. Son origine se perd dans la nuit des temps, c’est le cas de le dire, et elle fut l’objet des convoitises de tous les audacieux marins héritiers des Phéniciens, aussi fut-elle occupée tour à tour par les uns et les autres ; elle fut romaine, puis arabe, tomba aux mains des Chevaliers de Saint-Jean qui la gardèrent deux siècles avant de la remettre aux Turcs, alors qu’eux-mêmes durent se réfugier à Malte qui leur était offerte par Charles-Quint. Là se placent de beaux épisodes historiques comme la prise de possession par le grand-maître Foulques, de Villaret, et plus tard la résistance héroïque de Villiers de l’Isle-Adam, avec une poignée de chevaliers, pendant plus de six mois, contre l’armée de Soliman forte de cent cinquante mille hommes.
La ville, avec ses dix à douze mille habitants alors qu’on en compte au moins trente mille dans l’île, offre du reste encore de beaux souvenirs d’architecture, militaire surtout. Ce sont d’abord ses remparts avec leurs fossés profonds, d’une lieue de pourtour environ, puis le couvent des Chevaliers, converti en caserne et l’hôpital, le palais des grands maîtres un peu atrophié et transformé en prison, sans parler d’autres édifices et même de simples demeures qui ont laissé à cette ville tout le cachet d’une cité du quinzième siècle, aspect féodal au gothique flamboyant, un peu lourd parfois. Les anciennes églises sont devenues des mosquées sous le régime turc. La ville possédait trois ports, celui dit « des galères ou de l’arsenal défendu par la tour Saint-Nicolas, le port de commerce défendu également par des tours, plus un petit port à l’abri d’une ligne de récifs : malheureusement dans celui de commerce, le meilleur, on y est encore peu en sécurité, et au surplus les gros navires ne peuvent y accéder.
Les ruines ne manquent pas dans l’intérieur de l’île ; près Pinara, restes de théâtre, de tombeaux, près Tlos, d’acropole, de palais, de théâtre, à Pataco, de tours, de murs, puis encore à Kalamaki, Phellus, Lindos, Arnée, Apertæ, et autres lieux. La vieille cité de Rhodes était Ialissos, dont il subsiste des vestiges. Enfin des vieux monastères se cachent encore dans les montagnes, comme ceux de Saint-Élie et Notre-Dame de Toute-Grâce.
Karpathos et Kasos, avec quelques îlots rocheux, forment un groupe plus au sud, terminant cette longue suite d’îles.
La première qui comporte plus de 300 kilomètres carrés, est assez accidentée dominée par des sommets de 1 200 mètres au moins, ménageant des terres de culture. Elle nourrit du reste cinq à six mille habitants, se livrant aux travaux des champs et à la pêche, et groupés en plusieurs villages dont certains sont de petits ports.
L’Asie-Mineure désignée aussi sous le nom d’Anatolie, qui en réalité en est une province, est baignée au nord par la mer Noire et la mer de Marmara, à l’est et au sud par la Méditerranée. Elle présente du côté de l’Europe une façade très fantaisiste avec une dentelure capricieuse de côtes pittoresques, offrant des baies, parfois très profondes comme celles de Smyrne et de Kos, plus largement ouvertes comme le golfe d’Adalia, où plus resserrées et abritées comme celui d’Alexandrette. D’une façon générale le pays est accidenté, orographiquement il consiste en un bourrelet montagneux irrégulier et interrompu par des cours d’eau, lequel se rapproche ou s’éloigne de la mer, pour se transformer à l’intérieur en un vaste plateau d’une altitude moyenne d’un millier de mètres. Par-ci, par-là, de véritables chaînes de montagnes se dressent avec des sommets de 2 000, 3 000 mètres, et même davantage, comme le Taurus, l’Anti-Taurus, dans le sud, l’Alla dagh (montagne), la chaîne Pontique, l’Olympe de Bithynie, le Kaz dagh (ancien mont Ida), au nord, et à l’intérieur, le Baba dagh, le Kara dagh, l’Hassan dagh, pour ne citer que les principaux massifs. Il est encore des sommets détachés, isolés, comme le mont Argée, ancien volcan, point culminant d’Asie-Mineure avec ses 4 000 mètres ou peu s’en faut.
Des fleuves plus ou moins considérables découlent de ces montagnes en de belles et fertiles vallées souvent ; qu’il suffise de citer le ; Kizil Irmak et le Sakaria, au nord, ainsi que le célèbre Granique où faillit se noyer Alexandre le Grand, le Mander es (ancien Scamandre) et d’autres également célèbres dans l’antiquité, comme le Caïcus, l’Hermus ou Hermos, le Caïstre, le fameux et capricieux Méandre, coulant tous vers l’ouest, puis le Cydnus, le Xanthus, et autres encore, descendant au sud.
On rencontre et parfois non loin de la mer des lacs, comme dans le nord et le centre, certains sont vastes et bien encadrés de montagnes, d’autres constituent des bassins hydrographiquement parlant, comme sur les plateaux, et quelques-uns ont des proportions de mers intérieures, mais souvent leurs abords sont marécageux.
Telle est géographiquement cette péninsule, riche surtout sur ses bords, jouissant d’un beau climat un peu chaud l’été parfois, mais où les pluies sont peut-être trop rares. Il faut observer que le climat se modifie sur les plateaux, devenant continental, c’est-à-dire un peu extrême quelquefois dans le chaud comme dans le froid. Avec ses 1300 000 kilomètres carrés l’Asie-Mineure représente un territoire à peu près équivalent à celui de la France et qui ne serait peuplé que d’environ six millions d’habitants, c’est-à-dire qu’il y a encore de la place pour des générations futures.
Suivant une expression figurative heureuse l’Asie-Mineure semble « une main tendue vers l’Europe ». Par sa situation exceptionnelle en fait elle fut comme une annexe à la belle époque grecque, dont elle est pleine encore de souvenirs. Ne fut-elle pas au reste la patrie de Pythagore, d’Homère, d’Hérodote, et dénombré d’autres grands hommes de l’antiquité, mais sa réputation de terre privilégiée remonterait plus haut, s’il est vrai, comme le dit le savant G. Perrot, que la civilisation ionienne ait été le printemps de la civilisation grecque et qu’elle ait donné les primeurs à l’épopée et à la poésie lyrique.
Le fait certain c’est que son histoire tient de près à celle de l’humanité et que ses origines sont fort anciennes mais assez obscures, on pourrait ajouter. Elle fit partie de l’empire assyrien ; du quinzième au douzième siècle avant notre ère, elle vit la puissance de Troie ; du dixième au sixième elle connut la prospérité sous les rois de Lydie puis elle tomba sous la domination persane. Après, s’ouvre la grande époque où les colonies grecques si florissantes passèrent par des phases diverses, conquises, délivrées, reconquises, libérées enfin par Alexandre-le-Grand au quatrième siècle. Puis vint l’occupation romaine, au troisième siècle, et c’est là que se place l’installation dans la région d’Angora (Ancyre), de Galates, Gaulois entraînés dans les légions romaines, et dont il subsiste encore des descendants facilement reconnaissables.
L’Asie-Mineure resta sous le joug de Rome jusqu’au quatrième siècle après Jésus-Christ. Elle fut annexée à l’Empire d’Orient sous Théodose, conquise en grande partie au septième siècle par les Califes, puis par les Turcs Seldjoukides au onzième. Au Moyen Âge elle eut comme un éclat de prospérité qui ne dura guère qu’un siècle avant l’incursion mongole à laquelle devaient, dans la période suivante, se reproduire diverses invasions désastreuses, car ce pays si riche sous les Romains devait être ruiné par des luttes meurtrières et rester dans un état de demi-abandon, comme il l’est, on pourrait presque dire, encore aujourd’hui même, si l’on songe à ce qu’il pourrait et devrait être. À cette époque du Moyen Âge se rattache le souvenir des mémorables croisades, et ce fut par deux fois entre autres que les croisés traversèrent la péninsule à un siècle d’intervalle avec Godefroy de Bouillon et Frédéric Barberousse qui, au surplus, n’en devait pas revenir.
On peut rappeler au sujet de l’Asie-Mineure, ce mot de l’historien allemand Curtius « Il y a peu de pays où plus d’histoire se soit pressée en moins d’espace », et de fait, aujourd’hui, rien qu’à regarder la carte, partout, on pourrait dire, où se lit le nom d’un village moderne, se lève le fantôme d’une ville antique, suivant l’expression caractéristique du professeur Frédéric Lemoine. Et ainsi qu’il l’ajoute « si un grand nombre de vestiges historiques se trouvent à la surface du sol, ses entrailles en recèlent bien d’autres qui se sont enfoncés sous leur propre poids et celui des siècles. » Ajoutons que dans l’est et dans le centre de la péninsule on trouve surtout des vestiges de la grande époque Seldjoukide, tandis qu’à l’ouest et dans le sud, foisonnent les ruines grecques et romaines, comme nous allons chercher à en donner une idée.