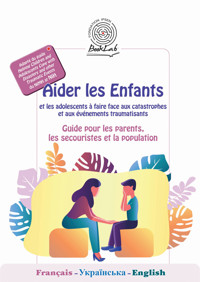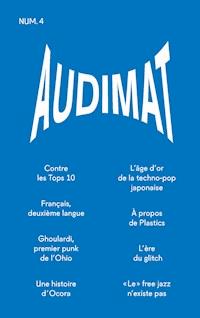
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Revue Audimat
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Découvrez le numéro 4 d'Audimat, une revue musicale qui transcende l'actualité pour apporter un regard de fond sur la musique !
Dans ce numéro :
• « Contre les Tops 10 », Drew Daniel
• « Français, deuxième langue », Agnès Gayraud
• « Ghoulardi, premier punk de l’Ohio », David Thomas
• « Une histoire d’Ocora », Étienne Menu
• « L’âge d’or de la techno-pop japonaise », Olivier Lamm
• « À propos de Plastics », W. David Marx
• « L’ère du glitch » ; Olivier Quintyn
• « "Le" free jazz n’existe pas », Francis Marmande
Un discours critique exigeant sur la pop music, son histoire, son écoute et sa diffusion dans le monde.
EXTRAIT
Contre la quantification du beau : treize raisons pour lesquelles je ne peux choisir mes treize disques préférés.
Pratique embarrassante du journalisme en ligne, contestable dans la forme comme dans le fond, les listicles (néologisme obtenu par la contraction des mots liste et article) sont le douloureux quotidien de l’amateur de musique du troisième millénaire. Attrape-clics, auto-promo, raccourcis problématiques... Ils condensent à eux seuls à peu près toutes les tares de la presse en ligne dédiée à la musique. En septembre 2014, dans les pages de The Quietus, Drew Daniel, moitié du duo électronique Matmos, professeur de littérature américaine et musicophage insatiable, retournait l’exercice, l’éventrait et en extirpait toutes les humeurs, pour mieux en exposer la profonde perversion.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un effort éditorial inédit : des textes sur la musique en long format qui abordent des sujets souvent pointus tout en évitant l’obscurantisme. -
GQ
Une grande réussite grâce à des textes passionnants. -
Global Techno
La revue est vraiment stimulante et se lit d’un bout à l’autre sans ennui. -
L’éditeur singulier
Audimat se lit avec suffisamment d’intérêt et d’excitation pour qu’aucune ligne ne soit laissée de côté. -
Noise
Audimat enterre définitivement les problématiques typiques de la génération des baby-boomers comme « Existe-t-il une critique rock ? » -
Magic
À PROPOS DE LA REVUE
Audimat est une revue de critique musicale éditée par le festival Les Siestes Électroniques.
Notre projet : une écriture sur la musique libérée des contraintes d‘actualité et des formats de la presse périodique. Audimat veut rendre compte de la situation actuelle de la pop music, et l‘éclairer par son histoire. Il s’agit de recenser ce qui se passe, d‘aller s‘entretenir avec la musique et son évolution, de se plonger méthodiquement dans l‘expérience musicale, et dans ce qu‘elle implique sur le plan des médiations, de l’imaginaire, de la société, de la pensée, de l’affectivité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Édito
Depuis son lancement, Audimat essaie de parler de ces choses « complexes » que sont les « émotions liées à la musique », pour paraphraser une des premières lignes de ce numéro. Nous pensons que ce n’est pas parce qu’il est simple de consommer des disques que l’on est obligé de négliger la densité de ce que l’on ressent en les écoutant. Tout comme la joie ou l’excitation procurée par un bon morceau ne doit dispenser de s’interroger sur l’interaction elle-même, sur ses ruses ou son usure.
On le répète encore : être « pointu », comme disent les caves — ou disons plutôt être exigeant, précis, érudit, couper les cheveux en quatre, et donc retourner une évidence, examiner de très, très près une chanson ou un son, digresser ou s’emballer — est une démarche qui vise avant tout à varier, élargir et raffiner les expériences d’écoute et de partage. En les intensifiant, les renversant, les déclinant pour les éprouver différemment. Ce n’est rien d’autre, finalement, qu’une quête de sensations toujours plus riches.
Audimat continue donc avec ce quatrième volume de préférer aux formules définitives auto-satisfaites des textes bien longs, bien touffus, dont il faut parfois relire des phrases pour être sûr de les avoir comprises. Pour ce nouveau numéro, nous avons voulu le retour de deux auteurs amis, Agnès Gayraud et Olivier Lamm, dont la sensibilité continue de résonner avec la nôtre. Mais nous avons également cherché à perméabiliser nos tissus. Aussi sommes-nous honorés d’avoir pu inviter quelqu’un comme Francis Marmande, même si c’est pour qu’il souligne au passage nos illusions. Nous avons également l’honneur de donner la parole à des musiciens, ce que sont également Agnès et Olivier : on retrouvera ainsi David Thomas, leader de Pere Ubu, et Drew Daniel du duo électronique Matmos.
On va donc ici s’intéresser, en vrac, à une « new-wave » japonaise et à un label d’État dédié aux musiques traditionnelles. On s’interrogera sur l’existence du free jazz ou sur les natures du français chanté dans la pop. On exhumera le glitch de la fin des années 1990, mais aussi la carrière d’un animateur d’une télé régionale américaine qui, dans les sixties, a été la principale inspiration de la scène punk de l’Ohio. Et on commence donc, avec Drew Daniel, par démonter l’obsession des classements et des listes, dans un texte aux allures de statement, fragile mais volontaire, dans lequel nous nous reconnaissons forcément.
Pratique embarrassante du journalisme en ligne, contestable dans la forme comme dans le fond, les listicles (néologisme obtenu par la contraction des mots liste et article) sont le douloureux quotidien de l’amateur de musique du troisième millénaire. Attrape-clics, auto-promo, raccourcis problématiques... Ils condensent à eux seuls à peu près toutes les tares de la presse en ligne dédiée à la musique. En septembre 2014, dans les pages de The Quietus, Drew Daniel, moitié du duo électronique Matmos, professeur de littérature américaine et musicophage insatiable, retournait l’exercice, l’éventrait et en extirpait toutes les humeurs, pour mieux en exposer la profonde perversion.
Il y a quelques semaines, The Quietus m’a demandé d’écrire pour sa rubrique « Baker’s Dozen » [« Treize à la douzaine »], un exercice léger consistant à choisir mes treize enregistrements préférés, à écrire un court paragraphe sur chacun d’entre eux, et voilà*, mission accomplie. Je me suis souvent prêté à ce genre d’exercice par le passé, alors pourquoi ne pas retenter ? Je me suis attelé à la tâche, passant mentalement en revue quelques-uns des disques qui ont compté pour moi, tapant quelques noms sur mon clavier. Puis, subitement, j’ai dû m’arrêter. Je ne pouvais pas continuer. Mon cerveau refusait obstinément cette idée, la recrachant comme une bouchée de nourriture avariée. J‘étais mal à l‘aise à l‘idée d‘alimenter le monceau de listes spécieuses qui jonchent désormais notre culture de la musique en ligne. Mal à l’aise de jouer à ce jeu-là avec quelque chose d’aussi complexe que mes émotions liées à la musique, d’isoler quelques élus, de laisser entendre que ces treize enregistrements seraient pour une raison ou pour une autre les meilleurs. Les meilleurs à quoi ? Dans quel but ? J’ai donc demandé à écrire plutôt sur ce rejet entêté, on m’a répondu que ça ferait l’affaire. Voici donc les treize raisons pour lesquelles, précisément, je refuse de choisir mes treize disques préférés.
1. Promotionnel donc biaisé.
Les musiciens qui évoquent leurs disques préférés peuvent être drôles, vulnérables et charmants : ils se fendent de lettres d’amour aux disques qui les ont sauvés, aidés, fait avancer, inspirés, bousculés, à ceux qui leur ont résisté ou à ceux qui leur sont restés farouchement inaccessibles mais vers lesquels sans cesse ils reviennent. Mais trop souvent, il ne s’agit que d’une énorme imposture : ces artistes réécrivent leur propre histoire, en façonnant leur image pour le lecteur, leur belle âme, leur « bon goût », leur accès à des choses rares et obscures, réservées aux initiés, leur pertinence sur la scène X ou leur statut de porte-parole d’une communauté Y. Les transactions « couverture médiatique contre travail » sont aujourd’hui monnaie courante dans cette nouvelle économie du partage ; les artistes produisent gratuitement du contenu pour les sites web, en échange d’une validation implicite de leur image publique par les sites en question. Il se dégage un âcre et nauséabond parfum de narcissisme lorsqu’un artiste écrit sur lui-même. Il ne fait aucun doute que listes et tops font office d’autoportraits indirects, et, dans un sens, d’exercices d’auto-marketing. Lana Del Rey susurrant dans « Brooklyn Baby », avec un détachement savamment étudié, qu’elle possède une « collection de disques de jazz rares » est un exemple douloureusement parlant. L’infortunée narratrice est transparente, c’est bien Lana qui parle. Faire ainsi publiquement étalage de ses goûts a quelque chose de suspect et de foncièrement intéressé.
2. Le « disque préféré », une idée conceptuellement incohérente.
Dans son essai « The Irreducible complexity of objectivity » [1], la philosophe Heather Douglas soutient que le mot « objectivité » possède au moins huit acceptions distinctes, sans qu’aucune ne soit équivalente à une autre, et que toutes sont, pour reprendre ses mots, « opérationnellement accessibles ». On pourrait en dire autant du mot « préféré », en le décomposant en autant des sens qu’il peut adopter. L’expression « disque préféré » signifie-t-elle « un disque qui a eu un impact profond sur ma perception de ce que peut être la musique » ? Signifie-t-elle « un disque que j’ai adoré avec la plus grande intensité subjective à un moment-clé de ma vie » ? Signifie-t-elle « un disque dont l’acuité du propos en tant qu’œuvre d’art m’a frappé » ? Signifie-t-elle « un disque que j’écoute fréquemment et avec constance depuis des années » ? Signifie-t-elle « un disque dont je souhaite assurer la survie culturelle envers et contre tout » ? Chacun de ces sens envisageables appelle au moins une objection basique. Pourquoi les influences contextuelles de l’un devraient avoir du sens pour un autre ? Pourquoi s’y fier ? Que signifie la « réussite » quand on évoque une œuvre d’art ? Comment mesurer l’intensité d’une expérience esthétique ? Pourquoi le nombre d’écoutes serait-il à corréler avec la qualité ? Passé au tamis de tous ces sens particuliers, l’épithète « préféré » s’avère d’un manque de précision inquiétant. Si l’on considère le nombre incommensurable de ses définitions potentielles et l’improbabilité qu’un seul mot puisse les contenir toutes, le concept même de « disque préféré » est voué à une incohérence fatale et il serait plus avisé de l’abandonner.
3. Une démarche en réalité souvent raciste ou sexiste...
Sans donner de noms, on connaît tous ces Tops 10 dans lesquels un producteur mâle et blanc est censé produire une liste de ses albums préférés : il établit alors consciencieusement une liste des Grands Chefs-d’œuvre de l’Homme Blanc. La pseudo objectivité de la liste, et ses prétentions numériques à établir les supposés meilleurs, transforme de facto un espace dévolu à la célébration de l’art en tribune dédiée à la célébration de mâles blancs par d’autres mâles blancs. Soyons clairs : je suis un homme blanc, et de surcroît, j’enseigne Shakespeare, je gagne donc ma vie en étant un homme blanc vantant les mérites d’un autre homme blanc à qui veut bien écouter. Mais ce faisant, je ne défends pas l’affirmation absurde qui voudrait que Shakespeare soit « le plus grand auteur de langue anglaise », car je pense que l’expression « le plus grand » n’est rien d’autre qu’un raccourci facile pour englober un ensemble bien précis, très balisé, d’hypothèses, de pratiques historiquement spécifiques, de débats critiques toujours en cours, et de bourbiers méthodologiques concernant les critères du jugement esthétique. J’aime la littérature, mais je n’aime pas que l’on parle de ses « plus grandes » figures, et pour exactement les mêmes raisons, je n’aime pas que l’on parle des « plus grands » groupes de punk rock, des « plus grandes » divas house ou des « plus grands » chanteurs honky tonk. Quand on adosse ce discours de domination à une longue tradition patriarcale et raciste, on choisit de renforcer une façon de classer les êtres humains en terme de supériorité et d’infériorité, de gagnants et de perdants, de meilleur et de pire. Qui entre ? Pourquoi ? Qui reste à la porte ? Pourquoi ?
4. … qui, par réaction, entraîne des postures artificielles.
Sans donner de noms, on connaît tous ces Tops 10 dans lesquels un artiste respecté associé au genre Y se fend d’une liste de huit ou neuf « classiques » révolutionnaires et influents, directement issus du genre en question, dans laquelle, pour donner un peu de relief, il glisse timidement une ou deux œillades aux genres X ou Z. Le contenu évolue avec les décennies, par exemple l’option dite du « compositeur-classique-qu’il-est-cool-d’aimer-pour-un-fan-de-rock » (salut Messiaen, adieu Gorecki). Mais la posture un peu forcée reste la même. Il serait mesquin et injuste de prétendre que tel artiste rockabilly n’aime pas vraiment Kind of Blue de Miles Davis, ou que ce chanteur folk n’apprécie pas tant que ça Enter the 36 Chambers du Wu-Tang Clan, ou que cet austère producteur de glitch n’est pas réellement fan du Reign in Blood de Slayer. Mais dans chaque cas, cette diversité spécieuse (même si bien intentionnée) n’amène pas réellement le lecteur à explorer le genre en question, les artistes choisis étant généralement des incontournables au sein de leur scène, de leur communauté ou de leur profil démographique. Ces postures artificielles et transparentes sont vaines.
5. Ignorer ses amis est malhonnête, les classer est malsain.
Vous vous souvenez de MySpace ? Vous vous rappelez de la rubrique Top 8, dans laquelle vous deviez choisir vos huit amis préférés ? De la cruauté crasse du procédé, aussi minuscules qu’en soient les enjeux ? En quoi choisir ses enregistrements préférés serait-il moins embarrassant ? Si vous répondez « Euh, parce que les disques ne sont pas des gens dont les sentiments peuvent être heurtés », c’est que vous n’avez jamais remarqué que les musiciens ont tendance à être amis avec d’autres musiciens, et collaborent souvent avec, ou sont influencés par, des musiciens qui deviennent leurs amis ou même intègrent leur groupe. Lister mes disques préférés en excluant les albums de mes amis serait malhonnête et mensonger. Je ferais semblant de ne pas avoir parmi mes disques préférés ceux de mes amis. Mais de la même manière, la perspective d’en glisser dans la liste et d’en laisser d’autres de côté me hérisse. Une telle complexité émotionnelle s’ajuste mal à cette logique d’exclusion qui limite à treize le nombre de places à table. L’idée de quantifier son amour et ses liens amicaux en public est horripilante.
6. Écoute et appréciation évoluent avec le temps.
Au lieu de vous engager pour le reste de votre vie aux côtés de Jésus, Satan ou Bouddha, vous pouvez vous en remettre totalement à un burrito pour une journée, à un tableau déniché dans une brocante pour une semaine, ou au toutou d’un inconnu croisé dans la rue pour une heure. Il m’est arrivé, certains jours, d’être follement épris de Driicky Graham ou des Limiñanas, et de presser inlassablement, béat, le bouton « play ». Mais un mois plus tard, la donne peut très bien avoir totalement changé. L’exercice qui consiste à choisir ses favoris passe sous silence ces toquades, ces curieux engouements se déployant dans nos panthéons personnels. On privilégie les classiques indéboulonnables, ceux qu’on écoute en toute occasion, au détriment des rencontres d’un soir, des passions fulgurantes qui nous agitent périodiquement. Mais la courte durée de cette ferveur n’efface pas l’intensité de l’investissement dans le moment, et seule la projection fantasmée d’un « soi stable » (une illusion) amène les gens à ne pas les citer quand des listes sont établies et soumises aux autres.
7. Nos disques préférés peuvent s’avérer très ennuyeux. À dessein.
Peut-on ranger dans ses préférés un disque dont on sait qu’il n’a rien de transcendant ? La réponse honnête serait oui. Comme la plupart de ceux qui travaillent assis à leur bureau à fixer un écran jour et nuit, je passe des heures entières de ma vie à écouter délibérément de la musique qui n’exige rien de moi, pleinement conscient que son vide et son absence de qualités notables (ruptures de ton, arrangements changeants, voix marquantes, évolution de la dynamique, puissants solos) en font précisément l’intérêt : elle offre assez d’activité pour éviter un silence oppressant, mais sans jamais s’imposer. Je dispose ainsi d’une sélection de disques propices à la concentration, qui m’aident à écrire, et je leur en suis très reconnaissant. Mais les étiqueter « préférés » représenterait mal l’usage que j’en fais, je ne leur accorde pas vraiment de l’attention pour ce qu’ils sont : je les condamne à ronronner à faible volume pendant que je travaille. Se lover dans un bruit de fond délibérément dénué d’ambition, presque négligeable, est un type de non-écoute qui induit aussi des préférences, puisque certains disques sont plus à même de remplir cette fonction que d’autres. Mais nous faisons peu de cas de ces préférences-là. Ce genre de disques a donc tendance à être ignoré quand les gens doivent parler de leurs goûts ; ceux qui font des listes les veulent pleines de choses excitantes. Ce qui mène à encore plus de malhonnêteté et de postures, puisque, penauds, ils font l’impasse sur les mornes exigences de fonctionnalité de la vie moderne.
8. Des expressions comme « meilleur » ou « pire » ne peuvent s’appliquent à l’art.
Question : Il est bien, l’album On the Beach de Neil Young ?
Réponse : C’est son meilleur !
Vous pensez que ce n’est pas une bonne réponse ? Vous avez raison. L’emploi du mot « meilleur » est un pis-aller pour désigner un tourbillon d’émotions, une histoire spécifique, un frêle écheveau de critères, relayés par une personne évoluant en permanence, au fur et à mesure que de nouvelles expériences la façonnent. Tout ceci est intéressant. Sauf le mot « meilleur ». Si son utilisation est discutable, il en va de même pour les locutions « meilleur que » ou « moins bon que » dont nous abusons pour justifier de la présence ou de l’absence d’un disque sur une liste. Chaque disque porte en lui les termes selon lesquels il doit être jugé. Certains visent haut et se ramassent, d’autres sont plus modestes et emportent la mise, mais qui décide ce qui constitue ces supposés succès ou échecs ? En premier lieu, de quel point de vue détermine-t-on que l’objectif est ambitieux ou modeste ? Que signifie « facile » ou « difficile » quand on fait de l’art ? Un disque à l’ambition supposément modeste est-il nécessairement moins bon qu’un disque qui prend d’énormes risques et tente des choses follement ambitieuses ? Si l’on considère la somme de travail, un album de drone avec des paroles inintelligibles sur la drogue marmonnées sur deux accords est plus facile à faire qu’un cycle de chansons plein d’esprit sur l’impérialisme américain, porté par des arrangements de cordes inspirés du calypso et des steel bands trinidadiens. Et alors ? Certains jours, The Sound of Confusion des Spacemen 3 m’apparaît clairement meilleur que Discover America de Van Dyke Parks. D’autres jours, l’inverse est tout aussi vrai. À aucun moment ces appréciations fluctuantes ne sont autre chose qu’un rapport subjectif de l’état de mes lubies, de mes plaisirs et de mes besoins. Faire des listes entretient l’illusion que ces lubies sont des faits qui méritent d’être rapportés.
9. Les gens mentent à propos de ce qu’ils écoutent vraiment.
Lorsque j’ai débuté ma liste finalement abandonnée, elle penchait nettement en faveur d’une sélection ésotérique des disques de musique industrielle britannique que j’écoutais en boucle durant ma jeunesse : Nurse With Wound, Coil et Throbbing Gristle constituent ma sainte trinité, j’ai passé des décennies à écouter leurs œuvres, à collectionner leurs enregistrements et à écrire sur eux. Leurs albums figureraient sans aucun doute dans n’importe quelle « liste d’albums préférés » que je pourrais penser à compiler. Sans hésitation. Et vous savez qui ne serait pas sur cette liste ? Beck. Nan. Pas moyen. Mais si je regarde sur mes différents ordinateurs et que je vérifie le nombre de plays sur iTunes, il semble que je nourrisse un étrange amour à répétition pour un sacré paquet de morceaux de... Beck. « Drew Daniel, fan de Beck » ne cadre pourtant pas avec l’idée que je me fais de moi. Je n’ai rien en particulier contre le gars (je l’ai rencontré backstage lors d’un concert de Björk à L.A. il y a des années et il était vraiment charmant), mais il ne me vient pas à l’esprit quand je fais le point sur mes goûts. Pourtant iTunes tente de me dire que Beck est un de mes artistes préférés, une affirmation contre laquelle mon esprit bute : je me cherche aussitôt des excuses, psalmodiant des paroles de Beherit en me bouchant les oreilles, brandissant frénétiquement mes cassettes de Sonny Sharrock et mes vinyles de Swimming Behavior of the Human Infant, dans l’espoir de sauvegarder ce qui peut l’être de ma crédibilité de hipster amateur de bizarreries. Pourquoi être sur la défensive et me comporter aussi connement ? Que nous disent mes réticences gênées quant à l’impossibilité des classements à s’aligner sur nos réelles habitudes d’écoute ?
10. Avoir des préférences est conservateur.
Et si s’amuser à choisir ses favoris n’était qu’une tentative de déjouer les embuscades de l’art, d’éviter qu’il nous surprenne ou nous déstabilise ? Les listes de disques préférés peuvent être des remparts que les gens – particulièrement les plus âgés d’entre eux – dressent pour se protéger des changements, du futur, de la force éruptive de ce que l’on ne choisit pas par soi-même mais qu’il peut s’avérer bénéfique d’entendre quand même. Je suis assez vieux pour avoir survécu à de nombreuses, très nombreuses vagues de modes et de hypes, à des ascensions et des chutes au sein de l’industrie musicale, tandis que suivent paisiblement leur cours des sagas dynastiques et que s’enchaînent les cycles capitalistes d’expansion-récession. Si je m’accroche encore aussi fermement au premier album de Die Kreuzen, au Seismogramm de G*Park, au Can You Party ? de Royal House, à ma cassette de Flag of Hate de Kreator ou au More Bounce to the Ounce de Zapp après toutes ces années, doit-on vraiment louer mon admirable fidélité et mon inébranlable constance ? Cela pourrait tout aussi bien être une façon de me vacciner contre les chocs esthétiques induits par de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles scènes, de nouvelles façons d’être réceptif, curieux et vulnérable face au monde. Et si ces « animaux empaillés » totémiques et adorés au sein de ma collection de disques ne m’aidaient pas à être un meilleur auditeur ou un meilleur artiste, mais formaient au contraire une espèce de carapace, une entrave ? Pourquoi les imposer aux autres et ce faisant tout réduire à une monoculture ?
11. Il s’agit d’une commande émanant d’une structure qui vit grâce à la publicité.
Même un enfant sait ça, il y a une trame capitaliste évidente qui sous-tend la popularité des listes (oui, c’est de toi que je parle, Buzzfeed) : en cliquant consciencieusement pour progresser dans une liste, vous augmentez le nombre de pages vues du site qui l’héberge, et ainsi quantifiez et aidez à valoriser sa capacité à vendre l’attention de ses lecteurs à des annonceurs avides. Le format liste est la façon la plus simple pour un site de faire fructifier vos globes oculaires surexcités. Cette structure impacte aussi la façon dont on nous soumet le contenu. Qu’il s’agisse d’Esquire qui me promet les « 50 chansons que tout le monde devrait avoir écouté » ou du Telegraph m’agitant sous le nez les « 50 meilleures chansons d’amour des eighties », ou encore du Guardian qui organise une ambitieuse marche forcée à travers les « 1000 chansons qu’il faut connaître » pour un lectorat épuisé, les questions de goût musical ne sont pas adaptées à ce type de grande échelle. De combien de chansons d’amour avons-nous besoin ? (Ne pas répondre si vous êtes membre des Magnetic Fields.) 10 ? 50 ? 500 ? 1000 ? Si 50 peut paraître un peu mince pour englober dix années d’amour et que 1000 peut sembler une exténuante corvée musicale, le vrai problème réside dans l’utilisation de ces insistantes formes verbales que sont « devrait » et « doit ». Devrait pourquoi ? Doit, sinon quoi ? À quelles fins ? L’implicite « ... avant de mourir » de ces listes est une arnaque agressive destinée à jeter, de manière précoce, un funeste linceul sur le lecteur. Cette idée que les listes constituent un genre de « Solution finale au problème musical » est perverse ; ceux qui suivent les dernières évolutions du journalisme musical le savent, ce postulat morbide déprimant est omniprésent. Que l’on titre une bonne fois pour toutes une compilation de standards « Vite, écoutons tous ensemble les mêmes classiques canoniques maintenant ! », et que l’on en finisse. Ce sentiment de devoir atteindre la ligne d’arrivée de la consommation, que vous allez manquer de temps et que vous aurez raté un truc essentiel si vous n’engloutissez pas les morceaux préférés des célébrités-qui-se-la-racontent A, B et C est absurde. Les sites web les adorent car elles actionnent le levier « Peur de rater quelque chose » pour faire de l’argent. Mais faites une pause et réfléchissez quelques secondes, vous ne tomberez plus dans le panneau de ces tactiques.
12. L’investissement personnel dans la musique n’est pas transférable.
Même si en apparence, il s’agit d’individualité et de l’attrait d’une distinction personnelle toute bourdieusienne (hey ! t’as vu comme j’ai bon goût ?), la débauche de listes en ligne semble dictée par un impératif contraire : tout ce qui peut être partagé doit être partagé, pour l’éternité, amen. Mais si des références et des recommandations peuvent être partagées, les expériences qui les sous-tendent et leur offrent une résonance, une signification et une force sont, elles, moins facilement transférables.
L’art n’est pas inerte, pas plus que nous ne le sommes lorsque nous le croisons. Si mon expérience du « Careless Whisper » de George Michael a été colonisée par la vidéo virale de sa reprise par le Sexy Sax Man, mais que vous n’avez pas encore goûté à ce plaisir douteux, partageons-nous vraiment une expérience similaire lorsque nous entendons ce riff de sax ? Ou bien le voile de ma subjectivité coloret-il pour moi cette œuvre d’une manière qui n’est pas vraiment transférable à d’autres ? Je peux faire des recommandations à longueur de journée, mais n’y a-t-il pas quelque chose d’irréductiblement personnel là-dedans ? Nos ressentis au sujet des chansons peuvent être indéfiniment refaçonnés, tout comme les chansons elles-mêmes. Elles ne sont pas simples, pas plus que les voies complexes qu’elles empruntent lorsqu’elles sont utilisées, détournées, reprises, remixées, partagées, piétinées, transmises, transposées, ignorées, adorées ou sorties de l’oubli. Mais le mandat « Voilà ma chanson préférée, maintenant tu DOIS l’écouter » suppose que vous allez en retirer la même chose que moi. Ce qui est faux.
13. Conclusion : l’utilisation de chiffres pour évaluer et classer la musique est une mauvaise chose.
Avant tout, en tant que musicien, je n’aime pas que l’on accole des chiffres à une expérience de l’art. Cela pourrait s’avérer rassurant si c’était simplement anecdotique, mais c’est activement nocif, dans la mesure où cela réifie ce qui est ineffablement subjectif (manière sophistiquée de dire que cela érige préjugés et opinions en évidences factuelles et concrètes). Cela prête un faux poids culturel et une force définitive à des humeurs et des engouements critiques passagers, récompensant des disques consensuels, faciles à aimer, qui utilisent toujours les mêmes recettes pour stimuler les récepteurs du plaisir, tout en écartant les ambitieux, les récalcitrants et les bizarres.
Certes, les classements numériques d’un critique intelligent et chevronné ne relèvent pas forcément du caprice aléatoire (et ne sont probablement pas que pur sadisme, comme s’en plaignent certains artistes paranoïaques), mais cela ne résout pas le problème conceptuel que constitue l’idée qu’un système métrique puisse rendre justice à la profusion sauvage de manières existantes d’appréhender l’art, ni le fond du problème : l’écoute est subjective. Le 8.2 de l’un sera pour un autre un petit 7, qui sera pour un autre un zéro pointé, qui sera pour un autre le gif animé d’un primate en train d’uriner. De tels gestes de quantification atteignent le reductio ad absurdum