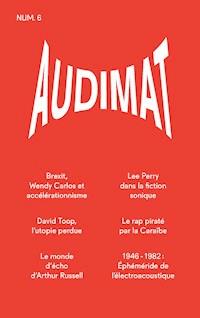
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Revue Audimat
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Découvrez le numéro 6 d'Audimat, une revue musicale qui transcende l'actualité pour apporter un regard de fond sur la musique !
Dans ce numéro :
• « Brexit, Wendy Carlos et accélérationnisme », Adam Harper
• « David Toop, l'utopie perdue », Simon Reynolds
• « Le monde d‘ échos d'Arthur Russell », Tim Lawrence
• « Lee Perry dans la fonction sonique », Kodwo Eshun
• « Le rap piraté par la Caraïbe », Nicolas Peillon
• « 1946-1982 : Éphéméride de l'électroacoustique », W. David Marx
Un discours critique exigeant sur la pop music, son histoire, son écoute et sa diffusion dans le monde.
EXTRAIT
On se dit parfois qu’écrire sur la musique procède d’une volonté de pacifier les débats, d’organiser un consensus sensible. Or la musique peut ne pas poser de problèmes. L’indifférence ou le mépris face à tel tube ou tel « phénomène » en restera à l’expression ponctuelle d’un dégoût ; parfois, rarement en fait, une performance de drone tournera à l’esclandre, puis chacun rentrera chez soi en ayant trouvé l’épisode étrange et même exotique. Peut-être alors que c’est la meilleure musique qui se charge de nous créer des problèmes, et en particulier des problèmes nouveaux. Telle nouveauté fait vieillir tout ce à quoi on s’était attaché jusqu’ici, tel classique rappelle que le monde fascinant qu’il a levé à l’écoute n’aura jamais de suite, dans la musique ou dans la vie. Parfois, écrire sur la musique, ce n’est pas construire un « safe space » entre amateurs éclairés, mais partager plus largement un peu du mal que la musique nous fait.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un effort éditorial inédit : des textes sur la musique en long format qui abordent des sujets souvent pointus tout en évitant l’obscurantisme. -
GQ
Une grande réussite grâce à des textes passionnants. -
Global Techno
La revue est vraiment stimulante et se lit d’un bout à l’autre sans ennui. -
L’éditeur singulier
Audimat se lit avec suffisamment d’intérêt et d’excitation pour qu’aucune ligne ne soit laissée de côté. -
Noise
Audimat enterre définitivement les problématiques typiques de la génération des baby-boomers comme « Existe-t-il une critique rock ? » -
Magic
À PROPOS DE LA REVUE
Audimat est une revue de critique musicale éditée par le festival Les Siestes Électroniques.
Notre projet : une écriture sur la musique libérée des contraintes d‘actualité et des formats de la presse périodique. Audimat veut rendre compte de la situation actuelle de la pop music, et l‘éclairer par son histoire. Il s’agit de recenser ce qui se passe, d‘aller s‘entretenir avec la musique et son évolution, de se plonger méthodiquement dans l‘expérience musicale, et dans ce qu‘elle implique sur le plan des médiations, de l’imaginaire, de la société, de la pensée, de l’affectivité.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Édito
On se dit parfois qu’écrire sur la musique procède d’une volonté de pacifier les débats, d’organiser un consensus sensible. Or la musique peut ne pas poser de problèmes. L’indifférence ou le mépris face à tel tube ou tel « phénomène » en restera à l’expression ponctuelle d’un dégoût ; parfois, rarement en fait, une performance de drone tournera à l’esclandre, puis chacun rentrera chez soi en ayant trouvé l’épisode étrange et même exotique. Peut-être alors que c’est la meilleure musique qui se charge de nous créer des problèmes, et en particulier des problèmes nouveaux. Telle nouveauté fait vieillir tout ce à quoi on s’était attaché jusqu’ici, tel classique rappelle que le monde fascinant qu’il a levé à l’écoute n’aura jamais de suite, dans la musique ou dans la vie. Parfois, écrire sur la musique, ce n’est pas construire un « safe space » entre amateurs éclairés, mais partager plus largement un peu du mal que la musique nous fait.
Ce numéro commence par des textes qui concernent la façon dont la musique incarne des utopies, ou plutôt des promesses, qui ont la mauvaise tendance soit à mal vieillir, soit à mal finir. Quand le Brexit met en doute le lien entre fraternité et émancipation, la version de l’Hymne à la joie par Wendy Carlos se superpose à l’originale de Beethoven pour couvrir son harmonie de résonances presque sarcastiques. Avec David Toop, on a pu croire un temps que les microsounds et la réinterprétation imaginaire des folklores mondiaux annonçaient une nouvelle liberté culturelle et politique, mais ce n’est évidement pas ce qui s’est passé.
Dans ces musiques et dans ces textes, pourtant, il y a quelque chose qui ne s’éteint pas tout à fait. Ce sont les styles, les projets de contamination sensible qui cherchent des ouvertures. En creusant la matière sonore et les mots, comme quand Kodwo Eshun exagère l’histoire de Lee Perry par des effets et des filtres langagiers dépaysants, à la limite de l’absurde. En faisant grimacer les mots pour Young Thug, Future et leur progéniture, chez lesquels on perçoit les spectres du vaudou, comme autant de vanités cachées dans la célébration de la marchandise. En jouant du violoncelle au bord des scènes mondaines, comme Arthur Russell l’a fait avant de devenir une icône posthume. Ou en organisant patiemment des alternatives, tout en se méfiant du goût de l’institution pour le neuf : dans sa micro-histoire précise et apaisée de la musique concrète et électroacoustique, écrite en 1982, Michel Chion parle surtout des collectifs d’individus qui, au moins pendant un temps, ne se sont pas lassés d’essayer de faire autrement.
Merci de nous lire et de partager nos problèmes.
Auteur d’Infinite Music (Zero Books, 2011), collaborateur de The Fader et accessoirement d’Audimat, puisqu’il participait déjà à notre numéro un, le Britannique Adam Harper, comme nombre de ses compatriotes, s’est réveillé un beau matin de juin dans le Royaume-Uni du « Leave », un air entêtant à l’esprit : l’ Hymne à la joie de Beethoven revisité par Wendy Carlos. Il en a tiré ce texte court et nerveux, en forme de manifeste esthético-politique, écrit à l’origine pour le site du festival 3hd, qui tente finalement de répondre à une question cruciale : comment la musique, prise dans sa dimension sensible, peut servir de ressource pour appréhender les turbulences qui agitent notre monde ?
Ce soir-là, nous sommes allés nous coucher dans un état d’excitation certain, cette excitation que l’on ressent en contemplant, bien au chaud à l’intérieur, l’orage qui dehors gronde et menace. Non, le Royaume-Uni ne voterait pas pour son départ de l’Union Européenne alors même que celui-ci constituerait un monstrueux désastre, une tragédie.
Pareille folie ne peut survenir que dans la fiction. Dans la vraie vie, au bout du compte, les gens finissent toujours par voter avec plus ou moins de bon sens et rien de grave n’arrive jamais vraiment. Ce soir-là cependant — cette semaine-là même —, il était à la fois étrange et stimulant d’imaginer que cela puisse être le cas. Mais les catastrophes, de celles qui réduisent en pièces le futur, se produisent parfois. La foudre s’abat vraiment. Je me suis réveillé aux alentours de quatre heures du matin, et dans un brouillard semi-conscient, entre rêve et réalité, je suis allé consulter mon téléphone. Le « Leave » était légèrement en tête. Je me suis dit que les votes des grandes villes n’avaient pas encore été décomptés, voilà tout. Ou quelque chose du genre. Tandis que j’émergeais des ténèbres, une ritournelle s’est imposée à moi — un de ces morceaux qui vous tournent dans la tête encore et encore, qui vous exhortent à les siffloter, à les écouter, à taper leurs noms dans Google. Il s’agissait du dernier mouvement de la Neuvième Symphonie de Beethoven, l’Hymne à la joie, mais dans la version arrangée par Wendy Carlos pour synthétiseurs Moog et vocoder, celle qui est utilisée dans Orange mécanique. Un morceau bizarre, énorme et tourbillonnant, qui ne vous laisse aucun répit, mais sonne en même temps étrangement kitsch et enfantin ; par moments, ses lignes s’entrecroisent sans fin, organiquement, et à d’autres, elles évoquent les cliquetis synchrones d’une parade de jouets mécaniques, avant d’être tout entières absorbées par la clameur, à la fois triomphale et distante, des voix au cœur des circuits. Cet air entêtant m’a poursuivi jusqu’au lendemain et toute la semaine suivante, se faisant plus insistant encore à mesure que se précipitaient les évènements au Royaume-Uni. Aux infos, Nigel Farage proclamant la victoire du « peuple réel » (par opposition, j’imagine, au peuple irréel, surréel voire hyperréel). La voix de David Cameron se brisant tandis qu’il réitérait sa foi en un Royaume-Uni terre d’accueil, avant de démissionner. Les discours froids, austères, clairement pusillanimes après une telle victoire à la Pyrrhus, de Boris Johnson et Michael Gove, tenants conservateurs du Brexit (qui allaient tous deux, contre toute attente, se débiner dans la course au poste de Premier ministre). Les centaines de rapports faisant état d’actes xénophobes à travers tout le pays. La gauche du parti travailliste en plein chaos, des douzaines de parlementaires se retournant contre le leader socialiste récemment élu, convaincus que le parti devait dorénavant proposer un « projet progressiste contre la liberté de circulation ». Très vite, je me passais la version Carlos de Beethoven en boucle et à plein volume.
La Neuvième symphonie de Beethoven est l’une des œuvres musicales les plus complexes de l’histoire. Par là, je n’entends pas que la musique en elle-même est compliquée — ces notes d’apparence neutres sur le papier — même si en son temps, on n’avait encore jamais rien entendu de tel. Non, je veux dire par là que son destin dans l’histoire s’est chargé d’en complexifier la perception.
Il semble que l’Hymne à la joie de Beethoven ait accumulé un passif culturel et politique venu de tous bords et tout particulièrement des extrêmes. Il a endossé à la fois le rôle de quintessence de ce que l’humanité a de plus noble et celui d’incitation à la violence la plus abominable. Accessoirement, c’est aussi l’hymne de l’Union Européenne.
Composée en 1823, la Neuvième Symphonie est profondément enracinée dans le Romantisme occidental : le monde des génies, des grands hommes et de leurs luttes avant-gardistes pour imposer une vision sublime, grandiose et triomphale de l’âme humaine et de sa place dans l’univers. Une conception de l’Art dont l’influence est aujourd’hui encore très vivace, notamment dans la musique populaire. Mais l’histoire ne débute vraiment qu’à la mort de Beethoven, quand la Neuvième entre dans la légende. Le compositeur Richard Wagner, dont l’antisémitisme est aujourd’hui avéré, chante alors ses louanges et voit en Beethoven un héraut de la musique allemande ; par son utilisation révolutionnaire de la voix dans sa symphonie, il a ébauché le modèle de l’œuvre d’art du futur que Wagner tente de produire dans ses propres opéras. La Neuvième a été un outil de propagande aussi important pour les nationalistes que pour les adeptes d’un humanisme transnational. Elle était jouée pour les anniversaires d’Hitler, dont elle était l’une des symphonies préférées, mais elle résonnait aussi dans les camps de concentration. On l’a entendue sur la place Tiananmen, à la chute du mur de Berlin, après le 11 septembre 2001. Dans les années 1970, elle est devenue aussi bien l’hymne de l’État colonial raciste de Rhodésie que de l’Union Européenne. En 1971, interprétée par Wendy Carlos, elle sert de bande originale à Orange mécanique. L’Hymne à la joie revu par Carlos fait à la fois saillir et renforce encore le caractère complexe et contradictoire de la pièce.
Sur son album Switched-On Bach (1968), la musicienne offrait aux pièces pour clavier de J. S. Bach des arrangements pour Moog. L’album connut un immense succès et constitua une avancée décisive pour la musique électronique grâce à une juxtaposition jusqu’au-boutiste du « classique » et du « moderne », comme s’il avait fallu aux auditeurs un peu de ce qu’ils connaissaient déjà pour les aider à accepter ce qu’ils ne connaissaient pas encore. Giorgio Moroder, producteur du séminal « I Feel Love » de Donna Summer, cite d’ailleurs Switched-On Bach comme étant l’origine de son goût pour les synthétiseurs. Le disque captura également l’imagination de Stanley Kubrick, habitué, lui, à puiser dans la musique classique pour illustrer ses films. La musique électronique a attiré, et attire encore, un nombre particulièrement important de membres de minorités, qu’elles soient raciales, sexuelles ou de genres. Elle est (ou était) ce monde nouveau au sein duquel règles et conventions n’ont pas encore été écrites, un monde entré en résonance avec ces déclassés quand les vieux schémas esthétiques éculés n’en étaient plus capables. Wendy Carlos a débuté sa transition de genre à la fin des années 1960, à une époque où ce genre de choses était encore rare. Jusqu’à la fin des années 1970, elle a sorti de la musique et s’est produite en public sous le nom de Walter Carlos, choisissant même d‘arborer une fausse pilosité faciale. Aujourd’hui, le genre non-normatif et la représentation sexuelle sont des éléments clés dans la musique électronique underground qui en explore et exprime les souffrances comme la liberté. Dans le roman L’Orange mécanique[1], l’Hymne à la joie inspire largement le comportement violent du protagoniste principal, le délinquant juvénile Alex (au cours de la décennie suivante, la musicologue Susan McClary affirmera d’ailleurs qu’un passage intervenant plus tôt dans la symphonie exprime « la rage meurtrière du violeur »). Si Carlos a remplacé l’orchestre par des synthétiseurs, pour les paroles elle a porté son choix sur le vocoder. Une machine aussi politiquement chargée que la symphonie elle-même : durant la Deuxième Guerre mondiale, le vocoder était secrètement employé pour encrypter des données envoyées autour du monde, dont l’ordre d’attaque sur Hiroshima. Les raisons et les significations qui se cachent derrière l’électronification de l’Hymne dans Orange mécanique sont volontairement ambigües, comme une forme de provocation. Peut-être, à l’instar du lait coupé aux drogues bu par les protagonistes du film, s’agit-il d’un Beethoven factice, plastique, une perversion épousant le point de vue biaisé d’Alex, la modernité scientifique dévoyée et la déroute morale du monde dans lequel il évolue ? Opter pour cette lecture serait éclairer l’art de Carlos d’une lumière peu flatteuse et, d’une certaine manière, pourrait s’apparenter à de la transphobie. Ce Beethoven synthétique pourrait tout aussi bien être interprété comme un rejet, une mise à distance du familier et du traditionnel, une façon de le faire entrer dans un monde nouveau, de le révéler sous un jour nouveau, bon ou mauvais (ou les deux). En outre, plus tard dans le film, l’Hymne à la joie sera bien sûr retourné contre Alex : le gouvernement instille en lui une réponse pavlovienne à la violence par la torture de la technique Ludovico — ses yeux sont maintenus ouverts de force tandis que défilent devant lui des images de violence et que résonne l’Hymne jusqu’à la nausée — dans une tentative de lui enseigner viscéralement que la violence, c’est mal. À la suite de quoi, comme le déplore dans le film une faction politique opposée, la joie et le libre arbitre qui le définissaient en tant qu’être humain le quittent, soit des valeurs précisément représentées par l’Hymne à la joie — même si celui-ci est corrompu au point de favoriser l’affirmation de soi jusqu’à la violence.
Orange mécanique n’est pas un film dont la conclusion offre une morale facile : la liberté par la violence ou l’oppression par la violence. De la même façon, la musique de Carlos hésite entre différence et rejet.
La version de l’Hymne à la joie par Carlos contient et intensifie tous les problèmes liés à la Neuvième, comme œuvre musicale étrangement intense et comme musique inscrite dans l’histoire.
Une œuvre musicale peut-elle être aussi lourde de sens et de contradiction ? Après tout, toute musique renferme de telles contradictions : l’Hymne original et l’Hymne version Carlos le font simplement de manière un peu plus évidente que les autres. Elle est, par définition, tiraillée entre la différence et la répétition ; le meilleur et le pire des deux options sont en équilibre précaire.
De manière fort à propos, le sentiment de contradiction ultime inspiré par la musique la plus sidérante, ce sentiment mêlé de peur et d’excitation, peut être perçu à la fois comme une impasse et comme une libération. Mais quelle signification donner à l’Hymne de Carlos après le Brexit ? À l’approche du référendum, mon obsession d’adopter sarcastiquement le point de vue biaisé des tenants du « Leave » m’a conduit, le matin du vote, à dire tout guilleret à ma colocataire que j’avais hâte de « reprendre mon pays ». Elle m’a alors mis en garde contre mes sarcasmes, si outrés qu’ils allaient finir par me conduire à voter « Leave » par erreur. L’Hymne à la joie de Carlos, dans une certaine mesure, c’est ça : faire l’expérience volontaire d’une subjectivité autre (dont le sarcasme serait l’une des formes les plus basiques).
Cela pourrait être cette caricature d’une Union Européenne monstrueuse que l’on a fait gober aux adeptes du « Leave ». Tandis que l’Hymne à la joie de Carlos tournait en boucle, je me disais : « Vous pensez sûrement que c’est ça, l’UE, que la fraternité et la solidarité, c’est ça. Peut-être même que vous avez raison, d’une certaine manière. » Une UE vue par le prisme de son hymne perverti, une fausse modernité qui s’emballe et devient folle, tyrannique, autoritaire, intrusive (la Grande-Bretagne a rejoint ce qui allait devenir l’UE deux ans après la sortie d’Orange mécanique, en 1973, et a voté très largement pour y rester lors du référendum de 1975).
Car bien sûr, comme tout le monde s’est empressé de le souligner avant le vote, l’UE n’est (ou n’était) pas précisément un horizon radieux, d’où que l’on se place sur le spectre des opinions progressistes. Mis au pied du mur par la réalité du vote sur le Brexit, je suis vite revenu de mes scénarios imaginant un Brexit progressiste de type « briser-la-vitre-en-cas-d’urgence » (parfois appelé « Lexit », pour left exit, la sortie de gauche) : et si l’UE était néfaste et que le Brexit allait permettre plus de souplesse pour un avenir meilleur, en empruntant je ne sais quelle voie tortueuse (et dangereuse) ? Mais quels que soient les atours dont on l’a paré, le vote pour le Brexit au Royaume-Uni s’est bien fait sous les auspices de la xénophobie. On a aussi parlé de l’expression d’un rejet du discours politique. Cela recouvre beaucoup de choses différentes mais c’est exact. Comme le monde et la musique d’Orange mécanique, cette année, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et bien d’autres pays dans le monde se sont retrouvés pris entre liberté violente et oppression violente, autrement dit une liberté dotée d’un visage auquel nous voulons pouvoir nous fier : la différence démocratique. La démocratie vote pour la haine, même si la haine est prête ensuite à prendre le pas sur la démocratie.
Le futur dystopique dont le monde rêve depuis des décennies est à nos portes, il est déjà là ; l’orage gronde de plus en plus fort, il se rapproche. La question est : est-ce stimulant ? Ou trop proche, trop dangereux ? Pour le dire autrement, l’art et la musique peuvent-ils s’en saisir ? La musique underground adopte sarcastiquement le point de vue biaisé du citoyen dystopique et déshumanisé depuis déjà longtemps, sous des formes très variées. Rien de neuf là-dedans : l’archétype en a été l’explosion, à l’été 1976, du punk rock britannique et de son patriotisme outrancier. Mais le frisson du sarcasme découle du privilège de la sécurité ; comme lorsque l’on observe l’orage, le frisson n’est possible que parce que nous sommes bien à l’abri à l’intérieur. Or un nombre croissant de personnes sont exposées. Certaines — les minorités de toutes sortes — n’ont même jamais rien connu d’autre que le danger, elles ont dû vivre au cœur de la tempête. Et si cette recherche sarcastique du frisson dystopique procuré par l’orage entretenait une trop grande proximité avec — ou au bout du compte équivalait à accomplir — le geste de voter pour lui (que ce soit par « erreur » ou autre) ?
À ce sujet, certains, moi compris, ont dernièrement beaucoup parlé d’« accélérationnisme ». L’une des figures de la gauche britannique, Owen Jones, a utilisé le terme sur Facebook pour évoquer ces gens qui vont voter Trump parce qu’ils n’ont pu avoir Bernie, espérant améliorer les choses en les rendant délibérément pires. On imagine que peu de personnes de couleur aux États-Unis s’y risqueront.
Avons-nous encore besoin de musique déshumanisante créée par des machines maintenant que nous avons Trump et que partout dans le monde enfle la haine ? Cela ne paraît plus aussi cool qu’il y a quelques années, n’est-ce pas ?
Dans ce tableau, mon propre point de rupture n’a que très peu d’importance, mais pour moi, ce fut la semaine de la tuerie d’Orlando et du meurtre de Jo Cox, parlementaire britannique en campagne pour le « Remain », assassinée par un homme au cri de « La Grande-Bretagne d’abord ! » Mon intérêt de moins en moins prononcé pour l’art et le clubbing dystopiques s’est changé en dégoût pur et simple. D’autres l’ont compris bien avant moi (ou l’ont toujours su), d’autres ont encore à atteindre ce point. Pourtant, on ne peut échapper au futur. En matière de musique comme pour le reste, nous y sommes toujours traînés de force avec pertes et fracas.
Bien sûr, il existe une différence de taille entre futur et futuriste. Ce qui est futuriste tient de la panoplie, c’est un frisson, une performance, une caricature, quelque chose qui se joue dans la sécurité du présent. Le futur est ce qui arrive vraiment et à un moment ou un autre, qui que vous soyez, vous en souffrirez. Qu’est-ce que l’art et la musique peuvent nous aider à accomplir et à dire avant que ce moment n’arrive ?
Comme on pouvait le lire dans un tweet déchirant après Orlando : « Pour les gays, le mot d’ordre a toujours été : profite de chaque moment avant qu’une personne haineuse ne te l’arrache. » Est-il possible d’avoir une musique autre, d’amour, de différence, d’amour pour la différence, sans subir la violence de l’aliénation ? Est-il possible de nous inscrire dans des catégories et des identités — je parle ici de performances, de désir, de genre, d’être — sans nous emmurer ? Est-il possible d’avoir de l’imagination sans « post-vérité » ? Du réalisme et de la réalité sans désillusion ni défaite ? De la solidarité sans appropriation ? De l’intimité sans l’isolement ? De la sécurité sans privation de libertés ? Une technocratie sans technophobie ? De la passion et de la fierté sans ennemis ? Telles sont les questions auxquelles la culture underground — la culture des marginaux, de ceux qui avancent vers la tempête, de ceux qui bougent — sera forcée de répondre dans les années à venir.
[1] BURGESS, Anthony, L’Orange mécanique (1962), traduit de l’anglais par George Belmont et Hortense Chabrier, 5e édition, Paris, Robert Laffont, coll. Pavillons poche, 2010, ISBN : 2-221-10849-3





























