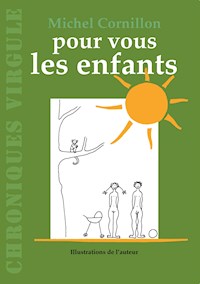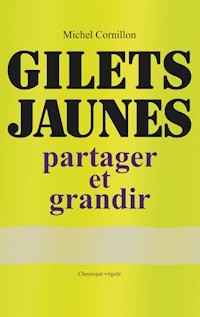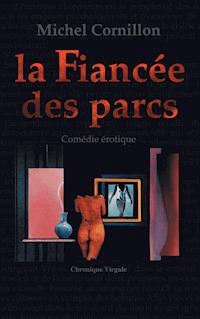Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
“Ouvrage politiquement peu correct“, jugea un éditeur parisien à la lecture du manuscrit de ce roman. Si cet éditeur manqua d’honnêteté en le refusant, il n’en a pas moins eu raison sur le politiquement incorrect. Car Michel Cornillon ne s’est pas soucié de plaire au prince lorsqu’il a mis ce livre en chantier. Il en a même profité pour dire ce qu’il pensait du sionisme et de la politique israélienne actuelle, laquelle est aussi celle de nombre de nations paraît-il évoluées. Car si l’action se déroule de septembre 1944 au 30 avril 45 (mort de Hitler), elle est narrée à l’époque actuelle par les deux cousins juifs, profession clowns, qui en furent les protagonistes. Ce qui permet au narrateur de juger les événements d’alors selon les lumières actuelles. Dès qu’ils reniflent en quel lieu les a conduits leur voyage de cinq jours en wagons à bestiaux, Yitzhak et Mordekhaï détalent comme des lapins à l’intérieur des barbelés d’Auschwitz. À la suite de quoi, travestis en SS et prenant en otage la femme du commandant, ils deviennent au black les véritables maîtres du lieu. Autoproclamés Vengeurs des Peuples, et rapidement alliés à quelques autres détenus, ils vont rendre à leurs “collègues“ SS la monnaie de leur pièce. Les sévices infligés aux déportés vont ainsi s’appliquer à ces pauvres nazis, qui en verront de vertes et de pas mûres, à commencer par un bon coup sur la cafetière suivi d’un passage immédiat au grill. D’autre part, cette inversion de la réalité en transformera le côté effroyable en un carnaval ou chacun pourra s’exprimer, c’est-à-dire se tailler à coups de pelle, de barre de fer et de planche à clous un chemin vers le rire et la liberté. Le lecteur suivra donc, principalement par les yeux de Yitzhak, les exploits tantôt hilarants, tantôt tragiques et parfois même épouvantables que vont accomplir nos héros depuis la nuit de leur arrivée jusqu’à l’évacuation du camp en janvier 45, puis de leurs “marches de la mort“ à leur visite au bunker du Führer. Saga à la fois chaotique et libératrice offrant un aperçu jubilatoire du Reich hitlérien aplati par les bombes. Détournement du réel ? Sans doute, mais Jorge Semprun n’a-t-il pas déclaré : « Maintenant que disparaissent les témoins de cette époque, c’est aux auteurs de fiction de prendre le relai ». Transformer en comédie la partie essentielle de l’horreur hitlérienne, et sans jamais la nier, au contraire, c’est ce que tenta l’auteur de ce roman peu commun.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Parce que vous avez soutenu et exécuté une politique qui consistait à refuser de partager la terre avec le peuple juif et les peuples d’un certain nombre d’autres nations […], nous estimons que personne, aucun être humain, ne peut avoir envie de partager cette planète avec vous. Pour cette raison, et cette raison seule, vous devez être pendu.
Hannah Arendt
Eichmann à Jérusalem
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Scène I
Scène II
Scène III
Scène IV
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
1
Accueilli royalement dans des wagons à bestiaux, ainsi que décidé par de hauts responsables, un entassement de vos semblables avec femelles et balluchons, progéniture et gémissements, autant dire du bétail. Et parmi cette cohorte humiliée et puante à souhait deux clowns dont je vous invite à faire la connaissance, deux Pieds Nickelés à la caboche en ruine : mon cousin Mordekhaï, vingt-quatre printemps à l’époque, et votre serviteur, Yitzhak, un an et demi de moins.
Remarquez, si j’ai dit clowns ce n’est pas par dérision ou autodérision, car nous avons notre fierté. Mais parce que tel avait été notre métier depuis que nous avions débarqué en France quelques années plus tôt, chassés de Pologne par les légions de l’enfer. Sitôt à Paris, et dès que nous eûmes troqué nos culottes courtes contre des pantalons d’adultes, nous avons en effet, nous deux Mordekhaï, été recueillis par l’oncle Chpitipoï, puis mis en selle par une bande de zozos dont le rôle principal, en cette haute époque d’humour, était d’amuser la galerie. Laquelle, essentiellement constituée de militaires en goguette accompagnés de filles de petite vertu, se précipitait sous le chapiteau du Chpit Circus, dont le spectacle principal tournait en dérision (attention, en dérision plaisante) tant les travers de l’armée française que ceux des Panzer Divisions et des bolcheviks. Le clou était l’entrée de la Wehrmacht dans les gravats d’une ville imaginaire, les décors s’écroulant sur les casques tandis que les derniers défenseurs de la place (nous-mêmes, plombés à la vodka), fuyaient sur des vélos décapités qui n’avaient plus qu’une roue, comme de juste voilée.
Donc, vous l’aurez compris, c’est au Chpit Circus, où nous jouions les déglingués, les enfarinés carburant à coups de pied, que nous avons connu la gloire. Sous des noms d’artistes bien sûr. Mordékhaï se planquant sous le pseudonyme de Khaï, moi pareillement, tous les deux nés des cris que nous poussions avant de nous enfuir — khaï ! khaï ! — dès que nous nous trouvions nez à nez.
Sitôt notre prestation achevée, sans nous démaquiller de peur qu’on ne perçoive nos origines, nous allions distribuer sur nos monocycles, dans le quartier de Picpus, des prospectus vantant le Chpit Circus et sa chèvre dressée, ses chats savants et nous-mêmes. Si bien que nombre de gamins formaient dans notre sillage une procession qui amusait au plus haut point les trois ou quatre Wachposten en faction aux alentours du chapiteau.
Le bon temps aurait ainsi duré jusqu’à la fin de la guerre, et même plus loin si le destin, retors comme il n’est pas permis, n’en avait décidé autrement.
Un soir de mai, un gradé qui avait assisté à la représentation et en avait pissé dans sa culotte, nous avoua-t-il, nous a priés, dans le but de nous présenter à la fine fleur de son état-major, de l’accompagner à l’hôtel où il résidait. Quelques instants plus tard, toujours en tenue de travail, nez rouges et flûtiaux à la main, nous pénétrions au Crillon, où nous fûmes aussitôt entourés. Décolletés, champagne, et allons-y pour une impro devant ces messieurs et leurs belles, et que je te perds ici une godasse, et que mon pantalon se décroche, et que tout le monde se marre et nous tape sur l’épaule… C’est ainsi que nous eûmes nos entrées dans ce haut lieu des troupes d’occupation, et que nous sûmes en profiter. Jusqu’au moment où, à la suite d’une mésaventure dont je m’en vais vous entretenir, nous nous retrouvâmes, après vérification de nos identités, coups sur le crâne, rinçage à l’eau de vaisselle — j’en passe et des meilleures — via la rue des Saussaies embarqués pour Drancy, puis dirigés vers Pétaouchnok.
Là, dans le fichu convoi qui nous menait dieu sait où, nous n’étions plus les seuls à nous ronger les sangs. Les gens que les nazis avaient entassés dans les immondices des camps provisoires, en plus d’avoir comme nous laissé derrière eux leur superbe, n’avaient plus rien d’humain, si ce n’est le sentiment d’humiliation que laissaient percevoir dos voûtés, yeux cernés, costumes en loques et robes à mettre à la poubelle. Se trouvaient là en effet, dans ce haut lieu de la civilisation, autant de femmes que d’hommes. et même des gosses aux trognes enluminées de crasse. Ayant perdu mère, père et toute protection familiale dans la panique du départ, certains mendiaient un quignon de pain, un rogaton ou un verre d’eau.
Bravo les boches, et bravo Vichy !
Toute notion du temps se perdit ainsi dans une promiscuité pesante, chacun s’évertuant à ne pas se laisser broyer par une masse abîmée dans un silence de mort où le tacatac des roues semblait ne jamais devoir cesser, non plus que la bouillie mentale brouillant toute perspective. On s’était retrouvé à plus de cent, bouclés de l’extérieur, dans des wagons prévus pour quatre chevaux, deux baudets et deux ânes. Avec en sus, pour Mordekhaï et moi-même, en souvenir d’une liberté que nous ne retrouverions jamais — nous l’avions vite l’avait compris dans le regard terrifiant d’un Führer encadré sur le mur — deux naseaux effroyables braqués sur notre effarement.
Les naseaux de Rottenschwein.
Nous dûmes nous endormir, récupérer quelque énergie dans l’embrouillamini des aiguillages. Lorsque nous recouvrâmes l’esprit, le tacatac s’était mué, par le miracle d’un roumpapoum, et roumpapoum, et roumpapoumpapoum, en une envie de meurtre. On allait retrouver Rottenschwein, et il allait y passer. Et les S.S. allaient tous y passer, pareillement leur Adolf. Après la grêle de coups dont ses geôliers nous avaient honorés, juré, nous allions lui en faire baver. Et rien à voir avec du vite fait, mais avec du méticuleux, du sadique, l’écume nous fleurissant les lèvres. On allait lui faire déguster son pot de chambre, le forcer à se rincer le gosier à l’eau des vespasiennes, puis on allait lui arracher les ongles, lui couper les doigts de pied, lui bousiller les articulations, chacune de haut en bas et de droite à gauche, et que ça craque sous notre acharnement, et que ça hurle sa douleur sur le fauteuil grinçant qui le mènerait à sa dernière demeure, à sa dernière extase dans la fosse à purin où l’attendait le démon.
Un ramassis de brutes que ces nazis répandant sur le monde leur urine de chien de guerre, leurs effluves de chiens de garde n’obéissant qu’à la voix de leur maître, de leur ayatollah tonitruant — Heil Hitler !
Et pas besoin de l’assentiment de quiconque : la chienlit hitlérienne, on l’avait reniflée depuis belle lurette. Depuis l’invasion de la Pologne, de la Hollande, de la totalité de l’Europe et enfin de la Russie, avec empilement de cadavres et multiplication de charniers. Car les nazis ne discutaient pas, les nazis ne plaisantaient pas, les nazis ne rêvaient pas. Forts de leurs certitudes, ils ne visaient qu’à l’éradication de races dont la noirceur du poil freinait la ruée de leurs meutes vers les gadoues qui les engloutiraient, vers l’abjection où s’abîmerait ce qu’ils considéraient comme la grandeur de leur espèce — nous dirons de leur engeance. Mais voici, à l’issue d’une errance de cinq jours dans le tacatac tacatac de l’acier sur l’acier, dans le badaboum rabadaboum de l’orchestre d’un oncle qui avait dû y passer lui aussi malgré qu’on n’eût rien dit, que le convoi ralentissait, s’immo-bilisait dans une succession de chocs, que ses portes s’ouvraient sur une débauche de projecteurs et de braillements, d’aboiements, de vociférations à hérisser le poil. Face à la garnison chargée de nous accueillir, tentative de remise en route d’esprits anéantis par la faim, la soif, la pestilence des baquets qui servaient de toilettes, dans chacune des voitures, à des centaines de gens passés à coup de gourdin de la ville à la bauge.
Oui, frères et sœurs, dans un déballage de sunlights, quantité de brutes dont ne se distinguait qu’une tête, comme de juste fossilisées dans le moule terrifiant des casques et des bottes. Un alignement de gorilles fonçant sur les mongoliens avant de passer aux Juifs, aux Tziganes, aux communistes et bientôt aux Peaux-rouges, aux Bantous, tous Untermenschen rivés à une reproduction exponentielle, tous cafards dont la plus mince évocation amenait sur la face des seigneurs une moue de dégoût. Et badaboum, rebadaboum, rabadaboum tsouin tsouin…
Achtung !
Tirés de notre abrutissement par des vociférations et des coups, nous ne pouvions évidemment raisonner de la sorte, ni formuler quoi que ce fût. Tout se mélangeait dans nos psychés en loques, et ce que nous rapportaient nos sens appartenait à un cauchemar qui n’en finissait pas, n’en finirait jamais car le nazisme se nourrit du Juif et que le Juif est immortel, et sans fond le cloaque vers lequel on le pousse, et sans pitié la soldatesque lui désignant la gare, et grimaçante la populace sachant où on le mène. Partout des ricanements qui saccageaient le rêve d’un havre sans violence, d’une pause dans cet acharnement. Partout des carnassiers excités par Adolf, maintenus par Goebbels dans l’érection de la haine et se ruant sur tout ce qui n’était allemand et furieusement nazi, puis se dirigeant au pas de l’oie, en rouleau compresseur laminant tout sur son passage, vers le pillage du monde. Du coup, malgré Beethoven, malgré Franz Liszt et Buxtehude, et malgré qu’on se fût évertué à leur lisser le poil, les valeureux Teutons retombaient dix mille ans en arrière, bombaient le torse pour se ruer vers une curée que jamais Attila n’aurait désignée à ses hordes. Robots conçus pour la saignée, ils soutenaient une pyramide qu’ils pensaient protectrice et se comportaient ainsi qu’on exigeait qu’ils fussent : en chevaux de trait sans autre souci que l’obéissance, en mécaniques menées à la déglingue par les hauts dignitaires de la férocité. Au garde-à-vous devant le psychopathe qui leur avait promis de fabuleuses curées, ils lançaient à la ronde le cri de l’âge de pierre, livraient par pleins wagons l’humanité aux écuries d’Augias, dardaient sur la misère la grimace du mépris.
Maintenant, sous le feu des projecteurs, la descente aux enfers.
Qu’ils se permissent de redresser le jabot, ces concepteurs d’une géhenne où ils allaient eux-mêmes sombrer. Qu’ils se cambrassent et tendissent le pétard, ces cerbères du charnier ! On allait par-derrière leur perforer le fion, les planches à clous allaient leur faire sauter pignons et engrenages, leur faire rendre leur jus. Non que nous fussions féroces, Mordekhaï et moi-même, mais tâchez de nous comprendre : huit ans que nous subissions les caprices de ces brutes, une décennie que nous les regardions saccager notre avenir, vider nos comptes en banque, nous chasser de nos emplois et des jardins publics, nous empiler dans des ghettos, nous jeter dans des wagons. Cela pour nous mener en fin de course, tandis que nous accueillait une armée de zombies regroupés en fanfare, dans des effluves à vous couper le souffle. Si la règle nous échappait, la sentence était là, indescriptible d’épouvante. Cerné de croix gammées, de Sturmgewehrs et de casques, chacun se voyait se noyer, sous le regard de l’abjection, dans une laideur qu’on eût dit volontaire.
Arbeit macht frei, terminus, alle raus, schell ! avaient quelques instants plus tôt hurlé les haut-parleurs. Et face à notre cohue des molosses qui tiraient sur leur laisse, des S.S. impavides, des projecteurs braqués sur une foule désespérant de tout.
Ce camp, nous l’ignorions encore, portait un nom promis à la célébrité. Un nom germanisé, souillé comme à plaisir avec, pour pimenter la sauce, une kyrielle de soudards préférant caresser leurs fusils que croiser nos regards. Un nom que nous découvririons à l’aube dans le bureau du commandant, éclairés que nous serions enfin sur notre destinée, et tacatac, et tacatac rabadaboum, par la pâleur d’un soleil assassin.
Mais ne brûlons pas les étapes. Mordekhaï et moi-même, aujourd’hui rattrapés par l’âge mais à l’époque assez vigoureux pour nous dépatouiller de tout, décidâmes sur-le-champ, bien que paralysés de trouille, de mettre en pièces ce bétail remonté des abysses. D’exterminer nazi après nazi, S.S. après S.S. pou après pou, selon un processus qui se terminerait par le plus malfaisant d’entre eux, le démiurge d’une dictature dont les émules portaient dans le registre des morts non pas des patronymes mais des traits et des croix. Encore que ces zélés fonctionnaires, qui alignaient bâtons après bâtons, additionnaient pantins et figuren, fabriquaient des montagnes de paperasse, ne pussent être tenus pour responsables d’un forfait dont ils ignoraient tout. C’est du moins ce qu’ont tenté de faire comprendre à leur procès ces prédateurs déchus.
— Täter ? les interrogeait-on à Nuremberg.
— Nicht Täters, no guilty, pas coupables, pleurnichaient les Göring et Keitel. Ce qui permit trente ans plus tard à ce haut fonctionnaire de l’infâme, déclaré grabataire, d’échapper à la corde. Et sans perdre de temps avec le tout-venant de la S.S., sans chercher à lui rendre ses gnons distribués à la pelle, nous viserions d’abord ses meneurs, précédés tous d’un maître sans égal, l’époustouflant Adolf.
Époustouflant car parti de rien, né de sa propre haine dans la boue des tranchées… Lui qui n’avait jamais joué lorsqu’il était petit, qui n’avait jamais ri, jamais touché le zizi des filles pour la simple raison qu’elles se gaussaient de son insignifiance et lui refusaient les privautés qu’elles réservaient à d’autres, les Juifs en premier lieu, voyez l’af-front, et mesurez les progrès accomplis à force de mensonges : auréolé d’oriflammes noires, symboles de la clarté de ses vues, il brandissait devant une soldatesque au garde-à-vous le fantastique braquemart de sa paranoïa, arrosait de son foutre ses troupes en ordre de bataille — en position de repli plutôt, le vent ayant tourné à Stalingrad, les Alliés occupés désormais à se tailler, dans un fatras de fantassins en loques et de chars déguenillés, une autoroute vers l’écrasement de la bête.
Mais quitte à ternir notre image, et pour en revenir à ma promesse, il me faut à présent dresser de nos individus un portrait objectif.
Petit retour en arrière.
Durant les deux années qui virent grandir dans les démocraties l’espérance d’une victoire, par là le Führer s’arracher les cheveux et humilier ses généraux, mon cousin Mordekaï et moi-même, malgré l’interruption brutale de notre formation de clowns, avons déployé les talents dont nous avait dotés notre naissance. C’est-à-dire qu’en plus d’humoristes, de lanceurs de couteaux et de bons mots, nous devînmes pickpockets. Conséquence : dans le bourbier où nous jeta notre imprudence, il nous fut aisé de prospérer, de jouer de notre fantaisie et de notre goût de la fête. Cela en appliquant avant l’heure aux tortionnaires des peuples le châtiment que leur infligerait plus tard la Justice des nations, liquidatrice de leur outrecuidance.
En gros, on s’est fait prendre la main dans le sac, plus exactement dans la poche d’un gradé du haut état-major. Nous en étions à folâtrer dans sa garde-robe, à nous approprier ses Ausweis et son fric tandis qu’il s’en allait frôler l’apoplexie devant le décolleté de Ginette, notre complice à tous les deux. Et voici, pile au moment où s’amorçait notre repli, que s’ouvrait à la volée la double porte du dressing, que nous étions tirés en pleine lumière et là, devant la croix gammée, mis aussitôt en joue. La routine, la facilité d’une tâche maîtrisée de longue date nous avaient en fin de compte fait baisser notre garde : dans le plaisir que nous prenions à le dépouiller, nous n’avions pas envisagé que l’Oberleutnant Wolfgang von Ehrfurt pût posséder, en la personne de l’Unteroffizier Rottenschwein, taupe de la Gestapo chargée de sa sécurité, ne le quittant donc jamais d’un œil, un garde du corps zélé, impitoyable donc, et qui, pour mieux le surveiller, avait pris position à l’abri des tentures. Ainsi, ayant suivi notre progression entre fauteuils et poufs, secrétaires et pendules, Rottenschwein venait-il d’introduire son minois en notre combine et braquait-il sur nous, en plus de deux nasaux à la pilosité dantesque, la menace d’un pétard.
Mais cessez de vous inquiéter, rescapés des barcasses de l’exode. Relevez la tête et souriez, moissonneurs d’un froment dont la semence vous fut livrée par la déconfiture du Reich : des derniers jours d’un été qui vit s’arrêter devant un alignement d’assassins une foule de jeunes filles abusées, d’enfants mourant de soif et de vieillards dépecés, jusqu’à l’engloutissement du nazisme dans ses propres latrines, le sang de la Schutzstaffel se mêla à la fange, sa chair carbonisa dans le crématoire numéro IV.
Il faut vous dire qu’un gaz on ne peut plus efficace, le fameux Zyklon B, anéantit dans une franche rigolade la prétention de ces rustauds.
2
Sur le quai d’arrivée, autrement dénommé la rampe, le comité d’accueil nous permit d’entrevoir, en cette nuit de septembre, le paradis aryen du troisième millénaire : l’Allemagne au pinacle de sa puissance et l’Europe à ses pieds, un continent entier délivré de ses intellos, de leurs cheveux coupés en quatre, de leurs béquilles et de leurs binocles. Le monde entier aux petits soins pour une chevalerie remise au goût du jour — pour le mâle invincible la gloire en ses muscles d’airain, pour le S.S. forgé par Wotan dans le feu de la Blitzkrieg une femelle admirative, chargée de fructifier ce dont la comblait son seigneur : une portée de nazillons élevés à la spartiate.
Pas de rêves inutiles, pas un atome de fantaisie, pas le moindre état d’âme sous les casques d’acier. Jardins secrets nivelés au bulldozer, pensées tenues en laisse et bientôt plus de pensée mais un bras qui se tend et deux talons qui claquent, un revolver tiré de son étui pour une saignée du côté de Babi Yar en hors-d’œuvre, d’Oradour en dessert… Mais évitons de mêler les torchons et serviettes, laissons à la Wehrmacht le plaisir de pleurer ses cadavres dès que le thermomètre, du côté de la Volga, atteignit des niveaux sibériens. Dans le gel leur soudant les jointures, on vit alors des processions de blindés boiter vers leur arrêt définitif, le svastika se briser sur la faucille et le marteau, le haut état-major pendant ce temps, demeuré près du poêle, n’ayant à proposer à ses bidasses que la chair des chevaux surgelés, peu après celle des rats, et pour finir (mais n’allez pas le crier sur les toits, il s’agit d’un secret) celle de leurs camarades abattus par les tirs soviétiques et congelés par l’hiver… Le général Paulus attaquant son bifteck pendant l’équarrissage des morts au champ d’honneur, on en aurait hurlé de rire dans les ghettos d’Europe !
Nous en venons ainsi au corps de notre ennemi, dont il suffit de soupeser les jambons pour constater que le meilleur morceau du nazi bien nourri et convenablement soigné, c’est-à-dire du bestiau de parade — nous parlons d’expé-rience — se situe, au sein de l’assemblage d’os, de muscles et de tendons constituant sa charpente, en deux lieux agissant de concert lors du salut au chef, décomposé comme suit : contraction des fessiers, claquement des talons, lever simultané du bras, exhibition de l’argument frappant devant l’univers pétrifié… Bien sûr, une telle succession de mouvements dans la même direction aurait provoqué la culbute si ne l’avait contrebalancée le passage à l’action. Soit, sur le plan individuel, l’embrayage au pas de l’oie, et sur un plan général l’invasion de la Pologne suivi de l’anéantissement de ses structures, Français et Britanniques se réunissant aussitôt pour ne rien décider. S’enclencha de la sorte, en une série d’opérations menées tambour battant, la ruée sur la Hollande et le déboulé sur la Belgique, le contournement de la ligne Maginot, le franchissement des Ardennes et la mise à genoux du continent européen, enfin la trogne du Prédateur devant la tour Eiffel.
Mais ce viol des démocraties, loin de traduire une quelconque supériorité, ne mettait en lumière que la volonté de dominer — volonté décuplée, selon le docteur Freud, par une libido détournée de son but (la chair poisseuse de la femelle) pour être dirigée vers l’acier du surhomme, autrement dit du Schweinführer S.S. Ernst Schultz, pour ne donner que cet exemple. Et bien sûr, en couronnement du Schwein, vers la caricature inimitable de son commandant suprême, épouvantail dont nul n’aurait tourmenté les enfants, lui préférant le loup.
Comme pièces de premier choix, donc, le fessier et la cuisse, suivis de l’épaule et du biceps. Venaient ensuite les côtes qu’on tournait sur la braise, puis les viscères et enfin les orteils que nombre de détenus serraient entre leurs griffes. Car pas question de se laisser voler la moindre rognure d’ongle. Un nombre grandissant de Häftlings amaigris, travaillés par les crampes d’estomac, n’attendait que la couenne qui pût accompagner la pomme de terre gelée allouée un jour sur deux par les Panzernutritionnistes. Souffrait-on d’un petit creux ? On attirait le fridolin derrière un baraquement, un coup sur la cafetière et hop, restait à se partager ses abattis, incinérer ses tripes. Et tant mieux si son chef le portait déserteur, et tant pis si le Talmud interdisait toute nourriture qui ne fût pas casher.
Mais assez de grimaces. Nul ne peut se vanter, parmi les rescapés de la génération « macht frei », de ne jamais avoir louché vers de la viande sur pied, de ne jamais avoir été tenté de tirer son coutelas pour trancher dans le vif. Il y eut même des cas où le bourrin n’avait pas rendu l’âme qu’il était englouti — c’est vous dire. Alors laissez-moi le plaisir de vous rapporter les fumets, ô combien capiteux comparés aux fadeurs de la restauration rapide, et celui d’évoquer les effluves sans lesquelles nous ne pourrions aujourd’hui vous entretenir de la mise au saloir de nombre de nos bourreaux. Pestilence et saveurs vont se mêler, se lier comme l’ont fait sous nos yeux l’infâme et le sublime, la mort du frère et la joie de mettre hors circuit le goret dont fumait le pistolet, puis de le regarder quitter la scène en lui disant au revoir, au revoir Unterführer, au revoir Scharfmachin de mes deux, adieu nazi de merde ! Ainsi en irait-il du malheureux S.S. qui arracha des bras de sa maman un nourrisson hurlant et qui, photographié dans ce fait d’arme qui lui vaudrait le premier prix européen d’inanité, le saisit par un pied et l’envoya dinguer dans le brasier où finissait tout Juif. Crocheté quelques instants plus tard et aussitôt cloué devant le Tribunal des Peuples, l’artiste allait se retrouver déculotté et débotté, les doigts de pieds dans la braise, puis hurlant, puis contraint de ravaler sous un déchaînement de galoches les S.O.S. qu’il adressait au ciel.
Car c’était cela, Auschwitz. Du moins pour nous, qui naviguâmes des deux côtés des barbelés, ainsi que pour les membres des Sonderkommandos dont une dizaine à peine, sur des milliers livrés au désespoir, virent le bout du tunnel. Œil pour œil, dent pour dent et mon poing dans la gueule, aucune circonstance atténuante, aucun recours possible, pas de pitié pour les dégénérés crochetés et déloqués, exécutés dans la foulée. À la suite des premières audiences, sachez en effet que fut appliquée la règle de jurisprudence, si bien que tout S.S. harponné en flagrant délit passait à la casserole dans la minute suivante.
De plus, dès que nous contrôlâmes le terrain, que nous eûmes nos entrées au sein de l’administration du camp, rien ne put nous interdire de faire paraître de nouveaux matricules, non plus que d’en escamoter. Un mot de Treblinka, de Guturdjieff ou autre et voici que disparaissait Friedrich, que Menahem enfilait ses bottes et le remplaçait dans ses tâches quotidiennes, constituées de gueulantes, de levers de gourdins et de descentes de schnaps.
Evidemment, dès qu’il sentait la lame lui pénétrer la couenne, Schmürk commençait à ruer, cherchait à rameuter Schrank, lequel partait à la recherche de Staffel et de Schutz, mais une planche à clous arrachée aux châlits avait tôt fait de le réduire à rien. Nous héritions alors de son uniforme, camouflage idéal pour nous glisser dans sa communauté, et à nous la belle vie. Soigneusement nettoyée par le Kommando des blanchisseuses tziganes, puis ajustée à son nouveau bénéficiaire par le génie des tailleurs juifs, la défroque hitlérienne nous permettait de pousser nos pions dans les rangs de la S.S., d’y pourrir son moral. De plus, au gré de nos battues, nous nous enrichissions de tout un arsenal : Pistolen, Sturmgewehr, Maschinengewehr sans lesquels tout nazi redevenait le paumé qu’il serait demeuré sans le triomphe de son Adolf aux élections de 1933.
Combien nos frères ont-ils pu en sucer, de ces fémurs, de ces omoplates arrachées aux Aryens dans leur lutte sans merci pour la suprématie de leur race ! En plus de la nourriture qu’ils nous abandonnaient, nous empochions la paye et les économies des gars, sans parler de leurs bagues, devises et dents en or dont ils avaient dépouillé nos semblables. En sus, nous récupérions ce qu’ils avaient de plus personnel, leurs papiers, et de plus précieux, leurs identités. Restait à se débarrasser de leurs carcasses, mais rien de plus facile : les crémations se poursuivaient en continu, tantôt sous un ciel bas et lourd, tantôt sous la voûte étoilée.
Ce qu’on a pu se réjouir dans le ronflement des fours, alors qu’en leur casernement cauchemardaient les pigeons que nous allions plumer !
— Ein Volk, und ein Land, und ein Führer ! lançait Yehuda en balançant aux braises les arpions de Ludwig, fiancé d’une grognasse à poil ras désormais veuve de guerre, dont passait la photo de mains de cannibales en pognes de scélérats.
— Celui-là, je te leur mets où je pense, ricanait 208 en pointant un majeur qu’il venait de cisailler.
— Et plus qu’à passer à la caisse, renchérissait 312 en exhibant un billet de loto tombé de la poche d’un héros du pas de l’oie.
Des coups de boule, des coups de latte, des cris vite étouffés et autant de P 38, de Borchardt, de poignards et de grenades — la liste s’allongeait de jour en jour, si bien qu’à la fin de la guerre nous possédions un tel armement que nous comptions l’expédier, à l’opposé des émanations qui avaient asphyxié nos frères, nos sœurs, nos cousins et cousines en plus de nos pères et de nos mères, de nos oncles et grands-parents, vers les rivages où nos enfants vivraient dans l’allégresse.
Revenons au comité d’accueil…
De notre traque à notre capture, des nuits de cristal aux rafles du Vel d’Hiv, des rafles à l’entassement de Drancy, et à Auschwitz pour finir, des balais de chiottes étions-nous devenus, nous autres rigolos. Quant à nos compagnons inclinés devant casques et bottes, ils n’eurent pas le temps d’envisager l’avenir, ni même de boire un coup. Dans l’heure suivant leur arrivée, dépouillés et tondus, ils s’en furent apprécier le Zyklon.
De notre côté…
Pour les S.S. nous attendant avec leurs chiens, pour leurs semblables postés en haut les miradors, si tout s’était passé selon le protocole, notre débarquement se serait inscrit dans la liste des arrivages ordinaires, notés d’une croix blanche dans le registre des entrées. Entrées suivies d’une sortie immédiate car la fournée que nous représentions cette nuit-là correspondait exactement à la capacité d’absorption des unités de gazage inaugurées par nos frères de Hongrie, éliminés voici peu sous le regard satisfait de l’Obersturmbannführer S.S. Rudolf Höss, servant de l’holocauste.
Manque de chance, l’arrivée de notre convoi a tourné au vinaigre. À tel point que notre débarquement se mua, pour les nazis et leurs idéaux, en une horreur dont peu d’entre eux se remirent. D’autant plus que notre action se poursuivit jusqu’à la fermeture du camp, puis dans les marches de la mort qui nous menèrent au zoo de Berlin, au beau milieu d’une ménagerie parmi laquelle cacatoès et chimpanzés, enthousiasmés de voir leurs gardiens mis en joue et flingués, ajoutaient à la confusion régnant parmi l’élite.
Quoi qu’il dût advenir en cette nuit d’arrivée, toute espérance avait fini par se noyer dans le fût à déjections qui nous accompagna tout au long du trajet, et qui versa si souvent que nous n’étions que répugnance devant la soldatesque en armes. Mais le désespoir allait répandre son adrénaline et nous permettre de taillader dans le noir, de surgir dans le dos d’un goret occupé à se vider la vessie, puis à se vider de son sang. Et de rajouter une croix par-ci, et une oreille parlà — et de deux, et de trois — à notre enviable tableau de chasse. Des croix gammées bien entendu, dont la signification demeura un mystère pour les Wilhelm, les Ernst et autres Kriegsburger dont la réflexion se bornait à l’appréciation de la taille des saucisses, au temps qui restait à tirer avant que ne vînt la gloire ou la pire des déroutes. Mais du naufrage annoncé interdiction de parler, et défense d’y penser. Mieux valait d’ailleurs ne penser à rien, ne rien penser du tout.
Donc, dans un halo de projecteurs, cauchemar nocturne où scintillaient des canons de mitrailleuses — voyez d’ici le tableau — deux fugitifs en cavale entre des empilements de cadavres surgis de tourbillons de cendres que le vent leur jetait au visage… Et de se tailler à coups de surin un chemin vers la sortie de cet ossuaire, de ce pandémonium où bourreaux et victimes — les premiers ne pouvant soupçonner ce que manigançaient les seconds — allaient intervertir leurs rôles… On allait voir sous peu, abandonnées ici et là, apparemment honorées par les rats et les mâchoires des chiens, les dépouilles de héros prématurément vieillis, défigurés par l’épouvante.
Deux tueurs impitoyables, donc, deux terroristes échappés d’un convoi de sous-hommes, de sous-femelles et de sous-gnards livrés à Eichmann par Pétain et Laval, leurs miliciens et leurs gardiens de la paix, leurs conducteurs de bus préférant ne rien voir mais n’en pensant pas moins, et tous acheminés vers l’Est, et tous menés au gaz dans l’heure suivant leur arrivée, au cendrier dans la foulée Tous rayés à jamais de la surface du globe, tous partis en fumée selon les ordres du plus impitoyable, du plus cynique des tueurs qu’on pût trouver dans le ramassis de détraqués présidant au destin de l’Allemagne. Le seul qui nous glissa entre les doigts, je veux parler du Reichsführer Himmler. Un demi-siècle plus tard, la rage me fait encore botter sa croupe de percheron, je jouis de ses gueulantes tandis que je lui lime le pif, que je le lui pèle le jonc pendant qu’une des hôtesses de notre American Jets, fruit de quarante ans d’ef-forts, lui énumère d’une voix douce les raffinements qu’il lui reste à connaître.
De l’entreprise hitlérienne d’assassinat des Juifs et des Tsiganes, avouons cependant que nous avons su nous en tirer, Mordekhaï et moi-même. Enfin nous en tirer de justesse, essentiellement sur le plan physique. Car sur le plan mental, étant donné ce dont nous fûmes à la fois les témoins impuissants et les acteurs contraints de jouer leur rôle, nous fûmes conduits à nous poser sur le fonctionnement de l’être humain, le nôtre en particulier, des questions demeurées sans réponse. J’avouerai même que nous eûmes la raison dévastée par les honneurs que nous rendîmes aux chiennes de Buchenwald, puis au Führer des Führers lors d’une dernière intervention.
Non contents de saigner nos pourceaux, nous en étions venus à pratiquer sur eux des actes dépassant les sévices dont eux-mêmes se vantaient. Sous l’emprise de l’ivresse où nous maintenait l’effluve des crématoires, on saignait le S.S. en jouissant de la vision de nos lames s’enfonçant dans sa chair pendant qu’on le dénoyautait… Mais la nuisance engendre la nuisance, et force nous est d’avouer, un demi-siècle plus tard, après que tout a sombré dans l’oubli, que les hurlements de l’assassin, victime de sa hiérarchie avant de l’être de ses suppliciés, viennent encore nous hanter. Au point que nos pensées se brouillent, que les mots se dérobent malgré les verres que nous levons à notre santé, notre regard glissant au travers les hublots sur le spectacle éblouissant d’un univers délivré de sa peste.
Mais cette vengeance du peuple d’Israël, ce sauvetage de quelques-uns de ses enfants, cette saga qui allait s’accomplir dans l’arrière-cour de la brutalité, je l’avouerai sans honte, nous ne l’avons pas entreprise de notre propre chef. Les mécréants que nous étions alors l’ont mise en route sur l’injonction de Dieu.
Dès l’immobilisation de notre convoi, sitôt que s’acheva le dégorgement de la foule répugnante que nous étions devenus en quatre jours d’un trajet cafouilleux, interrompu d’arrêts interminables pendant lesquels nous restions sans manger, sans boire ni rien savoir, nous nous sommes crus abandonnés. Le Seigneur avait quitté sa création, avions-nous pressenti aux gémissements de nos voisins dans la puanteur où nous avaient entassés le Maréchal et ses flics, ses nervis et ses hauts fonctionnaires, ses Darquier de Pelle-poix, ses Touvier, ses Bousquet, et autres. Pour des raisons que nul ne comprenait, Yahvé avait abandonné son peuple de moutons aux molosses de l’enfer.
Je vous en prie, ne nous en veuillez pas de ce manque de respect à l’égard du Seigneur, de ce mépris à l’égard de nos frères. Et permettez que je me justifie en ajoutant que certains d’entre nous avaient dû se mal conduire, faire preuve d’indifférence à l’égard des Gentils. Je le sentais sans trop l’analyser, mais la justesse de ce jugement me fut révélée voici moins d’une quinzaine par une série de documents d’archives passés à la télévision. Alors que résonnait le pavé de Varsovie sous le martellement des bottes, je remarquai une gamine polonaise qui regardait passer, en compagnie d’adultes, une procession de familles juives encadrées de S.S. Et le visage de cette gosse s’éclairait peu à peu, au point que la gamine souffreteuse, mal vêtue, mal nourrie, édentée et sans doute mal aimée qu’elle était, et qui venait dans la foule de reconnaître ses voisins, semblait s’illuminer. Hou les Juifs, hou les Juifs ! raillait-elle, les mains en porte-voix. Et bon voyage les Juifs ! ricanait-elle encore, comme sachant à l’avance ce qui les attendait, et nous attendait tous.
Pauvres de nous, qui n’avions remarqué les haillons de la détresse alors que nous étions prospères ! Pauvres de nous, dont la progéniture en socquettes blanches se rendait chaque semaine à ses leçons de piano, ses yeux glissant sans même la percevoir sur la hideur de la misère ! Ainsi, de banquiers satisfaits ou d’artisans sans le sou, de gens d’esprit ou de simples façonniers que nous étions lorsque coulait le miel, nous nous retrouvions grelottants, poussés vers l’abattoir dont des portes d’acier nous livraient au néant. Cependant, pour peu que nos réflexes nous permissent d’échapper aux horions et de bâtir un bunker où survivre, nous pouvions nous élever au rang d’électrons libres, nous occuper de sabotage, de destruction d’escadrilles, de mise en pièces de quartiers généraux…
C’est de cela dont je vais vous parler.
Avant tout, cependant, je tiens à préciser ceci : au Chpit Circus, quelques semaines plus tôt, Mordekhaï et moi-même, en l’insouciance de notre jeunesse, rejetions toute violence. La mère était sacrée, la jeune fille pareillement, et le vieil homme de même. Mais à Auschwitz, où aucune loi ne venait refréner les instincts les plus bas, ce qui jusque-là n’osait se montrer s’exprimait au grand jour. Ainsi, face aux Pitbull- et Dobermann-führers en quête de plaisanteries, avons-nous pris plaisir à saigner du pourceau. À le saigner lentement, avec la volonté de lui donner une leçon qui portât. Inutiles seraient en effet demeurées à nos yeux des représailles à la va-vite. Si la souffrance était indispensable, la mort ne l’était pas : il suffisait que l’assassin fût mis hors d’état de nuire, qu’il fût tout juste bon, amputé qu’il était de la langue ou du nez, à se traîner vers quelque trou où réfléchir, quelque miroir où se considérer en implorant pardon. Après l’avoir mis en charpie, nous pouvions même laisser à ses collègues le soin de l’achever sans s’inquiéter de savoir qui l’avait démoli de la sorte — question qui les aurait menés sur le terrain glissant d’une remise en question.
Mais inutile d’espérer une telle démarche intellectuelle de la part de héros de leur trempe, et le Kamerad Otto, se détournant pour rendre son dîner, d’achever d’une balle dans la nuque le Kamerad Julius, puis de se ruer vers la chambrée qui le protégerait, espérait-il dans le galop de son effroi, de l’ennemi qui le guettait, prêt à le désosser ainsi que l’avait été Julius — was ein Schreck, oh mein Gott, mon Dieu le malheureux !
Hitler avait-il décrété que nous ne valions pas même, nous autres Juifs, la balle de notre exécution ? Eh bien nous allions abonder dans son sens. Et non seulement l’assurer que nous étions capables nous aussi de cultiver la haine qui le protégeait de son côté, avec les résultats qu’on sait, de tout excès de flair ; mais aussi d’emprunter, depuis le mouroir où il nous entassait, la voie qui lui était si chère : celle du feu, du sang et de l’ordure.
Nous allions les saigner, ses Schutzstaffels chéris. Leur fendre l’occiput, leur arracher leur dernier souffle et les vider, les tourner sur le feu et nous les partager, jeter leurs os aux chiens qui n’attendaient que ça. Nous allions même devenir équarrisseurs de troupes d’élite, bâfreurs d’Ober-menschen au poivre — du coup plus de ventres creux au sein de notre multitude, ni de prédateurs qui pussent nous menacer. Nous les dégusterions crus ou grillés au lance-flammes, flambés au kérosène ou encore, pour sustenter de leur chair délicate les top-modèles qu’ils ramenaient de leurs bordées, farcis à la grenade.
Dans le ferraillement de la désespérance, je devais rêver ou cauchemarder car c’est à l’arrivée seulement, quand me revint l’esprit, que je m’en rendis compte : Dieu ne nous avait ni quittés ni abandonnés, du moins pas tout à fait.
C’est le rabbin Joseph qui nous le révéla, après le gnon dont le gratifia le comité d’accueil. Homme de Dieu, donc haï de la barbaresque, il fut sauvagement frappé et je vis dans son regard, avant que l’agonie ne le couchât sur le pavé, se refléter des croix gammées de plus en plus nombreuses, de plus en plus tranchantes. Mais de leur enchevêtrement montait une clarté, le noir des oriflammes se muait en un or qui chassait les ténèbres tandis qu’à quelques pas de là retentissait un coup de feu suivi d’un hurlement de femme. Des chiens partout, des Schäferhunds qui exhibaient leurs crocs, qui aboyaient et tiraient sur leurs laisses, et des nazis qui brandissaient et abattaient sur les nouveaux venus le gourdin de bienvenue. Tout cela dans une fumée, une puanteur me semblant provenir d’une lueur montée d’un édifice de briques, avant-poste de la géhenne où nous allions sombrer.
Nous étions des centaines, souillés comme il n’est pas permis à l’issue d’un voyage succédant à des semaines de Drancy pour certains, de Compiègne et de Pithiviers pour d’autres, sans la moindre goutte d’eau, sans lieux d’aisance qui ne fussent impraticables, avec ça affamés mais n’osant y penser. Et pour couronner le tout, vomie par notre cohorte, une abomination nous contraignant à détourner nos regards, de peur de nous y reconnaître : une dizaine de dépouilles parmi lesquelles celle d’une gamine dont la vision ne me lâcherait plus, d’une jolie petite fille à la jupe retroussée sur une culotte souillée.
Une fillette oubliée, une fillette étouffée, la fillette des leçons de piano…
Mais où puiser le cri ? Nous n’avions plus ni voix, ni raison. J’ai regardé mes semblables qui se détournaient, j’ai serré les poings tandis que s’effondrait le rabbin. On venait de nous priver de notre dernier espoir, on nous jetait sans un regard dans le brouillard et dans la nuit. Baissant les bras, j’ai attendu le coup qui me libérerait.
Quelques instants plus tard, dans le silence qui s’était installé, a retenti la Voix. Une voix éraillée qui m’a tiré de mon néant, m’a transporté dans un guignol où l’horreur atteignait au burlesque, où la fillette s’accrochait à des jupes de sorcière, où mon cousin Mordekhaï, soutenu par deux S.S. qui battaient du tambour en le menant au bûcher, riait à s’en décrocher la mâchoire… La voix s’éveillait d’un sommeil de mille ans, et la voix avait faim.
Comment vous dire ? Il me faudrait revenir à l’origine des faits, vous rapporter les déplacements de populations qu’avaient entrepris, à la suite d’on ne sait quelle surchauffe en ses relais, le commandement nazi et ses alignements de crocs. Pour tenter d’y voir clair et comprendre, il nous faudrait en appeler à la psychanalyse, mais historiens et politiciens, malades à l’idée d’une évolution trop brutale de la conscience de leurs semblables, sans parler de la transformation de leurs propres psychés et des douleurs de l’accouchement de soi, se sont contentés de fouiller les décombres, de dénombrer les corps, de s’accorder sur un chiffre acceptable.
En plus des millions de Polonais et de Russes dirigés à coups de bottes vers les fossés de leur exécution, plusieurs centaines de milliers de Tziganes et de Juifs anéantis dans une demi-douzaine de camps. Les uns après les autres, un nombre incalculable de cadavres saisis par les panards, traînés dans des couloirs, hissés sur des chariots, introduits dans des fours pour finalement, à peine une demi-heure plus tard, ne plus êtres que cendre dans un creuset où se distinguaient une molaire, un fémur, un débris, un rictus… C’est ce qu’ont découvert, après analyse du trafic ferroviaire de cette époque hors norme, consultation de registres aux trois quarts calcinés, examen de montagnes de chaussures et de lunettes, de dentiers, de cahiers d’écoliers et de meules de cheveux, puis recoupement des résultats, tracé de courbes algébriques, prolongement d’icelles vers l’asymp-tote de la nausée, pantois et refusant d’y croire, les premiers enquêteurs. Et les Allemands d’une Bundesrepublik créée de fraîche date n’ont pas osé piper, de peur du jugement de leurs mômes. Ils ont courbé l’échine, rasé les murs, versé les dommages réclamés et bossé en silence, développé sur la base des acquis de la guerre leurs industries métallurgique, chimique et médicamenteuse. N’ont pas pipé non plus les vieux commerçants du Sentier, trop contents de gémir en s’emplissant les poches… Même chose pour les fondateurs d’Israël, satisfaits d’engranger les subsides, de justifier par la plantation d’orangers l’expulsion de burnous vivant là depuis toujours ; trop heureux également d’accueillir en leur sein (à condition qu’ils gardassent pour eux-mêmes ce qu’ils avaient vécu), en premier lieu les survivants de la Shoah, ensuite les rescapés des innombrables vexations que perpétuait à leur encontre une Europe mal guérie.
Sans doute devrais-je garder par-devers moi ces vérités inadmissibles aux yeux des dirigeants de notre peuple, de même inacceptables dans les milieux de la diplomatie. J’en suis conscient, mais ne vous attendez pas à une quelconque repentance de ma part, ni de celle de Mordekhaï. Nous n’avons pas lutté contre les promoteurs de l’extermination, nous ne les avons pas étripés à la chaîne, non plus que nous n’avons flanqué le feu à leur Führer pour aujourd’hui courber l’échine devant des diplomates siliconés et retendus de la tronche, qui se passent des petits fours pour ne pas voir les grands, ceux dont les gueules ont rougeoyé au Cambodge, en Birmanie, en Afrique et j’en passe. Non plus que devant des cagoulards et des néonazis dont la philosophie se résume au mensonge, la dialectique à l’invective, l’action à la profanation de nos sépultures, la solidarité au partage de l’ordure.
Passerais-je pour un détraqué, un adversaire du confort où se complaisent l’homme de bien, le lettré et le béotien ? Dans ce cas extirpons le bourgeois de sa chaise longue, plantons la créativité dans le croupion des serviteurs du vide, l’innovation dans le postérieur des garants de la bonne conscience. Et en ce qui concerne l’idéal des chantres du libéralisme, du totalitarisme et du calcul des intérêts, amenons-les sous l’orifice défécatoire du profit à tout prix, de l’ignorance d’autrui, du massacre des phoques et de la planète entière.
La création d’Israël en terre de Palestine, — je le clame haut et fort — fut la plus remarquable maladresse commise au lendemain de l’écrasement du Reich. Le nectar que nous pensions en tirer, pauvres idéalistes que nous étions alors, a tourné au vinaigre, et c’était prévisible : rassembler sur une terre quelconque, contre la volonté d’occupants dépossédés de leurs habitudes et de leur mode de vie — et qui d’autre que nous, spoliés comme aucun peuple ne le fut, pourrait-il mieux le comprendre ? —, quelques millions de membres d’une communauté jalouse de ses coutumes, méprisant ses voisins et pratiquant une religion aussi peu tolérante que possible, eh bien si ce pas n’est creuser une nouvelle fosse, au beau milieu cette fois des terres sacrées de l’humanité, je veux être pendu.
Pourquoi, comme l’avaient proposé certains, ne pas nous avoir attribué, en guise de pardon pour nos millions de frères assassinés, en plus d’une fraction de la richesse des bourreaux une partie de leur pays… oui, une bonne moitié de l’Allemagne, afin que nous y bâtissions notre nation ! Nous en restons pantois.
Alors qu’on ne vienne pas nous jeter à la face que nous avons à notre tour agi en prédateurs. Car nous avons donné, Mordekhaï et moi-même ! Donné de notre fortune et de notre espérance aux enfants des kibboutz, de l’ensemen-cement du désert, du partage de ses fruits, du cadeau de leurs élans et de leur enthousiasme. Mais depuis que ces enfants, soutenus par une descendance laissée dans l’ignorance des faits (ou pire désinformée par des canailles n’ayant d’autre objectif que le pouvoir et l’argent), ont déployé des barbelés autour d’une Palestine paraît-il terre promise, érigé des murailles censées les protéger du terrorisme, comme l’ont fait autrefois ceux qui voulaient nous humilier, nous affamer avant de nous exterminer, et qui ont failli réussir sans que personne le sache… eh bien la peur nous paralyse.
« Quand est-ce qu’on mange ? » a chevroté un vieil homme sur le tarmac du camp d’extermination d’Auschwitz Birkenau, dans un silence à couper au couteau, devant un alignement de tueurs.
3
Quand est-ce qu’on mange !…
De quoi se tenir les côtes quand on sait le peu d’empres-sement que mettaient les nazis à nourrir leurs détenus. Nous l’ignorions, mais rien n’était prévu pour ceux que l’on allait exécuter dès leur descente du train, pas même le bonbon qui console, non plus que le moindre verre d’eau. Et si chacun envisageait le pire, le traitement qu’on nous réservait ne nous effleurait pas. Si bien que durant une seconde toute sensation d’abandon nous quitta. Chacun se sentit lié aux autres par la formulation de ce besoin, manger, si bien que la question du vieillard nous rassembla en une communauté dont nous avions perdu les codes. Communauté de condamnés, sans doute, mais communauté malgré tout, appartenance à la fratrie des hommes.
Pour les nazis, la question prit en revanche la forme d’un pépin, et de taille. Chars d’assaut enlisés, ils laissèrent s’installer un silence où traînaient, en plus d’une senteur de chenil, des effluves de graillon à vous soulever le cœur. Les S.S. du comité d’accueil, qui évitaient de croiser nos regards, comme si l’innocence et l’espoir qui se lisaient nos yeux leur jetaient au visage leur propre ignominie, fixaient l’extrémité de leurs bottes. Si bien que je compris, dans un vertige clamant que nulle cantine n’avait été prévue pour nous, qu’on ne nous avait débarqués ici que pour nous égorger loin des fillettes allemandes.
Quand est-ce qu’on mange ? Par la formulation de ce besoin, Dieu nous ouvrait les yeux pour aussitôt couper le son, nous inviter à mesurer le danger, nous pousser à réfléchir et prendre une décision. Je vis Mordekhaï me fixer, puis se baisser vers son lacet défait. Je me baissai de même, tirai la lame dissimulée dans le lambeau de chemise me servant de chaussette.
Le son fut rétabli au moment où nous nous redressions, le cœur à deux doigts d’éclater. Et voici que claquaient cent talons, que cent bras se tendaient vers un seigneur ganté de blanc, un ange qui arborait en plus d’une cravache, symbole d’aryennité, sous sa veste d’Oberführer la chemise festonnée d’un membre de la jaquette. Nous le vîmes se hisser sur l’estrade qu’avait dissimulée la foule, gonfler le torse et peu après, une main sur la crosse de son arme, puis sur la sacoche de cuir qu’un des troupiers venait de déposer devant lui, se faire admirer sous des angles choisis avant de tourner sa noblesse vers nos milliers de paires d’yeux. Un sourire engageant illumina ses traits, un projecteur rehaussa d’or la blancheur de ses dents.
Vous désirez souper ? se prit-il à chanter sur l’air de la fraternité, après un long silence qui lui permit de nous jauger, de nous toiser me sembla-t-il, de nous peser et d’évaluer le nombre de couteaux nécessaires au traitement de notre foule. Je vous entends, mes amis, je vous entends ! Voyez d’ailleurs, reprit-il, nous désignant le rougeoiement qui m’avait intrigué et m’éclaira soudain, encore que l’énormité de la chose la rendît impossible… nos cuisiniers sont aux fourneaux et les fourneaux s’activent. Si j’en crois l’intendance — il tira de sa sacoche une feuille qu’il déplia et entreprit de lire — vous aurez droit ce soir… d’abord à un bouillon de poule accompagné de pommes de terre et de carottes au lard, ensuite à une crème fouettée. Cela vous convient-il ? Alors un peu de patience, poursuivit-il, faux cul, entreprenant de fouiller sa trousse pour en extraire un nouveau bobard, et laissez-moi vous désigner vos places. Puis revenu à son sujet : Cependant, avant de passer à table et de vous sustenter, mes amis, que diriez-vous d’une douche ? Mais auparavant — il désigna deux corps gisant sur le pavé — aidez vos hôtes à tirer à l’écart ceux qui se sont assoupis… et sans vous bousculer, bitte. Danke. Maintenant veuillez vous dévêtir, vêtements à mettre ici pour la désinfection, et pas de bousculade… les femmes et les enfants de ce côté, les hommes de ce celui-ci… ni de rouspétance bitte, sinon…
Schnell, Schweinen Juden, schneller ! ne put alors s’empêcher de brailler le comité d’accueil, réveillé en sursaut.
Mordekhaï et moi-même n’avons pas eu besoin de nous consulter. Un échange de regards, et tout s’est accompli dans une pagaille indescriptible. Tandis que les matraques s’abattaient au hasard, que les gosses se pendaient à leur mère, que les mères s’accrochaient aux maris, qu’une mamie cabossée s’affaissait à nos pieds alors que son conjoint se faisait estourbir, nous nous sommes élancés…
Pour ceux qui nous ont vus agir, notre action dut sembler suicidaire : fuir un tel déploiement d’hommes en armes ne pouvait mener loin. En sus (nous l’apprîmes dans l’après-midi) notre fuite éperdue fut payée au prix fort : les nazis trouvèrent là le prétexte de liquider l’ensemble du convoi, et nul parmi les détenus de longue date n’entendit parler du moindre survivant, personne d’ailleurs ne faisant d’assez vieux os pour accéder à de telles statistiques. En tout cas, pour nous, ce fut une épreuve d’autant plus éprouvante que nous étions au bord de l’épuisement. Depuis notre départ sous les horions des fonctionnaires d’une police française aux ordres de la Gestapo, nous n’avions eu pour réconfort que la puanteur de wagons à deux doigts de la casse, pour berceuse les sanglots des enfants et les râles des vieillards.