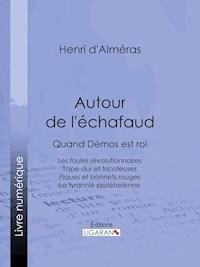
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Qu'est-ce que le peuple considéré comme classe ? Que désignait-on sous ce nom, au XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution, et pendant la Révolution ? En quoi le Peuple se distinguait-il de la Noblesse, de la Bourgeoisie ? En quoi différait-il de la Populace ? Questions délicates mais auxquelles je dois tout d'abord répondre, et par des définitions exactes. Pour bien comprendre les choses, il faut bien définir les mots."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
QU’APPELAIT-ON LE PEUPLE, SOUS LA RÉVOLUTION ?
Qu’est-ce que le peuple, considéré comme classe ? Que désignait-on sous ce nom, au XVIIIe siècle, à la veille de la Révolution, et pendant la Révolution ? En quoi le Peuple se distinguait-il de la Noblesse, de la Bourgeoisie ? En quoi différait-il de la Populace ? Questions assez délicates mais auxquelles je dois tout d’abord répondre, et par des définitions exactes. Pour bien comprendre les choses, il faut bien définir les mots.
Ouvrons, au mot peuple, le Dictionnaire de Trévoux (édition de 1732) :
« Peuple se dit plus particulièrement par opposition à ceux qui sont nobles, riches ou éclairés. Plebs. vulgus. » « Qui dit peuple dit plus d’une chose ; c’est une vaste expression. Il y a le peuple qui est opposé aux Grands, c’est la populace et la multitude. Il y a le peuple qui est opposé aux sages et aux habiles ; ce sont les grands comme les petits » (La Bruyère). « Il y a bien de la différence entre populus en latin et peuple en français. Le mot de peuple ne signifie d’ordinaire parmi nous que ce que les Romains appelaient plebs. » (Vaugelas). « Il faut être bien peuple pour se laisser éblouir par l’éclat qui environne les Grands » (Saint-Evremont). « Les gens de cour méprisent le peuple et ils sont souvent peuple eux-mêmes (La Bruyère). En ce sens, peuple signifie les manières basses et les sots préjugés du peuple. Tout le monde n’est pas peuple ; c’est-à-dire tout le monde n’est pas sot ou dupe. Le peuple est peuple partout, c’est-à-dire sot, remuant, aimant les nouveautés. Inconstants, variants, mutabilis. Cet homme est gâté de toutes les erreurs et opinions du peuple. Il est de la lie du peuple. Le petit peuple, le menu peuple, le commun du peuple est malin et séditieux. Il y a bien du peuple au quartier des Halles, c’est-à-dire de la populace, de la canaille. »
Voyons maintenant dans le même dictionnaire (le plus important et le plus complet avant la publication de l’Encyclopédie), le mot populace.
« Menu peuple, la lie du peuple ; foule de petites gens. Plebs, plebecula. Dans les grandes cérémonies, on est fort embarrassé de la populace : il faut mettre des gardes pour chasser la populace. Quand la populace est une fois émue et irritée, il est difficile de l’apaiser. "Il faut qu’un prédicateur accoutume ses auditeurs à se voir traiter en honnêtes gens et non point en populace" (Ménage). "Rien n’est si puissant pour tenir en bride une populace effrénée que le prétexte de la Religion" (Vaugelas). "La populace se fait craindre si elle ne craint. " (Bouhier). »
On a assez fréquemment confondu, bien à tort, ces deux termes, peuple et populace, et c’est ce que fait, par exemple, au mot « petit peuple », le DICTIONNAIRE DE RICHELET (édition de 1738) :
« C’est toute la racaille d’une ville. C’est tout ce qu’il y a de gens qui ne sont pas de qualité ni bourgeois aisés, ni ce qu’on appelle honnêtes gens. Le petit peuple de Londres est méchant. »
En somme, si nous essayons de nous y reconnaître dans toutes ces définitions, nous pourrons constater que la partie de la population appelée le Peuple, on l’opposait aux nobles, aux bourgeois aisés et aux « honnêtes gens ». Honnêtes gens, on qualifiait ainsi, non pas ceux qui se signalaient par une probité exceptionnelle, mais ceux qui, « bien nés », bien éduqués, et appartenant à une carrière libérale, ne paraissaient pas déplacés dans une réunion mondaine. On les jugeait et on les classait, comme aujourd’hui (sans trop approfondir), sur les apparences les manières, le costume, – et les « honnêtes gens » n’étaient pas toujours des gens honnêtes.
Un boutiquier, un artisan, un petit fonctionnaire étaient du peuple, et ne s’en cachaient pas, mais on les aurait blessés et humiliés en les rangeant dans la populace. Ce terme de populace avait un sens très péjoratif. Il signifiait non seulement manque complet d’instruction, de culture, d’éducation, vulgarité, grossièreté, mais aussi vie précaire, au jour le jour, et instincts anarchiques.
Lorsque Jules Favre affirmait à Bismarck, en 1571, qu’il n’y avait pas à Paris de populace, il voulait dire que toute la population parisienne n’était composée que de bons citoyens, honnêtes travailleurs, hostiles au désordre et à l’émeute ; et il disait cela quelques mois avant la Commune.
Pendant la Révolution, chaque parti prétendait avoir pour lui le peuple et contre lui la populace, formée surtout d’étrangers, de bandits soldés et cosmopolites.
« Dites-nous, demandait Robespierre à Louvet, le 5 novembre 1792, à la Convention, dites-nous ce que vous entendez par les deux portions du peuple que vous distinguez dans tous vos discours, dans tous vos rapports, dont l’une est flagornée, adulée, égarée par nous ; dont l’autre est paisible mais intimidée ; dont l’une vous chérit et dont l’autre semble incliner à nos principes… Votre intention serait-elle de désigner ici et ceux que Lafayette appelait les honnêtes gens, et ceux qu’il nommait les sans-culottes et la canaille ? »
Les chefs de la Révolution et même, ce qui paraîtra plus surprenant, les victimes de la Révolution ne voyaient ou affectaient de ne voir dans les émeutiers, les meurtriers et les pillards, qu’une bande peu nombreuse mais résolue, qui, à force d’audace, subjuguait Paris. Paris tremblait devant ces bandits, et combien étaient-ils ? Un millier, assurait l’Ami des Patriotes, du 1er janvier 1791, un millier qui imposait ses volontés à cinquante ou soixante mille personnes, lesquelles, pendant qu’on tuait, « restaient enfermées dans leurs ateliers, dans leurs boutiques, dans leurs cabinets ».
André Chénier, dans une brochure, publiée en 1791 sur l’Esprit de parti, soutenait la même thèse :
« Je ne conçois pas, écrivait-il, comment tant de personnes et même de législateurs, se rendent assez peu compte de leurs opinions pour prodiguer sans cesse ces noms augustes et sacrés de peuple, de nation, à un vil ramas de brouillons qui ne feraient pas la centième partie de la nation ; mercenaires étrangers à toute honnête industrie, inconnus et invisibles tant que règne le bon ordre, et qui, semblables aux loups et aux serpents, ne sortent de leur retraite que pour outrager et nuire. »
Presque tous les historiens, presque tous les psychologues de la Révolution ont adopté aveuglément cette théorie du Peuple qui reste sans reproche, sinon sans peur, au milieu de tant de crimes. L’un d’eux, et un des plus réputés, Paul Janet écrivait, en 1872, dans la Revue des Deux Mondes :
« Pour M. Louis Blanc, les girondins représentent la bourgeoisie, les montagnards, le peuple. Rien de plus faux selon M. Michelet. Les jacobins n’étaient pas moins des bourgeois que les girondins, "pas un ne sortait du peuple". La stérilité des girondins tient non pas à leur qualité de bourgeois, mais à leur fatuité d’avocats. Les deux sectes avaient cela de commun de se croire l’une et l’autre bien au-dessus du peuple : "Les deux partis reçurent leur impulsion des lettrés". On veut voir du socialisme dans toutes les émeutes populaires. C’est insulter au peuple et le rabaisser. "Partout où ils rencontrent du pillage, du brigandage, c’est le peuple. Voilà le peuple !" Selon M. Michelet, la question ouvrière n’existait pas alors et même "la classe ouvrière n’était pas née". La France nouvelle, celle du paysan et de l’ouvrier, s’est formée en deux fois : "Le paysan est né de l’élan de la révolution, et de la guerre et de la vente des biens nationaux. L’ouvrier est né en 1815 et de l’élan industriel de la paix". Écartons l’hyperbole et nul doute que ces lignes ne soient l’expression de la vérité. »
Il y a dans cette vingtaine de lignes presque autant d’erreurs que de mots, et c’est ce que nous essaierons de démontrer.
Et d’abord, ce millier d’émeutiers professionnels dont parlait l’Ami des Patriotes, dans son article du 1er février 1791, à combien de milliers s’élevait-il ? « Une immense population, disait Mirabeau en 1790, une immense population accoutumée depuis des années à des succès et à des crimes. »
Sans doute, dans ces foules qui, les jours d’émeute, remplissaient les rues, les curieux, les badauds dominaient. Beaucoup de Parisiens, pour ne pas tacher leur habit, n’auraient pas voulu mettre la main à la pâte. Leur plaisir ne s’en trouvait pas sensiblement diminué. Ils ne tuaient pas, n’en ayant pas l’habitude ni peut-être le goût, mais ils étaient assez désireux de voir tuer. Ils allaient assister aux massacres comme à une représentation théâtrale, et cette représentation était gratuite.
Cela nous étonne un peu (pas trop), mais probablement parce que nous jugeons ces choses d’hier avec nos idées d’aujourd’hui, parce que nous ne tenons pas assez compte de la mentalité révolutionnaire, de la mentalité de la Révolution. Nous en sommes encore à la grande image d’Épinal, où la guillotine est cachée par les drapeaux de Valmy.
En 1793, ceux qui n’avaient pas abdiqué tout sentiment de pitié se cachaient, sortaient le moins possible. Les autres, quand ils n’étaient pas cruels par instinct, le devenaient par réflexion. Ils se disaient qu’en somme toutes ces victimes, que leur mort tragique semblait rendre intéressantes, avaient mérité leur sort. N’étaient-ce pas des aristocrates, des prêtres, des ennemis du peuple ? N’avaient-ils pas conspiré ? N’avaient-ils pas souhaité la fin de la République ? On ne les massacrait que pour sauver la patrie.
Il est vrai que, parmi ces victimes, on comptait, et en assez grand nombre, des vieillards, des enfants. Mais ces vieillards avaient si peu de temps à vivre ! On ne leur prenait que quelques années. Quant aux enfants, ne seraient-ils pas devenus, eux aussi, des aristocrates dangereux, des adversaires de la République ? Mieux valait les supprimer.
Ainsi raisonnait le patriotisme, l’aveugle patriotisme, surchauffé par les clubs, les journaux, les pamphlets, surexcité, jusqu’à la folie, par l’atmosphère d’exaltation et de terreur dans laquelle on vivait alors.
Patriotisme chez quelques-uns, haine chez beaucoup d’autres. La haine formait alors, comme elle formera toujours, le fond de l’âme humaine. Le patriotisme, si fanatique qu’on le suppose, se serait lassé, la haine ne se lassa pas. Seule elle explique comment un pays (et ce pays ne pouvait être que la France), pendant deux années au moins, supporta, rechercha, sans frémir de dégoût et d’horreur, sans protester, sans même fermer les yeux, le spectacle presque quotidien de ces égorgements.
Or, cette haine devait exister surtout dans la classe la plus impulsive, la moins affinée, dans la classe qui se croyait opprimée, et qui avait subi tant d’humiliations et qui avait à prendre tant de revanches.
Ce n’était pas seulement la populace, c’était le Peuple, dont parlait avec une tardive indignation, après l’avoir elle aussi adulé, Mme Roland, dans ses Mémoires :
« Quelle Babylone présenta jamais le spectacle de ce Paris, souillé de sang et de débauches ?… Quel peuple a jamais corrompu sa morale et son instinct, au point de contracter le besoin de voir des supplices, de frémir de rage quand ils sont retardés, et d’être toujours prêt à exercer sa férocité, sur quiconque entreprend de l’adoucir et de le calmer ? Les journées de septembre ne furent que l’ouvrage d’un petit nombre de tigres enivrés ; celles des 31 mai et 2 juin (1793) marquèrent le triomphe de la scélératesse, par l’apathie de tous les Parisiens et leur aveu tacite à l’esclavage : depuis cette époque, la gradation est effrayante… Un peuple nombreux environne le palais de la justice et sa fureur éclate contre les juges qui ne prononcent pas assez vite la condamnation de l’innocence. ».
Était-ce de la populace, cette foule de marchands, de bourgeois, d’artistes qui, le 18 avril 1791, lorsqu’un commencement d’émeute empêcha le Roi de partir pour Saint-Cloud, se pressait et vociférait sur la place du Carrousel ?
Appartenait-il à la populace ce boutiquier qui, le 14 juillet 1789, se distingua parmi les meurtriers du prévôt des marchands Flesselles ?.
Il ne fut pas une exception, à cette époque. On pourrait appliquer son histoire, avec quelques changements et d’autres noms, à des milliers de petits bourgeois parisiens.
C’était un orfèvre, originaire du village de Charleville, en Champagne. Il s’appelait Moraire. Il avait sa boutique rue de l’Arbre-Sec, cul-de-sac de la petite Bastille.
Au moment où Flesselles essayait de sortir de l’Hôtel de ville, il lui tira un coup de pistolet dans la tête.
Plus tard, ce Moraire voulut se faire nommer capitaine d’une des compagnies du centre, à Paris, dans la Garde Nationale. On le repoussa comme assassin.
Au début de la Terreur, à un moment où il aurait pu se rendre si utile, à Paris, il le quitta brusquement. Il se réfugia en province, puis en Italie, puis en Espagne, de nouveau en Italie, accablé de remords, ayant sans cesse sous les yeux l’image de sa victime, toujours poursuivi et traqué par la crainte du châtiment.
Il n’est pas douteux, et on pourrait le prouver par une infinité d’autres exemples, que beaucoup de boutiquiers, imbus des haines populaires et, comme nous le verrons, exaspérés par une crise économique qu’ils attribuaient aux royalistes, figurèrent fréquemment dans les bandes de massacreurs. Pendant les journées de septembre, ils se montrèrent féroces. Peu instruits, peu cultivés, l’esprit rétréci et aigri par le trafic quotidien, la recherche d’un gain précaire, la jalousie contre les concurrents, la haine contre les riches, ils se rattachaient au Peuple. Ils n’en formaient pas la partie la plus intéressante.
Dans le peuple proprement dit, il y eut, on doit le reconnaître, des exemples de pitié, de bonté. La monarchie y conservait des partisans, et assez nombreux, dans la corporation des porteurs d’eau notamment. Je ne m’explique pas pourquoi mais il faut bien que ce soit vrai puisque, à une séance de la Commune, le 23 septembre 1793, Hébert le constate et le déplore. Après avoir attaqué vivement ces porteurs d’eau, des Auvergnats sans doute, des têtes carrées peu attirées par les innovations, il ajoute : « Il y a beaucoup d’aristocrates parmi ces messieurs. »
On continuait dans les guinguettes, entre amis, à chanter la chanson royaliste sur la captivité de Louis XVI et de sa famille, Pauvre Jacques.
De braves gens restaient fidèles au malheur.
Lorsque le journaliste du Rosoy eut l’idée de faire appel aux royalistes les plus dévoués pour servir d’otages, et en publia la liste dans la Gazette de Paris (où l’on voit entre autres noms un Balzac, un Banville et un Musset-Patay), il y eut, parmi ceux qui répondirent, un petit artisan de Vaas, près de Château-du-Loir, Paul Méchin : « Je suis pauvre, écrivit-il, mais je porte un nom français ; si l’on ne me juge pas indigne de l’honneur d’être otage de mon roi et de sa famille, j’irai prendre des fers. Je n’ai point assez d’argent pour me mettre en route, je vendrai mes boucles et ma montre pour subvenir aux frais du voyage. »
Même en pleine Terreur, il y avait encore des cafetiers royalistes. L’observateur Moncey, dans son rapport du 19 février 1794, en signale un qui ne cachait guère ses opinions.
« Deux citoyens étant dans le café qui fait le coin de la rue des Bons-Enfants et de la rue Saint-Honoré, voulaient chanter une chanson patriotique, le limonadier qui est aristocrate n’a pas voulu qu’ils chantent chez lui. Ces citoyens ont dit : Mais c’est du patriotique que nous chantons ; cela m’est égal, vous ne chanterez pas chès moys. Ce qui a fâché ces citoyens et de paroles en paroles ils se sont pris au collet, mais d’autres citoyens les ont séparés. Ces deux citoyens lui dirent en s’en allant, va, aristocrate, tu mériterais bien que nous allions te dénoncer. ».
Un de ces braves gens de la classe populaire qui se distinguèrent, au milieu de tant de fanatiques et de pseudo-justiciers, par leur tolérance, par leur pitié, ou même par leur dévouement, ce n’était pas un cafetier, comme l’anti-chansonnier de la rue des Bons-Enfants, mais il appartenait à la même profession, et il répondait au nom ou plutôt au surnom de Pisse-Vinaigre.
Bailleul nous le présente dans son Almanach des bizarreries humaines ou Recueil d’anecdotes sur la Révolution, publié en 1796. Il l’avait connu pendant son emprisonnement avec soixante-douze autres députés girondins.
« Un pauvre garçon limonadier, attaché à un café près de la prison appelée la Force, avait pris en affection les soixante et quelques députés qui y étaient détenus. Il leur rendait quelquefois des services qu’on ne peut attendre que de l’amitié. Ils voulurent d’abord lui donner de l’argent. Il refusa, en disant : Je prendrai volontiers les quelques sous que l’on donne à un garçon quand on prend le café ; mais jamais je ne recevrai rien pour ce que je fais par pure amitié pour vous ».
Je suis fâché, qu’on ait donné à cet estimable jeune homme un nom ridicule ; on l’avait surnommé Pisse-Vinaigre. Mais, enfin, c’est ainsi qu’on l’appelait et il ne s’en fâchait pas.
Lorsque les députés furent transférés de la Force aux Madelonnettes, Pisse-Vinaigre, les larmes aux yeux, suivait les charrettes au milieu des femmes éplorées. Il venait de temps en temps voir ses chers prisonniers, au moyen d’une fenêtre qui donnait dans une cour où l’on pouvait quelquefois parvenir. Arrivé là, il faisait un cri bien connu des députés. Il en venait quelques-uns à la fenêtre. Pisse-Vinaigre les voyait, il témoignait sa satisfaction et s’enfuyait.
Pour moi, je trouve quelque chose de bien touchant dans ces témoignages d’affection, mais voici qui l’est davantage. Les députés furent de nouveau transférés des Madelonnettes aux Bénédictins du faubourg Marceau. Cette translation fut ordonnée brusquement, exécutée à l’instant, et eut lieu entre onze heures et minuit. Leur émotion surpassa leur surprise lorsqu’ils entendirent le cri accoutumé de Pisse-Vinaigre. C’était lui en effet qui suivait les voitures, qu’il ne quitta qu’au moment où les députés furent entrés dans leur nouvelle prison. Où la vertu va-t-elle se nicher ?…
Même parmi les émeutiers, parmi les meurtriers, il s’en trouva qui valaient mieux que la besogne qu’ils accomplissaient et qui ne furent, par fanatisme, que des assassins provisoires et intermittents. L’un d’eux sauva le maréchal de Mailly, pendant la journée du 10 août.
Le maréchal de Mailly, qui avait alors 87 ans, était, le 10 août, aux Tuileries dont il dirigeait la défense. Il essaya de s’en échapper et il eut la chance d’y réussir, mais, arrivé sur le quai, il fut aperçu par deux émeutiers qui rôdaient par là et qui se précipitèrent dans sa direction : « Voilà un de ces coquins d’aristocrates. Tuons-le ! » Au même moment, passa près d’eux un autre fuyard, mais plus ingambe, et qui courait de toutes ses forces. L’un des deux hommes dit à son camarade : « Tâche de rattraper celui qui a pris la fuite, moi je me charge de celui-ci. » Aussitôt qu’ils furent seuls, il s’approcha du maréchal et changeant brusquement de ton et de manière : « Brave vieillard, lui dit-il, je vois que vous marchez péniblement. Appuyez-vous sur mon bras et ne craignez rien. » Puis, lui ayant demandé où il habitait, il le conduisit jusqu’à son hôtel. Là, le maréchal de Mailly se nomma. Il interrogea celui qui venait de le sauver et qui était un pauvre artisan chargé de famille, et après l’avoir remercié, et l’avoir engagé à revenir le voir, il lui donna un assignat de 200 livres.
Une vingtaine de jours plus tard, pendant les journées de septembre, un des détenus de l’Abbaye, Jourgniac de Saint-Méard dut en partie son salut à un des égorgeurs qui, ayant reconnu en lui, a son accent, un méridional (Jourgniac était gascon et l’autre, originaire de Villeneuve-lès-Avignon, languedocien) se mit à lui parler patois, le prit sous sa protection et l’aida à s’en aller sain et sauf, le 4 septembre.
Ces définitions et ces explications données, je reviens à la question posée au début de ce chapitre préface, qu’est-ce que le peuple ? Ce mot Peuple, je l’écris trop souvent dans mon livre pour que je ne me croie pas obligé de dire ce que, pour moi, il signifie.
Il y a, assurément, dans le Peuple, une sorte d’aristocratie, intellectuelle, morale. Cette aristocratie n’est pas le Peuple. Tôt ou tard, même quand elle a l’air de s’y maintenir, elle s’en sépare et le dépasse.
J’appelle Peuple, non pas une classe distincte, déterminée et délimitée, fatale et infranchissable, comme une ancienne caste de l’Inde, mais, en prenant ce mot dans son sens le plus péjoratif, tout ce qui, dans toutes les classes, se rapproche le moins de l’élite, lui est contraire, opposé et hostile – l’ignorance contre l’instruction, la sottise, hargneuse, agressive, contre l’intelligence, la foi aveugle contre la libre-pensée, le fanatisme contre la tolérance, le patriotisme étroit et obtus contre une large compréhension de la solidarité humaine, la brutalité des appétits contre le goût de l’étude et le culte du Beau.
Tout cela, pour moi, c’est le Peuple (et on ne saurait nier que c’est dans la classe populaire qu’on le rencontre le plus fréquemment) et tout cela c’est aussi, pour peu qu’on veuille y réfléchir, le règne du Peuple, la Démocratie, jalouse, niveleuse, anarchique, destructrice des supériorités les plus légitimes, les plus nécessaires, semeuse d’envie et de haine.
À travers la Révolution, qu’elle a fait dévier de son noble programme, qu’elle a rendue, à son image, haineuse, violente et stupide, c’est la Démocratie que j’ai visée, et je ne m’en cache pas. Les allusions au temps présent, je ne les ai pas recherchées mais je n’ai pas voulu les fuir.
Je me suis efforcé d’être impartial. J’ai toujours pensé, et je continue à croire que l’Histoire doit être réaliste et matérialiste. Plus encore que le dénigrement, l’idéalisation conduit, inévitablement, à l’erreur.
Examiner, contrôler, enregistrer, agir comme un juge d’instruction ou un détective, interroger les témoins, peser les témoignages, se défier des déformations et des embellissements et des phrases et des attitudes, n’attacher d’importance qu’aux faits, et à condition de les bien connaître, et ne prendre parti que pour la vérité, telle est la tâche qui s’impose à un historien.
Qui serait capable de la remplir ? Il faudrait avoir un cœur assez froid, un esprit assez calme pour étudier l’animal humain – dont les sentiments et les passions sont beaucoup plus bornés qu’il ne pense – comme un naturaliste sans imagination, mais bien renseigné, étudie un chimpanzé ou un cynocéphale.
Salle ogivale dite d’Héloïse et Abeilard, sous la salle du Tribunal révolutionnaire.
Sous la Révolution, comme aujourd’hui, paysans et ouvriers formaient les d’eux principaux éléments du Peuple. Il y avait entre eux de grandes différences.
Le paysan, ce qui le caractérisait – et le caractérisera toujours – c’était l’amour forcené, exclusif, de la terre. Sa terre, c’était son royaume. Il ne songeait qu’à l’étendre. Non pas seulement par goût, mais par orgueil. L’importance qu’il se donnait, et qu’on lui donnait dans son village, se mesurait à l’étendue des prés, des vignes, des bois dont il était le maître et seigneur. Conquérant de la terre, il regardait d’un œil jaloux, il menaçait sans cesse, comme tous les conquérants, le royaume, grand ou petit, de ses voisins. Et cette jalousie, cette ambition, il les eut à toutes les époques, au Moyen-Âge comme dans les temps modernes : « Au XIIIe siècle, comme toujours, remarque un de ceux qui, dans le cours de leurs études historiques, eurent à parler de lui, on retrouve, chez le villageois, l’envie, la convoitise du bien de son voisin. Il manque rarement de tracer un petit sillon en dehors de son champ, recule à droite et à gauche les bornes de son pré. »
Ce désir, ce besoin de posséder, d’acheter de la terre, il les poussait jusqu’à la monomanie. Toutes ses économies y passaient. Prés ou vignobles, bois ou pâturages, il ne connaissait pas d’autre forme de la richesse, et cette richesse, trop étalée sur le sol, trop soumise aux variations de la température, devint une des principales causes de sa misère.
Rien ne le corrigeait. Rien n’affaiblissait sa passion. Il ne pouvait pas payer l’impôt, il n’avait pas de quoi manger à sa faim, et presque tout le territoire de la France lui appartenait. Un demi-siècle avant la Révolution, l’abbé de Saint-Pierre constate que « les journaliers (nous dirions aujourd’hui les travailleurs agricoles) ont presque tous un jardin ou quelque morceau de vigne ou de terre. »
De nos jours, vivant trop près les uns des autres, ils se jalousent entre eux. Jadis ils étaient encore plus resserrés et isolés dans leur village, avec moins de moyens de s’en évader, de s’en affranchir, mais toutes les jalousies, secrètes et silencieuses, se tournaient contre le château, qui imposait la corvée, qui exigeait de multiples et gênantes redevances, contre le couvent, qui percevait la dîme. Et le paysan courbait la tête, saluait humblement ceux qu’il haïssait, et, patiemment, la rage au cœur, attendait son heure.
La Révolution, dès qu’elle éclata, dès que les canons postés devant la Bastille sonnèrent le tocsin, ce fut, pour ce paysan, l’occasion attendue et le moyen offert de se libérer, de se venger. Il le fit brutalement, sauvagement. Colères réfrénées, humiliations subies, tout prit sa revanche. Revanche terrible, féroce, car il n’y avait pas seulement une exaspération, dans bien des cas, justifiée ou du moins excusable. Il s’y ajoutait, et ce fut très visible, la brutalité naturelle au paysan, la sournoise violence de cette partie de la population dans laquelle, même relativement, il se commet le plus grand nombre de crimes.
De village en village, le pillage des châteaux avait commencé. Ce fut une jacquerie comparable à celle du Moyen Âge. Ce fut « la grande peur de 1789. »
Le signal de la Terreur, le paysan, avec ses fureurs de taureau, le donna. Certains épisodes de cette Terreur villageoise peuvent être rapprochés des massacres de septembre.
Au Mans, M. de Montesson fut égorgé, après avoir vu égorger sous ses yeux son beau-père. En Languedoc, M. de Barras fut coupé en morceaux devant sa femme près d’accoucher. Le chevalier d’Ambly fut traîné sur un tas de fumier. On lui arracha les cheveux et les sourcils, et comme le peuple a besoin de danser quand il est content, hommes et femmes improvisèrent, autour de ce malheureux chevalier, une ronde assez semblable à la danse du scalp.
Un journal appelait ces divertissements rustiques « des scènes sanglantes mais nécessaires ».
Pendant qu’elles se déroulaient un peu partout des petites troupes de bandits et de vagabonds parcouraient les campagnes, et sans aucun parti pris, pour ne pas afficher une opinion politique, saccageaient également, avec la même ardeur, les châteaux et les chaumières. Ils ne se privaient pas non plus de détruire les récoltes. Telle est l’origine des fameux Chauffeurs qui sévirent surtout à l’époque du Directoire.
Tant que dura la « grande peur », beaucoup de seigneurs furent obligés, le couteau sur la gorge, de renoncer à des redevances résultant d’accords librement consentis. Dans bien des cas, les actes prouvant ces accords n’existaient plus. Ils avaient disparu dans l’incendie des châteaux et ces incendies n’avaient souvent d’autre raison que de les faire disparaître. En même temps, l’émigration laissait sans défense des terres dont s’emparaient des voisins plus avides que scrupuleux.
Le paysan devint ainsi le grand bénéficiaire de la Révolution, mais aussitôt qu’on eut supprimé (quand il ne les supprima pas lui-même par la violence) les abus qui le gênaient, il s’empressa d’en établir d’autres, à son profit. Ainsi, pour me borner à un exemple, il se plaignait des chasseurs qui ravageaient ses terres, mais, à peine délivré de ces chasseurs, il se mit à braconner et à détruire un peu partout le gibier.
Propriétaire féroce, il gardait ses terres, le fusil à la main, contre les maraudeurs. Pour ne pas perdre un chou, il aurait tué un homme.
Il gardait contre les citadins, les hommes de la ville, sa vieille antipathie d’homme sauvage, d’homme des cavernes, et nous verrons comment elle s’exerça.
Dans la misère universelle, il fut le riche, le nouveau riche, le mauvais riche.
Dans un rapport à la Convention, le 3 août 1793, Fabre d’Églantine indique comment, à cette époque, le paysan prospérait, s’engraissait, arrondissait son domaine, alors que tant de Français se ruinaient, crevaient de faim.
« Le fermier qui, avec 10 000 livres en assignats, paie au propriétaire son bail de 10 000 livres, qui n’éprouve aucune perte dans le change, et qui se hâte de renchérir son blé, ses foins et son beurre, celui-là, certes, s’enrichit trop vite aux dépens de la société. »
Ajoutez (et cela, Fabre d’Églantine ne le disait pas et ne pouvait pas le dire) que beaucoup de ces paysans avaient volé les biens des seigneurs ou les avaient acquis à des prix dérisoires.
Nous les voyons, plus tard, ces paysans, dans le portrait qu’en fait Mercier, l’auteur du Nouveau Tableau de Paris, gorgés d’argent, enflés d’une épaisse et insolente vanité, étalant lourdement leurs écus, et n’éprouvant aucun sentiment de pitié pour les victimes de la Révolution, dont souvent ils se partageaient les dépouilles :
« Ces fermiers riaient des souffrances des Parisiens et en tiraient tout le parti que peut inspirer la plus ardente et la plus détestable avarice. La révolution, qui leur a restitué une si grande dose de liberté, et qui fait leur richesse, ils ne savaient ni la reconnaître ni jouir de ses bienfaits avec reconnaissance. Leurs femmes ont acheté toutes les nippes des bourgeoises ; elles mangent sur des assiettes d’argent ; elles ont la migraine et disent à leur mari : Je ne me lèverai pas aujourd’hui ; qu’on dise que je suis malade. On voit des meubles de damas et des tables d’acajou à côté des charrues, du fumier et de l’attirail de la ferme…
Une mesure de farine à la main, le fermier enlève tout ce qu’on lui présente. Il a fait rafle des bagues, des croix d’or, des dés et de tous les bijoux des habitants des faubourgs…
Tandis qu’il mangeait à sa volonté, le menu peuple se réunissait en tas, dès les six heures du matin, aux portes des boulangers et des bouchers… »
Tout ceci ne rappelle que de très loin les pastorales de Florian ou les opérettes villageoises de Favart.
Émancipés, gorgés par le nouveau régime, les paysans ne lui en savaient aucun gré. Comme il arrive d’ordinaire, révolutionnaires et terroristes quand ils étaient pauvres, riches ils devinrent les plus bornés et les plus obtus des conservateurs. Ils se montraient plus que jamais arriérés, rétrogrades, attachés à leurs vieilles coutumes.
Leur ignorance de tout, sauf de la culture de la terre, les empêchait de rien comprendre à ce qui se faisait, à ce qui se disait à la ville. Le drame qui se jouait près d’eux ne les passionnait pas. Les massacres, les exécutions, dont il leur arrivait un écho affaibli, leur causaient moins d’émotion que de plaisir. Seul, les intéressait le prix des denrées, et ils ne s’émurent véritablement que lorsque fut menacée une religion dont ils ne voyaient, d’ailleurs, que les côtés les moins recommandables. Alors, à l’appel de leurs curés, en Vendée et ailleurs, ils prirent le fusil et la faulx.
Quelle que fût son arme, quel que fût son outil, le paysan resta toujours hostile à la Révolution, et c’est lui qui la tuera.
L’ouvrier se pose volontiers en victime. Nous allons voir que, sous la Révolution, il fut plutôt un privilégié.
On avait créé pour lui, après le 14 juillet, des ateliers nationaux, les premiers. Ils donnèrent de si mauvais résultats, comme ceux qui devaient suivre, qu’on fut obligé de les supprimer.
L’Assemblée constituante envoya en province une grande quantité d’ouvriers, pour des travaux de canalisation mais il en restait encore beaucoup, sans travail, à Paris, parmi lesquels de nombreux chômeurs volontaires et professionnels. Ils formèrent des rassemblements tumultueux sur la place Vendôme et la place de Grève, et s’emparèrent des canons qui se trouvaient au poste du Petit Saint-Antoine. La Garde Nationale les désarma, mais il ne suffisait pas de les désarmer, il fallait, pour qu’ils se tinssent tranquilles, les occuper.
Après le 10 août (1792), l’Assemblée législative avait décrété la formation, dans les environs de Paris, d’un camp composé de fédérés du département et chargés de la protéger contre le mauvais esprit parisien. En s’emparant de l’idée et du projet, la Commune les fera complètement dévier.
Au début, « le camp fut à la mode ». Hommes et femmes, les hommes parce qu’il y avait des femmes, les femmes parce qu’il y avait des hommes, allaient, sans exiger aucun salaire, mais sans s’imposer une trop grande fatigue, gratter quelque peu la terre, creuser des retranchements, élever des talus. C’était l’amusement du jour, et même de la nuit. On en fut vite lassé. Après les journées de septembre, on n’employait plus que des ouvriers payés. Un décret du 13 septembre généralisa le système, qui pouvait, dans une certaine mesure, remédier au chômage. Aux ouvriers qui travailleraient au camp, on promit un salaire de 42 sols par jour.
Ce qui se passa, à la suite de ce décret, une des Sections de Paris va nous le dire, la Section des Quinze-Vingts (du faubourg Saint-Antoine), qui ne comptait certes pas parmi celles que l’on pouvait taxer d’incivisme. À peu de jours d’intervalle, des délégués de cette Section présentèrent à la barre de l’Assemblée législative deux adresses protestant contre cet atelier national où on travaillait le moins possible.
« Législateurs, disait une de ces adresses, un fait n’a pu échapper à la Section des Quinze-Vingts qui toujours veille pour le bien public et ne peut souffrir d’abus.
Vous avez ordonné un camp sous Paris qui demande les travaux les plus assidus. Votre intention n’est donc pas qu’on enrôle des gens pour ne rien faire, néanmoins on reçoit à tout âge ; des filles se présentent même, déguisées en hommes…
Un seul moyen de remédier à ces abus et de ne payer que des ouvriers utiles serait de payer à la tâche et non à la journée. »
Le 17 septembre, l’Assemblée générale de la Section des Quinze-Vingts prit cette délibération :
« L’Assemblée indignée de voir que la presque totalité des ouvriers qui ont des états et de l’ouvrage quittent leurs maîtres où ils ne gagnent de l’argent qu’en travaillant pour aller gagner 42 sols au dit camp à presque rien faire, ce à quoi ils ont été recrutés à son de caisse ; tous les travaux étant à la veille de manquer par cette perversité.
L’Assemblée nomme MM. Violet, Guyot, Gofflet, Colin, Seigneury et Villard pour porter son vœu à ce sujet qui est : qu’aucun ouvrier ne pourra être admis aux travaux du camp s’il ne peut prouver qu’il est sans ouvrage et qu’il ne peut en trouver ; plus, qu’aucun ouvrier dudit camp ne sera payé qu’au prorata de l’ouvrage qu’il aura fait, soit à la tâche, soit à la toise, et non autrement.
VIOLET, président ; RENÉ, secrétaire. »
Le lendemain, 18 septembre, le ministre du Trésor public, Cambon, fit décréter que les ouvrages du camp seraient payés aux journaliers et ouvriers « à marche fixe et non à la journée ».
Le 25 septembre la Section des Sans-Culottes (quartier du Jardin des Plantes), intervenant à son tour, disait dans une adresse à la Convention :
« Le service du camp dévore par semaine 26 000 livres.
Il y a là 8 000 hommes qui ne font rien, gardés par 200 hommes qui n’empêchent aucun désordre. »
Le 26 septembre, le procureur général syndic du département de Paris écrivait aux administrateurs du district de Saint-Denis : « Citoyens, le maire de la Chapelle nous avertit que l’on dévaste les cultures de sa municipalité, que, pour se chauffer au camp, on abat les arbres de l’avenue Saint-Denis. »
Le même jour, le Comité militaire proposait une loi qui réglait les travaux du camp, excluait les femmes et les enfants au-dessous de quinze ans, établissait comme règle le travail à la tâche et fixait un salaire qui variait de 25 à 30 sols par jour.
Une délégation d’ouvriers vint protester à la barre, le 2 octobre, mais les abus de cet atelier de fainéants avaient fini par soulever l’opinion publique. La Convention fut obligée de le fermer et tous ceux à qui il procurait des loisirs trop coûteux pour l’État furent licenciés, à partir du 20 octobre.
D’ailleurs la préparation de la guerre fournissait du travail à ceux qui en voulaient et l’ouvrier ne tarda pas à avoir, au milieu de la misère publique, une situation très enviable. Avec les assignats multipliables à volonté, on pouvait, comme aujourd’hui avec les billets de banque, adapter de jour en jour ses salaires à l’accroissement constant du prix de la vie. Dans ses MÉMOIRES ANECDOTIQUES POUR SERVIR À L’HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE qui parurent en 1823, un homme très renseigné, Lombard de Langres, note « la création du papier monnaie et l’usage immodéré qu’on en fit à cette époque pour salarier la populace… » Le mot populace est un peu gros mais on ne saurait nier, à moins de vouloir nier l’évidence, que la moitié de la France n’entretînt alors l’autre moitié.
Le papier avec lequel on payait son travail suffisait si bien à l’ouvrier qu’il ne prit qu’une faible part aux émeutes et que le nombre des vols et des meurtres tendit plutôt à diminuer, les gens que l’on ruinait, des rentiers, des petits bourgeois, n’ayant pas l’habitude de recourir à ce genre d’opérations pour augmenter leurs ressources.
On maintint ces salaires, qu’il aurait fallu réduire proportionnellement, quand on se décida à prendre des mesures pour faire descendre le prix de la vie, et Jaurès en convient dans son Histoire socialiste de la Révolution française :
« … À Paris, la Commune se hâta d’appliquer aux gros marchands la loi du maximum. Envers les petits détaillants, envers les revendeurs qui narguaient la loi, la Commune semble avoir usé de beaucoup de tolérance. Et surtout, tandis qu’elle se hâtait de taxer les denrées, les denrées détenues par le gros commerce, elle ne s’occupait pas d’appliquer la taxe des salaires. Aussi les ouvriers, assez rares à cause de l’immense appel d’hommes fait par les armées et en tout cas très occupés à cause des livraisons incessantes que réclamait l’administration de la Guerre, bénéficiaient, comme acheteurs, de la taxe des denrées, et, au contraire, comme vendeurs de travail, utilisaient la loi de l’offre et de la demande qui, à ce moment-là, leur était favorable… »
Ce ne fut qu’exceptionnellement que certaines municipalités, Albi, par exemple, taxèrent, de leur autorité privée, les salaires aussi bien que les marchandises.
Bien loin de manifester la moindre gratitude à un gouvernement, à un régime qui les traitaient en privilégiés, bien loin de faire preuve de la moindre bonne volonté pour aider au relèvement économique du pays, les ouvriers de la République augmentaient, par leurs exigences continuelles, comme par leur paresse, le prix, déjà excessif, de la vie. Ils n’ignoraient pas cependant que chacune de ces exigences et chacune de ces heures perdues rendaient encore plus pénible, encore plus intolérable, l’épouvantable misère dans laquelle se débattaient deux ou trois millions de Français, qui n’étaient pas tous des bourgeois.
Le rapport de police qu’on va lire (du 4 mars 1794) et qui est pris entre beaucoup d’autres du même genre, nous fait connaître l’irritation, l’indignation non pas des aristocrates, car il n’en restait plus guère et ils se cachaient, mais des petits artisans, des ménagères qui, le panier sous le bras, bavardaient aux portes des boulangeries et des boucheries :
« Les garçons maçons et charpentiers ne veulent plus travailler que moyennant 6 francs par jour (20 à 25 fr. d’aujourd’hui) ; de décade en décade, ils augmentent de 10 sols. Il en est de même des manœuvres dans ces deux états ; ils sont parvenus à se faire payer leur journée 3 francs 10 sols. Si l’on fait difficulté d’acquiescer à leurs demandes immodérées, ils menacent de ne plus travailler…
On crie de tous les côtés contre cette tyrannie des ouvriers ; on espère, on attend que le prix de leurs journées sera taxé dans le nouveau maximum, dont toutes les dispositions seraient illusoires si la main-d’œuvre, qui est une marchandise comme une autre et qui fait la base nécessaire du prix de tous les autres objets, n’était comprise dans ces dispositions et réduite à un taux proportionnel… »
Chômeur, ce qui se produit rarement, l’ouvrier est, pour une raison quelconque, – membre du comité, du club, etc., – entretenu par l’État. Occupé, il se fait payer cher en menaçant de se croiser les bras.
Quels seront sur sa mentalité, sur ses mœurs, les résultats de cette sécurité, de cette prospérité relative ? Dans son Nouveau Tableau de Paris, du Paris de la fin de la Révolution et du Directoire, Mercier nous le montre, cet ouvrier, buveur, paresseux et gourmand, et Mercier n’est pas seulement un témoin très averti, un observateur de premier ordre, c’est un solide républicain, qui restera républicain en face de Napoléon.
« … Le maximum, dit-il, fut dans toutes les bouches, orna les conversations des coins de rues ; et, après une foule d’interprétations, il signifia l’eau-de-vie que la multitude boit sans ménagement. Cette boisson n’a pas laissé de faire dans les mœurs du peuple un changement notable ; une voix enrouée en est devenu le premier signe physique…
… Ce qui frappe le plus, c’est la fainéantise du peuple. Le peuple travaille très doucement. Ses bras daignent à peine faire le moindre effort. Son métier est devenu pour les uns une espèce d’amusement. Le gros travail lui fait peur : le brancard est peu chargé, la hotte est légère. Il loue ses bras comme par condescendance ; il veut dans une heure gagner le prix d’une journée entière ; il semble enfin, en travaillant, avoir l’insouciance la plus marquée, obliger encore le maître ou le bourgeois qui le paie chèrement… Il a presque honte du travail de la boutique…
… Du moment qu’un simple ouvrier a pu gagner, dans la force du papier-monnaie, deux cents écus par jour, il s’est habitué à dîner chez le restaurateur ; il a laissé le chou au lard de côté pour la poularde au cresson ; il a renoncé à la pinte d’étain pour la bouteille cachetée à 40 sous. Il lui a encore fallu régulièrement la tasse de café et le petit verre. La bonne chère le rendit insolent, paresseux, libertin, avide et gourmand… »
Dans son rapport du 3 août 1793, à la Convention, sur l’agiotage et le change, Fabre d’Églantine, un Jacobin, indiquait comme une des principales causes du désarroi financier et de la misère publique « l’aveugle cupidité des marchands et des ouvriers ».
Dulaure évalue à 200 000 environ le chiffre des domestiques, laquais, valets de chambre, etc. à Paris, vers 1789. Ce chiffre doit être réduit au moins d’un tiers.
Ces domestiques étaient, en tout cas, très nombreux, trop nombreux. Ils représentaient un sérieux élément de désordre, et ils l’avaient toujours représenté, depuis qu’il existait des maîtres et des serviteurs.
À chaque soulèvement populaire, on les voyait au premier rang.
Au XVIe siècle, ils ne reculaient ni devant le vol à main armée ni devant l’assassinat.
Plus tard, sous le grand Roi, ils ne tuaient plus mais ils continuaient à voler, et, surtout, comme s’ils eussent été des gentilshommes, ils se plaisaient à molester les courtauds de boutique et les vils croquants. « Leur insolence est extrême, écrivait un voyageur, et le Roi leur a défendu, sous de grièves peines, de porter des bâtons, avec quoi ils faisaient tous les jours de nouveaux désordres. Surtout étant plus de cent mille, capables de toutes sortes d’impertinences… »
Au XVIIIe siècle, ils n’avaient pas changé. Par contagion ou par esprit d’imitation, ils se donnaient les vices de leurs maîtres, et ils y ajoutaient leurs propres vices, ceux qu’ils tenaient de leurs origines, la grossièreté, la brutalité, l’ivrognerie.
Pendant la Révolution, grisés par les idées d’égalité, aigris par la profession servile et humiliante qu’ils avaient adoptée ou subie, presque tous fils de paysans et d’autant plus enclins à l’envie, ils saisirent avec empressement l’occasion qui se présentait de satisfaire leurs rancunes.
Ils prirent une spécialité, qui leur était facile autant qu’agréable, la dénonciation.
La dénonciation a été une des plaies et une des hontes de cette époque. La nier, ne pas la voir est absolument impossible. Des milliers de documents l’attestent, la prouvent, la montrent. J’en demande bien pardon à ceux qui s’évertuent à canoniser ou à diviniser les hommes de la Révolution. Ces nouveaux saints, ces nouveaux dieux étaient presque tous des délateurs.
Peu usité, sous l’ancien régime – sauf pour les professionnels – et mal vu, le mot mouchard ne passait pas pour un terme honorifique. On n’avait d’ailleurs aucun besoin de dénoncer son prochain, à part des cas très rares et des natures très basses et prédisposées.
La Révolution fit de la délation un des devoirs du citoyen. Tout le monde s’improvisa mouchard, mouchard national et patriotique.
Il fallait purger le pays de tout ce qui n’était pas républicain. On dénonçait parce qu’on était un bon jacobin, un pur. On dénonçait pour se mettre en avant, pour se donner de l’importance. On dénonçait (et c’était le cas le plus fréquent) pour satisfaire une haine personnelle. On dénonçait par peur. On dénonçait pour ne pas être dénoncé.
Déjà, en 1791, à une époque où cette sinistre monomanie n’était pas encore encouragée, imposée par la loi, par les mœurs, André Chénier la flétrissait, j’allais dire la dénonçait :
« Examinons, écrivait-il, un des moyens les plus sûrs et le plus souvent employés dans tous les temps, pour tenir la multitude en haleine : les délations. Nous en avons été inondés pendant deux ans… Que de tristes infamies nous avons vues en pure perte ! Les dénonciations les plus vagues et les plus odieuses accueillies avec éloge ; les parentés, les amitiés, suspectes ou perfides, les épanchements d’une confiance antique portés à une audience ; des convives ne rougissant pas de venir révéler les propos tenus à la table hospitalière où ils s’étaient assis ; des citoyens, assemblés en espèce de tribunal, ne rougissant pas de recevoir cette honteuse déposition ; des écrivains ne rougissant pas de décorer du nom de civisme cette lâcheté méprisable !
Nous respirions : le mauvais succès de ces délateurs les avait réduits au silence ; et voilà que des sociétés entières les excitent de nouveau, les appellent au secours de la patrie, se déclarent solidaires pour eux… Elles rendront les délations plus fréquentes : les rendront-elles plus croyables, plus vraies, plus utiles ?… »
Le nouveau régime n’avait pas perdu de temps pour établir ce système de délation mutuelle, qui devait installer à chaque foyer la crainte et la défiance et faire peser sur tout le pays la tyrannie la plus odieuse et la plus intolérable.
Dès le 21 octobre 1789, un arrêt de la Commune créait un Comité des Recherches qui devait s’occuper spécialement « des dénonciations contre les ennemis de la chose publique ».
Bientôt, au-dessous de ce Comité des Recherches et dépendant d’abord de lui, se multiplièrent, centres et organes d’inquisition politique, aussi effrayants par leur zèle que par leur nombre, des comités de vigilance, de surveillance, de police, une infinité de comités révolutionnaires, stimulés par les sociétés populaires, les clubs, les assemblées de section, les journaux, et n’ayant tous qu’un objectif et un but : dénoncer.
Le clergé était particulièrement visé.
L’article III du décret du 26 mai 1792 contre les prêtres insermentés ne leur laissait aucune sécurité, constituait pour eux une menace permanente. Cet article disait :
« Lorsque vingt citoyens actifs d’un même canton se réuniront pour demander la déportation de l’ecclésiastique non sermenté, le Directoire du département sera tenu de prononcer la déportation, si l’avis du directoire du district est conforme à la pétition. »
Le prêtre condamné à la déportation avait vingt-quatre heures pour sortir du canton, trois jours, du département, un mois, du royaume. En cas d’indigence reconnue il recevait jusqu’à la frontière trois livres par jour.
Mais, objectera-t-on, pour justifier cette rigueur, il attaquait la République et, du fond de son village, avec une douzaine de vieilles dévotes, il la mettait en danger. Sans doute, et c’est justement ce que je voulais dire. Personne n’avait alors le droit de ne pas être républicain.
Le projet de Tribunal révolutionnaire fut rédigé par un homme incontestablement honnête mais d’un fanatisme inflexible, impitoyable, un Torquemada jacobin : Robert Lindet, député de l’Eure, que Brissot avait surnommé la Hyène. Robert Lindet avait inséré dans son projet cet article : « Il y aura toujours dans la salle destinée à ce tribunal un membre chargé de recevoir les dénonciations. » La Convention, rendons-lui cette justice, repoussa l’article mais, dans la suite, elle ne s’en montra pas moins favorable à la délation.
Le Tribunal révolutionnaire existait à peine depuis une vingtaine de jours qu’elle se préoccupait de lui fournir des victimes, à l’aide de son décret du 29 mars 1793, et du premier article de ce décret : « Tous propriétaires et principaux locataires, concierges, fermiers, régisseurs, portiers, logeurs et hôteliers des maisons et de toutes habitations dans le territoire de la République, seront tenus d’afficher à l’extérieur des maisons, fermes et habitations, dans un endroit apparent et en caractères bien lisibles, les noms, prénoms, surnoms, âge et profession de tous les individus résidant actuellement ou habituellement dans lesdites maisons, fermes ou habitations… »
La délation pouvait ainsi facilement choisir ceux qu’elle voulait atteindre, et on peut croire qu’elle ne s’en priva pas.
Ce fut surtout dans les derniers mois de 1793, et plus spécialement après le vote de l’abominable loi des suspects (17 novembre 1793) qu’une véritable pluie de dénonciations s’abattit sur toute la France. Qui pouvait désormais échapper à la haine et éviter la guillotine ? Qui pouvait, malgré toutes ses précautions et des prodiges de lâcheté, ne pas passer pour suspect ?
Dans son passionnant volume, le Vrai Chevalier de Maison Rouge, M. G. Lenotre cite la dénonciation contre les gens qui avaient dans leur maison des plaques de cheminée « portant des signes de féodalité », contre des femmes qui se refusaient (et il y en eut beaucoup) à arborer la cocarde tricolore, et enfin contre trois jeunes gens suspects « parce qu’ils ne sortent jamais et ne mettent pas le nez à la fenêtre… »
Comme sous la Rome des Césars, au temps de Tacite ou de Pline le Jeune, les délateurs surgissaient de tous les côtés. Il y en avait de payés, auxquels la délation servait de gagne-pain. D’autres se payaient eux-mêmes par l’assouvissement d’une haine personnelle, par le simple plaisir de nuire, ou par la conviction qu’ils accomplissaient un devoir.
Il parut même (en 1789) un journal intitulé le Dénonciateur National (1), qui n’eut d’ailleurs que sept numéros. Le premier adressait aux lecteurs un appel qui sans doute ne fut pas assez pressant :
« Le libraire invite le public à lui faire passer les noms et délits que tout homme aurait pu commettre ; il se fera un plaisir de les dénoncer sans égards à leurs noms et qualités. »
Dénonçons-nous les uns les autres : c’était la devise de la République. Un fonctionnaire désirait-il obtenir un avancement, s’il pouvait connaître ses concurrents, il les dénonçait comme royalistes. Un mari voulait-il se débarrasser d’un amant, il suffisait d’une bonne dénonciation bien rédigée, bien adressée, pour le faire arrêter par quelque comité de surveillance.
Les députés passaient leur temps à se dénoncer entre eux. Camille Desmoulins dénonçait Brissot, Louvet dénonçait Robespierre, Robespierre dénonçait Danton, Marat dénonçait tout le monde.
Dans tous les clubs, dans toutes les sociétés populaires, il en était de même et Démos, le bon Démos, ravi du spectacle, marquait les coups.
Dans sa courageuse comédie, l’Ami des Lois, Laya appelle le Délateur un « animal triste ». C’était peut-être un animal, mais il n’était pas triste.
Il pouvait même être très jovial, comme par exemple le sapeur Rocher.
Ce sapeur Rocher était un ancien sellier. On a prétendu qu’il fit quatre fois faillite. Quatre fois, c’est beaucoup. Une seule suffit pourvu qu’elle soit bonne.
Geôlier du Temple, il s’amusait à lancer des bouffées de sa pipe au visage de Marie-Antoinette et de Mme Élisabeth. Il aimait à plaisanter et à rire. Il aimait aussi à se mettre en avant. Il était en tête du cortège qui conduisit triomphalement Marat à la Convention, après son acquittement par le Tribunal Révolutionnaire.
Comme Hanriot, Rocher appartenait à cette variété de révolutionnaires qu’on pourrait qualifier de vinicole.
Le biographe qui met à son actif, ou plutôt à son passif, quatre faillites, affirme que, quelquefois, pour se désaltérer, il buvait « un verre de sang ». Je crois bien qu’il préférait « un verre de vin », suivi de plusieurs autres, et j’ai l’impression que, dans la dénonciation qu’on va lire, dans cette prose agitée et titubante, à travers le tape-dur, on voit l’ivrogne.
Cette dénonciation forme le post-scriptum d’une lettre à Hébert (1792).
« Tu ne croiras pas, vieux tonnerre de mes entrailles, que j’oubliais de dire que, dans la ci-devant cathédrale d’Orléans, j’ai vu des endroits, foutre, des endroits parsemés de fleurs de lys, comme si nous n’avions pas des lois qui disent, ventre de ma mère, de les arracher ! Que j’ai vu encore à Amboise, dans la maison d’arrêt, ce vieux bougre d’aristocrate de Penthièvre, en portrait de ma hauteur, avec de l’ordure, nom d’un boulet ramé, tout autour, tenant dans sa vieille sacrée main, un bâton d’amiral, avec des fleurs de lys, nom de Dieu, encore des fleurs de lys. C’est son jean-foutre d’intendant qui est procureur syndic du district qui souffre cela. Juge, bon père Duchesne, du patriotisme de ces Messieurs du district d’Amboise »..
Les délateurs tenaient le haut du pavé. On n’osait pas les mépriser. Ils étaient trop !
Pourvoyeurs de la guillotine, ils se donnaient comme les défenseurs de la République, et la République les protégeait, les encourageait.
Le 24 septembre 1792, Destournelles, « ministre des contributions publiques », déclarait, dans une lettre à Hébert : « La dénonciation doit être honorée et encouragée par les républicains, car elle tient essentiellement au salut public » et, dans son journal, dans un numéro de novembre 1793, Hébert se montrait encore plus affirmatif : « Le vrai républicain, disait-il, doit dénoncer son meilleur ami, son père, quand il a des reproches à lui faire. »
Parfois, attristé, indigné, un Alceste de la presse avait le courage de se plaindre de ce débordement de haine, caché sous des apparences de patriotisme, et de l’importance, chaque jour plus grande, que prenaient à la Convention les dénonciations incessantes qui la discréditaient, qui l’affaiblissaient. « Quelle peste que tout cela ! » un rédacteur des Révolutions de Paris, terminait ainsi un article où il déplorait cette funeste monomanie, ces perpétuelles accusations qui allaient bientôt devenir meurtrières.
Par le rapport de Courtois sur les papiers de Robespierre, et les exemples qu’il cite, on voit sur quels motifs ridicules, sur quels commérages de quartier, sur quels propos de loge ou d’antichambre, se basaient trop souvent ces dénonciations :
Vassan (Charles-François) et sa femme, ex-nobles, domiciliés maison des Lions Paul, Sect. de l’Arsenal :
« Très suspects, aristocrates dangereux, ayant conservé le fol espoir de faire reprendre une livrée à leurs gens. »
Bergeron, marchand de peaux, rue de la Vieille-Monnaie, n° 5, Sect. des Lombards : « Suspect, n’ayant rien fait pour la Révolution ; très égoïste, blâmant les sans-culottes de ce qu’ils abandonnent leur état pour ne s’occuper que de la chose publique. »
Pautier François, Sect. des Gardes Françaises :
« On trouva chez lui des tasses à café à l’effigie du dernier tyran et de son agent Necker ; il les avait retirées des mains d’un citoyen qui voulait les casser. Il était porteur aussi de divers papiers manuscrits en forme de prophéties propres à entretenir un fanatisme contre-révolutionnaire, avec un chapelet de forme extraordinaire. »
La seule chance qu’on put avoir d’échapper à une de ces dénonciations, qui menaçaient tout le monde, c’était de vivre isolé le plus possible, de renoncer à toutes ses relations, car on n’était sûr de personne, et de se cacher. Les amis, les parents, n’osaient se voir. Si je demandais à quelqu’un des nouvelles de son ami : « Il y a deux mois, trois mois que je ne l’ai vu. Nous ne sortons plus. Chacun reste chez soi, trop heureux s’il pouvait se faire oublier. »
Belle époque ! charmant pays !
Le cafardage est un vice d’enfant et d’enfant né dans un milieu inférieur, habitué chez lui aux bas commérages, aux conflits de voisinage, aux disputes de palier, aux propos geignards ou exaspérés contre le gouvernement, les ministres, les curés, les propriétaires, les patrons, les riches qui sont tous des fainéants et des bandits.
Ce vice du cafardage, si vous lui donnez comme compléments ou comme stimulants le manque de culture auquel correspond souvent un manque de délicatesse morale, et ce parti-pris de défiance et cette manie de la persécution et ce fanatisme obtus, qui caractérisent, nous l’avons vu, ce qu’on appelle le Peuple, vous ne serez sans doute pas étonné que ce soit dans cette classe, pendant la Révolution, qu’il ait particulièrement sévi. Et comme les plus aigris se montrent d’ordinaire les plus malveillants et les plus haineux, il ne vous paraîtra pas non plus très surprenant que parmi ceux qui dénoncèrent (deux à trois cent mille vraisemblablement), aucune corporation n’ait dénoncé autant que celle des domestiques, des subordonnés, les commandés, les humiliés professionnels.
Qu’ils n’aient pas eu, au dix-huitième siècle, avec les progrès du luxe, de la vie mondaine et de la vanité, une situation, non pas matérielle, mais morale, égale à celle de ces valets et de ces servantes décrits par Molière, au temps de Dorine et de La Flèche, c’est incontestable – et explique bien des choses.
« Les domestiques faisaient autrefois partie de la famille ; on les traitait moins poliment, mais avec plus d’affection ; ils le voyaient et devenaient sensibles et reconnaissants. Les maîtres étaient mieux servis et pouvaient compter sur eux, fidélité fort rare aujourd’hui. Autrefois, leur vie était laborieuse et dure, mais on les comptait pour quelque chose et le domestique mourait de vieillesse à côté de son maître. Maintenant, ils sont plus payés, mais méprisés ; ils le sentent. Ce sont nos espions et nos ennemis. »
Mercier écrivait ceci dans son TABLEAU DE PARIS, et il n’exagérait en rien.
Il y eut certainement de mauvais maîtres, mais il y eut aussi de mauvais serviteurs (et si j’ajoutais qu’il y en a encore, je crois bien que personne ne se hasarderait à me contredire).
Il y en eut à toutes les époques.
« Vers le milieu du XVIe siècle, sous le règne de Charles-Quint, une vieille femme de 85 ans, Marie de Bourgogne, dénoncée par sa servante comme ayant dit que les chrétiens n’avaient ni foi ni loi, est tenue emprisonnée pendant cinq ans, tant l’instruction de son procès rencontrait de difficultés. Aucune preuve n’étant relevée, on se décida à lui appliquer la question. La malheureuse avait quatre-vingt-dix ans… Broyée littéralement, on la rapporta dans sa cellule, où elle expira au bout de deux jours. »
Marie-Antoinette avait des défauts, et nombreux (elle les expia cruellement), mais on n’a jamais pu l’accuser sérieusement de méchanceté. Or, au mois de juillet 1793, un homme fut surpris la nuit dans le corridor qui menait à la chambre de la Reine, et il avait, assure Mme Campan, l’intention de l’assassiner. Cet homme appartenait à la domesticité des Tuileries.





























