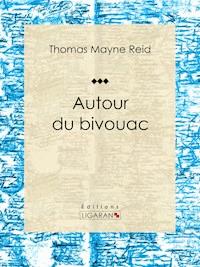
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Sur la rive occidentale du Mississippi, à douze milles de son confluent avec le Missouri, se trouve la ville de Saint-Louis, poétiquement surnommée la Cité-des-Monts. Elle fut fondée par les français. C'est là que l'émigrant se repose, c'est là que le chasseur s'équipe avant de s'enfoncer dans les sauvages solitudes de l'intérieur."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054859
©Ligaran 2015
Sur la rive occidentale du Mississippi, à douze milles de son confluent avec le Missouri, se trouve la ville de Saint-Louis, poétiquement surnommée la Cité-des-Monts. Elle fut fondée par les Français. C’est là que l’émigrant se repose, c’est là que le chasseur s’équipe avant de s’enfoncer dans les sauvages solitudes de l’intérieur.
Je me trouvais à Saint-Louis pendant l’automne de 18… La ville était remplie de gens désœuvrés, qui semblaient n’avoir pas autre chose à faire que de tuer le temps. Chaque hôtel était bondé ; sous chaque véranda, au coin de toutes les rues vous pouviez voir des gentlemen bien mis qui causaient et riaient tout le long du jour. La plupart étaient des oiseaux de passage venus là de la Nouvelle-Orléans pour fuir la fièvre jaune. Il y avait aussi des voyageurs européens qui avaient laissé derrière eux les aises de la vie civilisée pour aller passer une saison dans les sauvages déserts de l’Ouest : peintres en quête de pittoresque, naturalistes curieux d’une flore nouvelle, chasseurs qui, fatigués de courir après le petit gibier, parlaient pour ta grande prairie afin de prendre part à la noble chasse du bison.
J’étais moi-même un de ces derniers.
Il n’y a pas de pays au monde où la table d’hôte soit plus goûtée qu’en Amérique, et où les gens oisifs se lient plus vite. Je ne mis pas longtemps à nouer des relations d’amitié avec un bon nombre de ces désœuvrés, désireux, comme moi, d’entreprendre une expédition cynégétique dans les prairies. Cinq d’entre eux consentirent à se joindre à moi.
Après force discussions, nous tombâmes d’accord. Chacun s’équiperait à sa guise, mais tous se pourvoiraient d’un cheval ou d’une mule. Un fonds commun servirait à acheter un wagon ou chariot, avec des tentes, des provisions et des ustensiles de cuisine. Deux chasseurs de profession seraient engagés, des hommes connaissant bien le pays et qui seraient nos guides au cours de notre expédition.
Nos préparatifs nous prirent toute une semaine ; au bout de ce temps, par une riante matinée, une petite cavalcade quittait les faubourgs de Saint-Louis gravissait les hauteurs au-delà desquelles commençaient les sauvages prairies de l’Ouest : c’était notre expédition de chasse.
La cavalcade se composait de huit hommes montés et d’un chariot attelé de six fortes mules, celles-ci sous la direction de Jack, un nègre libre à la noire face luisante, aux lippes épaisses, aux dents d’ivoire que découvrait un perpétuel sourire.
Sous la tente du wagon on entrevoyait une autre figure qui formait le plus parfait contraste avec celle de Jack. Cette figure avait été rouge à l’origine, mais le hâle, le soleil et d’innombrables taches de rousseur avaient changé ce rouge en jaune d’or. Une crinière de cheveux d’un bond ardent surmontait le front, à demi caché par un chapeau grossier. Toujours clignant d’un œil, il avait la physionomie irrésistiblement comique d’un acteur dans une farce bouffonne. Une courte pipe toujours en mouvement entre ses lèvres ajoutait à l’expression comique de cette face, qui était celle de Mike Lanty, un Irlandais de Limerick.
Qui étaient les huit cavaliers escortant le wagon ? Six étaient des gentlemen par la naissance et par l’éducation, les deux autres étaient les rudes trappeurs engagés pour nous servir de guides.
Un mot sur chacun de mes huit compagnons. Le premier était un Anglais, haut de six pieds et large à proportion, avec des cheveux châtain clair, un teint fleuri, des moustaches et des favoris encadrant un visage régulier et noble. C’était un véritable gentilhomme, un de ceux qui, dans leurs voyages à travers les États-Unis, ont le bon sens de porter leur parapluie eux-mêmes et de laisser leurs titres derrière eux. Nous le connaissions sous le nom de M. Thompson, puis, quand nous nous fûmes un peu liés, de Thompson tout court ; ce ne fut que longtemps après, et par hasard, que j’appris son rang et son titre.
Son costume se composait d’une jaquette tic drap à huit poches, d’une veste à quatre, d’un pantalon et d’une casquette, le tout d’un drap pareil. Dans le wagon il avait un carton à chapeau en cuir épais, avec courroies et cadenas, et contenant, non pas un chapeau, comme nous le supposions d’abord, mais différentes brosses, y compris une brosse à dents, des peignes, des rasoirs et du savon. Le chapeau, il l’avait laissé à Saint-Louis.
Mais il n’y avait pas laissé son parapluie, un énorme hémisphère de baleine et de toile qu’il portait alors sous son bras. Sous ce parapluie il avait chassé les tigres dans les jungles de l’Inde, les lions dans les plaines de l’Afrique, les autruches et les vigognes dans les pampas de l’Amérique du Sud ; et maintenant, sous ce même hémisphère de toile bleue, il allait porter la terreur et le carnage parmi les sauvages bisons des prairies.
Avec ce parapluie, une véritable arme défensive, M. Thompson portait aussi un lourd fusil à deux coups, signé « Bishop, de Bond Street ». Il montait un robuste étalon bai, avec une queue coupée court et une selle anglaise.
Le numéro deux de notre compagnie différait du numéro un autant que peuvent différer deux animaux de la même espèce. C’était un Kentuckien, qui mesurait six pouces de plus que Thompson. Ses traits étaient marqués, saillants, irréguliers, d’une irrégularité encore accusée par la bosse d’une chique de tabac. Son teint était foncé, presque olivâtre, sa face entièrement glabre, sans moustache ni favoris ; mais de longs cheveux, noirs comme ceux d’un Indien, lui pendaient sur les épaules. Il avait un air de gravité qu’il devait à son teint basané et aux plis qui, des coins de sa bouche, descendaient jusqu’à son menton ; mais en fait il était aussi gai et jovial que pas un de nous.
Notre Kentuckien, un riche planteur, réputé dans son pays comme un grand chasseur de cerfs, était vêtu comme il l’aurait été dans son domaine par quelque froide matinée : justaucorps de drap, long pardessus taillé dans une couverture verte, avec des poches nombreuses, pantalon serré dans une paire de grosses bottes en cuir de cheval, chapeau de feutre tout cabossé. Il montait un cheval haut, membru, possédant quelques-uns des caractères qui distinguaient son cavalier. Aux épaules du Kentuckien pendaient un sac à munitions, une corne de chasse et un havresac ; sur ses orteils reposait la crosse d’un lourd rifle, dont le canon arrivait au niveau de son épaule.
Le numéro trois était un disciple d’Esculape, non point maigre et pâle comme ils le sont d’habitude, mais gras, rose et enjoué. À dire vrai, le docteur aimait à boire. Il adorait ta musique et chantait avec goût. Ce n’était point l’amour de la chasse au bison, mais plutôt le désir d’accompagner des amis qui l’avait décidé à se joindre à nous. Nous l’en avions tous prié, tant pour jouir de son aimable compagnie, que pour mettre à contribution sa science médicale au cours de notre voyage.
Le docteur Jopper avait conservé le vêtement noir de sa profession, tant soit peu râpé par un long usage, mais avec adjonction d’une casquette en fourrure et de guêtres en drap brun.
Il montait un petit cheval maigre, d’humeur paisible, qui, outre son maître, portait la trousse et la boîte à médicaments.
Un élégant jeune homme, aux traits mâles et beaux, aux yeux vifs et noirs, aux épaisses boucles frisées, était aussi des nôtres. Un pantalon de cotonnade bleu de ciel, une jaquette de même étoffe qui lui moulait le torse, un magnifique chapeau de Panama et un manteau de drap bordé de velours composaient le costume de cet adolescent, dont la fine moustache et l’impériale accentuaient encore la virile physionomie.
C’était un créole de la Louisiane, et, en dépit de sa jeunesse, le plus illustre botaniste de son pays. Il se nommait Jules Besançon. Il n’était pas le seul naturaliste de la troupe. Nous en avions avec nous un autre d’une célébrité universelle, et dont le nom était aussi familier aux savants de l’Europe qu’à ses concitoyens. C’était déjà un vieillard à l’aspect vénérable ; mais sa démarche était ferme, et son bras assez solide pour manier un long et lourd rifle à deux coups. Une ample redingote en drap bleu foncé couvrait son corps ; ses jambes étaient enveloppées dans une culotte à boutons, et un chapeau en poil de zibeline abritait son front large et haut. Nous l’appelions M, A…, le chasseur naturaliste. C’est à son amour pour l’étude que nous devions l’honneur de sa présence parmi nous. Entre lui et le jeune Besançon, nulle jalousie. Au contraire, la similitude des goûts eut bientôt créé entre eux une amitié réciproque.
Je me cataloguerai moi-même sous le numéro six. Une courte description de moi suffira. J’étais alors un tout jeune homme, assez bien élevé, féru de sport et d’histoire naturelle ; surtout j’aimais un bon cheval à la folie, et j’en possédais un de toute beauté. Mon visage n’avait rien de désagréable, ma taille était moyenne. J’étais vêtu d’une blouse en peau de daim brodée, avec une cape aux bords frangés, et d’un pantalon de drap écarlate. Une casquette de drap brun couvrait mes cheveux noirs. Une poire à poudre, un sac à plomb, une ceinture avec un couteau de chasse et deux révolvers ; un léger rifle dans une main, mes rênes dans l’autre ; une haute selle espagnole de cuir gaufré ; une couverture rouge pliée et attachée sur la croupe, un lazzo, un havresac, une corne de chasse… – voilà tout !
Deux personnages me restent à décrire : les guides, qu’on appelait respectivement Isaac Bradley et Mark Redwood, deux trappeurs aussi différents l’un de l’autre que deux hommes peuvent l’être. Redwood était un colosse, visiblement aussi fort qu’un bison, tandis que son confrère, maigre, nerveux, musculeux, avait dans l’allure quelque chose de la belette. Les manières de Redwood étaient franches et décidées, ses yeux gris, ses cheveux châtains ; une épaisse barbe brune couvrait ses joues. Bradley, au contraire, avait de petits yeux noirs et perçants, une face glabre et bronzée comme celle d’un Indien avec des cheveux noirs taillés en rond.
Tous deux étaient couverts de vêtements de peau de la tête aux pieds : blouse de chasse, culottes collantes, mocassins, et bonnet en fourrure. Le fusil de Bradley était de la plus grande taille, il mesurait six pieds de long, et c’était le trappeur lui-même qui en avait façonné le bois. Le rifle de Redwood était aussi long, mais d’une forme plus moderne, de même que son équipement.
Tels étaient nos guides. Mark Redwood était réputé comme l’un des plus célèbres montagnards de ce temps-là, et Isaac Bradley avait été surnommé le « vieil Ike le tueur de loups ».
La route que nous avions prise se dirigeait vers le Sud-Ouest. Le point le plus rapproché où nous espérions rencontrer les bisons se trouvait à deux cents milles plus loin. À cette époque, tout le pays était désert et sauvage ; à peine trouvait-on de rares fermes isolées. Nous n’avions donc pas l’espoir de nous abriter sous un toit avant notre retour à Saint-Louis ; mais nous nous étions munis de deux tentes.
Quoique le pays que nous traversions semblât giboyeux, nous n’aperçûmes ni un oiseau ni un quadrupède de toute la journée. Ce résultat n’était guère encourageant. Nous étions heureusement bien approvisionnés de vivres : un grand tonneau de biscuit, un de farine, des jambons, du lard, du café, du sucre, sans compter la provende des mules et des chevaux.
Nous fîmes trente milles le premier jour. Le chemin était bon. Nous campâmes le soir au bord d’un ruisseau limpide. Nous installâmes toutes choses suivant un ordre régulier que nous observâmes par la suite jusqu’à la fin de notre expédition. Chacun de nous dessella son cheval ; nous n’avions pas de serviteurs dans la prairie. Lanty s’occupait exclusivement de la cuisine, et Jack avait assez à faire avec ses mules.
Nos chevaux et nos mules furent attachés à des piquets au milieu d’un espace découvert. Les deux tentes s’élevèrent côte à côte, près du ruisseau, et le wagon fut placé à l’arrière.
Dans le triangle formé par le wagon et les tentes, un grand feu fut allumé, aux deux extrémités duquel nous plantâmes deux perches dont les sommets faisaient la fourche. En travers des deux fourches, au-dessus de la flamme, un jeune tronc fut posé. C’était la crémaillère de Lanty, le feu lui servant de fourneau.
Le souper est prêt, et Lanty est décidément. Si cette heure, le personnage le plus important de notre cercle. Il est debout devant le feu, avec une petite poêle à frire au long manche, dans laquelle il grille le café. La crémaillère supporte une large cafetière en fer battu, pleine d’eau bouillante ; et une seconde poêle, plus grande que la première, est remplie de tranches de jambon, et prête à être placée sur les charbons ardents.
Notre ami anglais Thompson est assis sur un tronc d’arbre ; devant lui, tout ouvert, son carton à chapeau, d’où il a tiré son assortiment de peignes et de brosses. Il a déjà, fait ses ablutions, et maintenant il achève sa toilette, arrangeant ses cheveux, ses favoris, ses moustaches, nettoyant ses dents et ses ongles.
Le Kentuckien, lui, debout, tenant d’une main un couteau à longue lame, à manche d’ivoire – un de ces bownie-knifes qu’on appelle « cure-dents de l’Arkansas, – et de l’autre une tablette de tabac, en taille un morceau qu’il fourre aussitôt dans sa bouche et se met à mastiquer.
Et le docteur Jopper, que fait-il ? Il est au bord de l’eau, et tient dans une main un de ces flacons d’étain qu’on appelle « pistolet de poche ». Ce pistolet est chargé d’eau-de-vie, et le docteur est précisément en train d’en décharger une partie, laquelle, mêlée à un peu d’eau fraîche, se déverse dans l’intérieur d’un gosier très altéré.
Besançon est assis près de la tente, et le vieux naturaliste est à côté de lui. Le premier s’occupe des plantes qu’il a recueillies, il les classe méthodiquement entre les feuilles d’un grand album ouvert sur ses genoux. Son compagnon, fort expert en la matière, l’aide dans sa besogne.
Les guides se tiennent près du wagon. Le vieux Ike change la pierre de son rifle, et Redwood, d’une humeur plus joviale, plaisante avec Mike Lanty.
Jack est toujours occupé avec ses mules, et moi avec mon cheval favori, dont je viens de laver les pieds dans le ruisseau.
Çà et là s’étalent nos selles, nos brides, nos couvertures, nos armes et nos ustensiles. Tout sera mis à l’abri avant le moment du repos. Tel est le tableau que présente notre camp.
Mais voici que le souper est servi, et la scène change.
L’atmosphère, même en celle saison, est assez fraîche ; aussi, à peine Mike a-t-il annoncé que le café est fait, tout le monde, y compris les guides, se presse autour du brasier. Chacun trouve son écuelle, son couteau, son gobelet ; chacun se sert et se place où il veut pour manger.
Malgré la fatigue d’un premier jour de marche, nous fîmes joyeusement honneur à ce souper. La nouveauté et l’appétit ne contribuaient pas peu à nous le faire trouver délicieux.
Le repas fini, tous fumèrent, qui la pipe, qui un cigare, qui des cigarettes. Puis, comme nous étions fatigués, nous nous retirâmes de bonne heure dans nos tentes, et, nous roulant dans nos couvertures, nous ne tardâmes pas à nous endormir.
Le lendemain, nous étions sur nos pieds avant que le soleil n’eût montré son disque au-dessus des chênes verts qui formaient l’horizon. Déjà Lanty avait ravivé son feu ; la cafetière bouillait, et la grande poêle à frire embaumait le camp d’un parfum plus agréable que les essences d’Arabie. L’air vif du malin nous rapprocha du brasier. Thomson se faisait les ongles ; le Kentuckien se taillait une nouvelle chique dans sa tablette de tabac ; le docteur revenait du ruisseau où il était allé se rafraîchir avec une goutte de son flacon d’étain ; Besançon empaquetait ses albums, le vieux zoologiste allumait sa longue pipe, et le « capitaine » (c’était moi) s’occupait de son cheval favori, tout en dégustant un excellent havane.
En une demi-heure le déjeuner était expédié, les tentes et les ustensiles replacés dans le wagon, les chevaux sellés, les mules attelées, et l’expédition en route. Le terrain était plus accidenté, nous dûmes passer à gué plusieurs cours d’eau, et nous ne fîmes que vingt milles dans cette journée. Nous ne rencontrâmes pas plus de gibier que la veille, à notre grand déplaisir. Notre seconde halte se fit aussi sur le bord d’un ruisseau. Presque aussitôt Thompson partit à pied avec son fusil. Il avait remarqué non loin de là un marais ou il espérait tirer des bécassines. Le bruit de trois détonations nous démontra qu’il avait trouvé du gibier. Il revint avec trois oiseaux qui nous semblèrent plus gros que des bécassines. Le vieux zoologiste nous apprit que c’étaient des courlis d’Amérique. Courlis ou bécassines, ils furent aussitôt plumés, vidés, cuits dans la poêle de Lanty et déclarés délicieux.
Ces oiseaux formèrent le thème de notre conversation après souper. Nous en vînmes à parler des diverses espèces d’oiseaux de passage que l’on rencontre en Amérique, et finalement du singulier échassier que l’on appelle ibis. À propos d’ibis, Besançon se ressouvint d’une aventure qui lui était arrivée en poursuivant ces oiseaux dans les marais de la Louisiane, et proposa de nous la conter, ce que nous nous empressâmes d’accepter. Après avoir roulé une autre cigarette, le botaniste commença son récit :
Pendant une de mes vacances de collège, je fis une excursion botanique dans la partie sud-ouest de la Louisiane. Avant de partir, j’avais promis à un ami cher de lui apporter les peaux des oiseaux rares que je trouverais dans les régions marécageuses où je devais passer ; mais il désirait spécialement quelques spécimens de l’ibis rouge pour les faire empailler.
La partie sud de l’État de la Louisiane est un vaste labyrinthe de marais, de ruisseaux, de lagunes et d’îlots, où pullulent l’alligator et le brochet, où volent d’innombrables espèces d’oiseaux aquatiques : flamant rouge, aigrette, cygne-trompette, héron bleu, oie sauvage, butor, pélican, ibis.
Au bout de deux jours j’avais pu me procurer tous les spécimens dont j’avais besoin, excepté l’ibis. Le troisième ou le quatrième jour, je quittai la petite ferme ou je m’étais logé, au bord d’un large ruisseau, sans autre arme que mon fusil ; je n’avais même pas de chien, mon épagneul favori ayant été mordu par un alligator. Je montai dans un de ces batelets dont se servent les habitants, et je suivis le fil de l’eau. Mais au bout de quatre ou cinq milles, comme aucun ibis rouge n’apparaissait, je m’engageai dans un des bras de la rivière et je ramai avec vigueur pour remonter le courant. J’arrivai bientôt dans une région solitaire, marécageuse, couverte de grands roseaux. Pas d’habitation, aucun vestige qui révélât la présence de l’homme. Je tirai des ibis blancs, un aigle à tête blanche ; mais l’oiseau que je souhaitais le plus, l’ibis écarlate, impossible de me le procurer.
J’avais fait ainsi trois milles à force de rames, et je m’apprêtais à m’abandonner de nouveau au courant, lorsque j’aperçus à peu de distance un petit lac, profond, bourbeux, et rempli d’alligators jouant, poursuivant les poissons et se battant entre eux. Mais ce qui attira surtout mon attention, ce fut, vers le milieu du lac, un îlot sur l’extrémité duquel étincelaient des oiseaux au plumage écarlate, – les ibis rouges que je quêtais d’une si belle ardeur.
Je m’avançais en ramant sans faire de bruit. Il y en avait une douzaine en tout, qui se balançaient, suivant leur usage, sur une seule patte ; ils avaient l’air endormis, ou plutôt comme accablés par la chaleur, qui était grande ce jour-là. Je pus donc accoster à l’extrémité opposée de l’îlot sans leur donner l’alarme. Je mis aussitôt en joue et fis feu presque simultanément de mes deux coups. Quand la fumée se fut dissipée, je constatai que tous tes oiseaux avaient pris leur vol, à l’exception d’un seul qui gisait sur le bord de l’eau.
Le fusil à la main, je sautai hors de mon bateau et traversai l’îlot pour aller ramasser mon ibis. Cela me prit quelques minutes à peine, et je revenais vers mon embarcation, lorsque, à mon grand effroi, je la vis qui fuyait sur le lac.
Dans ma hâte, j’avais négligé de l’amarrer, et le courant l’emportait au loin. Elle était déjà à cent mètres de l’îlot, et je ne savais pas nager.
Ma première pensée fut pourtant de m’élancer dans le lac et de rattraper mon bateau. Mais en arrivant au bord de l’ilot, je m’aperçus d’un coup d’œil que l’eau avait la profondeur d’un gouffre ; et ma seconde pensée fut que mon bateau était perdu, irrémissiblement perdu.
J’étais sur un îlot nu et stérile, au milieu d’un lac, à un demi-millier du rivage, seul, et sans autre alternative que de mourir de faim ou de me noyer en essayant de me sauver. Et je me sentis envahir par le désespoir le plus affreux.
Combien de temps demeurai-je couché sur le sol, dans un état d’accablement presque inconscient, je ne saurais le dire ; plusieurs heures sans doute, car le soleil allait disparaître, lorsque je fus tiré de ma torpeur par une étrange circonstance.
J’étais entouré d’objets sombres, d’une forme hideuse. Ils étaient devant mes jeux depuis longtemps, et je ne les voyais pas, je n’avais qu’une vague conscience de leur présence. Mais à la longue je finis par percevoir l’étrange bruit qu’ils faisaient ; on eût dit le soufflet d’une forge, qu’interrompait une note plus rude et plus puissante, comme le beuglement d’un taureau. Ce bruit me fit tressaillir ; je levai les yeux, et j’aperçus de gigantesques lézards : c’étaient des alligators.
Il y en avait au moins cent, qui rampaient sur l’îlot devant moi, derrière moi, de tous les côtés. Leurs longues mâchoires se tendaient vers moi à me toucher ; et leurs yeux, habituellement éteints, semblaient fulgurer.
Sous le coup de ce nouveau péril, je bondis sur mes pieds ; reconnaissant la forme debout de l’homme, les reptiles se sauvèrent, plongèrent dans le lac et disparurent sous l’eau.
Je parcourus ma prison dans tous les sens. J’entrai dans l’eau pour en mesurer la profondeur ; mais je perdais vite pied : à trois longueurs de moi j’enfonçais jusqu’au cou. Les énormes reptiles nageaient autour de moi, souillant et reniflant ; ils étaient plus hardis dans leur élément. Effrayé par leurs démonstrations, je regagnai bien vite la terre ferme, et j’arpentai mon îlot avec mes vêtements mouillés.
Je continuai à marcher jusqu’à la nuit. Avec l’obscurité des voix nouvelles s’élevèrent, les voix inquiétantes du marais nocturne, le qua-qua du héron, le hululement du hibou, le cri du butor, le el-l-uk du grand crapaud, le coassement des grenouilles. Mais plus terrifiants résonnaient à mon oreille les beuglements des alligators ; ils me rappelaient que je ne pouvais pas songer à dormir. Dormir ! Je ne l’aurais pas osé, même pour un instant. Quand je demeurais quelques minutes sans remuer, les horribles reptiles rampaient autour de moi, si près que j’aurais pu les toucher de la main.
Par intervalles, je sautais sur mes pieds, je criais, je brandissais mon fusil ; les alligators plongeaient brusquement dans l’eau, mais sans trop de frayeur. À chaque démonstration de ma part, ils manifestaient moins d’alarme ; et le moment vint où ni mes cris ni mes gestes menaçants ne réussirent plus à leur faire peur. Ils se retiraient à quelques pieds de moi, en formant un cercle irrégulier.
Je chargeai mon fusil et fis feu sans résultat. Les alligators n’ont de vulnérable que l’œil ou le défaut des épaules ; il faisait trop sombre pour viser l’un de ces deux endroits, et mes bulles rebondissaient contre les écailles de leurs corps. Néanmoins le bruit et la lueur des détonations les épouvantèrent ; ils s’enfuirent pour ne revenir qu’après un long intervalle. Je m’étais endormi en dépit de mes efforts pour demeurer éveillé, mais je fus tiré de mon sommeil par le contact de quelque chose de froid, et à moitié suffoqué par une forte odeur de musc qui remplissait l’air. J’étendis le bras ; mes doigts se posèrent sur un objet visqueux ; c’était l’un des monstres, un énorme alligator. Il avait rampé jusqu’à moi, et se préparait à m’attaquer. Je vis qu’il se courbait en forme d’arc, et je savais que telle est la position de ces animaux quand ils vont frapper leur victime. Je n’eus que le temps de faire un saut, pour éviter un coup de sa puissante queue, qui balaya le sol où j’étais étendu l’instant d’auparavant. De nouveau je fis feu, et mon ennemi se rejeta dans le lac. Mais adieu le sommeil !
Une fois encore avant le matin, je dus livrer bataille et décharger mon fusil pour forcer les hideux reptiles à la retraite. Enfin le jour se leva mais sans apporter aucun changement à ma position dangereuse.
Vers le soir, je commençai à souffrir de la faim. Je n’avais rien mangé depuis mon départ de la petite ferme. Pour apaiser ma soif, je bus de l’eau bourbeuse du lac ; j’en bus en quantité, car elle était chaude ; mais je ne réussis qu’à humecter mon palais sans calmer les tiraillements de mon estomac.
Que manger ? – L’ibis ? Mais comment le faire cuire ? Rien pour allumer du feu, et pas un morceau de bois. Qu’importe ? La cuisson des aliments est une invention moderne, un luxe de délicats. Je dépouillai l’ibis de son brillant plumage, et je le dévorai tout cru. J’abîmais ainsi mon « spécimen », mais à ce moment je m’en souciais fort peu.
L’ibis ne pesait pas plus de trois livres, y compris les os. Il me servit pour un second repas, un déjeuner ; mais à ce déjeuner sans fourchette je dus ronger les os.
Que devenir ? Mourir de faim ? – Non, pas encore. Dans mes luttes avec les alligators pendant la seconde nuit, l’un d’eux avait reçu un coup mortel, et sa hideuse carcasse gisait sur le bord. « Je ne mourrai donc pas de faim, je puis manger de l’alligator, pensai-je. Mais il faudra que je souffre rudement de la faim pour me décider à toucher à cette viande musquée.
Deux autres journées sans nourriture eurent raison de ma répugnance. Je tirai mon couteau, je coupai une tranche dans la queue de l’alligator, et je la mangeai ; ce n’était pas le premier alligator que j’avais tué, mais un autre ; le premier, déjà putréfié par l’action brûlante du soleil, empoisonnait l’îlot de son odeur.
Cette odeur ayant fini par devenir insupportable, je réussis, avec l’aide de mon fusil, à pousser la carcasse à moitié décomposée dans le lac : peut-être le couvant remporterait-il au loin. En effet, j’eus la satisfaction de la voir flotter et s’éloigner.
Cette circonstance donna un nouveau tour à mes réflexions.
Pourquoi le corps de l’alligator surnageait-il ? C’est qu’il était gonflé par des gaz. Ha !…
Une idée m’avait brusquement frappé l’esprit, une île ces idées lumineuses qu’enfante la nécessité. Je pensai à l’alligator flottant, à ses intestins : si je les gonflais ?… Oui… oui ! Flotteurs, vessies, appareils de sauvetage… Telles étaient mes pensées. J’ouvrirais des alligators, je ferais avec leurs intestins gonflés une ceinture qui tue porterait hors de l’îlot !…
Je ne perdis pas un instant ; j’étais plein d’énergie, l’espoir m’avait donné une vie nouvelle. Je chargeai mon fusil, un gigantesque crocodile qui nageait près du bord reçut ma balle dans l’œil, je le tirai sur la berge, avec mon couteau je lui mis les entrailles à nu. Une des grosses plumes d’ibis me servit de chalumeau pour gonfler les boyaux. Je les vis s’enfler, comme autant, d’énormes saucisses, je les attachai ensemble, puis, m’en ceignant le corps, je me jetai dans le lac, et me sentis flotter à la dérive. Je tenais mon fusil des deux mains hors de l’eau, prêta m’en servir comme d’une massue, dans le cas où les alligators m’auraient attaqué ; mais j’avais choisi l’heure chaude de midi, alors que ces animaux restent dans un état de demi-torpeur, et je ne fus pas inquiété.
En une demi-heure le courant me porta à l’extrémité du lac, à l’embouchure du ruisseau. Là, à ma grande joie, j’aperçus mon bateau dans le marais, où il avait été retenu par les joncs ; et bientôt, me hissant par-dessus le plat-bord, je fendais à grands coups d’aviron l’eau unie du ruisseau.
Ainsi finit mon aventure. Je regagnai sain et sauf la petite ferme, sans rapporter, il est vrai, l’ibis rouge, objectif de mon excursion. Mais je pus m’en procurer un quelques jours après, et j’eus ainsi le plaisir de tenir la promesse que j’avais faite à mon ami. »





























