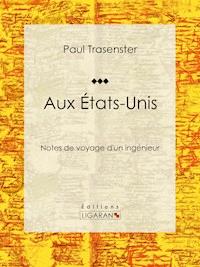
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Disposant de trois mois de vacances, je me décide à visiter les États-Unis, en compagnie d'un ami, ingénieur comme moi. Tout d'abord, nous avons à résoudre un problème compliqué : c'est le choix de la route à suivre. Une vingtaine de lignes hebdomadaires servent aujourd'hui de trait d'union entre l'Europe et les États-Unis ; nous avons à nous décider entre les paquebots d'une douzaine de Compagnies de premier ordre."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054576
©Ligaran 2015
LE CHOIX DU NAVIRE.– LA CUNARD-LINE.– LES LÉVRIERS DE L’ATLANTIQUE.– L’OREGON.– UNE COURSE SUR L’OCÉAN.– LES PROGRÈS DE LA NAVIGATION À VAPEUR.– LES ATLANTIC-EXPRESS DE L’AVENIR.
Disposant de trois mois de vacances, je me décide à visiter les États-Unis, en compagnie d’un ami, ingénieur comme moi.
Tout d’abord, nous avons à résoudre un problème compliqué : c’est le choix de la route à suivre.
Une vingtaine de lignes hebdomadaires servent aujourd’hui de trait d’union entre l’Europe et les États-Unis ; nous avons à nous décider entre les paquebots d’une douzaine de Compagnies de premier ordre.
Le patriotisme et l’économie plaident en faveur de la Red Star Line dont les navires partent tous les samedis des nouveaux quais d’Anvers ; cette voie réduirait pour nous, au minimum, l’ennui des changements de trains, des transbordements et des formalités douanières ; les steamers sont aménagés avec tout le confort désirable, mais ne marchent pas très vite : la traversée dure au moins dix jours. La Compagnie transatlantique du Havre possède des paquebots plus rapides ; elle a la réputation d’avoir une bonne table et se recommande spécialement aux amateurs de la cuisine et des vins français.
Les voyageurs pressés et ceux qui craignent plus le mal de mer que les potages poivrés, les légumes bouillis et les vins alcoolisés, s’embarquent de préférence sur les navires anglais à Liverpool ou à Queenstown.
Ces derniers rencontrent depuis peu une concurrence sérieuse de la part du Norddeutscher Lloyd de Brême, qui possède cinq steamers neufs, à grande vitesse, faisant escale à Southampton.
Le port de Liverpool a, sur tous ses rivaux, un avantage sérieux : c’est celui de la fréquence des départs. Les Compagnies Cunard, Inman, White Star, Guion, National, Anchor, expédient chacune par semaine un paquebot pour New-York ; l’Allan et la Dominion Line, un paquebot pour Québec. Les prospectus des lignes canadiennes font valoir qu’on n’a guère à subir que cinq jours de haute mer, des côtes d’Irlande à l’embouchure du Saint-Laurent.
Après avoir consulté la liste des départs des diverses lignes, nous nous décidons pour l’Oregon, de la Compagnie Cunard, le plus rapide des transatlantiques à flot, sur lequel nous nous embarquons le 10 juillet 1884 ; trois mois plus tard, le 8 octobre, nous repartions de New-York sur le même navire.
Étant peu sensible aux séductions du poker, qui retient bon nombre de passagers rivés toute la journée autour des tables à jeu du fumoir, je me mets à étudier notre navire ; la complaisance du capitaine et la bibliothèque du bord facilitent mon voyage d’instruction dans le domaine nautique. L’histoire des progrès de la navigation transatlantique se confond, du reste, en quelque sorte avec celle de la Compagnie Cunard, dont le pavillon flotte aux mâts de notre navire.
C’est en 1839 que la première ligne de paquebots entre l’Europe et l’Amérique fut constituée à Liverpool par Samuel Cunard son premier steamer, le Britannia, était un navire en bois, à aubes, long de 63 mètres, jaugeant 1 150 tonneaux et mis en mouvement par une machine de 740 chevaux indiqués ; le premier départ eut lieu le 4 juillet 1840, et le Britannia fit en 14 jours 8 heures la traversée de Liverpool à Boston, ce qui correspond à une vitesse de 8 nœuds.
La Compagnie Cunard n’eut pas de concurrents sérieux jusqu’en 1849, année de la création de la ligne Collins, sous pavillon américain ; dans la lutte qui s’engagea entre les deux lignes, l’avantage resta, au point de vue de la vitesse, aux navires américains qui firent en moins de 10 jours la traversée de New-York à Queenstown, mais ce succès fut de courte durée : la perte de deux paquebots, survenue en 1854 et 1856, amena le discrédit et la dissolution de la Compagnie Collins.
En 1856 le Persia, de la ligne Cunard, fit en 9 jours la traversée de l’Atlantique, ce qui correspond à une vitesse de 12,5 nœuds, et en 1863, le Scotia de la même Société fit le trajet en 8 jours 3 heures, soit à raison de 14 nœuds. Le Scotia, navire en fer de 3 800 tonneaux, fut le dernier steamer à aubes employé sur l’Atlantique.
Les steamers à hélice de la Compagnie Inman, constituée en 1850, ne tardèrent pas à battre les navires Cunard : une traversée de 7 jours 22 heures fut accomplie en 1869 par le City of Brussels et une de 7 jours 15 heures en 1875 par le City of Berlin, navire de 5 500 tonneaux, le plus grand de l’époque après le Great Eastern.
D’autres Compagnies, l’Anchor, la National, la Guion et la White Star Line s’étaient constituées dans l’entretemps ; la dernière venue, la White Star Line, inaugura en 1870 de nouveaux types de bateaux, remarquables par leur coupe, leur élégance et leur vitesse. En 1877, le Britannic et le Germanic traversèrent l’Atlantique en 7 jours 11 heures, soit à raison de 15,6 nœuds, et la Compagnie obtint une vitesse moyenne de 14 nœuds pour l’ensemble de son service pendant toute une année.
En 1879, le championnat de l’Atlantique passa à une autre Compagnie. L’Arizona de la Guion Line, franchit en 7 jours 9 heures et postérieurement en 7 jours 3 heures la distance de Queenstown à New-York.
Le succès de l’Arizona fut le signal d’une lutte acharnée entre les anciennes et les nouvelles Compagnies, qui lancèrent coup sur coup une série de navires de plus en plus grands, de plus en plus rapides.
Dans cette lutte de vitesse, la victoire est restée à la Guion Line : d’abord avec l’Alaska , construit en 1881 et qui a fait la traversée en 6 jours 18 heures ; puis avec l’Oregon, construit en 1883 et qui a parcouru en 6 jours 9 heures et 22 minutes les 2 800 milles marins qui séparent Queenstown de New-York, ce qui représente une vitesse moyenne de 18,5 nœuds ou 34 kilomètres à l’heure. Cependant la Guion Line s’aperçut bientôt qu’elle avait remporté une victoire à la Pyrrhus, et fut obligée de vendre son meilleur navire, l’Oregon, à sa rivale, la Compagnie Cunard.
Si celle-ci avait jusque-là conservé la vogue, elle le devait moins à la vitesse de ses navires qu’à la sécurité de son service ; la Cunard Line peut se vanter de n’avoir perdu ni un passager, ni un colis postal, pendant les quarante-cinq années de son exploitation, alors qu’il y a eu pour cette période près de 70 naufrages de paquebots transatlantiques qui ont coûté la vie à plus de 5 000 personnes ; deux navires Cunard figurent, il est vrai, dans la liste des naufrages, mais ils ont échoué près des côtes, et l’on a pu sauver tous ceux qui les montaient.
L’achat de l’Oregon, le plus rapide des lévriers de l’Atlantique, montre que la Compagnie Cunard ambitionne également la palme de la vitesse. Des passagers, qui font la traversée avec nous, prétendent cependant que l’Oregon va être relégué au second rang par un nouveau concurrent, l’America, un navire d’une grande finesse de lignes, que la National Line vient de mettre en service.
Trois mois plus tard, à mon retour, j’ai la chance d’être témoin d’une course à travers l’Atlantique entre les deux rivaux : le 8 octobre 1884, à 7 heures du matin, l’Oregon, à bord duquel je me trouve, et l’America sortent ensemble du port de New-York à destination de Queenstown. Jusqu’au soir les deux navires naviguent parallèlement, mais suivant des routes divergentes ; la voie suivie par les navires Cunard s’infléchit en effet un peu vers le Sud, afin de diminuer les chances de collision. Par suite de cette circonstance, nous perdons l’America de vue dès le second jour et nous ne le revoyons plus de tout le voyage. Nous arrivons à Queenstown le 15 à 2 heures 41 minutes du matin, ayant fait la traversée en 6 jours 12 heures 31 minutes, en tenant compte de la différence d’heure ; nous avons la satisfaction d’apprendre que l’America n’est pas encore signalé ; le soir du même jour nous lisons dans les journaux de Liverpool que notre concurrent est arrivé à Queenstown 5 heures après nous. Notre brave Oregon reste donc le champion de l’Atlantique.
Le capitaine nous apprend cependant qu’il ne jouira plus longtemps de cet honneur : la Compagnie Cunard a fait construire deux nouveaux navires, l’Umbria et l’Etruria, qui doivent traverser l’Atlantique en 6 jours. L’Umbria, qui a été complètement achevé en quinze mois par M. J. Elder, le principal constructeur de Glasgow, vient de faire son trial trip (course d’essai), sur la Clyde, où il a atteint l’énorme vitesse de 21 nœuds ; dans les mêmes circonstances, l’Oregon avait filé 20 nœuds.
Ajoutons que, dès son second voyage en mai 1885, l’Etruria a fait en 6 jours 6 heures et 25 minutes, soit avec une vitesse moyenne de 18,8 nœuds, la traversée de Queenstown à New-York et a maintenu pendant 3 jours consécutifs une vitesse de 19 nœuds.
À l’exemple de la Compagnie Cunard, d’autres lignes anglaises ou continentales ont renouvelé leur matériel.
Depuis 1880, il n’a pas été mis en service moins de vingt-cinq paquebots transatlantiques, jaugeant de 5 000 à 8 500 tonneaux, et dont une quinzaine sont plus rapides que le Britannic ; cette transformation de la marine à vapeur a été facilitée par la substitution de l’acier au fer dans la construction de la coque et des chaudières, et par le perfectionnement des machines.
Les nouveaux navires à grande vitesse appartiennent aux lignes suivantes :
CUNARD (Liverpool) :
Servia, construit en 1881, 7 500 tonneaux de jauge brute, vitesse de 17,8 nœuds aux essais sur la Clyde, avec 10 350 chevaux indiqués, coque en acier.
Aurania, 1882, 7 500 t., 18 n., 10 000 chev., acier.
Oregon, 1883, 7 500 t., 20 n., 12 400 chev., fer.
Umbria, 1884, 8 000 t., 21 n., 13 500 chev., acier.
Etruria, 1884, même construction.
ANCHOR LINE (Liverpool) :
Austral, 1881, 5 600 t., 17,75 n., 6 300 chev., acier.
City of Rome, 1881, 8 400 t., 18 n., 10 000 ch., fer.
GUION LINE (Liverpool) :
Arizona, 1879, 5 500 t., 17,3 n, 6 550 chev., fer.
Alaska, 1881, 6 900 t., 10 500 chev., fer.
NATIONAL LINE (Liverpool) :
America, 1884, 6 500 t., 19,5 n., 10 000 ch., acier.
WHITE STAR LINE (Liverpool) :
Belgic, 1885, 4 500 t.
Gaëlic, 1885, 4 500 t.
NORDDEUTSCHER LLOYD (Brême) :
Elbe, 1881, 5 100 t., 16,6 n., 6 115 chev., fer.
Werra, 1882, 5 100 t., 17 n.
Fulda, 1882, 5 100 t., 17,8 n., 6 400 chev., fer.
Eider, 1883, 5 250 t., 17,8 n., 7 000 chev.
Ems, 1884, 5 250 t., 18,5 n., 7 000 chev.
COMPAGNIE TRANSATLANTIQUE (Havre) :
Normandie, 1882, 6 000 t., 17,2n., 8 000 chev., fer.
Champagne, 1885, 7 000 t., acier.
Trois autres en construction.
J’ajoute, comme points de comparaison, les meilleurs navires de trois lignes concurrentes.
ALLAN LINE (Liverpool-Québec) :
Parisian, 1881, 5 350 t., 15,5n., 6 000 chev., acier.
DOMINION LINE (Liverpool-Québec) :
Vancouver, 1884, 5 300 t., 15,5 n., 6 000 ch., acier.
RED STAR LINE (Anvers-New-York) :
Westerland, 1883, 5 500 t., 14 n., 4 000 ch., acier.
Pour calculer la durée de la traversée, il faut tenir compte de la distance, qui est pour les principales lignes :
Liverpool-Québec : 2 640 milles.
Queenstown-New-York : 2 800 milles.
Liverpool-New-York : 3 100 milles.
Southampton-New-York : 3 100 milles.
Le Havre-New-York : 3 150 milles.
Anvers-New-York : 3 300 milles.
Il faut aussi remarquer que la vitesse moyenne de marche, dans les circonstances les plus favorables, est inférieure de 1 à 1,5 nœud à la vitesse obtenue dans les essais qui se font sur un parcours limité.
La traversée la plus rapide des divers navires cités correspond aux vitesses moyennes suivantes : Etruria, 18,8 nœuds ; Oregon, 18,5 ; America, 18 ; Alaska, 17,5 ; Aurania, 17,1 ; Servia 16,9 ; City of Rome, 16,9 ; Austral, 16,8 ; Eider, 16,8 ;Ems, 16,6, Arizona, 16,6 ; Werra, 16,5 ; Fulda, 16,5 ; Normandie, 16,5 ; Elbe, 16,1 ;Britannic, 16 ; Westerland, 13,9.
Tous ces navires, à l’exception du dernier, ont franchi, en moins de 8 jours, la distance de 3 100 milles environ, qui sépare Liverpool, Southampton ou le Havre de New-York, ou les 2 700 milles qui séparent Liverpool de Québec.
Les traversées les plus courtes ont été de 6 jours 6 heures pour Queenstown, soit environ 7 jours pour Liverpool, 7 jours 16 heures pour Southampton, 7 jours 22 heures pour le Havre, 9 jours 11 heures pour Anvers.
Au point de vue de la rapidité du voyage entre New-York et le continent européen, on peut hésiter entre les lignes sous pavillon anglais, allemand ou français, à condition de prendre un des navires rapides indiqués ci-dessus, et dont on compte 10 dans la flotte de Liverpool, 5 dans celle du Lloyd et 1 dans celle du Havre qui en aura bientôt 5 également.
Bien que les navires anglais soient plus rapides, on est exposé à perdre plusieurs heures à Queenstown, Liverpool ou Londres, pour attendre la : correspondance ou faire visiter les bagages. Plus d’une fois, les voyageurs de la ligne allemande sont arrivés à Londres avant ceux de la ligne Cunard, partis en même temps de New-York.
Lors de notre retour, les voyageurs et les lettres n’ont pu arriver à Paris ou Bruxelles que 30 heures après le débarquement à Queenstown.
Comme il est généralement d’usage de prendre un billet d’aller et retour, il y a lieu de tenir compte, non seulement du steamer que l’on choisit pour partir, mais des 3 ou 4 autres paquebots de la même Compagnie, car il faut 4 ou 5 navires rapides pour desservir un service hebdomadaire entre l’Europe et les États-Unis.
Or, à ce point de vue, si l’on se reporte à la liste des navires rapides, on constate que les Compagnies les mieux partagées sont la Cunard Line et le Norddeutscher Lloyd. Cette dernière Société possède cinq navires neufs, qui ont atteint une vitesse moyenne de 17,5 nœuds aux essais, de 16,5 en service dans les circonstances les plus favorables.
La Compagnie Cunard possède cinq navires qui ont filé en moyenne 19,5 nœuds aux essais, 18 nœuds dans leurs meilleures traversées. Pour la saison de 1884, il n’y a pas eu un écart de plus de 6 heures entre la traversée la plus rapide et la plus lente de l’Oregon.
La Compagnie transatlantique doit, d’après son nouveau cahier des charges, obtenir une vitesse de
17,5 nœuds aux essais, une moyenne de 15 nœuds en service, ce qui suppose pour les meilleures traversées une vitesse de 16,5 nœuds ; elle se trouvera donc dans les conditions de la ligne brémoise.
Il faut remarquer, à l’avantage des lignes sous pavillon français et allemand, que le trajet de Southampton ou du Havre à New-York se fait sans arrêt, tandis que les steamers de Liverpool, qui ne peuvent sortir du port qu’à marée haute, sont souvent obligés de perdre plusieurs heures à Queenstown pour attendre la malle et embarquer les 3 à 400 sacs de lettres qu’elle amène.
Quant à la dépense, il n’y a pas grande différence d’un navire ou d’une ligne à l’autre. L’avantage que donne aux Compagnies la rapidité des steamers est d’attirer un plus grand afflux de voyageurs.
Les prix varient naturellement avec la situation et les dimensions des cabines ; les cabines extérieures qui ont jour direct par les hublots ou petites fenêtres rondes percées dans le bordage, se paient, par voyageur, une centaine de francs de plus que les cabines intérieures.
Le prix de la traversée, pour les cabines intérieures à deux personnes, est de 400 francs, pour un billet simple ; 720 francs, pour un double voyage, par les lignes du Havre et d’Anvers ; de 15 et 25 guinées (environ 400 et 665 francs) par les lignes anglaises. Sur les navires anglais de tout premier ordre, on paie cependant 18 et 30 guinées pour les cabines intérieures situées au centre du bateau, tandis que sur certains navires plus lents on peut avoir des cabines intérieures à 12 guinées.
Le prix de la seconde classe est de 7 ou 8 guinées. Les émigrants paient généralement 100 francs ou 4 guinées, nourriture comprise ; certaines lignes allemandes et anglaises ont récemment réduit ce prix à 75 francs et même à 50 francs pendant quelques mois.
Le voyage en première classe, de Paris ou Bruxelles à Liverpool, revient à une centaine de francs.
Ayant eu tout le loisir d’étudier l’Oregon, je donnerai une courte description de cette ville flottante.
L’Oregon a été construit en 1883 sur la Clyde, dans les chantiers de MM. J. Elder et Cie.
Si l’on excepte le Great Eastern, qui est pratiquement hors de service, l’Oregon occupe, comme tonnage, la troisième place parmi les Leviathans de l’Atlantique. La première appartient au City of Rome de l’Anchor Line, qui jauge 8 400 tonneaux de gros tonnage et mesure 170 mètres de longueur. L’Umbria et l’Etruria viennent ensuite avec 8 000 tonneaux ; l’Oregon, le Servia et l’Aurania occupent le troisième rang avec 7 500 tonneaux. Ces cinq navires appartiennent à la Compagnie Cunard.
La coque de l’Oregon, qui est en fer, mesure 158 mètres de longueur, 16m50 de largeur et 12m40 de creux. Le navire est divisé en cinq étages par autant de ponts. Le premier, surélevé, est un pont-promenade, qui s’étend sur toute la largeur et sur une grande partie de la longueur du navire, et est réservé aux passagers de première classe. Vient ensuite le pont supérieur (upper deck) dont la partie centrale est occupée par les cabines des officiers, des machinistes, le fumoir, les cuisines, la boulangerie, le garde-manger, les glacières ; tout autour règne un promenoir qui est accessible aux émigrants qui se tiennent à l’arrière, et à l’équipage qui occupe le gaillard d’avant. Plus bas vient l’étage principal (main deck), comprenant les salons, le boudoir des dames et des cabines pouvant loger 346 passagers de première classe, 92 de seconde et 285 émigrants.
Le salon des premières, qui occupe toute la largeur du navire et est long de 20 mètres, est meublé de cinq tables où 250 passagers peuvent s’asseoir à l’aise.
L’entrepont (Lower-deck), qui sert actuellement au transport des marchandises, pourrait être éventuellement aménagé pour loger un millier d’émigrants. Le pont inférieur (Orlop-deck) et la cale reçoivent les marchandises et l’approvisionnement de charbon.
Le navire est divisé en onze compartiments par des cloisons étanches. On comprend qu’il faille un appareil moteur d’une énorme puissance pour imprimer à un pareil colosse – qui représente, chargé, un poids de 12 500 tonnes – une vitesse comparable à celle d’un train de chemin de fer. La machine de l’Oregon est une machine Compound de la force de 12 à 13 000 chevaux indiqués. Elle se compose d’un premier cylindre de 1m75 de diamètre, 1m80 de course, où la vapeur travaille à haute pression, et de deux cylindres à basse pression, de 2m60 de diamètre et 1m80 de course, où la vapeur se détend à sa sortie du premier cylindre. L’arbre qui fait 63 à 64 tours par minute est en acier au creuset. La vapeur est fournie par neuf grandes chaudières doubles en acier ; elles ont 5 mètres de diamètre et autant de longueur et sont timbrées à 8 atmosphères. Chaque chaudière a huit foyers intérieurs (quatre de chaque côté) et est desservie par deux chauffeurs. Il y a trois brigades de 18 chauffeurs qui se relaient de 4 en 4 heures.
Les chaudières consomment 260 tonnes de houille par 24 heures, de sorte que l’approvisionnement de combustible pour un voyage occupe près de la moitié de la capacité de chargement du navire.
Le personnel comprend 10 officiers, 45 matelots et quartiers-maîtres, 9 machinistes, 110 chauffeurs et manœuvres pour le service des chaudières, 88 stewards et stewardess, soit une armée de 262 personnes.
Comme détail d’aménagement, signalons que toutes les parties du navire, salon, cabines, fumoir, dépendances, sont éclairées par des lampes électriques du système Edison, au nombre de 460.
L’Umbria et l’Etruria, les derniers navires construits par M. J. Elder pour la Compagnie Cunard, ne diffèrent de l’Oregon que par quelques détails. La coque est en acier et mesure un mètre de plus en largeur, ce qui porte la jauge brute à 8 000 tonneaux ; les cylindres à vapeur ont chacun un pouce de plus en diamètre, et la force développée lors de la course d’essai a atteint 13 500 chevaux indiqués, soit 1 000 de plus que pour l’Oregon ; la machine de l’Umbria est probablement le plus puissant moteur à vapeur du monde entier. L’éclairage de chaque navire est fourni par 850 lampes à incandescence du système Swan et chacun d’eux peut loger 720 passagers de première classe sur le main-deck.
Un fait qui a bien son importance, c’est que chacun de ces navires coûte 8 millions de francs ; c’est le tiers du prix du Lepanto ou de l’Italia, les grands cuirassés italiens, qui ont à peu près le même tonnage de déplacement.
En estimant à 10 % l’amortissement annuel, ce qui ne paraît pas exagéré si l’on considère avec quelle rapidité les navires se démodent, on arrive à une annuité de 800 000 francs ; cela représente pour 20 voyages – service annuel ordinaire des navires Cunard – 40 000 francs par voyage.
Un second élément du prix de revient est la consommation de charbon, qui croît très rapidement avec la vitesse du navire. Le travail de la machine augmente comme le cube de la vitesse ; c’est-à-dire que pour doubler la vitesse, il faut augmenter le travail développé, et par suite la consommation de charbon par heure, dans la proportion de 1 à 8. Il est vrai que la durée du voyage est réduite de moitié, de sorte que la consommation totale augmente dans la proportion de 1 à 4, soit comme le carré de la vitesse. C’est ainsi, par exemple, que l’Umbria, marchant à toute vapeur, serait capable de faire le tour du monde en 45 jours, mais à condition de remplir trois fois ses soutes de charbon, tandis qu’il pourrait faire le même voyage en 80 jours sans renouveler son approvisionnement. On voit combien Phileas Fogg est distancé.
En même temps que l’on augmente la force des machines, on les perfectionne sans cesse. Le poids des machines a été abaissé de 285 à 130 et même à 70 kilogrammes par force de cheval ; la consommation de combustible a subi une réduction analogue. Les premiers steamers de la Compagnie Cunard brûlaient 2,1 kilogrammes de houille par cheval et par heure, le Persia en 1856 et le Scotia en 1866 descendaient à 1,5 kilogramme. L’application du système Compound, qui consiste à utiliser en quelque sorte deux fois la même vapeur dans deux cylindres séparés, a été un progrès considérable : la consommation est descendue à 0,85 kilogramme avec les machines Compound du Britannic, et à 0,75 kilogramme avec les machines du type de l’Oregon, admettant de la vapeur à 8 atmosphères, qui se détend ensuite dans deux cylindres à basse pression.
Un nouveau pas en avant s’accomplit actuellement : c’est la construction de machines Compound triples, dans lesquelles de la vapeur à très haute pression passe successivement dans trois cylindres, en se détendant ; ce système a été appliqué à 30 ou 40 navires de tout tonnage et l’on a constaté une économie de 20 % relativement aux machines Compound ordinaires. Ce système exige des pressions de 10 et 12 atmosphères que les chaudières d’acier peuvent seules supporter ; certaines de ces chaudières sont faites en tôles d’acier de 35 millimètres d’épaisseur.
On n’a pas seulement perfectionné les machines, on a aussi perfectionné les bateaux, de façon à diminuer leur résistance au mouvement. Un des moyens employés est l’accroissement du tonnage des navires, facilité par la substitution de l’acier au fer ; il y a en effet avantage, au point de vue de la dépense relative de force motrice à augmenter les dimensions de la coque. Le travail nécessaire pour obtenir une vitesse donnée croît comme le carré d’une dimension, tandis que la capacité du navire croît comme le cube de cette dimension.
Un navire quatre fois plus long, plus large et plus profond qu’un autre et de même forme, marche deux fois plus vite avec la même consommation de force ou de charbon par tonneau de déplacement, ou bien il peut acquérir la même vitesse avec une consommation relative dix fois plus petite.
Pour citer un exemple, l’Invicta, qui fait le service de Douvres à Calais et ne déplace que 1 250 tonneaux, doit dépenser 3 900 chevaux, ou 3 chevaux par tonneau pour atteindre une vitesse de 20 nœuds, tandis que l’Oregon arrive à la même vitesse avec un travail de 1 cheval par tonneau de déplacement. Quelques chiffres permettent de se rendre compte des progrès dus à ces différentes causes.
En 1840, le Britannia, qui déplaçait 2 050 tonneaux, obtenait une vitesse de 8,3 nœuds avec 740 chevaux indiqués et une consommation de 38 tonnes de houille par jour, 544 par traversée.
En 1866, le Scotia, de 6 890 tonneaux de déplacement, arrive à une vitesse de 14,5 nœuds avec 4 200 chevaux indiqués et une consommation de 160 tonnes par jour, 1 305 par traversée.
En 1877, le Britannic, déplaçant 8 500 tonneaux, marche à 15,6 nœuds avec 4 920 chevaux, 100 tonnes de charbon par jour, 745 par traversée.
En 1882, le Servia, déplaçant 12 500 tonneaux, fait 17 nœuds avec 10 000 chevaux, 190 tonnes de charbon par 24 heures, 1 350 par traversée.
En 1884, l’Oregon, déplaçant 12 500 tonneaux, marche à 18,5 nœuds avec 12 500 chevaux, 260 tonnes de charbon par 24 heures, 1 665 par traversée de New-York à Queenstown.
En d’autres termes, le Britannia consommait 2,5 tonnes de charbon par tonneau de fret, tandis que la consommation n’est plus que de 0,25 tonne, soit dix fois moins dans le Britannic qui marche cependant deux fois plus vite. Elle atteint 0,4 tonne pour le Servia et 0,55 tonne pour l’Oregon ; ce chiffre relativement élevé n’est pas seulement la conséquence de la vitesse, mais elle est également due à une autre circonstance.
Les grands navires tels que l’Oregon et le Servia ne peuvent pas profiter complètement de l’avantage de leurs dimensions ; le tirant d’eau des ports où ils arrivent les empêche d’utiliser leur capacité de chargement.
Le chenal d’accès du port de New-York, n’est accessible qu’à des navires tirant 26 pieds au maximum, et ceux-ci ne peuvent entrer ou sortir du port de Liverpool qu’à marée haute.
Dans ces conditions un navire de 7 500 tonneaux comme le Servia, déplace 12 500 tonneaux ou mètres cubes d’eau. Or, comme la coque d’acier pèse 4 250 tonnes, la machine et les chaudières environ 1 700, les cloisons en bois, l’ameublement et les agrès 1 700, la capacité de chargement est réduite à 4 850 tonnes dont 1 850 environ représentent l’approvisionnement de charbon pour la traversée.
Le navire pourrait, en toute sécurité, supporter un enfoncement de 30 pieds, ce qui ajouterait 3 000 tonneaux de déplacement ; le poids mort restant constant, ces 3 000 tonneaux seraient presque entièrement gagnés par la capacité de chargement utile du steamer.
On est tenté de se demander, en présence des progrès accomplis, où s’arrêtera l’audace des constructeurs et la vitesse des steamers transatlantiques.
La limite sera évidemment atteinte le jour où le combustible nécessaire à un voyage absorbera toute la capacité de chargement du navire. Or, avec des navires du type de l’Oregon, cette limite ne serait atteinte qu’en doublant la force de la machine, ce qui, d’après les principes théoriques exposés, permettrait d’accroître la vitesse de 25 %, et de faire en 5 jours la traversée de Queenstown à New-York. On reculerait encore cette limite très notablement en augmentant le tonnage, en construisant des machines plus légères et plus économiques, par exemple du type Compound triple, ou en substituant à la houille un combustible d’un plus grand pouvoir calorifique, tel que le pétrole brut. Le célèbre constructeur Thornycroft a déjà construit des bateaux torpilleurs qui, tout en ne déplaçant que 40 tonneaux, et ne mesurant que 30 mètres de longueur, atteignent une vitesse de 22,5 nœuds en développant 640 chevaux. Si l’on pouvait construire un bateau de même forme en multipliant toutes les dimensions par 4, ce steamer ferait 45 nœuds et traverserait l’Atlantique en moins de trois jours.
Seulement, ce navire ne devrait déplacer que 2 500 tonneaux, avec un moteur de 40 000 chevaux, ce qui est un problème insoluble dans l’état actuel de la science des constructions navales.
On peut cependant affirmer que l’Umbria et l’Etruria ne sont pas le dernier mot de l’art de l’ingénieur. On arrivera certainement à construire de véritables Atlantic-express, réservés au service des voyageurs et de la poste, et qui ne prendront pas de marchandises ; il n’est pas démontré qu’il en résulterait un grand accroissement dans le prix du voyage.
Les dépenses fixes, c’est-à-dire l’amortissement du steamer et la rétribution du personnel, constituent certainement une bonne partie de la dépense. Actuellement les navires de la Compagnie Cunard et de plusieurs autres ne font qu’un voyage aller et retour tous les cinq semaines. Avec des steamers-express, faisant régulièrement le voyage en moins de 7, et peut-être de 6 jours, et ne devant pas perdre de temps dans les ports pour embarquer du fret, on arriverait certainement à faire un double voyage en trois semaines.
Si l’on estime à 800 000 francs l’amortissement annuel du steamer et à 500 000 francs les salaires du personnel, comprenant 250 personnes, ce qui nous paraît modéré, les frais fixes par traversée atteignent 65 000 francs dans le premier cas, moins de 40 000 francs dans le second.
Cet écart de 25 000 francs représente le prix de 1 000 à 1 500 tonnes de charbon ; et permettrait d’avoir des machines d’une force double de celle de l’Oregon, sans accroissement de dépense, et de faire en moins de 6 jours la traversée de Liverpool, Southampton ou le Havre, à New-York.
Quant à la perte de 2 à 3 000 tonneaux de fret elle serait compensée par l’accroissement de la recette des voyageurs, sur la nourriture desquels on ferait de plus une certaine économie. On pourrait peut-être faire deux étages de cabines et avoir des cabines plus spacieuses et plus nombreuses ; le mouvement des voyageurs entre l’Europe et l’Amérique est assez important pour assurer l’encombrement d’une ligne express.
D’autres améliorations sont encore possibles dans les services transatlantiques. Actuellement on perd encore beaucoup de temps au départ ou à l’arrivée, soit en attendant la malle à Queenstown, ou la marée haute à Liverpool, soit par suite de la lenteur du débarquement et de la visite des bagages à Liverpool.
Une ligne express devrait supprimer l’escale de Queenstown, et peut-être choisir un autre port d’attache.
Le port de Milford, à l’extrémité occidentale du South-Wales, qui est le plus beau port naturel de l’Angleterre et est relié à Londres par les rails du Great Western, est tout indiqué pour servir de terminus en Angleterre ; une ligne partant d’Anvers ou du Havre, avec escale à Southampton ou à Plymouth, serait également dans de très bonnes conditions.
L’accroissement de vitesse des navires a en effet pour conséquence d’annuler l’avantage de la situation géographique de certains ports européens, par rapport à l’Amérique ; avec des steamers comme l’Oregon ou l’Umbria, dont la vitesse se rapproche de celle d’un train de chemin de fer, lettres et voyageurs du continent parviendraient plus vite en Amérique en s’embarquant au Havre ou à Anvers qu’à Queenstown. Déjà actuellement les navires du Lloyd allemand franchissent en 24 heures la distance de Brême à Southampton, ce qu’il serait impossible de faire par la voie de terre et de Calais-Douvres.
Si l’on tient avant tout à réduire la durée de la traversée, on pourrait établir un service entre Galway, en Irlande, et St-John, dans l’île de Terre-Neuve ; la distance n’est que de 1 720 milles et elle a été franchie en 6 jours 1 heure en 1858, par un des navires de la ligne Collins. L’Etruria ferait le trajet en 3 jours et 18 heures.
On ne doit pas s’attendre à voir ces nouveaux progrès se réaliser tout de suite, en présence de la situation des affaires. La crise générale n’a pas épargné les armateurs, qui doivent être peu disposés à faire de nouvelles immobilisations.
La Compagnie Cunard, malgré une recette postale de 2,5 millions de francs, n’a pas distribué de dividende pour les exercices 1883 et 1884 ; elle avait donné 3 % en 1881, 4 % en 1882 ; il sera curieux de voir si le renouvellement de son matériel améliorera cette situation.
Parmi les autres Compagnies transatlantiques anglaises, la National et la Monarch Line sont dans le même cas que la Compagnie Cunard ; la State, l’Anchor Line ont distribué un petit dividende ; les Compagnies White Star et Guion sont des entreprises privées qui ne publient pas leur bilan.
Les Sociétés allemandes ont fait, en général, de meilleures affaires, ce qui s’explique par le grand mouvement d’émigration entre l’Allemagne et les États-Unis.
Le Lloyd de Brême a transporté en 1884, 135 000 passagers et réalisé une recette postale de près d’un million de francs. Le bénéfice brut, qui comprend celui d’autres lignes, a atteint 5 millions de francs, dont les trois quarts ont été consacrés à des amortissements et à l’accroissement du fond de réserve ; le surplus a permis de distribuer un dividende de 6,5 % au capital de 25 millions de francs ; le dividende de 1883 avait été de 10 %. La Compagnie Hambourgeoise a distribué à ses actionnaires 9 % pour 1882, 4 % pour 1883, et rien pour 1884.
La Compagnie Transatlantique du Havre, qui reçoit du gouvernement français une subvention annuelle de 5,5 millions de francs pour son service hebdomadaire vers New-York, a réparti à son capital-actions de 40 millions, un dividende de 7 % pour l’exercice 1883.
En présence des résultats en général peu brillants de ces entreprises, il est probable que l’Atlantic-Express Company ne trouvera pas de sitôt les 30 ou 40 millions de francs qui lui seraient nécessaires pour se constituer.





























