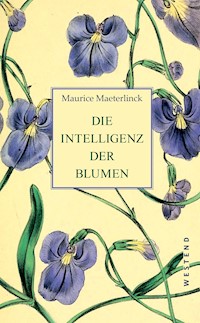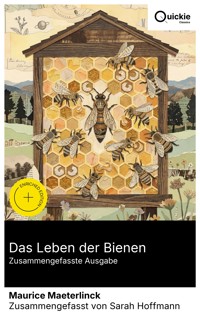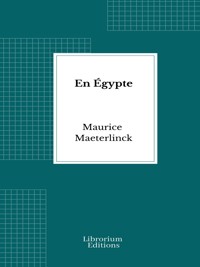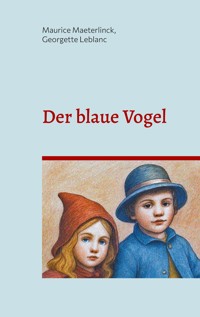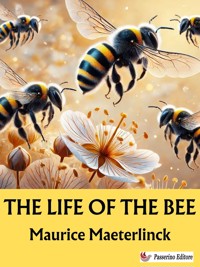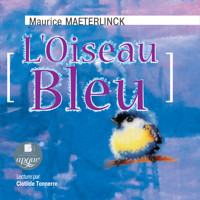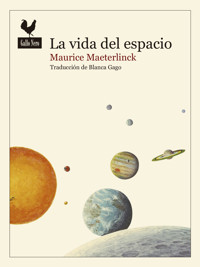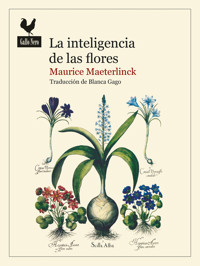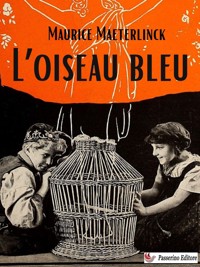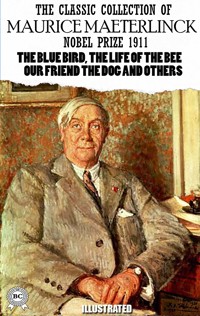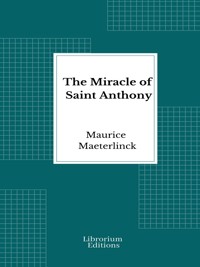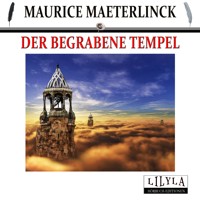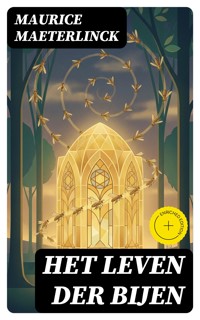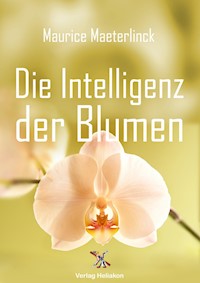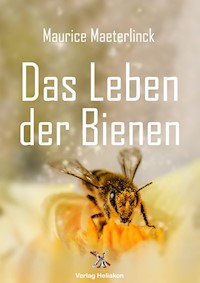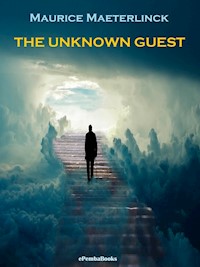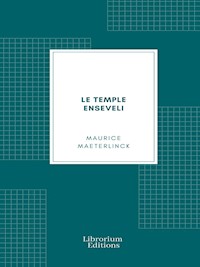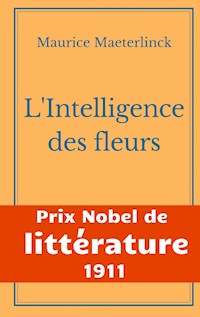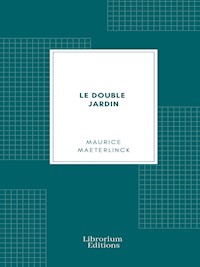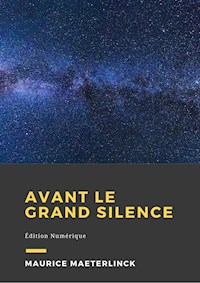
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L'humanité n'a-t-elle pas accepté, durant deux mille ans, tous les mystères, c'est-à-dire toutes les puérilités, toutes les absurdités qu'on attribuait au Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans ? Pourquoi ne pas accepter, en attendant mieux, l'inexplicable d'un univers que nous commençons à peine d'interroger ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maurice Maeterlinck, né le 29 août 1862 à Gand (Belgique) et mort le 6 mai 1949 à Nice (France), est un écrivain francophone belge, prix Nobel de littérature en 1911.
Figure de proue du symbolisme belge, il reste aujourd'hui célèbre pour son mélodrame
Pelléas et Mélisande (1892), sommet du théâtre symboliste mis en musique par Debussy en 1902, pour sa pièce pour enfants
L’Oiseau bleu (1908), et pour son essai inspiré par la biologie
La Vie des abeilles (1901), œuvre au centre du cycle d'essais
La Vie de la nature, composé également de
L'Intelligence des fleurs (1910),
La Vie des termites (1926),
La Vie de l’espace (1928) et
La Vie des fourmis (1930).
Il est aussi l'auteur de treize essais mystiques inspirés par Ruysbroeck l'Admirable et réunis dans
Le Trésor des humbles (1896), de poèmes recueillis dans
Serres chaudes (1889), ou encore de
Trois petits drames pour marionnettes (1894, trilogie formée par
Alladine et Palomides,
Intérieur, et
La Mort de Tintagiles).
Son œuvre fait preuve d'un éclectisme littéraire et artistique (importance de la musique dans son œuvre théâtrale) propre à l'idéal symboliste.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant le grand silence
Maurice Maeterlinck
– 1934 –
AVANT LE GRAND SILENCE
Hadrien, fils adoptif et successeur de Trajan, fut l'un des grands et bons empereurs de Rome. On ne sait pas pourquoi l'histoire ou la tradition ne le met pas exactement au même rang qu'Auguste, Titus, Trajan, Nerva, Antonin-le-Pieux et Marc-Aurèle. Est-ce à cause de quelque chose d'équivoque dans une sagesse où passe parfois, on ne sait quelle odeur féline qui a fait croire qu'il était un Marc-Aurèle sous lequel rugissait sourdement un Néron ? C'est possible ; mais il dompta le Néron jusqu'au bout, et ces luttes secrètes que ne connurent pas un Antonin ou un Marc-Aurèle, presque trop parfaits, sont très méritoires.
Est-ce peut-être à cause d'Antinoüs, le beau pâtre bithynien ? Mais cette amitié ne fut-elle pas purifiée par une mort héroïque, puisque pour obéir à un oracle qui annonçait la fin de l'empereur si une victime volontaire ne se substituait pas à celle que réclamait le destin, Antinoüs se jeta dans le Nil et s'y noya ? Du reste Trajan n'avait-il pas le même vice, outre qu'il était notoirement ivrogne, et Titus lui-même (qui le croirait ?), le Titus de Bérénice, avec les eunuques, les bouffons et les danseurs d'avant son avènement, se trouvait-il, sous ce rapport, à l'abri de tout reproche ? Ne jugeons pas les hommes du passé selon nos préjugés d'aujourd'hui.
Ce que je tiens à montrer, c'est qu'outre un grand politique, un grand capitaine, un grand juge, un grand artiste, Hadrien fut l'homme le plus instruit, le plus érudit, le plus éclairé de son temps. Il avait consacré quinze ans de son règne à voyager à travers l'Empire qui comprenait une partie de l'Asie, de l'Afrique, la Grèce et à peu près tout le reste de l'Europe habitable. Il voyageait très simplement, presque sans suite, en touriste, curieux de tout apprendre, de tout comprendre, de tout embellir en roi, a-t-on dit ; et j'ajouterai, de tout contrôler en savant.
N'oublions point que c'est à sa villa de Tibur qu'il orna de la copie de tous les chefs-d'œuvre remarqués au cours de ses longs voyages, que nous devons la plupart des statues de nos musées. Surtout, ne perdons pas de vue que nous lui devons d'abord Antonin-le-Pieux et ensuite Marc-Aurèle qu'il devina et, qu'avec une prévoyance prophétique, il imposa comme fils adoptif à Antonin. Ils furent les deux maîtres du monde les plus parfaits dont l'homme ait gardé le souvenir. Après eux, ce fut la fin de Rome et de la vie policée.
Mais Rome, à l'instant où nous sommes, était partout victorieuse et sa civilisation à son comble. Toutes les religions orientales, et le christianisme même, lui avaient révélé leurs secrets, de même que toutes les philosophies. On peut dire que ce fut une des plus belles, des plus heureuses époques de l'histoire. Hormis ce que nous avons acquis dans les sciences matérielles, on savait alors tout ce qu'on sait aujourd'hui d'essentiel sur les grandes questions de la vie et de la mort, des origines et de la fin. Il est même possible que, loin d'avoir appris davantage, l'homme ait perdu la connaissance de choses fort importantes, dont il n'est pas resté de traces.
Quoi qu'il en soit, c'est dans ce monde, parmi les sommets de ces mystères et de cette science que vivait et se déplaçait le fils adoptif de Trajan et le père d'Antonin-le-Pieux.
Promptement arrivé au bout du savoir de son temps, dont le champ n'était pas bien grand, afin de fournir à son intelligence l'aliment qu'elle demandait en vain à ce qui semblait connu, il s'était naturellement tourné vers les sciences secrètes qui livraient alors à l'esprit une étendue que nous avons peut-être trop réduite. L'astrologie, notamment, le passionnait. Chaque année, le soir du 31 décembre, il consultait les astres ; et, d'après leur avis, écrivait, jour par jour, les événements de l'année qui allait commencer. Mais au début de la vingt-deuxième année de son règne, il ne dressa son horoscope que jusqu'au 10 juillet ; et c'est précisément le 10 juillet qu'il mourut.
C'est du moins ce que rapporte son historien, l'abréviateur Aelius Spartianus, dans les Scriptores historiœ Augustœ. En tout cas, il serait étonnant qu'un homme aussi sérieux, aussi équilibré, aussi pratique qu'Hadrien, se fût astreint, durant vingt-deux ans, à un travail aussi compliqué, aussi fastidieux, si les résultats en eussent toujours été décevants et démentis par la réalité.
Mais le point où je voulais en venir et sur lequel j'appelle l'attention, est celui-ci : Hadrien, en tant qu'empereur souverain, auquel on ne pouvait rien refuser et qu'il eût été mortellement dangereux de tromper, avait été initié à tous les mystères antiques, notamment à ceux d'Égypte, pères de tous les autres et surtout, par deux fois, à ceux d'Eleusis, qui étaient les mystères par excellence, ceux des suprêmes vérités, des grandes certitudes qui mettaient l'homme au rang des dieux. Or, aux dernières heures de son agonie, qui fut longue, douloureuse et qu'il aurait abrégée par le suicide si Trajan ne l'en eût empêché, l'impérial initié d'Eleusis eut peur comme un enfant dans les ténèbres et composa, sur le sort incertain de son âme, les petits vers angoissés, frissonnants et plaintifs que voici :
Animula, vagula, blandula,
Comes hospesque corporis,
Quœ nunc abibis in loca ?
Pallidula, frigida, nudula,
Nec, ut soles, dabis jocos.
Qui sont bien l'adieu désolé que peuvent faire à leur âme ceux qui ignorent tout, et à qui, ni les dieux ni les hommes n'ont rien appris parce qu'ils n'avaient rien à leur apprendre. Et si aucune révélation n'a jamais trahi les secrets d'Eleusis, c'est assurément parce que ces secrets n'existaient point, n'étaient au fond qu'un aveu d'ignorance totale et qu'il n'est pas possible de trahir le néant.
Nous devrions, autour des morts qui nous furent chers, répéter ce que la foule romaine disait aux funérailles de Marc-Aurèle : « Ne le pleurez pas, adorez-le ! » En effet, tout mort qu'on a profondément aimé est devenu un dieu.
J'essaye de m'ennuyer afin que les dernières heures de ma vieillesse me soient plus longues ; mais elles passent plus vite que celles de ma jeunesse et de mon âge mûr. Il est bien difficile de cultiver l'ennui quand on s'y prend trop tard.
Nous avons tous, en nous, le même nombre de morts. Ce qui nous différencie, ce n'est pas le nombre, mais la qualité de ces morts.
N'oublions jamais que Celui qui nous jugera est celui qui nous a faits.
Usque adeone mori miserum est ? (Virgile, Enéide, XII, 466.)
« Est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre ? (Racine, Phèdre.)
Si Dieu existe tel que nous sommes capables de le concevoir ; il ne pourrait être qu'une sorte de surhomme bien inquiétant. J'aime mieux une force aveugle, mécanique ou mathématique. C'est plus rassurant.
Cette conscience dont nous sommes si fiers, qui est notre tout, sans laquelle l'immortalité serait pour nous l'égale de la mort, qu'est-elle au fond ? Peut-être une sorte de membrane opaque, un néoplasme, un parasite, de notre cerveau qui nous isole à jamais du reste de l'univers ; le plus néfaste de nos dons qui nous masque la réalité de tout ce qui existe ?
Tout ce que l'humanité cherche, tout ce qu'elle trouvera, existe déjà autour de nous. Il s'agit de le voir. De même que tout ce que diront les génies futurs est déjà dit en nous.
Tout ce que nous sommes est le fruit de ce que nous avons pensé ; n'est fait que de nos pensées.
Ce que nous appelons Justice, n'est que l'organisation de notre égoïsme qui serait plus nuisible s'il n'était pas canalisé.
Dieu. Il est la fleur de notre âme, le sommet de notre Moi, plus Moi que tout le reste de notre Nous. Il est notre création incessante. Il change de siècle en siècle, d'âge en âge, de jour en jour. Celui dont le Dieu de la vieillesse serait semblable au Dieu de l'enfance ou de l'adolescence, n'aurait pas été un homme mais un mort. Il vit, grandit, se développe, se perfectionne, s'élève, se nourrit de notre force, de notre intelligence et de nos vertus. Ton Dieu c'est toi, ce que tu fus, ce que tu es et surtout ce que tu espères devenir. Il y a autour de toi, comme autour de Lui, tout l'espace, tout le temps, tout l'infini, tout l'inconnu que tu pourras t'annexer.
Tous les systèmes de gouvernement seraient bons si l'homme était meilleur ou plus intelligent. Mais il faut qu'il soit extrêmement intelligent pour être à peu près bon.
La clef de tous les malheurs des peuples, c'est leur stupidité. Toutes les explications politiques ou économiques ne sont que des ornements littéraires autour de cette stupidité foncière, à peu près incurable et qui ne s'est pas sensiblement amendée depuis les temps historiques.
Le Démos de la lumineuse Athènes, tel qu'il revit dans Aristophane et dans Démosthènes, celui de la Rome républicaine et impériale, celui du moyen âge et de la Renaissance, celui de l'Angleterre, tel que nous le montre Shakespeare, celui de la France sous la Fronde et la Révolution, était exactement aussi borné, aussi aveugle, aussi sourd, aussi bas, aussi hébété que le Démos d'aujourd'hui que l'on croit éclairé par la presse, le phonographe, le cinéma et la T. S. F.
On se demande s'il ne s'agit pas d'une loi organique, fondamentale et intransgressible ; et si une nation sélectionnée, qui ne serait formée que d'individus extrêmement intelligents et cultivés, ne descendrait pas bientôt et fatalement, au bout d'une ou deux générations, au cloaque où se débat la foule dans le Jules-César et le Coriolan de Shakespeare.
Il est à craindre, il est possible qu'elle descende encore plus bas. Combien de générations faudra-t-il pour qu'une vie collective, à peu près coprophage et semblable à celle des termites, nous paraisse la seule normale, plausible, humaine, heureuse et désirable ? Beaucoup moins, nous en avons déjà l'exemple sous les yeux, qu'on ne serait tenté de le croire. Peut-être deux ou trois, après quoi notre existence individuelle, s'il en restait quelque trace, nous semblerait un absurde et presque inimaginable cauchemar. Les vivants, comme les morts, vont vite dans la pourriture.
Je ne prophétise pas cette fin, mais elle est naturelle et possible, en attendant une réaction qui sera tardive, difficile et sanglante.
La stupidité de Démos semble, en ce moment, très nettement infra-humaine et doit avoir des causes étrangères, et peut-être extérieures à la terre, que nous ne soupçonnons pas encore.
Fatalement, automatiquement Démos rabaisse à son étiage tous ceux qui croient l'éclairer, le guider, le servir.
Les idées absurdes ou nuisibles, même quand elles ne sont pas exprimées, se répandent bien plus facilement que les idées saines proclamées du haut de la tribune ou de la chaire ; de même que la maladie la plus secrète est incomparablement plus contagieuse que la santé la plus manifeste.
L'humanité ne semble pas menée par la raison, ni même par le sentiment, mais par des forces étrangères et inconnues. Peut-être subit-elle l'influence de certains climats cosmiques, de certaines zones éthériques qu'elle traverse au cours de son voyage dans l'espace et le temps. Elle n'a en propre que sa stupidité collective qui l'empêche toujours de suivre les avertissements de ceux qui, instinctivement ou intelligemment, entrevoient où ces forces la mènent.
Faites des lois comme si tous les hommes étaient bons : triomphe des méchants, écrasement des bons.
Faites des lois comme si tous les hommes étaient mauvais : ceux-ci passent au travers ou les tournent. Seuls les bons y obéissent et en souffrent.
Les démocraties qui finissent toujours en démagogies, pourraient peindre sur leurs bannières, l'image de Catoblépas. Mais Catoblépas a une bouche pour se manger les pattes et une bouche implique je ne sais quoi qui ressemble à une tête. C'est pourquoi, je leur conseillerais d'adopter l'Amphioxus, l'ancêtre de tous les vertébrés, animal sans cerveau, dont la tête, si tête il y a, est exactement pareille au derrière ou à la queue ; en telle sorte qu'on ne sait par quel bout le prendre pour lui faire entendre raison.
Nous sommes sûrs de trouver la lumière froide du ver luisant ou de la luciole, puisque cette lumière existe et que lentement nous parvenons à imiter tout ce que la nature a inventé avant nous.
L'humanité finira peut-être quand l'homme aura reproduit et épuisé toutes les inventions de la nature ; c'est-à-dire quand il aura tout tenté, tout entrepris, tout compris. Mais il est plus probable que bien avant, elle se sera tuée de ses propres mains.
L'indéfinissable infini d'Anaximandre de Milet, le grand philosophe pré-socratique, cet infini dont toutes les parties étaient susceptibles de changements, mais dont le tout était immuable, n'est-ce pas exactement le nôtre ?
Dans les métamorphoses des plantes et des animaux, par exemple dans celles du crapaud, de la larve au têtard et à l'adulte, si bien décrites par Jean Rostand, on croit suivre le travail de toute une équipe de petits employés médiocrement intelligents, fureteurs, bricoleurs, tatillons, méticuleux mais parfois distraits, maladroits, hésitants, économes et somme toute assez malheureux dans leurs expériences. C'est l'équipe de la nature qui préside à nos destinées.
Lorsque l'inconnu nous l'appelons Dieu, nous admettons à l'instant tout l'inexplicable, tous les mystères et toutes les absurdités. Mais si nous l'appelons Nature, tout devient inacceptable à ceux qui nous blâment de ne pas l'appeler Dieu.
Il ne faut jamais cesser d'agir et de penser, comme si l'inconnaissable pouvait être connu, bien que nous sachions qu'il est infini et hors de notre atteinte.
Les balances, les pesons à leviers, la romaine, le crochet à viande, le pont à bascule, le pèse-lettres, ne font que subdiviser, canaliser, enregistrer, la volonté ou l'énergie qui vient du centre de la terre, en tenant compte de l'appel de tous les astres qui modifient cette énergie ; en sorte que lorsque nous pesons un kilogramme de sucre, nous invoquons le conseil ou la collaboration de toute la matière éparse dans l'univers.
Savons-nous si le poids d'un lingot de plomb a augmenté ou diminué depuis les athlètes grecs ? Notre force musculaire a-t-elle suivi les variations du poids ou de l'attraction terrestre ? Serait-il possible de le constater ? Et les vingt-cinq siècles qui nous séparent de la Grèce de Périclès sont-ils suffisants ? Qu'est-ce que vingt-cinq siècles dans l'histoire d'une planète qui a des millions ou des milliards d'années ?
Les relativistes disent que le temps absolu n'existe pas parce qu'il n'est pas le même pour un observateur immobile que pour un observateur en mouvement. Mais l'espace non plus n'est pas le même pour deux observateurs du même genre. Donc, il n'y aurait pas d'espace ni de temps absolus. Si bien que deux infirmes, placés dans une situation extrêmement précaire, changeraient la nature des seules réalités de l'Univers ?
Qu'importe n'importe quoi, le jour où l'on peut se dire : « Mon moi ce n'est pas moi. »
Avec un peu de pratique et de persévérance, on y arrive plus facilement qu'on n'espérait, car notre moi tient à si peu de choses qu'il devient possible de constater qu'on n'est plus soi, et qu'on s'en détache très curieusement et très réellement. On commence vraiment à ne plus exister.
Coriolan c'est l'Hamlet méridional, l'Hamlet monté de deux ou trois crans, ne marchant plus à pas feutrés dans le silence dangereux, dans l'obscurité suspecte et la sourde bienséance d'Elseneur, mais gesticulant au soleil, sous l'aveuglante lumière du Forum ; exubérant, sanguin, méprisant, vociférant, toujours indigné, toujours en colère, déchaîné contre la stupidité et les mauvaises odeurs de la foule et les basses intrigues de ses meneurs. Au fond le même homme, la même âme, le même caractère, dans un milieu, dans des circonstances, sous des cieux et des vêtements dissemblables. Coriolan éclate déjà dans Hamlet, par exemple dans les scènes avec Polonius, avec Ophélie, avec les comédiens, comme toute la tristesse d'Hamlet transparaît dans le Coriolan des dernières scènes avec Volumnie et la silencieuse Virgilie.
Mais Coriolan c'est aussi Macbeth, comme Macbeth est Hamlet qui ose parce qu'il est dédoublé et que sa volonté s'est extériorisée dans sa femme. Au fond, Macbeth est un velléitaire, un sentimental bardé de fer, qui n'a osé qu'après de longues méditations et trop tard, ce que Coriolan a risqué tout de suite et trop tôt.