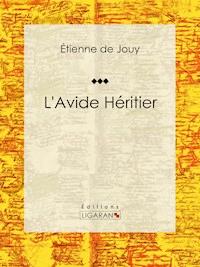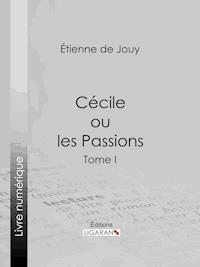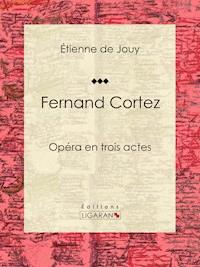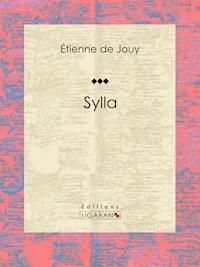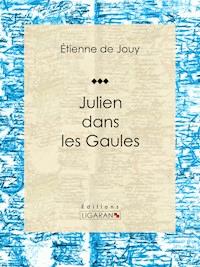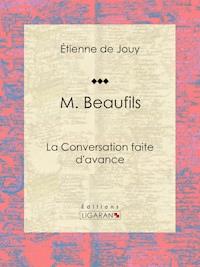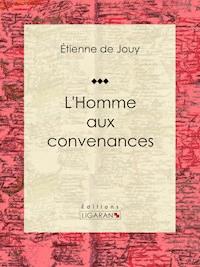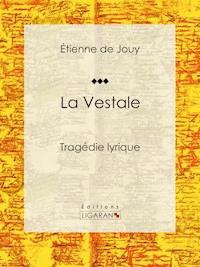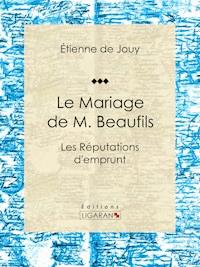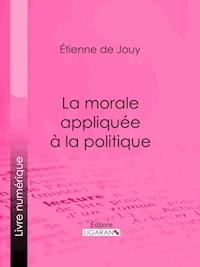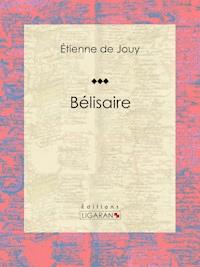
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "MARCIEN : Quels changements, Léon, quelle étrange disgrâce, Nous rassemble aujourd'hui dans les champs de la Thrace ! LÉON : Depuis près de dix ans qu'un sévère destin, M'éloigna sans retour des murs de Constantin, Des factions du cirque instrument et victime, J'abjurai sans regret mon pays qu'on opprime; Des Romains avilis, d'une cour que je hais, Un éternel exil me sépare à jamais. Mais, Marcien, mais vous, illustrés dans la guerre..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335087512
©Ligaran 2015
À M. ARNAULD,
ANCIEN MEMBRE DE L’INSTITUT,
AUTEUR DE GERMANICUS.
MON AMI,
C’était un besoin pour mon cœur de vous dédier cette Tragédie ; j’ai pourtant balancé, avant de vous rendre ce témoignage public de mon amitié ; je vous dois compte du motif de cette hésitation.
Après trois ans d’un malheur dont il n’est pas un Français qui ne doive déplorer les causes, et accuser la persévérance, un grand nombre de nos compatriotes (parmi lesquels vous tenez un des rangs les plus honorables) gémissent encore sur la terre d’exil : nos regrets qui les y ont accompagnés, nos vœux qui les rappellent, se sont fait souvent entendre aux pieds du trône, sans pouvoir arriver jusqu’au Monarque. Les mêmes hommes dont les cris de haine ont intercepté nos plaintes ne se sont pas contentés d’en calomnier l’expression ; ils ont soulevé l’autorité contre la prière ; ils l’ont aigrie contre l’infortune.
Votre nom, prononcé plus souvent que tout autre dans nos remontrances, s’est vu, par cela même, plus directement en butte à leurs atteintes, et pour frapper à la fois et celui qu’ils poursuivent et ses amis, dont le zèle est un crime à leurs yeux, ils n’ont pas craint d’avancer que nos supplications importunes armaient contre vous un pouvoir qui ne doit, disent-ils, céder qu’à la seule impulsion de sa propre clémence.
Cette considération qui recevait quelque poids de l’inutilité de nos efforts a pour un moment enchaîné ma plume ; j’ai pu craindre, en plaçant à la tête de mon Ouvrage un nom cher à la patrie, aux lettres et à l’amitié, de fournir de nouveaux prétextes à la malveillance, de nouvelles armes à la persécution ; mais je n’ai pas tardé à m’apercevoir qu’une pareille défiance, injurieuse à l’autorité, m’associait en quelque sorte auxperfides intentions de nos ennemis communs. Plus je respecte le Gouvernement sous lequel nous vivons, plus je me fais gloire de l’attachement que je porte à un homme qui honore son pays par de grands talents, de grandes vertus et de grandes infortunes.
Dans le partage des maux qui ont accablé notre commune patrie, quelques Français ont été, si j’ose m’exprimer ainsi, privilégiés par le malheur : quand tout le monde souffrait, leur plainte éloignée a pu se perdre dans le murmure d’un mal-être général ; mais aujourd’hui que tout renaît parmi nous à la vie et à l’espérance ; que la France libre du joug de l’Étranger ne compte plus que ses enfants ; le premier soin de son auguste Chef sera, n’en doutez pas, de rassembler sa famille et de lui prescrire, par son exemple, ce devoir d’union et d’oubli que chacun a droit d’exiger et que tous, sans exception, ont le même intérêt à remplir.
Germanicus et Bélisaire ont eu à peu près le même sort ; tous deux ont été bannis du Théâtre ; le premier après y avoir paru avec gloire, le second après y avoir été annoncé avec éclat ; tous deux en ont appelé au public, d’un arrêt de proscription rendu par l’esprit de parti, le moins équitable des juges.
L’opinion qui finit toujours par casser les arrêts injustes a réhabilité votre Ouvrage, en lui assignant unrang distingué parmi les productions dramatiques qui soutiennent l’honneur du Théâtre Français. Je me présente aujourd’hui devant elle avec moins de confiance dans mon propre droit, mais aussi fort de mes intentions, aussi digne, j’ose le dire, des ennemis que vous avez eu à combattre, et protégé par l’intérêt qui s’attache à votre nom.
JOUY.
SUR LA CENSURE
DES OUVRAGES DRAMATIQUES.
Il y a quelque temps (je ne me rappelle pas exactement l’époque) qu’un jeune Prussien d’origine, d’esprit et de cœur français, nommé Charles Lombard, me fut adressé par un de mes amis de Bruxelles. Ce jeune homme, adorateur passionné des lettres, et principalement de l’art dramatique, qu’il cultive avec beaucoup de succès, venait à Paris pour y faire représenter une comédie, dont il fit chez moi la lecture. La nouveauté du plan, l’originalité de la conception, la force de l’intrigue, la vérité des caractères et des mœurs, l’élégance et la vigueur du style, lui méritèrent les suffrages unanimes du petit comité d’amateurs qui s’était réuni pour l’entendre. Après la lecture il nous apprit « qu’il avait débuté dans cette carrière par quelques ouvrages allemands, mais qu’il avait été forcé de renoncer à travailler pour un théâtre où la censure s’exerçait avec une rigueur qui s’opposait aux progrès de l’art. Il venait, continua-t-il, jouir à Paris des bienfaits d’une liberté garantie par la faveur éclairée du prince, avant qu’elle l’eût été par les institutions politiques, et à laquelle la France était redevable de tant de chefs-d’œuvre immortels. »
Nous ne jugeâmes pas à propos de refroidir ses espérances ; il devait lire sa pièce le lendemain à la Comédie Française, et n’était occupé que de l’accueil qu’il recevrait au parlement comique. Les vers de Voltaire lui revenaient à la mémoire : peut-être, me disait-il en me quittant, vous dirai-je bientôt comme le Pauvre Diable :
Le lendemain je le vis arriver la tête haute et la figure rayonnante : « Félicitez-moi, me dit-il, les successeurs des Duménil, des Grandval, des Sarrasin, n’ont hérité que des talents de leurs devanciers ; ils m’ont traité avec une politesse pleine de bienveillance : ma pièce est reçue à l’unanimité, et l’on m’accorde un tour de faveur : je ne vous parle pas de quelques tracasseries pour la distribution des rôles ; j’aurai à lutter ici comme ailleurs avec des amours-propres, des prétentions et des habitudes invétérées : mais je suis jeune, et je sais comment on traite avec les passions et les intérêts de coulisse. Dans huit jours ma comédie sera mise en répétition. – Et la censure ? – Je n’ai rien à démêler avec elle ; j’ai usé du privilège accordé depuis longtemps à la comédie, de peindre les mœurs, les travers, les ridicules de la société ; mais je n’ai pas dit un mot de politique. – Vous avez parlé de gloire, de patrie, de liberté ; vous avez prononcé les noms de roi, de ministre, de grands seigneurs ; vous avez laissé entendre qu’un courtisan pouvait être un fat, qu’un juge pouvait être un fourbe, qu’un conseiller d’état pouvait être un sot, et vous croyez n’avoir rien à démêler avec la censure ?
– Molière a fait jouer le Tartufe sous le règne d’un monarque absolu et dévot. Racine a fait représenter Britannicus devant ce même prince dont il frondait indirectement les goûts et les travers : si le théâtre, au temps du despotisme, a conservé chez vous ses franchises, de quelle liberté ne doit-il pas jouir sous la garantie des lois constitutionnelles qui régissent maintenant la France ? – Revenez me voir quand votre manuscrit censure vous aura été rendu ; peut-être alors me dispenserez-vous de répondre à cette question.
Vous aviez raison, me dit M. Lombard, que je rencontrai quelques jours après au foyer de l’Opéra : messieurs les censeurs ne sont pas aussi traitables que je le croyais ; ils me demandent des changements sans vouloir m’expliquer et sans que je puisse m’expliquer à moi-même sur quoi portent les objections qu’on me fait : par exemple, il est question dans ma pièce de la sœur d’un ministre dont on sollicite l’intervention pour faire parvenir un mot de vérité à l’oreille de son excellence. Eh bien ! on veut que je fasse de cette sœur, une mère ou une tante ; et ce n’est que par arrangement qu’on me permet d’en faire une cousine. Les deux principaux personnages de ma comédie sont, comme vous le savez, un noble pair d’Angleterre, beaucoup moins considéré par son rang et son immense fortune que par ses grandes qualités ; et son neveu, de mœurs passablement scandaleuses, à qui son oncle témoigne en toute occasion le regret qu’il a de laisser son nom, son titre et ses richesses, à un héritier si peu digne de lui. Croiriez-vous qu’on me force encore d’établir entre ces deux personnages d’autres rapports de parenté ? Je ne conçois rien à de pareilles chicanes ; néanmoins, comme ces changements ne touchent pas au fond de mon ouvrage, je les ferai dans le cours des répétitions. – On ne vous a pas encore rendu votre manuscrit ? – Il est depuis plusieurs jours à la signature du ministre, et je l’attends aujourd’hui même. »
M. Lombard était encore chez moi lorsqu’on le lui apporta ; il le parcourut avec anxiété. Quel spectacle de destruction, de mutilation ! Combien d’accolades accompagnées de ce funeste signe D ! On lui enjoint de faire disparaître une scène tout entière, où il peint le bonheur d’une famille qui revoit, après trois ans, son chef exilé ;
Une autre, où il retrace les suites funestes de l’ambition, qui finit par éteindre dans un cœur honnête tout sentiment généreux ;
Une autre, où il oppose à un vertueux magistrat un homme, sous le mortier duquel se sont réfugiés toutes les préventions de l’esprit de parti, tous les calculs de la vanité, tous les ridicules du bel esprit de province.
On exige qu’il supprime le rôle entier d’un vieux général qui n’a jamais à la bouche que les mots honneur et patrie, et à qui le souvenir des pontons, où il a passé deux ans de sa vie, n’inspire pas pour les Anglais une amitié assez vive.
M. Lombard commençait à croire que la censure en France n’était pas beaucoup plus libérale qu’en Allemagne ; mais sa colère ne s’étendait pas jusqu’à l’autorité supérieure ; et, convaincu qu’il était victime de quelque intrigue de bureau, il résolut de porter sa réclamation à Monseigneur en personne.
Notre jeune auteur ignorait que le Grand-Lama n’est pas plus invisible qu’un ministre de la police : il ne put arriver que jusqu’à l’antichambre d’un sous-secrétaire, auquel il représenta très humblement « que sa pièce n’offrait aucune espèce d’allusion, qu’on n’y trouvait que les vices de tous les temps, les travers de tous les pays ; qu’il avait passé trois ans de sa vie à composer cet ouvrage, d’où peut-être dépendait sa fortune et sa réputation ; » ce à quoi l’expéditionnaire, qui avait plus de mémoire que de politesse, répondit, sans lever les yeux de dessus son papier, que le temps ne faisait rien à l’affaire, et que pour les gens de lettres la pauvreté était l’aiguillon du génie. M. Lombard est colère de sa nature ; il riposta d’une manière un peu tudesque, et la querelle allait s’engager très sérieusement, lorsque le commis s’aperçut que le poète portait à sa boutonnière un ordre étranger : sa qualité de Prussien méritait quelques égards ; il fut convenu qu’on lui restituerait le rôle du vieux général, à condition qu’il ne parlerait pas de ses campagnes en Amérique.
Toute mutilée qu’elle était, la comédie de M. Lombard, bien écrite et fortement conçue, avait encore quelques chances de succès ; on en reprenait pour la troisième fois les répétitions, lorsqu’on le prévint qu’il fallait, pour la forme seulement, en donner connaissance au ministre des relations extérieures, attendu que la poésie et la littérature étaient maintenant en France du domaine des affaires étrangères.
Le conseil des ministres, convoqué pour délibérer sur une comédie, arrêta, dans sa sagesse, que l’auteur serait tenu de changer le lieu de la scène ; et, après avoir passé en revue tous les états de l’Europe, on convint unanimement qu’une pièce dont le sujet, l’intrigue, les mœurs et les caractères avaient été pris dans la société anglaise du dix-neuvième siècle, ne pouvait être jouée sans inconvénient à Paris que sous le costume turc et dans l’intérieur d’un sérail.
Je n’ai jamais vu de désespoir pareil à celui de ce pauvre jeune homme ; je retirai du feu son manuscrit qu’il y avait jeté ; je parvins à lui prouver qu’à l’exemple de Beaumarchais on pouvait réussir à peindre les mœurs d’un pays sous un costume étranger, et qu’après tout l’impression lui ferait justice des tribulations qu’on lui faisait souffrir. Cette idée le consola ; il se remit à l’œuvre, travailla trois semaines à habiller ses Anglais à la turque, et le jour de la représentation fut enfin annoncé.
Messieurs les chambellans (je ne sais pas bien quelle était alors la couleur de leur livrée) avaient aussi leur droit de censure : ils l’exercèrent, en faisant disparaître, par égard pour le pape, quelques passages où il était question du mufti