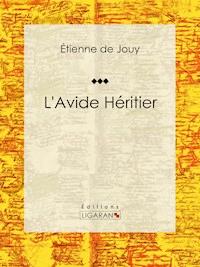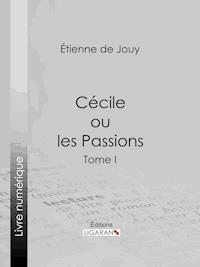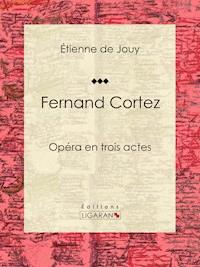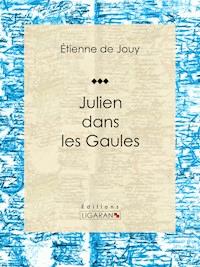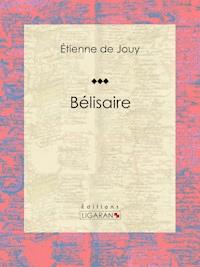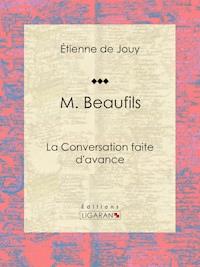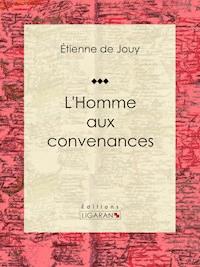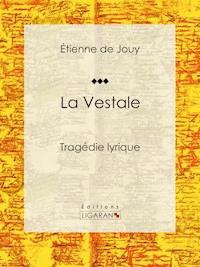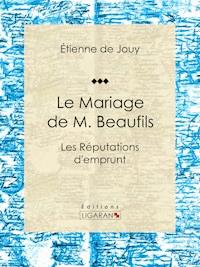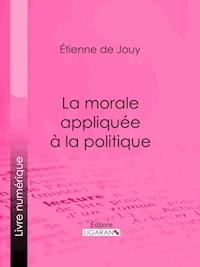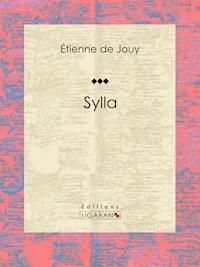
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "ROSCIUS : Un ordre inattendu que je n'ose comprendre, Cette nuit, au palais, m'avertit de me rendre : Je ne m'en défends pas ; un invincible effroi, À cette heure, en ces lieux, s'est emparé de moi. MÉTELLUS : La crainte, Roscius, ne peut être permise, À celui que Sylla protège et favorise. Pour toi le dictateur adoucit sa fierté, Que l'insolent vulgaire appelle cruauté ; Il se plaît à t'entendre ; il souffre que ta bouche..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335087529
©Ligaran 2015
ÉPÎTRE DÉDICATOIRE
À M. LACRETELLE AÎNÉ.
MON RESPECTABLE AMI,
Si je connaissais un meilleur citoyen que vous, un homme qui honorât par plus de vertus, par un plus noble caractère, par l’emploi d’un talent plus estimable, le siècle philosophique dont vous avez vu la dernière moitié, c’est à cet homme que je dédierais mon ouvrage.
Élevé à l’école des Diderot, des d’Alembert, des Turgot, des Malesherbes, de tous ces philosophes d’une immortelle renommée, votre jeunesse s’est formée sous leurs yeux à la pratique des hautes vertus, à la méditation des grandes pensées qui ont consacré ces noms illustres dans la mémoire des hommes.
On n’oubliera pas que dans la carrière du barreau, où vous avez laissé de si honorables souvenirs, vous avez offert un des premiers modèles de cette éloquencejudiciaire qui rattache aux grands intérêts de la société la cause du dernier citoyen.
Ami d’une sage et patriotique liberté, vous n’avez point abandonné sa défense au milieu des discordes civiles, et vous avez traversé la plus terrible révolution sans avoir transigé sur aucun principe, et sans avoir reculé devant aucun péril.
Parmi les écrivains français qui ont survécu à cette lutte mémorable, et qui ont pris la parole dans cette grande question politique, vous êtes du très petit nombre de ceux dont on peut dire : « Ils n’ont pas eu un reproche à se faire ; ils n’ont pas soutenu une opinion qu’ils ne défendent encore. »
Depuis longtemps, mon respectable ami, j’éprouvais le besoin de vous offrir un témoignage public des sentiments que vous m’avez inspirés, et qui doivent vous rendre cher à tout ce qui porte un cœur français.
JOUY.
Paris, 27 décembre 1821.
Les réputations se forment au hasard ; les contemporains les reçoivent toutes faites, et les transmettent pour l’ordinaire sans discussion et sans examen. Les années, les siècles s’écoulent ; et l’écho des passions du moment, en se répétant d’âge en âge, forme ce bruit équivoque et monotone que l’on appelle l’histoire.
Cyrus, Alexandre, Sylla, César, Mahomet, Gengiskan, ces noms frappent l’oreille et la pensée d’une idée de grandeur vague et mal comprise. Mille écrivains nous ont entretenus de leurs vertus, de leurs crimes, de leur gloire ; leur caractère personnel n’en reste pas moins un problème.
Les mêmes nuages qui enveloppent la destinée des hommes couvre celle des nations. Que fut l’Égypte ? un vaste monastère où quelques centaines de moines hypocrites, dont les rois n’étaient que les premiers sujets, gouvernaient un peuple crédule et stupide. Les historiens qui en ont porté ce jugement ont-ils raison contre ceux qui nous représentent le royaume des Pharaons comme une admirable théocratie fondée sur les principes de la plus haute sagesse ?
Que penser de Rome ? Cette république, souveraine du monde, eut une caverne pour berceau ; mais elle produisit des héros, comme les autres états produisirent des hommes, et la grandeur en toute chose paraît avoir été son élément. Rappelons ses crimes, on nous oppose ses vertus inouïes ; abandonnons-nous à l’enthousiasme que ses vertus inspirent, et l’on ne manquera pas de nous prouver que ses crimes, comme nation, ont surpassé ceux que la justice des tribunaux, chez tous les peuples de la terre, poursuit et punit du dernier supplice.
En élevant de pareils doutes, mon intention n’est pas de les résoudre, mais de montrer qu’ils sont également applicables et à Rome et à l’homme le plus extraordinaire qu’elle ait vu naître, au terrible et mystérieux Sylla.
Ou pourrait croire qu’il entrait dans les destinées de la république romaine de se personnifier elle-même sous la figure de ce dictateur. Il fut grand comme elle ; elle fut atroce comme lui : il voulut comme elle être libre, et, comme elle, se faire une immortelle renommée : elle parvint à ce double but par l’asservissement et la ruine des autres nations ; il l’atteignit par la proscription et les meurtres de ses concitoyens, et par son héroïque abdication.
Les premières années de Sylla s’étaient passées au milieu des discordes publiques. La dépravation du peuple, l’impunité des crimes des tribuns, la vénalité passée en usage dans les classes élevées, l’intolérable orgueil d’une aristocratie corrompue dans sa source, enfin le brigandage des proconsuls, annonçaient que, fatigués des vertus, enivrés de gloire, affamés de richesses et de pouvoir, également incapables de supporter le travail et le repos, les citoyens de Rome n’étaient, plus que les descendants dégénérés des Brutus et des Paul Émile. Dans cet état de dépravation ils n’attendaient qu’un chef pour se lancer dans la carrière sanglante que la mort des Gracques avait ouverte devant eux.
Marius se présenta. Un courage farouche avait révélé l’existence de ce soldat obscur ; la nature l’avait fait insatiable et jaloux. « Les honneurs, dit Plutarque, tombaient dans son âme comme dans un gouffre sans fond. » C’était un brigand ivre, que le sang et les triomphes ne pouvaient désaltérer, et qu’irritait toute gloire étrangère. Marius, vainqueur des ennemis de l’état, voulut se rendre maître de la république, et pour y parvenir il flatta l’hydre du peuple, brisa tous ses liens, souleva toutes ses passions, et devint le chef d’une anarchie sanglante, à laquelle le descendant des Scipions, l’orgueilleux Sylla, avait dès-lors résolu de mettre un terme.
Jaloux du pouvoir de Marius, Sylla voulut d’abord se créer dans les camps une gloire rivale, et faire oublier les exploits du vainqueur des Cimbres. Tandis que le soldat d’Arpinum souillait ses trophées au milieu des sanglantes orgies où s’écoulaient ses derniers jours, Sylla détruisait des armées entières, s’attachait par toutes les ruses d’une politique habile les légions qu’il commandait, prenait d’assaut toutes les villes ennemies sous les murs desquelles il se montrait, et déjà se proclamait lui-même le favori de la fortune et l’homme du destin.
À soixante-dix ans Marius reprend les armes, et veut marcher contre le plus redoutable ennemi des Romains ; il s’abaisse à briguer le commandement des troupes envoyées contre Mithridate ; Rome se partage en deux grandes factions ; le sénat se prononce en faveur de Sylla, et le nomme au commandement de l’armée d’Asie.
Cet acte du sénat a donné le signal de la guerre civile : Marius déchaîne ses sicaires, à la tête desquels s’élance le tribun Sulpicius ; le Forum est inondé de sang. Sylla, dont l’élection est faite, dont la cause cette fois est juste, rejoint son armée dans la Campanie, la ramène dans Rome ; et, content d’avoir frappé de terreur ses adversaires, d’avoir vu fuir Marius, il vole à de plus glorieux triomphes contre les ennemis de sa patrie : Marius y rentre à la faveur des dissensions survenues entre les deux consuls, et les plus horribles vengeances signalent son retour dans la cité de Romulus.
Ce n’est qu’après avoir surpassé la gloire de son rival, après avoir vaincu à Orchomène, à Chéronée, après avoir triomphé de Mithridate et subjugué la Grèce, que Sylla reparaît sous les murs du Capitole à la tête de ses légions victorieuses.
Marius n’existait plus ; son fils ne craignit pas de s’opposer aux progrès du vainqueur de l’Asie : il fut défait et forcé de s’enfermer dans Préneste, où il se donna la mort.
Sylla mit le siège devant cette ville, s’en rendit maître, en extermina tous les habitants, et rentra triomphant à Rome, où il se proclama lui-même dictateur perpétuel.
Marius avait ouvert le champ des proscriptions, et s’y était lancé comme un monstre furieux qui égorgeait pour assouvir sa rage : Sylla parcourut plus froidement cette affreuse carrière ; il s’y montra plus vindicatif que cruel, plus politique que féroce. Indifférent aux maux de ses ennemis, une ironie amère semblait guider son poignard ; on eût dit, au choix des victimes, qu’il punissait les Romains de leur lâcheté. Cinq cents patriciens sont immolés ; les deux premiers noms inscrits sur cette liste sont ceux des consuls.
Il poussa au-delà des bornes de toute vraisemblance son triomphe sur la bassesse de ses concitoyens, et crut ne pouvoir réveiller en eux le sentiment de l’existence que par la douleur et les supplices. Les proscriptions dévastèrent Rome, Spolette, Sulmone, Boviane, Érnésie, Télésie, Florence, Préneste ; et cependant, parmi tant d’hommes immolés à la voix de l’inexorable dictateur, les deux historiens de cette terrible époque, Plutarque et Appien, ne citent pas un seul nom véritablement célèbre.
Sylla, dominateur des nations subjuguées par ses armes, maître de Rome, où il avait fondé son pouvoir sur la ruine des factions qu’il avait étouffées dans leur sang ; sans autre appui contre tant de haines et de vengeances amoncelées sur sa tête, que l’autorité dictatoriale dont il s’est revêtu lui-même, Sylla prend tout à coup la résolution la plus sublime, la plus audacieuse que le génie de la puissance ait jamais conçue ; il convoque le peuple au Forum, et abdique insolemment le pouvoir souverain.
« Me voici semblable au dernier d’entre vous, dit-il, et prêt à rendre compte de tout le sang que j’ai versé. »
Tels sont les grands traits de la vie de Sylla ; je les ai recueillis dans Plutarque, Appien, Florus, Valère-Maxime, Velleius-Paterculus, etc. Quant à son terrible caractère, aucun de ses historiens n’a su le pénétrer, et Montesquieu est le seul qui ait éclairé cet abyme d’un rayon de son génie.
Sous la plume de l’auteur immortel du dialogue d’Eucrate, Sylla devient le réformateur de Rome ; il asservit les Romains pour leur faire haïr l’esclavage ; il veut les ramener à l’amour de la liberté par les horreurs de la tyrannie ; et quand il a suffisamment abusé du pouvoir dans l’intérêt de la république, qu’il ne sépare pas de ses vengeances personnelles, satisfait de la leçon sanglante qu’il a donnée à ses compatriotes il brise lui-même la palme du dictateur, qu’il a usurpée, et vient, avec un sourire effrayant, se confondre parmi les citoyens dont chacun peut lui demander compte d’un acte de sa cruelle dictature.
Ainsi toute cette vie est une combinaison ; toute cette tyrannie est un calcul ; toute cette audace est du sang froid et du raisonnement.
Plus j’ai médité sur l’étonnante contradiction du caractère de Sylla, plus je me suis convaincu que le génie de lumière qui avait su expliquer l’énigme de la grandeur des Romains avait également pénétré l’âme de cet homme extraordinaire.
Ce n’est point le Sylla si imparfaitement esquissé par Plutarque, c’est le Sylla si admirablement indiqué par Montesquieu que j’ai voulu reproduire sur la scène.
Après avoir suffisamment établi la vérité de l’ensemble, je m’arrêterai sur quelques traits particuliers du modèle, que m’ont fournis les auteurs anciens que j’ai consultés.
Sylla, dans l’exercice du pouvoir, était aussi sombre, aussi sévère, qu’il était facile et communicatif dans la vie privée.
Il ne cherchait pas le péril, il le méprisait ; il se croyait protégé par un génie qui veillait à sa fortune : il avait pris le surnom de Faustus (heureux), qu’il avait transmis à son fils.
Plein de mépris pour les prêtres, il était superstitieux, et consultait sans cesse les devins et les oracles. Rien ne lui plaisait davantage que l’aspect des troupes s’essayant aux manœuvres sous les murailles de Rome. Le luxe des camps était le seul qu’il favorisât, et l’on n’était jamais lus sûr d’en être accueilli qu’en se présentant devant lui à la tête d’un escadron hérissé d’or et d’acier.
Tour à tour superbe et familier, il effrayait d’un regard, ou séduisait par un sourire quand il s’abaissait à vouloir plaire.
Remarquable par une éloquence brusque, par un langage heurté, ses discours se bornaient presque toujours à quelques phrases.
Au commencement de la plus célèbre bataille qu’il ait gagnée, ses troupes fuyaient ; il se jette au-devant d’elles.
« Je meurs ici, dit-il ; vous, retourne ? à Rome ; et si l’on vous demande où vous avez abandonné votre général, vous répondrez : À Orchomène. »
Grassus lui demandait une escorte pour remplir une mission périlleuse qu’il lui donnait.
« Pour escorte, répond Sylla, je vous donne votre frère, vos parents et vos amis, égorgés par Marius, et qu’il faut venger aujourd’hui. »
Une plaisanterie sèche, une ironie sanglante, décelaient l’amertume de son âme ; il parlait avec un froid mépris de sa gloire et de sa puissance.
Jamais homme n’a exercé plus d’empire sur les esprits et même sur les cœurs : ses soldats l’adoraient. Ce lion-renard, comme le nommait Carbon, était, suivant l’occasion, féroce, généreux, adroit, souple, d’une force d’application sans exemple, ou d’une activité sans bornes.