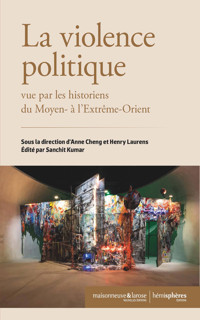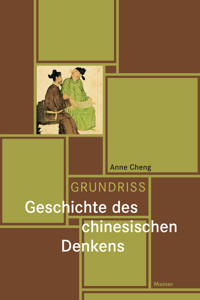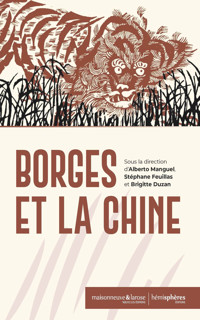
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hémisphères Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La Chine comme possibilité d’une imagination et d’un système de pensée « autres » est à la base de certains des textes les plus importants de Borges, notamment « Le jardin aux sentiers qui bifurquent », « La muraille et les livres », « Le langage analytique de John Wilkins », « Qu’est-ce que le bouddhisme ? », ainsi que de nombreux autres textes mineurs.
Ce volume, issu d’un colloque international tenu en juin 2023 au Collège de France, se propose de discuter des sources de la Chine de Borges et d’étudier les réflexions borgésiennes autour de certains thèmes constants dans son œuvre comme le confucianisme, le Tao, les légendes, les mythes et la littérature fantastique chinoises. Il rassemble les travaux de chercheurs originaires d’Europe, d’Asie, d’Argentine, des Etats-Unis et du Maroc, pour qui les œuvres de Borges représentent un horizon et un langage communs, voire universels.
À PROPOS DES AUTEURS
Anne Cheng Titulaire de la Chaire d'Histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France
Alberto Manguel Spécialiste de Borgès, écrivain traducteur critique littéraire Argentino Canadien
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN : 978-2-37701-257-2
© Hémisphères Éditions, 2025 3, quai de la Tournelle - 75005 Pariswww.hemisphereseditions.com
Réalisation des versions numériques : Libres d’écrire
Sommaire
Couverture
Copyright
Note liminaire
Borges invente la Chine
Borges et la Chine
« La muraille et les livres », Le Livre des êtres imaginaires Deux mythes complexes repensés par Borges
Introduction
« La muraille » et « les livres », un processus de recréation
La Chine revisitée par “les êtres imaginaires”
Conclusion
Le Corbeau et les Menards Réécriture, traduction, modernité Segalen, Cavafy, Borges
Pierre Ménard
Introduction
Plagiat
Faux
Interprétation
Relecture / récriture
Reconstruction
Conclusion
Ébauches d’une esthétique de l’incertain Sur quelques références « chinoises » de Jorge Luis Borges
Le Rêve de Zhuang Zhou ou le rêve du papillon
Le chiffre du Yi-king
Un texte de Han Yu
Quelques remarques conclusives
Borges and China: A Bond that the Universe Needs
Conclusion
La Chine de Borges : jardins, labyrinthes et encyclopédies
Le Jardin aux sentiers qui bifurquent
Les volumes de l’Encyclopédie perdue
Le Rêve dans le pavillon rouge (Honglou meng)
Les Villes invisibles
Déclin et chute finale
Imagining China: Buddhism, Reading, and Audience in Borges
The Forking Paths or Buddha in Buenos Aires
Chinese Stories for the Great Public
Fiction and Doctrine: Buddha in China
Some Conclusions
La Chine et Borges : de l’autre côté du miroir
Le précurseur : Ma Yuan
Ge Fei, le « Borges chinois »
Can Xue, interprète de Borges
Ge Mai, Xi Chuan : rêves de poètes
Chen Chunc heng : autres bifurcations , autres rêves
Chez le même éditeur
NOTE LIMINAIRE
ALBERTO MANGUEL, BRIGITTE DUZAN ET STÉPHANE FEUILLAS
N’espère rien des écrits qu’ont laissés
Les vieux maîtres implorés par ta crainte ;
Tu n’es que toi, centre d’un labyrinthe,
Et c’est celui que tes pas ont tracé1.
L’ouvrage qui est entre vos mains est le fruit d’une rencontre et d’un colloque qui s’est tenu au Collège de France le 21 juin 2023 à l’initiative de Mme le Professeur Anne Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine et d’Alberto Manguel, écrivain et titulaire de 2021 à 2022 de la chaire annuelle L’invention de l’Europe par les langues et les cultures. Au cours de discussions informelles rendez-vous fut pris pour une journée entière consacrée à la réverbération dans l’œuvre de Borges de ses lectures chinoises, multiples, foisonnantes, presque obsessionnelles. Il ne s’agissait pas de minimiser les autres écritures qu’a investies l’auteur argentin, dont on connaît le goût pour Les Mille et une nuits, pour les sagas islandaises, l’Inde de Kipling ou encore la littérature et la philosophie européennes du XVIIe siècle. L’objectif était plutôt d’explorer le rayon chinois de sa bibliothèque-monde et d’interroger, parfois avec perplexité, les mouvements, les prédations, les haltes dans la forêt des livres de « ce tigre de papier2. »
Les contributeurs venus de Chicago, du Texas, d’Amérique latine, de la presqu’île de Singapour et de Paris ont reconduit une géographie rêvée où les frontières ne sont plus que des passages à la ligne. Tous, et chacun à sa manière, tantôt savante et au plus près des manuscrits, tantôt suggestive, en creusant la référence, en pistant l’intertextuel, en explorant la vie intime de Borges ou en érigeant Pierre Menard en grand architecte du Livre, ont exploré des sentiers, des « bifurcations » avec le plaisir de se perdre. Qu’ils en soient ici remerciés !
Difficile dans ces conditions de construire un sommaire… Les différents articles reviennent parfois sur les mêmes références, déploient les mêmes sources en autant de variations sur les propres variations de Borges. Si une tonalité devait se dégager, ce serait celle d’une harmonique s’étirant dans le silence et l’invitation à relire Borges, ses « fictions », ses essais, ses poèmes.
Deux intrus apparaîtront, comme il se doit sans doute quand on arpente la sylve des livres. Le texte de Jean Levi est issu d’une communication délivrée au Centre Georges Pompidou dans le cadre du Cinquième Centenaire de la Rencontre des Deux Mondes. Cette manifestation d’ampleur réunissait conférenciers, artistes, cinéastes ou musiciens qui, dans un ensemble d’interventions d’octobre 1992 à février 1993, célébraient les « Amériques latines » et où l’écrivain argentin et le brésilien Jorge Amado étaient le thème de deux expositions. Comme on le lira, l’article de Jean Levi sur Borges et la Chine contient en germe les autres contributions.
Le dernier texte nous a paru aussi nécessaire qu’édifiant. Il forme un contrepoint parfait, musical lui aussi : non plus « Borges et la Chine », mais « la Chine et Borges » dans la littérature d’après la Révolution culturelle. Brigitte Duzan y témoigne, en traductrice attentive aux dernières parutions comme aux présences antérieures et encore embryonnaires, de la richesse et de l’exubérance des ré-appropriations par les auteurs contemporains chinois d’une œuvre qui jamais ne se clôt sur elle-même.
N. B. : La transcription des caractères chinois utilise le système le plus répandu aujourd’hui, dit pinyin. Lorsqu’une autre transcription est utilisée en particulier, dans les textes cités de Borges, la translittération est indiquée lors de la première occurrence. Elles concernent essentiellement l’Empereur Jaune, Hoang-ti ou Huangdi 黃帝, et le fondateur de la première Dynastie chinoise, Qin Chi Hoang-ti ou Qin Shi Huangdi 秦始皇帝 (r. 221-210 av. J.-C.).
1. « Tu n’es pas les autres », trad. Ibarra, dans Jorge Luis Borges, La rose profonde, La monnaie de fer, Histoire de la nuit, Paris, Gallimard, p. 120.
2. Nous détournons évidemment une expression de Mao Zedong qui désignait les opposants à la Chine communiste, au premier rang desquels l’impérialisme américain, tigres apparemment terrifiants, mais en réalité inoffensifs. Comme on le verra, ce tigre chinois et borgésien est loin d’être anodin, il est doté d’une puissance vaguement inquiétante : déstabiliser les certitudes, confondre le même et l’autre, défaire les rangements commodes du semblable et du dissemblable, dissoudre le moi et le monde dans le quelconque.
BORGES INVENTE LA CHINE
ALBERTO MANGUEL
L’œil d’un écrivain de fiction n’est pas celui d’un essayiste ou d’un historien. Même si nul d’entre eux ne peut jurer faire preuve d’une exactitude et d’une objectivité impossibles, l’écrivain de fiction a la possibilité de créer un monde factuel que l’historien est seulement autorisé à décrire et à analyser. Les conventions de la fiction et de la non-fiction sont déterminantes en ce sens : si un livre est étiqueté « Histoire » et un autre « Roman », le premier est censé reposer (ou du moins tente de reposer) sur une documentation factuelle, tandis que le second a la liberté de choisir et d’agencer les faits supposés de la narration. C’est véritablement une question de foi poétique.
Tenter d’examiner la relation qu’a entretenue Jorge Luis Borges avec le vaste univers que nous appelons la Chine illustre parfaitement ce dilemme. Borges a abordé la Chine (comme il a abordé tant d’autres sujets) en revendiquant le droit, en tant que lecteur, de choisir, d’écarter, de lire de travers, de mésinterpréter, selon les besoins de son imagination créatrice. Sur les étagères de Borges, livres apocryphes et auteurs inventés de toutes pièces côtoient auteurs et textes dont l’existence est avérée. Les uns ne l’emportent pas sur les autres dans la librairie de l’esprit.
L’endroit où tout a commencé, si l’on veut examiner la relation de Borges à l’univers chinois, c’est la terre natale où Borges est né dans la dernière année du dix-neuvième siècle : Buenos Aires. Chaque société, chaque classe sociale a sa propre vision du monde, essentiellement faite de préjugés culturels, de vieilles histoires de bonnes femmes et de vœux pieux. Le Buenos Aires de Borges avait sur le monde une perspective qui lui était propre.
Au début du vingtième siècle, l’Argentine était un pays en quête d’identité. Le monde qui la composait était vaste et barbare, avec des poches d’indigènes dont les criollos blancs ne connaissaient pratiquement rien sinon qu’ils étaient sauvages, dangereux et donc propres à être exterminés. Quant au monde extérieur, il se constituait tout au plus de quelques zones européennes : l’Espagne, la mère patrie dont l’Argentine était devenue indépendante ; l’Italie, d’où arrivaient des vagues de nouveaux immigrants ; l’Angleterre, miroir de l’élégance et des bonnes manières; et la France, berceau de la culture et, par conséquent, Mecque des aristocrates, des artistes et des intellectuels argentins. Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l’Argentine connut une richesse obscène, et ses familles bourgeoises se rendaient en Europe à bord de luxueux paquebots afin d’en rapporter ce qui était du dernier cri en matière d’art et de mode. Mais le reste du monde demeurait terra incognita, avec tout l’attrait et la toute la crainte que suscite l’exotisme : l’étoffe dont sont faits nos songes.
Borges fit un voyage en Europe avec sa famille en 1914 : il avait 15 ans et son père avait besoin de consulter un ophtalmologue en Suisse. Quand la Première Guerre Mondiale éclata, la famille se trouvait à Genève où Borges fut forcé d’aller au lycée pour achever ses études secondaires, apprenant le français et l’allemand. Par la suite, Borges n’eut de cesse, tout au long de sa vie, d’exprimer sa gratitude envers la seule ville où, dit-il, il avait vraiment été heureux. Vers la fin du mois de mars 1921, la famille rentra chez elle. Borges avait alors vingt-deux ans. Or, pour Borges, même le concept du « chez soi » était étroitement lié aux livres. De retour à Buenos Aires, Borges entreprit de découvrir de manière imaginative la ville aux immeubles bas et aux toits en terrasse qui s’étendait à l’ouest en direction, écrivit-il, de « ce que les cartographes et les intellectuels appellent La Pampa » (Borges 1970). Cette année d’absence avait permis à Borges de prendre un certain recul vis-à-vis de sa ville natale, mais pas forcément avec objectivité. Pour cette Argentine qu’il redécouvrait, Borges commença à élaborer, de façon tout à fait délibérée, une mythologie de truands, de seuils de porte mal éclairés et d’accords de guitare, avec une « Fondation mythique de Buenos Aires » (ainsi qu’il intitula l’un de ses poèmes). « Heureusement, écrivait Borges en 1930, le style prolixe de la réalité n’est pas le seul : il y a aussi celui de la mémoire, dont l’essence n’est pas la bifurcation des faits, mais plutôt la persistance de traits isolés. Cette poésie est la poésie naturelle de notre propre ignorance »1 (Borges, 1930). Si les mots, en nommant le monde, deviennent le monde, ou deviennent ce que nous connaissons ou pouvons connaître du monde, alors l’inverse est sûrement vrai également : cette conviction qui hante tout écrivain – et c’est particulièrement vrai dans le cas de Borges –, selon laquelle nous pouvons construire (ou reconstruire) le monde à travers les mots, selon laquelle nous pouvons articuler en syllabes cohérentes tout ce qui existe et qui est accessible à nos sens. Pour Borges, nommer Buenos Aires, c’était créer Buenos Aires. Et il fit véritablement sien ce credo pour plusieurs autres lieux de la géographie qu’il commençait à mettre en place dans son imagination.
À cette « persistance des traits isolés », qui définit, pour Borges, la ville qu’il appelle son « chez lui », s’oppose l’Altérité historique et géographique, celle qui se distingue par « le style prolixe de la réalité », une réalité onirique glanée dans les mots des livres, un Orient chimérique. Le monde arabe de Borges, par exemple, s’est constitué à partir des contes des Mille et une nuits et, comme il le dit dans « La quête d’Averroès », au moyen de « quelques bribes de Renan, de Lane, et d’Asín Palacios »2 . Les vastes royaumes de ce qui était connu comme « l’Orient » – le Japon, la Corée, et particulièrement la Chine – se sont matérialisés, pour Borges, à travers des lectures sur le bouddhisme, des histoires et des romans de fantômes, et plusieurs passages pris au hasard de l’Encyclopaedia Britannica. Comme William Marx l’a si bien noté, « toute culture est faite d’emprunts »3.Surtout celle de Borges.
Dans les mains d’un lecteur moins talentueux, de semblables trouvailles n’auraient produit, tout au plus, qu’un chapelet de lieux communs. Dans les mains de Borges, ces découvertes éclectiques furent transformées en visions précises, à la fois personnelles et universelles. Un passage sec comme celui qui suit, tiré de l’entrée consacrée à la Chine dans le sixième volume de la onzième édition de l’Encyclopaedia, donna naissance à l’un des textes littéraires essentiels du vingtième siècle, « La muraille et les livres » (un sujet que je laisse aux mains plus savantes et expérimentées du Professeur Hassan Fathi) :
Along the northern provinces of Chih-li, Shan-si, Shen-si and Kan-suh, over 22° of longitude (98° to 120° E.), stretches the Great Wall of China, built to defend the country against foreign aggression. It was begun in the 3rd century B.C., was repaired in the 15th century, and in the 16th century was extended by 300 miles. Following the windings the wall is 1500 miles long.
À partir de cette information factuelle, Borges construisit le cœur de son ars poetica, résumé dans la phrase finale de « La muraille et les livres » : « L’imminence d’une révélation qui ne se produit pas est peut-être le fait esthétique »4. Cette définition parfaite de ce qu’est l’art, le « fait esthétique » imprègne tous les écrits de Borges.
Il convient de noter que Borges a donné des exemples de ce procédé, pour ainsi dire, depuis l’autre côté, depuis la perspective de l’histoire chinoise vue de l’intérieur de la Chine. Par exemple, il a mentionné au détour d’une conversation que cela l’avait amusé de penser que la Grande Muraille, représentation symbolique d’un pouvoir colossal et d’une ambition démesurée, était une invention des Jésuites qui avaient produit, pour l’Empereur Kangxi, au dix-huitième siècle, la première carte complète de la Chine. Apparemment, Kangxi tenait à connaître toute l’étendue de son empire et à voir à quoi ressemblait la Grande Muraille dans son intégralité5. La carte dessinée par les Jésuites, ces étrangers Occidentaux, contribua à rendre visible aux yeux de l’Empereur cette réalité chinoise insaisissable. La cartographie, faisait remarquer Borges, en tant que branche de l’écriture, ne peut pas se réduire à des lectures impartiales.
Borges était éminemment conscient de ce paradoxe selon lequel l’inexistant avait pouvoir sur l’existant et le rendait réel. À de nombreuses reprises, Borges avoua que, dans la vie que nous appelons réelle, le bonheur était resté hors de sa portée, sauf dans les pages d’un livre. Il reformula souvent la même pensée : « J’ai lu beaucoup de choses et en ai vécu très peu »6. Et pourtant, paradoxalement, le fait de vivre (ou d’essayer de vivre) par procuration lui permit d’être extraordinairement sélectif dans ses expériences, contrairement au commun des mortels qui n’a d’autre choix que de subir les circonstances que la vie place sur de son chemin. Un lecteur, Borges le savait, peut choisir ses propres aventures.
Pour Borges, le monde à l’extérieur de la page et le monde à l’intérieur d’un livre étaient indiscernables l’un de l’autre. Ou plutôt, il arrivait que le monde extérieur interférât de temps en temps avec l’expérience du monde réel, celui constitué de mots. « La muraille tenace », écrivait Borges, « qui à ce moment précis, ainsi qu’à tous les autres, projette son ombre sur des terres que je ne verrai pas »7, existe au moment où Borges la convoque, dans son impossible intégralité, comme ce fut le cas pour Kangxi quand il la vit dessinée sur un morceau de papier, parce qu’une muraille de pierres et de mortier qui court sur d’innombrables kilomètres est impossible à appréhender, même pour un Empereur.
Tous les sujets abordés par Borges proviennent des livres de sa bibliothèque, rangés là à dessein ou au hasard. Borges jouait avec les fantasmes du temps et de l’espace à travers l’œuvre de certains mathématiciens et philosophes (Héraclite, Schopenhauer, l’évêque Berkeley, Hinton, Bertrand Russell, Zhuangzi). Il faisait l’expérience d’une vie d’actions physiques et de violences à travers le genre épique (les sagas nordiques notamment et les contes de Kipling). Il tomba amoureux inlassablement par le truchement des mots de certains poètes (Heine, Verlaine, les préraphaélites). Il explora les aventures exotiques en feuilletant des encyclopédies, et ce sont les encyclopédies en particulier qui procurèrent à Borges les faits à partir desquels il construisit sa géographie imaginaire (le Professeur Andrew Hui abordera, en partie, le sujet de l’encyclopédie comme labyrinthe).
« Les encyclopédies ont été, dirais-je, la lecture majeure de ma vie ». Ce sont les mots de Borges.
J’ai toujours eu un intérêt pour les encyclopédies. En fait, j’avais l’habitude de me rendre à la Bibliothèque Nationale de Buenos Aires – et parce que j’étais si timide, j’avais l’impression que je n’arriverais pas à demander un livre, à parler à un bibliothécaire, alors je cherchais l’EncyclopaediaBritannica sur les étagères. Après, évidemment, j’ai eu cet ouvrage chez moi, à portée de main. Je pouvais alors prendre n’importe quel volume au hasard et me mettre à le lire… Et j’en suis venu à me dire : quelle bonne idée ce serait d’envisager une encyclopédie du monde réel, puis une encyclopédie, d’une grande rigueur naturellement, d’un monde imaginaire, où toutes choses seraient liées. Où, par exemple, on aurait, disons, une langue, puis une littérature qui irait avec cette langue, puis une histoire qui irait avec, et ainsi de suite. Et après je me suis dit, eh bien, que j’allais écrire une histoire de l’encyclopédie fantastique8.
Cette histoire, c’est bien sûr « Tlön Uqbar, Orbis Tertius ».
Dans son introduction de 1959 aux récits de l’écrivain japonais Ryunosuke Akutagawa, Borges s’est risqué à une définition de ce que l’Orient voulait dire pour l’Occident – et par Occident, il entendait à l’évidence lui-même et sa propre galaxie intellectuelle.
Thalès, écrivait Borges, mesurait l’ombre d’une pyramide pour en connaître la hauteur ; Pythagore et Platon enseignaient la transmigration de l’âme ; soixante-dix scribes, séquestrés sur l’île de Pharos, produisirent soixante-dix versions identiques du Pentateuque après soixante-dix jours de travail ; Virgile, dans le deuxième livre des Géorgiques, s’interrogea sur les délicates étoffes de soie faites en Chine et, ces derniers jours, des cavaliers de la province de Buenos Aires se disputaient la victoire dans un jeu de polo persan. Vraies ou apocryphes, les informations hétéroclites dont je viens de faire la liste (auxquelles il conviendrait d’ajouter, parmi tant d’autres, la présence d’Attila dans les chants d’Edda Major) ponctuent les étapes successives d’un processus laïc très élaboré, et qui n’a pas encore pris fin : la découverte de l’Orient par les nations occidentales9.
Pour Borges, la Chine était l’essence même de ce « mystérieux Orient », de cet « Orient impénétrable », de cet « Orient à la sagesse millénaire » ou de quelque autre lieu commun qui vienne à l’esprit. Borges affirmait ce lien imaginaire en le nourrissant de manière imaginative, ou plutôt, comme dirait le Professeur Sun Haiqing, comme « un lien dont l’univers a besoin ». Et cette énormité chinoise issue de l’imagination était officiellement décrite dans l’Encyclopaedia Britannica :
This vast country is separated from the rest of continental Asia by lofty tablelands and rugged mountain ranges, which determine the general course—west to east—of its principal rivers. On the north and west the Mongolian and Tibetan tablelands present towards China steep escarpments across which are very few passes. On the S.W. and S., on the borders of Yun-nan, high mountains and deep valleys separate China from Burma and Tongking. On the narrow N.E. frontier the transition from the Manchurian plateau to the alluvial plain of northern China is not abrupt, but, before the advent of railways, Manchuria afforded few and difficult means of access to other regions. Thus China was almost cut off from the rest of the world save by sea routes.
Or ce n’étaient pas les précisions géographiques qui comptaient pour Borges, mais ce que représentait la Chine : une réalité trop vaste pour être autre chose que littéraire (un thème abordé dans un contexte plus large par le Professeur Haun Saussy). « Si on écrit sur la Chine, dit un jour Borges à Adolfo Bioy Casares, peu importe que l’on fasse des erreurs. On donnera, de toutes façons, l’impression de quelque chose de faux, de quelque chose de fictionnel »10. Pour Borges, « fictionnel » n’était pas un terme ignominieux.
Robert Burton, dans son Anatomie de la mélancolie dont Borges s’inspira souvent de très près, faisait écho à cette notion révérencieuse et rêveuse de l’Orient, citant un proverbe chinois apocryphe : « Les Chinois disent que les Européens n’ont qu’un œil, qu’eux en ont deux, et que tout le reste du monde est aveugle »11. L’Anatomie est constituée de citations provenant de la Bible et de la littérature classique ; pour Borges, des ouvrages comme celui de Burton – pas entièrement une création originale mais plutôt un patchwork de textes du passé – sont, paradoxalement, les plus personnels, dans la mesure où « nous sommes ce passé »12. La Chine de Borges était une part considérable de cet immense passé. Quand Bioy Casares avoua à Borges son affinité avec le poète chinois du dix-huitième siècle, Yan Mei, Borges fit ce commentaire : « Pour ressentir une telle affinité, le poète doit être distant aussi bien dans l’espace que dans le temps »13. La Chine de Borges remplissait ces deux conditions.
Le long article consacré à la Chine dans la onzième édition de l’Encyclopaedia Britannica, accompagné de quelques cartes, est signé collectivement par Philip Lake, Richard Lydekker, Augustine Henry, Herbert A. Giles, George Jamieson, Henry Yule, Friederich Hirth, Robert K. Douglas, Ignatius V. Chirol, Laurence Binyon, Charles J. Holmes and Lionel Giles. Parmi ces grands noms, Borges connaissait sans doute Herbert A. Giles, aujourd’hui considéré comme peu fiable par la plupart des spécialistes. Borges avait lu son History of Chinese Literature (1901) and ses Chinese Fairy Tales (1911), et, une fois de plus, il prit chez l’érudit britannique quelques fragments épars en accord avec son imagination. Il en inclut un grand nombre dans, par exemple, l’anthologie Contes brefs et extraordinaires (1953) compilée avec Adolfo Bioy Casares. Un de plus importants de ces fragments, c’était le rêve du papillon de Zhuangzi (sur lequel reviennent, parmi d’autres lectures, plus longuement et selon des perspectives variées Juan Pablo Canala, Stéphane Feuillas ou Jean Levi. Il est peut-être trop connu pour qu’on en rappelle la teneur. La version brève dit ceci : « Un jour, Zhuangzi rêva qu’il était un papillon. Quand il s’éveilla, il ne sut pas s’il était Zhuangzi qui avait rêvé qu’il était un papillon, ou s’il était un papillon qui rêvait à présent qu’il était Zhuangzi ».
Dans son Histoire de la pensée chinoise, Anne Cheng remarque :
« La pensée de Zhuangzi respire en deux temps : elle commence par s’attaquer radicalement à la raison et au discours en montrant que tous les principes censés fonder la connaissance et l’action sont eux-mêmes sans fondements. Puis, une fois que tout est démoli, se pose la question de savoir ce qui reste : rien que le naturel et le spontané, ce qui est ‘de soi-même ainsi’ et qu’il suffit de refléter tel qu’il est, comme un miroir »14.
Borges trouva cette reductio ad finem au cœur de la fable chinoise infiniment séduisante : la fin n’est pas une fin, mais le nouveau commencement d’une spirale infinie d’existences réelles et d’existences rêvées. Plusieurs de ses écrits développent cette mise-en-abyme, qu’il s’agisse des « Ruines circulaires » où le rêveur est lui-même rêvé, ou de « Le Sud » où une possible mort à l’hôpital prend l’allure d’une aventure grandeur nature qui, à son tour, prend l’allure d’une fin héroïque. Emprunter le récit du papillon à ce Giles peu fiable fut pour Borges une façon d’incorporer les vastes philosophies chinoises dans son propre univers. La fable de Zhuangzi devint celle de Borges.
Par la suite, Borges élargit et diversifia ses lectures sur la philosophie chinoise (comme nous le montre avec minutie le Professeur Canala). Dans une interview qu’il donna en 1976, Borges avoua :
Je pense que mon inspiration vient des livres que j’ai lus et aussi de ceux que je n’ai pas lus. Toute la littérature du passé… J’ai consacré, par exemple, de nombreuses années de ma vie à étudier la philosophie chinoise, en particulier le taoïsme, qui m’a beaucoup intéressé, et j’ai aussi étudié le bouddhisme. Tout cela m’a donc influencé, mais je ne saurais dire jusqu’à quel point exactement. J’ai étudié ces religions, ou ces philosophies orientales, comme des possibles de pensée et du comportement15.
Mais, je me permets d’insister, la première incursion de Borges dans l’univers chinois s’est faite à travers des passages tirés de l’Encyclopaedia Britannica, comme celui-ci :
The Chinese themselves, until the material superiority of Western civilization forced them to a certain degree to conform to its standards, looked down from the height of their superior culture with contempt on the “Western barbarians.” Nor was their attitude wholly without justification. Their civilization was already old at a time when Britain and Germany were peopled by half-naked barbarians, and the philosophical and ethical principles on which it was based remain, to all appearances, as firmly rooted as ever. That these principles have, on the whole, helped to create a national type of a very high order few Europeans who know the Chinese well would deny. The Chinese are naturally reserved, earnest and good-natured; for the occasional outbursts of ferocious violence, notably against foreign settlements, are no index to the national character. There is a national proverb that “the men of the Four Seas are all brothers,” and even strangers can travel through the country without meeting with rudeness, much less outrage. If the Chinese character is inferior to the European, this inferiority lies in the fact that the Chinaman’s whole philosophy of life disinclines him to change or to energetic action.
Et pourtant, malgré ces préjugés culturels explicites, Borges réussit à extraire un matériau qu’il fit sien comme par un procédé de transmutation alchimique. De certaines notions chinoises de l’ordre, par exemple, il tira l’invention de l’ordre de la Bibliothèque Universelle, rangée et chaotique, ainsi que la mystérieuse et apocryphe classification des animaux qui inspira à Foucault Les mots et les choses. Borges avait lu dans l’Encyclopaedia Britannica :
In the spoken language there would occur the word light, the opposite of dark, and this would be expressed in writing by a certain symbol. Then, when it became necessary to write down light, the opposite of heavy, the result would be precisely what we see in English. But as written words increased, always with a limited number of vocables (see Language), this system was found to be impracticable, and Radicals were inserted as a means of distinguishing one kind of light from another, but without altering the original sound. Now, in the phonetic dictionary the words are no longer arranged according to the radicals in such groups as:
Sun-light
Sun-beam
Sun-stroke
Sun-dial
Now they are arranged according to the phonetics, in such groups as:
Sun-light
Moon-light
Foot-light
Gas-light
All the above four are pronounced simply light, without reference to the radical portion which guides towards the limited sense of the term.
Si ces notions chinoises de l’ordre inspirèrent à Borges ses classifications inventives, les romans chinois lui fournirent davantage de matière pour ses fictions (le Professeur Enrique Larreta aborda ce sujet). Borges avait lu et admirait le Hong Lou Meng ou Le Rêve dans le pavillon rouge, d’où il tira le nom de son protagoniste, Yu Tsun, dans « Le jardin des sentiers qui bifurquent » ; le Shuihu Zhuan ou, dans la traduction française, Au bord de l’eau, dans lequel Borges trouva un miroir à l’épopée nationale de l’Argentine, Martín Fierro ; le Liao Zhai zhiyi ou Les Contes de Liao Zhai, qui confirmèrent le goût de Borges pour le surnaturel qui estompe les limites entre le monde onirique et la réalité de tous les jours. Dans la traduction que Giles fit d’extraits choisis de Jingu qiguan, publiée sous le titre de Joyaux de la littérature chinoise16, Borges découvrit l’histoire d’un ingénieux jeune homme qui, souhaitant refuser les avances d’une femme entreprenante, s’inventa une « fiancée des temps difficiles » qui l’attendait, disait-il, dans son pays natal. Borges s’en inspira en partie et créa le faux héros de son récit « Thème du traître et du héros ». Et dans un poème du onzième siècle de Bai Juyi, « Le Prisonnier », traduit par Arthur Waley – poème dans lequel un prisonnier chinois, détenu de nombreuses années par les Tartares, est tué en venant à la rescousse de l’armée chinoise, parce qu’on le prend pour un Tartare –, Borges perçut l’écho d’une histoire racontée par sa grand-mère, celle d’une femme retenue captive par les Indiens (une histoire qu’il retranscrivit dans « Histoire du guerrier et de la captive »). Les effets de miroir, le thème du double, les échos et les répétitions de ce genre fascinaient Borges: il les recherchait assidûment et il les trouva dans la littérature chinoise.
Dans une introduction aux Voyages de Marco Polo, Borges observa : « Marco Polo savait que ce que les hommes imaginent n’est pas moins réel que ce qu’ils appellent réalité »17. En ce qui concerne la vision que Borges avait de la Chine, comme le colloque l’a prouvé, cette observation était tout à fait juste.
BIBLIOGRAPHIE
Bioy Casares, Adolfo. 2006. Borges. Buenos Aires: Destino.
Borges, Jorge Luis. 1970. « Autobiographical Notes ». The New Yorker, September 19, 1970. [Plus tard inclus comme « An Autobiographical Essay » dans The Aleph and Other Stories, New York: Dutton, 1970, pp. 203-60]
Borges, Jorge Luis. 1976. « Borges habla de Borges ». Interview de Rita Guibert. Jorge Luis Borges.
Borges, Jorge Luis. 1981. « Epílogo » dans Obras completas en colaboración. Madrid: Alianza.
Borges, Jorge Luis. 1930. Evaristo Carriego. Buenos Aires: Manuel Gleizer Editor.
Borges, Jorge Luis. 1950. « La Muralla y los Libros ». La Nacion, 22 octobre, 1950. https://www.lanacion.com.ar/cultura/la-muralla-y-los-libros-nid814407/
Borges, Jorge Luis. 1949. « La quête d’Averroès » dans El Aleph. Buenos Aires: Editorial Losada.
Borges, Jorge Luis. 2011. « Marco Polo » dans Obras Completas 4. Buenos Aires: Sudamericana.
Borges, Jorge Luis. Prologue à Kappa, de Ryunosuke Akutagawa. Buenos Aires: Ediciones Mundonuevo, 1959.
Burton, Robert. 1621. « Democritus to the Reader » dans Anatomy of Melancholy. Oxford.
Cheng, Anne. 1997. Histoire de la pensée chinoise. Paris : Éditions du Seuil.
De Ville, Saskia. Avec William Marx. La Quatre Saisons n’est pas qu’une pizza. Podcast Audio. 14 avril, 2023. https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/la-quatre-saisons-n-est-pas-qu-une-pizza/william-marx-ecrivain-historien-de-la-litterature-4338949
Herbert A. Giles. 1884. Gems of Chinese Literature. London: Bernard Quaritch.
Kellogg, Carolyn. 2010. « Would Borges have been a fan of Wikipedia? ». Los Angeles Times, 11 mai, 2010.
Searls, Damion. 1997. « The Wall and the Books ». Variaciones Borges No. 4: 174-176.
Vargas Llosa. 2020. « Jorge Luis Borges en entrevista con Vargas Llosa (I): ‘El lujo me parece una vulgaridad’ ». La República, 15 juin, 2020. https://larepublica.pe/cultural/2020/06/15/jorge-luis-borges-en-entrevista-con-mario-vargas-llosa-el-lujo-me-parece-una-vulgaridad
Waldron, Arthur. 1990. The Great Wall of China: From History to Myth. Cambridge: Cambridge University Press.
1. « Afortunadamente, el copioso estilo de la realidad no es el único: hay el del recuerdo también, cuya esencia no es la ramificación de los hechos, sino la perduración de rasgos aislados. Esa poesía es la natural de nuestra ignorancia ».
2. « Unos adarmes de Renan, de Lane y de Asín Palacios ». Cf. Borges 1949.
3. Marx 2023.
4. Searls 1997, p. 176.
5. Cf. Waldron 1990.
6. « Muchas cosas he leído y pocas he vivido ». Cité dans Vargas Llosa 2020.
7. « La muralla tenaz que, en este momento, y en todos, proyecta sobre tierras que no veré su sistema de sombras ». In Borges, 1950.
8. Cité dans Kellogg 2010.
9. Voir Borges 1959. « Tales midió la sombra de una pirámide para indagar su altura; Pitágoras y Platón enseñaron la transmigración de las almas; setenta escribas, recluidos en la isla de Pharos, produjeron al cabo de setenta jornadas de labor setenta versiones idénticas del Pentateuco; Virgilio, en la segunda Geórgica, ponderó las delicadas telas de seda que elaboran los chinos y, días pasados, jinetes de la provincia de Buenos Aires se disputaban la victoria en el juego persa del polo. Verdaderas o apócrifas las heterogéneas noticias que he enumerado (a las que habría que agregar, entre tantas otras, la presencia de Atila en los cantares de la Edda Mayor) marcan sucesivas etapas de un proceso intricado y secular, que no ha cesado aún: el descubrimiento del Oriente por las naciones occidentales. »
10. « Si uno escribe sobre China, no importa que no se equivoque; la impresión de falsedad la da igual ». Bioy Casares 2006, p. 893.
11. Burton, 1621.
12. Borges 1981, p. 977.
13. Bioy Casares : « Siento fraternidad por ese escritor distante ». In Bioy Casares 2006, p. 266.
14. Cheng 1997, p. 131.
15. «Creo que mis inspiradores han sido los libros que he leído y los que no he leído también. Toda la literatura anterior... He dedicado, por ejemplo, muchos años de mi vida al estudio de la filosofía china, especialmente del taoísmo, que me ha interesado mucho, y también he estudiado el budismo. De modo que todo eso ha influido en mí, pero no sé hasta dónde. He estudiado esas religiones, o esas filosofías orientales como posibilidades para el pensamiento o para la conducta». Lire Borges 1976, p. 318-355.
16. Giles 1884.
17. Borges 2011, p. 496.
BORGES ET LA CHINE
JEAN LEVI, CNRS
Witold Gombrowicz, qui n’appréciait guère Borges, lui reproche entre autres son goût pour l’érudition. Dans les Pérégrinations argentines il aura cette formule assassine : « Toute érudition est et ne peut être que pseudo ; Borges érudit est d’une ignorance terrifiante, et, en outre, d’une intelligence discutable, car l’érudition est par définition inintelligente. » Ne pourrait-on pas dire, de la même façon, à propos de sa métaphysique : Borges est conteur, essayiste, érudit, mais est-il réellement philosophe ? S’il donne parfois l’impression de philosopher, il s’agit toujours d’une philosophie en trompe-l’œil ; considérée en elle-même, en se référant à sa valeur intrinsèque, elle ne vaut pas tripette. Mais il faut bien comprendre que pour lui la philosophie, tout comme l’érudition, possèdent avant tout une fonction stylistique ; ce sont de simples procédés littéraires grâce auxquels il a pu créer un genre inédit à mi-chemin entre la nouvelle et l’essai. Le monde chez Borges n’est jamais perçu qu’à travers des images, de même la discussion théorique ne vaut jamais que comme trame d’une intrigue romanesque, ce qui peut donner effectivement le sentiment que son œuvre est « trop ancrée dans la culture et pas assez dans la vie ». Ces intrigues alambiquées transposent sur le plan de la composition artistique la cécité dont l’auteur est affligé dans la vie réelle. Le monde ne lui parvient jamais directement à la conscience par l’œil, organe qui assure le sentiment de l’immédiateté de la présence au monde ; il ne lui est accessible que par un effort de reconstruction intellectuelle, à travers des intermédiaires divers. Quoi qu’il en soit, sans vouloir entrer dans la querelle entre les deux écrivains, ni se livrer à une psychanalyse de Borges, on doit constater que le parti pris résolument imitatif de ce dernier se trahit dans la technique narrative, introduisant toujours filtres et médiations entre le lecteur et l’histoire qui confèrent parfois à sa pseudo métaphysique quelque chose de tarabiscoté ; il se manifeste aussi et surtout dans ces symboles – bibliothèques, miroirs, labyrinthes, échiquiers – qui hantent ses vers et sa prose, de même que la Kabale, la gnose, les querelles théologiques, les innombrables et vaines réfutations des paradoxes de Zénon fournissent le matériau de prédilection de sa philosophie mimétique.
Il est toutefois d’autres thèmes plus marginaux, à la fois dans l’œuvre de l’écrivain et dans notre culture et qui pour cela même me paraissent mériter notre attention, ne serait-ce que parce qu’ils sont moins rebattus. Ce sont, entre autres, les thèmes empruntés à la Chine : thèmes apparents du rêve dans le rêve et des palais-univers, thème plus secret du signe comme substitut parfait du réel. Sans tenir la place centrale des grands mythes, ils reviennent néanmoins avec suffisamment d’insistance pour qu’il ne soit pas tout à fait futile de s’interroger sur leur fonction et leur signification. Je crois même que c’est une des meilleures façons de saisir sur le vif le dévoiement narratif que fait subir aux systèmes philosophiques la pratique littéraire borgesienne, dévoiement qui aboutit par contrecoup au basculement métaphysique de la narration.
La référence chinoise joue tout d’abord en elle-même et par elle-même ; elle constitue le point ultime où vient se briser l’érudition. À la fois limite de l’univers livresque et univers de livres par excellence. La simple évocation de la Chine, sous forme d’un des fils du Céleste Empire, d’un ouvrage de l’esprit ou d’un palais, produit un double effet d’irréalité et d’éternité. Borges, lecteur assidu de De Quincey, a hérité, ou tout au moins joué, des images de cette « Asie antique, solennelle, monstrueuse et compliquée » qui envahissent les rêves enténébrés d’opium de l’anglais. Ainsi l’Empire du Milieu peut opérer sur le double registre de la parabole et de la parodie : l’Orient est ce lieu à demi imaginaire de bâtisses si effroyablement vastes qu’elles englobent l’univers et d’empereurs si puissants que, juchés sur un entassement monstrueux d’aïeux, ils s’égalent au cosmos ou prétendent arrêter le temps. Mais la Chine est aussi le miroir – un miroir déformant – des propres obsessions de Borges qui, s’anéantissant alors dans leur excès même comme projet d’interprétation de la diversité du réel, se colorent d’une pointe d’humour. Toutefois, Borges ne peut user efficacement de l’archétype que parce qu’il connaît intimement l’histoire de la Chine et sa philosophie, à la différence de De Quincey. Et la magie du cliché est issue, non des brumes du délire, mais de la rigueur érudite.
Quatre contes où se décèle un motif extrême-oriental confortent cette intuition ; ils permettent aussi de nuancer ce que ces déclarations préliminaires ont de péremptoire. Ce sont « Les Ruines circulaires », « La Muraille et les livres », « La Parabole du Palais » et « Le Jardin aux sentiers qui bifurquent ».
Rien de « chinois » à première vue dans « Les Ruines circulaires ». Si référence littéraire il y a, elle serait à chercher plutôt dans l’Iran sassanide et les Mille et une nuits. La nouvelle – un conte fantastique d’horreur – raconte l’histoire d’un chiromancien qui essaie de donner réalité à un rêve dans un temple dévoré par les flammes et par le temps, et découvre, après avoir exécuté son projet, que lui-même est le rêve d’un autre.
Nous retrouvons bien plutôt ici la modulation du thème des reflets spéculaires qui engendrent une chaîne infinie de simulacres : au milieu des gradins en ruines plane comme le soupçon que la dernière des créatures rêvées est peut-être celle qui rêve la première, reproduisant, sur le mode fantasmatique, cette circularité du vide esquissée par la clôture de l’amphithéâtre calciné.
Ce récit présente des rapports très étroits avec « L’Écriture de Dieu » de L’Aleph : même atmosphère de cauchemar, même relation entre temples et flammes, même thème de la chaîne infinie des rêves : « Tu ne t’es pas réveillé à la veille mais à un songe antérieur… » Mais le conte pourrait tout aussi bien s’inscrire dans la veine aztèque qui a inspiré par exemple à Cortázar la belle nouvelle fantastique de son recueil Les Armes secrètes, « La Nuit face au Ciel ».
Un paysage violent et tropical donc qui n’évoque pas la Chine, telle qu’on se plaît tout au moins à se l’imaginer habituellement, mais où, ce me semble, on pourrait là encore malgré tout voir une influence du Mangeur d’opium, qui se débat dans les maléfices d’un songe halluciné et obsédant : « Sous les deux conditions connexes de chaleur tropicale et de lumière verticale, je ramassais toutes les créatures, oiseaux, bêtes, reptiles, arbres et plantes, usages et spectacles que l’on trouve communément dans toute la région des tropiques et je les jetais pêle-mêle en Chine ou dans l’Indoustan1. »
Et je me demande si, pour construire le rêve circulaire d’un rêveur produit lui-même d’un rêve, Borges ne s’est pas servi de la fameuse anecdote de Maître Tchouang (ou Tchouang Tseu), penseur taoïste du IVe siècle av. J.-C., qui s’éveillant d’un rêve où il était papillon ne sait plus s’il est un philosophe rêvant qu’il était un papillon ou le rêve d’un papillon se croyant philosophe.
Il ne s’agit nullement dans l’apologue d’une modulation poétique de la formule, somme toute banale, « la vie n’est qu’un songe », mais d’un questionnement sur le principe de réalité et d’identité du moi. La réflexion est précédée, dans l’œuvre du philosophe chinois, de ce dialogue dont le rêve fournit la modulation anecdotique :
L’ombre de l’ombre interrogea l’ombre : « Tout à l’heure tu marchais et maintenant tu t’arrêtes. Tout à l’heure tu étais assise et maintenant tu es debout, serait-ce que tu ne disposes pas de ta propre autonomie ? »
L’ombre répondit : « Si je dépends d’un autre pour être ainsi, ne pourrait-on pas supposer que celui dont je dépends dépend lui aussi d’un autre pour être tel » 2.
Le renversement accompli par le rêve n’est pas sans rappeler celui opéré par le miroir qui n’en est peut-être que la concrétion sensible ; tous deux fournissent le préalable à toute interrogation sur la réalité du réel. Tchouang Tseu recourt à la parabole du rêve du papillon pour saper nos tranquilles certitudes concernant l’existence de la réalité ; et c’est l’abyssal mystère que recèle toute image renvoyée par un miroir qui décida Platon à introduire le non-être au cœur même de l’être. La formule emblématique du rêve qui sert de prologue au roman chinois Le Rêve dans le Pavillon rouge : « Quand on tient le faux pour le vrai, le vrai à son tour est faux ; si du néant on fait l’être, l’être retourne au néant3 » ne vise pas tant à faire reconnaître le rêve pour ce qu’il est, un mensonge, mais à souligner que celui-ci, en incitant à une mise en doute de la réalité du réel, débouche sur la quête de la vérité. Si ce que l’on tient pour vrai est faux, réciproquement le faux mène au vrai – ou plutôt le faux est la vraie réalité, ce qui serait une autre formulation de l’assertion de Hegel selon laquelle le faux est un moment du vrai.
L’interrogation sur le rêve du papillon de Tchouang Tseu qui vient clore le chapitre II ainsi que les modulations sur le même thème qui le précèdent était parfaitement connues de Borges. Elles l’ont d’ailleurs profondément marqué ; n’en fait-il pas en effet l’objet d’une longue discussion dans « Nouvelle réfutation du temps » ? L’anecdote y sert à illustrer les implications ultimes de la théorie idéaliste qui, en mettant en cause la permanence du moi, aboutissent à la négation du temps et de l’espace. Important dans les paradoxes borgesiens, le motif inspire aussi sa poésie. N’en sent-on pas comme des échos dans ces vers :
Dieu créa les nuits qui engendrent
les rêves, et les formes des miroirs
Pour que l’homme sente qu’il est reflet lui-même
Et vanité. Ainsi en sommes nous alarmés 4.
ou encore dans le « Jeu d’échecs » :
Dieu meut le joueur et le joueur la pièce
Quel dieu derrière Dieu, commence cette trame
De poussière et de temps, de rêves et de larmes 5.
Notons toutefois qu’à la différence de l’auteur argentin et de Platon dont ce dernier était imprégné, chez Tchouang Tseu, le thème du miroir, quoique bien présent dans sa réflexion, n’est pas lié à celui du rêve. Loin de constituer un symbole de la vacuité du réel, il fournit l’image quintessenciée de la plénitude du vide et de sa puissance créatrice, tout à la fois comme instrument de connaissance et comme parade contre les atteintes de la réalité. Ainsi aura-t-il cette formule à la fin du chapitre VII, juste avant la parodie de mythe cosmogonique, sur le démembrement de Hundun, l’outre Chaos, allégorie de la mort de l’indistinction qui est en nous, lorsque la conscience s’ouvrant au monde s’encombre de connaissances, allégorie sur laquelle se clôt le chapitre : « L’esprit de l’homme parfait est un miroir. Un miroir ne reconduit ni n’accueille personne ; il renvoie une image sans la garder. C’est ainsi qu’il domine les êtres sans être blessé 6 ».
Dans la nouvelle de Borges, le drame de la dépendance est renforcé par le caractère très volontaire de l’acte de création, accompagné d’essais réitérés, en sorte que le sorcier dans ses efforts, ses repentirs et ses échecs ne peut manquer d’évoquer l’écrivain, forgeur de rêves et de merveilles. Mais dans sa réalité et par sa réalité, la fantasmagorie frappe tout l’univers d’inconsistance, à commencer par son auteur lui-même. Et voilà qui nous renvoie une fois encore à Tchouang Tseu et à ses variations sur le rêve comme éveil à l’irréalité du réel. Ainsi dans cette leçon dispensée par le Maître du Grand Catalpa à un disciple de Confucius, figurant dans le même chapitre II où il s’emploie à récuser la confiance de Confucius dans la stabilité du réel sur laquelle est assis le Rite en tant que norme cosmique diffractée dans la sphère sociale :
Qui nous dit qu’une fois morts nous ne regretterons pas notre attachement à la vie ? Qui a rêvé de viandes et de vin pleure au réveil, mais qui a pleuré dans son rêve, bien souvent, part joyeux à la chasse. Nul ne sait au moment où il rêve, que son rêve est un rêve et non pas la réalité. Il arrive même que, dans un rêve, on tire les horoscopes des rêves. Ce n’est qu’au réveil que l’on comprend que ces rêves eux-mêmes étaient rêvés. Ce n’est qu’à l’issue du Grand Réveil que nous réaliserons que nous nous éveillons d’un long sommeil traversé de cauchemars. Seuls les sots demeurent persuadés qu’ils sont toujours en état de veille, jusqu’au moment où, soudain, la Grande Transformation les décille ! Prince ou vacher, n’est-ce pas la seule chose d’assurée ? Confucius et toi n’êtes que des rêves. Et moi qui vaticine ainsi sur le rêve, je suis peut-être tout simplement en train de rêver – et on aurait envie d’ajouter : « à moins que je ne sois le rêve d’un autre »7.
Le second conte que je vais évoquer maintenant est si différent par le propos et la facture que le rapprochement peut sembler arbitraire. Pourtant, il se relie au premier par les deux fils ténus de la muraille et du feu. Dans l’essai intitulé « La Muraille et les livres » sur lequel s’ouvre Enquêtes