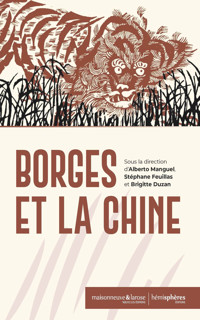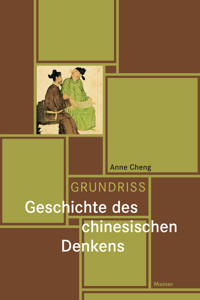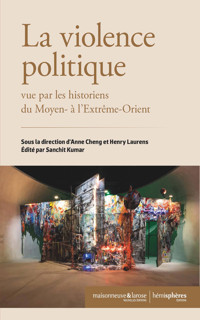
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hémisphères Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans l’imaginaire européen subsistent des relents de l’orientalisme dénoncé par Edward Said, avec à la clé une dichotomie implicite entre, d’un côté, un « Moyen-Orient » volontiers perçu comme le terrain par excellence de la violence politique, voire comme le foyer de fanatismes congénitalement dressés contre toutes les valeurs les plus chères à l'Occident et, de l'autre, un « Extrême-Orient » où tout ne serait qu’ordre et beauté, luxe, calme et prospérité. Or, ces deux représentations opposées relèvent pourtant d’un même type de fantasmagorie dont cet ouvrage, fruit d’un colloque qui s’est tenu en 2022 au Collège de France, se propose de montrer le caractère anhistorique et idéologique. sur l’Europe, l’état de l’Union 2025 rassemble des contributions les plus pertinentes pour répondre aux grandes questions contemporaines. Il donne la parole à ceux qui façonnent l’Europe comme à ceux qui l’analysent. Agrémenté́ de cartes originales et de données statistiques commentées, cet ouvrage constitue un outil indispensable pour comprendre les enjeux d’une Europe en pleine transformation.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Anne Cheng Titulaire de la Chaire d'Histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France.
Henri Laurens Titulaire de la chaire d'Histoire contemporaine du Monde Arabe au Collège de France.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture : Janus Gate © Ayman Baalbaki
ISBN : 978-2-37701-238-1
© Hémisphères Éditions, 2023 3, quai de la Tournelle - 75005 Pariswww.hemisphereseditions.com
Sommaire
Couverture
Copyright
Avant-propos
Introduction
La question d’Occident
L’inachèvement de l’État
La question palestinienne
Le poids de la géopolitique
L’exportation des conflits
Violences politiques au Moyen-Orient
« Gravement préoccupé par l’escalade de la violence »
L’élaboration d’un système international de condamnation de la violence et ses conséquences au Moyen-Orient
Avant d’être une préoccupation, la violence comme occupation et comme mode d’interaction avec la région
Conclusion
Violences en bord d’Euphrate
Un impérialisme non violent ?
1947. La consécration internationale du panasiatisme indien ?
Delhi, théâtre des dissensions asiatiques
La science au service du panasiatisme indien : l’exposition archéologique oubliée (1947-1948)
Le mythe de la “colonisation indienne pacifique” : une coproduction franco-indienne ? (1889-1947)
Bibliographie
Les sources primaires des officiers japonais lors du massacre de Nankin
Résumé
0. Propos introductif
1. Évolution générale de l’historiographie japonaise sur le massacre de Nankin jusqu’au milieu de la décennie 1980
2. La Kaikōsha et l’affaire du massacre du Nankin
3. Conception et contenu du corpus des officiers
4. Deux documents emblématiques : les journaux de guerre de Matsui et de Nakajima
5. En conclusion
6. Bibliographie sélective
Viêt-Nam, de la « guerre du peuple » à la « guerre civile révolutionnaire »
Introduction : Guerre et destin vietnamien
De l’importance des sources vietnamiennes
Comment nommer la guerre du Viêt-Nam ?
Conceptualiser la guerre
Ce que faire la guerre révolutionnaire veut dire
Questionner la guerre populaire vietnamienne
Conclusion
Principales références
La Flèche de l’intelligence ou le filet de la loi
Le filet de la loi
La Chine : un État de droit ou de loi ?
Le rêve chinois est-il légiste ?
Conclusion
Bibliographie
La civilisation des mœurs comme programme politique dans la Chine post-maoïste
De la militarisation à la civilisation en passant par la brutalisation
« Civiliser » les Chinois : un mot d’ordre des réformes post-maoïstes
Généalogie de la « civilisation »
Une société réceptive ?
Comment accepter l’idée d’un génocide ?
Un peuple martyr
Définir ce mot qui fait peur
Découvrir le Xinjiang des années 1980
Les prémices inquiétantes des années 1990 et 2000
Une femme à la tête de la résistance ouïghoure
Après le 11 septembre 2001
Des personnes qui disparaissent
Xi Jinping lance la répression tous azimuts
Le silence des victimes
Après les Xinjiang Leaks
Les joies de la désinformation
Un monde évanoui ?
Protégeons les témoins !
Une impossible paix ?
Le révisionnisme historique et la fabrique du mensonge
La « Nouvelle-Russie » : l’eurasisme et le panslavisme revisités
Une dérive du régime poutinien vers le totalitarisme ?
Chez le même éditeur
Avant-propos
Anne Cheng Collège de France, Chaire d’Histoire intellectuelle de la Chine
Les idées contenues dans chaque article de ce volume ne reflètent que l’opinion de son auteur(e) qui en assume seul(e) l’entière responsabilité.
Le présent volume1 est pour large part le résultat d’un colloque qui s’est tenu au Collège de France en juin 2022 et qui faisait suite à un autre colloque international organisé par la Chaire d’Histoire intellectuelle de la Chine en juin 2019. Intitulé Historians of Asia on political violence et publié en ligne en 2021 dans la série « Myriades d’Asies » de l’Institut des civilisations, ce premier colloque réunissait d’éminents historiens de l’Inde, du Japon et de la Chine invités à traiter de divers aspects de la violence politique dans ces pays d’Asie et d’Extrême-Orient. Il a ensuite paru intéressant et souhaitable d’étendre ces discussions à ce qu’il est convenu d’appeler le « Moyen Orient » en faisant appel à la collaboration de la Chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe.
Dans l’imaginaire européen subsistent encore des relents de l’orientalisme dénoncé par Edward Said, avec à la clé une dichotomie implicite entre, d’un côté, un « Moyen-Orient » volontiers perçu comme le terrain par excellence de la violence politique, voire comme le foyer de fanatismes congénitalement dressés contre toutes les valeurs les plus chères à l’Occident et, de l’autre, un « Extrême-Orient » où tout ne serait qu’ordre et beauté, luxe, calme et prospérité. Or, ces deux représentations opposées relèvent pourtant d’un même type de fantasmagorie dont il s’agissait de montrer le caractère anhistorique et idéologique. Le colloque de 2019 s’efforçait déjà de dénoncer l’illusion d’optique et les préconceptions orientalistes qui font encore croire à une Chine « harmonieuse », à un Japon « esthétique » ou à une Inde « non violente ». Dans le volume Historians of Asia on political violence sont abordés entre autres la question de la violence d’État sous ses multiples formes, les moyens d’y résister ou de s’y opposer, les discours visant à la justifier, à la nier ou à la gommer, que ce soit dans l’Inde ancienne, le Japon panasiatiste ou encore la Chine maoïste.
Ce nouveau volume, intitulé La violence politique vue par les historiens du Moyen- à l’Extrême-Orient, consacre sa première partie à l’Orient arabe qui apparaît aujourd’hui comme une « terre de sang » d’où rayonne la violence sous forme de terrorisme dans les autres régions du monde. Comme Henry Laurens commence par le rappeler dans son article introductif, les événements récents montrent bien que ce n’est pas une réputation usurpée. Pourtant – et c’est la conclusion commune à laquelle parviennent Eberhard Kienle, Manon-Nour Tannous et Matthieu Rey – la violence n’est pas innée dans cette région, elle est le produit de toute une série de facteurs. Le premier est l’intégration de l’espace allant de la Méditerranée à l’Inde dans le système politique européen, puis occidental, depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle. On se trouve ainsi dans un jeu permanent d’ingérences et d’implications de la part des acteurs régionaux et internationaux. Le second est la constitution de l’État moderne censé s’appuyer sur une nation unifiée ne prenant pas en compte, au moins dans le discours, des compositions multiples des sociétés : tribus, ethnies, communautés religieuses. Ces dernières ont tendance à devenir des acteurs dans le grand jeu des ingérences et des implications. Le troisième est le rôle des grandes idéologies mobilisatrices depuis le XIXe siècle : libéralisme, nationalisme, socialisme, islamisme. Toutes ont tenté de s’imposer par la violence en jouant sur la disqualification des autres forces en compétition. Le quatrième est le rôle de l’économie de rentes, en particulier de la rente pétrolière qui tente d’affranchir l’État de la société. De petits États peuvent devenir de grands acteurs mondiaux grâce à leur puissance financière, redéfinissant ainsi la notion de soft power. La convergence de l’ensemble de ces facteurs aboutit à la constitution de systèmes autoritaires de plus en plus conservateurs (défenseur de la stabilité) et kleptocratiques jouant sur l’antiterrorisme pour justifier la répression des oppositions. On se trouve devant l’inachèvement de l’État qui, en cas de révolution, se disloque au profit de milices représentant des groupes ayant des projets divers allant du brigandage mercenaire au millénarisme le plus violent. Il en résulte un exode continu de réfugiés à destination des sociétés européennes, elles-mêmes perturbées par les projections des conflits de la région sur leurs propres sociétés.
Or, ce diagnostic porté sur l’Orient « moyen » ou « proche » n’épargne pas l’Orient plus lointain qu’est l’Inde dont Pierre Singaravélou montre que le panasiatisme promu par Nehru, sous couvert de non-violence, n’est pas exempt de visées impérialistes. Il en va de même pour l’Orient dit « extrême » qui donne à première vue l’impression d’un monde moins agité et plus prospère. Toutefois, point n’est besoin de remonter très loin pour retrouver le passé militariste et destructeur du Japon aujourd’hui tant apprécié pour sa modernité esthétique et pacifiste. Arnaud Nanta poursuit ici l’enquête entamée dans le précédent volume sur l’historiographie du massacre de Nankin, encore objet d’un négationnisme virulent de la part de certains historiens japonais. Un autre souvenir encore vivace dans les mémoires d’un état de guerre ultra-violente et prolongée est ce qui a fini par être appelé au Vietnam « la guerre civile révolutionnaire » dont François Guillemot retrace les origines et les influences chinoises. La Chine, qui se targue aujourd’hui d’être sortie du déchaînement de violence maoïste décrite dans le volume précédent et de maintenir ordre et stabilité, n’en reste pas moins soumise à un régime brutal et totalitaire dont Olivier Boutonnet détecte les sources d’inspiration dans le légisme antique. Victor Louzon-Benrekassa présente le discours actuel sur la « civilisation des mœurs » comme une réaction à la violence de la Révolution culturelle des années 1960-1970, laquelle peine toutefois à masquer le caractère éminemment autoritaire d’une politique imposée d’en haut. La manière dont la société chinoise subit le contrôle permanent de l’État-Parti est portée à ses extrêmes limites de violence dans le cas des minorités, notamment tibétaines et ouïgoures, dont le traitement par le pouvoir central s’assimile à du génocide selon Marie Holzman.
Le texte qui clôt notre volume est dû à Claude Romano qui nous livre ses réflexions de philosophe sur la récente irruption de la violence à l’état pur au cœur même de l’Europe avec l’invasion de l’Ukraine par son voisin russe en février 2022 et sur l’idéologie qui l’a inspirée. Quelle meilleure façon de rappeler que la violence politique n’est innée dans aucune région du monde, qu’elle peut surgir en tout temps et en tout lieu, voire qu’elle se signale paradoxalement de manière encore plus brutale dans les « États-civilisations » que prétendent être la Russie et la Chine ?
1. Toute notre reconnaissance va à Sanchit Kumar pour son assistance indéfectible tout au long de la phase éditoriale et à Serge Lauret pour son dévouement total dans l’énorme travail de mise en page de ce volume.
Introduction
Henry LaurensCollège de France Chaire d’Histoire contemporaine du monde arabe
Il y a déjà trente ans, j’avais participé à un ouvrage collectif sur la violence dans le monde avec bien entendu la charge de l’Orient arabe contemporain1. Mon but était alors de dégager ce qui pourrait être défini comme le substrat anthropologique d’un côté et l’organisation politique de l’autre.
La spécificité arabe viendrait de son appartenance à l’ordre segmentaire dont la définition classique serait d’être formée d’une multiplicité de groupes qui s’emboîtent les uns dans les autres et dont le trait dominant réside dans les relations qui s’instaurent entre eux. Ainsi dans une société présentant une segmentation en familles, clans et tribus : les familles s’opposent entre elles mais se rassemblent dans un même clan, opposé à son tour à d’autres clans, etc.
L’adage serait : « Moi contre mon frère, mon frère et moi contre mon cousin, mon cousin, mon frère et moi contre l’étranger. »
Ce serait ainsi une succession de groupes solidaires s’opposant à d’autres groupes solidaires dont l’illustration parfaite se retrouve dans la lutte pour le pouvoir.
La notion d’honneur, coextensive de celle de la virilité, est le ciment de ces groupes. L’homme vrai est un combattant portant les armes pour défendre son honneur. Selon l’expression célèbre de l’imam Moussa Sadr en 1974, « les armes sont l’ornement de l’homme » (al-silāḥ zīnat al-riǧāl). Un homme désarmé est un homme humilié.
Il existe dès lors des mécanismes de limitation de la violence comme le fameux « prix du sang » pour mettre fin à une vendetta. Il faut un arbitre, accepté par les parties, qui doit fixer la compensation censée remettre à égalité les groupes engagés.
Ensuite j’étudiais les différentes expressions de l’État dans la région et je concluais par l’importance de la violence morale définie comme une donnée permanente. La violence physique ne sert la plupart du temps qu’à l’entretenir. Si l’Orient arabe est moins une terre de massacres et de génocides qu’on ne le croit, la peur du massacre et du génocide y est bien une réalité du vécu des populations, engendrant de nouveaux comportements de violence. En résumé, la violence est périodique, mais elle sert à alimenter une intimidation permanente.
Trente ans après, le diagnostic est beaucoup plus pessimiste : des « terres de sang » comme la Syrie et l’Iraq avec des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés et de réfugiés tandis que la contre-révolution qui l’a emporté après le printemps arabe de 2011 travaille à prendre le contrôle de la religion au nom de « l’islam modéré » ou bigoterie d’État. Enfin la question palestinienne se retrouve reléguée à l’arrière-plan (ce n’est plus vrai depuis le 7 octobre 2023).
La violence moyen-orientale s’exporte aussi par des actes de terrorisme visant des populations civiles un peu partout dans le monde.
La question d’Occident
Ma réflexion d’aujourd’hui s’est alimentée de la lecture d’un texte de Toynbee, publié en mars 1922, la question d’Occident en Grèce et en Turquie, une étude du contact de civilisations (The Western Question in Greece and Turkey, A Study in the contact of civilisations). C’est le résultat d’un voyage d’étude fait en 1921 sur le champ de bataille gréco-turc. Il est témoin de terribles atrocités et son intervention a certainement sauvé la vie de plusieurs centaines de réfugiés turcs.
Il opère deux renversements :
Le premier est le retournement de la question d’Orient. Elle n’existe pas en tant que telle, elle est une question d’Occident dans la mesure où chaque acteur local est persuadé, aussi bien au niveau le plus bas de la société que chez les décideurs, que le conflit engage les puissances européennes à tous les niveaux. Durant la bataille d’Inonü en mars 1921, bien des soldats des deux camps pensaient que c’était une bataille entre la France et la Grande-Bretagne pour la possession de l’Anatolie. Ils étaient persuadés qu’il y avait des officiers de ces pays dans le camp d’en face.
Le paradoxe est là : sur le terrain les gens sont absolument convaincus que tous les Français et tous les Britanniques suivent attentivement le conflit alors que les opinions publiques de leurs pays sont largement indifférentes et peu informées.
Les intéressés ne peuvent pas croire que l’on se sente éloigné de ce qui leur arrive : « Ils insistent (naturellement de façon erronée) que les immenses effets produits tout ce temps en Orient par l’action occidentale doivent être le produit d’une politique. Il est inconcevable qu’ils puissent être involontaires et inconscients.2 »
Cette affirmation surprenante a une part de vérité. Les puissances occidentales sont bien des protagonistes de cette guerre à distance et les populations souffrantes en sont les pions. Mais elles le font avec beaucoup d’hypocrisie et en conservant les bonnes manières entre elles.
Toynbee imagine une pièce de théâtre qui s’appellerait les « Patriotes » avec des personnages comme Masaryk, Venizelos, Stambolisky, Pilsudsky, Faysal, Mustafa Kemal, des hommes vivant dans un rêve comme Pitt et Napoléon, puis ce serait la réalité représentée par les bureaux et les couloirs du Quai d’Orsay ou de Downing Street. Et il ajoute la place des observateurs : un chœur impuissant de commentateurs comme lui3.
Le second renversement lui permet d’aborder pour la première fois la question des civilisations et surtout celle du nationalisme.
En raison de l’hégémonie de l’Occident qui a mis fin à l’ordre social traditionnel, les peuples non occidentaux se doivent d’adopter les formes occidentales de pouvoir. Or les États de l’Ouest de l’Europe sont fondés sur une homogénéité linguistique et ethnique. La volonté d’homogénéiser les sociétés orientales conduit inexorablement au massacre. Le processus a commencé avec la guerre d’indépendance de la Grèce en 1821.
Ce qui s‘est passé en Macédoine et en Anatolie occidentale est la démonstration par l’absurde de la force meurtrière du principe des nationalités. La balkanisation, terme inventé lors de la paix de Brest-Litovsk, va s’étendre jusqu’à l’Inde.
Sans qu’il exprime distinctement, il existe bien un second sens à la question d’Occident, celle de l’occidentalisation des Orients.
Le point essentiel est que Toynbee, à qui on doit en pleine guerre la première étude complète du génocide arménien, apparaît cette fois comme très proche des Turcs. Pourtant, durant le demi-siècle qui suit (il meurt en 1975), il ne remettra pas en cause son premier travail.
La différence repose sur le fait que son étude sur le génocide arménien se construit sur la notion juridique de responsabilité tandis que Western Question aborde celle de processus. Il est possible de mettre des responsables sur le banc des accusés, mais non des processus (« la force des choses » disait Saint-Just). Les quatre cavaliers de l’apocalypse sont bien des processus et non des personnes : géopolitique, constitution de l’État moderne, idéologies mobilisatrices, économie de rentes. Ils appartiennent pleinement à la question d’Occident avec leurs aboutissements autoritaires et kleptocratiques.
Un siècle après, les chercheurs forment toujours le chœur grec des observateurs impuissants cherchant au mieux à établir ce qui est dans l’ordre des responsabilités et ce qui est celui des processus, entre ce qui appartient à la libre détermination des acteurs et ce qui est le piège des logiques de situations. Parfois ils reproduisent dans leurs corporations les clivages de leurs domaines d’études.
Le XIXe siècle avait défini la géopolitique de la région selon un axe largement fictif, la route des Indes. La Grande-Bretagne s’était acharnée à interdire son accès à ses compétiteurs, la France d’abord et ensuite surtout la Russie. De ce fait, la question d’Orient impliquait la survie de l’Empire ottoman soumis à la double contrainte de la réforme intérieure et de la gestion extérieure collective des « Puissances » (les six États signataires du traité de Paris de 1856).
Mais la logique de la modernisation entraînait celle de l’émergence des nationalités, d’abord dans les Balkans ensuite en Anatolie et finalement dans l’Orient arabe. En dehors de ce dernier espace, les nationalismes, qui ont joué le jeu des Puissances, ont produit des violences de masse, des nettoyages ethniques et finalement des génocides.
L’inachèvement de l’État
Après 1918, l’horizon fondamental de l’action politique est la constitution de l’État sur les ruines de l’Empire ottoman. Que ce soit en système mandataire ou non, la logique est la même: on part d’un noyau central, pouvant être défini comme une capitale (Jérusalem, Damas, Bagdad, Amman, Riyad) qui doit à la fois prendre le contrôle d’un territoire délimité plus ou moins par la Grande-Bretagne et d’une population qui peut être rétive à cette autorité en voie de constitution. L’action politique passe aussi bien par la négociation et l’affrontement avec la puissance étrangère dominante (la Grande-Bretagne et éventuellement la France) que par l’intégration plus ou moins forcée des régionalismes. Chronologiquement cela s’étend au moins jusqu’aux années 1950.
Dans ce cadre se pose la question kurde. En Irak, le soulèvement kurde entraîne à partir du début des années 1960 une guerre civile de plus en plus meurtrière sous le régime de Saddam Hussein. En Syrie, les régimes successifs refusent la reconnaissance d’une personnalité kurde allant jusqu’à refuser d’accorder la nationalité syrienne à une fraction de la population concernée. La violence est ici directement liée à la constitution de l’État dans son travail de définition du territoire et de la population.
Il en est de même avec la question des communautés confessionnelles. Au XIXe siècle, les Ottomans avaient accordé une existence officielle aux communautés non musulmanes (système dit des Millet), mais l’avaient refusé aux musulmans non sunnites (chiites, druzes, alaouites, ismaéliens etc.). La fin du califat ottoman entraîne l’émancipation des non-sunnites sur le modèle des non-musulmans tandis que les sunnites continuent à s’identifier à l’État. En même temps, les communautés (ta’ifa) s’inscrivent dans la perspective nouvelle des minorités qui émerge à la fin de la Première Guerre mondiale. Il en résulte soit le confessionnalisme politique à la libanaise avec une répartition des pouvoirs en fonction de l’importance démographique supposée des communautés, soit à l’hégémonie d’une communauté à l’issue d’une âpre lutte pour le pouvoir (Irak, Syrie). L’absence de dépassement du cadre communautaire est ainsi source de guerres civiles.
Comme au XIXe siècle, la violence est étroitement associée aux projets de modernisation. Les coups d’État militaires successifs en Égypte, Syrie et Irak se justifiaient par la volonté d’établir des régimes socialistes ayant pour vocation de rattraper par l’industrialisation rapide le retard sur les sociétés dites développées. Mais cela passe par le refus de tout pluralisme. Dans un premier moment, l’évocation de la révolution permet de tout justifier. Dans un second moment, ce même refus trouve une légitimation contraire, le maintien d’une stabilité censée éviter les désordres.
C’est que l’islam politique, vaincu des premières luttes contre les nationalismes, a repris le flambeau de la contestation, la révolution islamique d’Iran en 1979 ayant démontré la possibilité de la prise du pouvoir puis de son exercice.
Ainsi le projet étatique, en raison même de ses différents inachèvements, produit des régimes politiques qui se fondent d’abord sur un imposant appareil sécuritaire réprimant toute éventuelle contestation en allant jusqu’au bain de sang si nécessaire. Il entraîne l’absence d’un véritable État de droit et l’impossibilité de la contestation et de la divergence. Tout doit procéder par en haut et la population est sommée d’applaudir. Faute de contrôle, la corruption se retrouve à différents niveaux de l’État. La kleptocratie devient le corollaire du système sécuritaire qui ne peut se permettre une justice indépendante.
La question palestinienne
Pour des raisons démographiques ainsi que celle de la possession des sols, la constitution d’un État juif en Palestine implique une dépossession et une expulsion de la population arabe sur une partie conséquente du territoire. L’aboutissement ne peut être que le refoulement total ou la concentration de la population originelle dans l’équivalent d’une réserve indienne ou de bantoustan de l’Afrique du Sud de l’apartheid.
Venu de l’extérieur, le mouvement sioniste dépend de façon constante de soutien externe à la région (les Puissances d’avant 1914, le mandat britannique et après 1948 surtout les États-Unis). Le projet implique un effort constant de propagande auprès des opinions publiques des pays concernés. La terrifiante destruction des Juifs d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale devient un argument essentiel. On se pose en citadelle de l’Occident en terre hostile et en atout stratégique. La revendication d’être la seule démocratie de la région est la reprise du discours colonial de la civilisation contre la barbarie.
La revendication palestinienne centrée sur le droit au retour remet en cause la légitimité du mouvement sioniste et de l’État d’Israël. Elle s’articule à son tour sur la revendication de l’État et au recours à une puissante action de propagande à l’extérieur. On a ainsi dans les deux cas, une internationalisation du conflit avec une mobilisation des affects que l’on ne trouve pas ailleurs avec une telle intensité.
Il s’agit ici d’un processus ou plus précisément d’une logique de situation, celle de la colonisation de peuplement. Les deux peuples engagés sont prisonniers l’un de l’autre et la volonté de se séparer engendre encore plus de violences, puisqu’il est impossible de vivre ensemble et d’éliminer totalement l’autre.
La tentative de conciliation des années 1990 a échoué du fait de l’absence d’une décolonisation réelle. Les diplomates constituent maintenant leurs propres chœurs avec des lamentations qui sont autant d’expressions figées qui s‘éloignent toujours plus de la réalité du terrain. Sauf intervention divine, cela semble bien parti pour quelques siècles.
Le poids de la géopolitique
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la région connaît une duplication de la géopolitique européenne puis mondiale. Dans la première moitié du XXe siècle, la route de l’Inde perd progressivement de son importance, mais elle est remplacée par celle des approvisionnements en pétrole.
Il ne faut pas penser en termes de domination territoriale comme au temps des empires coloniaux. Le prix du pétrole, en temps de paix, est fixé en fonction de l’offre et de la demande sur le marché mondial, même s’il y a pu avoir cartellisation d’abord des grandes compagnies pétrolières ensuite des pays producteurs. Le contrôle de la production et de l’exportation est une donnée virtuelle en fonction d’une situation de guerre, comme dans le cas des deux conflits mondiaux où l’Allemagne et ses alliés ont été coupés du marché mondial.
En jargon local, cette situation est définie comme « la sécurité des approvisionnements pétroliers » avec aujourd’hui une part croissante du gazier. Elle comprend aussi l’interdiction de constitution d’un partenaire dominant comme l’Irak de Saddam Hussein a tenté de le faire en 1990-1991 en annexant le Koweït. Par là même, les pays consommateurs se sont engagés à assurer la sécurité des pays exportateurs. Ces derniers les ont plus moins « mercenarisés » par le biais du recyclage de la rente pétrolière, les commandes faramineuses d’armement, les relations publiques et multiples formes de corruption. Aujourd’hui la lutte contre les tentatives hégémoniques de l’Iran alimente cette mécanique de la mercenarisation.
L’entre-deux-guerres a constitué une parenthèse inattendue avec l’existence d’une hégémonie britannique régulatrice des conflits avec un réduit français en Syrie et au Liban. Cette hégémonie a été progressivement démantelée avec la création de l’État d’Israël et la guerre de Palestine. Elle a créé une intersection dans les années 1950 où la guerre froide mondiale s’est introduite par le biais de l’armement fourni par le bloc de l’Est à certains belligérants arabes du conflit de Palestine. La guerre froide générale s’est ainsi reproduite spécifiquement en guerre froide arabe. Le recoupement s’est fait par la volonté de l’Union soviétique de se faire reconnaître comme gestionnaire à part entière des affaires du Moyen-Orient et de la volonté américaine de l’en éliminer.
La conséquence a été que toute force politique locale ou régionale a cherché à obtenir un ou plusieurs soutiens régionaux ou internationaux créant une demande symétrique de la part de ses concurrents. C’est un retour à la logique d’avant 1914, mais sans la gestion collective, d’un « concert européen ». Toute crise régionale doit avoir un traitement collectif soit « arabisation » soit « internationalisation » soit les deux à la fois.
L’inachèvement de l’État, ou plutôt sa confiscation kleptocratique, y a eu sa part. L’idéologie nationaliste arabe de tendance unitaire a eu pour conséquence la contestation de la légitimité de l’État issu des indépendances. Il a paru légitime à tous d’intervenir dans les affaires intérieures des voisins. Les partenaires les plus forts peuvent ainsi être définis comme des acteurs et les plus faibles comme des enjeux. La région dans sa globalité devient ainsi une série d’enjeux pour les puissances externes.
La relation fonctionne dans les deux sens. L’acteur local manipule autant les grandes puissances que ces dernières le manipulent. Ingérences et implications se produisent en même temps. Elles génèrent des discours de justification des actes qui sont autant de produits des relations publiques. La mise en sens de ce qui se passe prend la forme du récit complotiste. Le problème est qu’il existe aussi des complots réels…
De ce fait, il ne peut y avoir de marges de manœuvre dans les espaces pluralistes. Le pluralisme libanais est devenu la reproduction des luttes d’influence régionales au point de « faire la guerre pour les autres ». Il en a été de même pour le pluralisme palestinien: toutes les organisations palestiniennes ont eu besoin de financements externes pour exister avec les alignements que cela implique. L’Irak d’après 2003 est devenu un champ de bataille et il en est de même pour la Syrie d’après 2011. On a vu ainsi réapparaître des « coalitions » de forces locales, régionales et internationales. Chaque événement sur la scène mondiale est immédiatement interprété en fonction de ses supposées répercussions régionales et il en est de même dans l’autre sens.
En conséquence, toute ouverture politique pluraliste réelle constitue un risque d’ingérence étrangère. Nasser justifiait ainsi sa dictature. Elle était la garantie de l’indépendance et du statut d’acteur. Les monarchies disposent de la légitimité historique d’incarner l’État. Les dictatures se contentent de gouverneurs à vie avec une tendance à vouloir se transformer en pouvoir héréditaire. L’idée d’alternance politique est en soi une subversion quasi blasphématoire aussi bien dans une logique révolutionnaire qu’au nom de la préservation de la stabilité.
C’est cette malédiction de la géopolitique qui justifie la définition de cette région en termes politiques, le Moyen-Orient, et non en références géographiques, l’Asie occidentale.
L’exportation des conflits
Les différentes implications ont entraîné une importation des conflits internationaux. Durant la période de la lutte anti-impérialiste, les « progressistes » avaient le sentiment de participer à un combat tricontinental (Asie, Afrique, Amérique latine). Le mythe du Tiers Monde permettait de se poser en universalisme liquidant anciens et nouveaux impérialismes. Mais la disparition de l’Union soviétique et l’accession de la Chine au statut de grande puissance économique ont mis fin à tout espoir de solution socialiste. Le néolibéralisme, s’il pouvait être promesse de croissance économique, était aussi annonce de démantèlement des embryons d’État providence.
Les luttes pour l’indépendance nationale avaient légitimé l’usage de la guérilla urbaine et rurale. L’exemple de la guerre d’Algérie puis celui mal compris du Vietnam étaient allés dans ce sens. Le « terrorisme » était la seule expression possible de la lutte armée palestinienne. Il s’est ainsi exporté à l’extérieur de la région sous forme d’action publicitaire (détournement d’avions) et de lutte contre Israël (Munich 1972). Il a pu dégénérer en violences mercenaires comme celles du groupe Carlos en liaison avec les révolutionnaires sans révolution européens, et du groupe Abou Nidal prêt à assassiner sur commande.
L’islamisme, que l’on peut présenter comme un projet utopique de société, a suivi cette voie d’abord dans l’affrontement aux régimes en place dans les années 1980-1990 puis en s’exportant à l’extérieur comme violences « victimaires » (vengeance d’être victimes et volonté de faire des victimes) dans le double but de faire le maximum de retentissement et de l’annihilation héroïque de soi. La question devient alors de savoir si on se trouve devant une radicalisation violente de l’islam ou une violence radicale qui prend l’islam comme prétexte. C’est la résurgence de la problématique ancienne de savoir si ce sont les idées qui sont les moteurs du projet que l’on cherche à imposer ou si elles servent à penser les actions que l’on mène.
La radicalisation venue de l’extérieur conduit ainsi les Occidentaux à adopter de plus en plus des formes d’État sécuritaire avec les limitations de liberté qu’elles impliquent.
Les pays occidentaux se trouvent ainsi pris dans le piège de leurs attentes. D’un côté, ils souhaiteraient bien avoir de sympathiques États de droit comme partenaires dans la région et ils y travaillent par différents programmes de coopération, de l’autre leurs demandes vont en sens contraire.
Les exigences européennes et occidentales sont pour le moins triple. La première est la sécurité des approvisionnements pétroliers et gaziers qui les implique dans les jeux politiques régionaux, la seconde est la lutte contre les différentes formes de terrorisme qui exige une forte coopération avec les systèmes sécuritaires de la région, la troisième est la lutte contre l’immigration clandestine, dont le but est de fixer les migrants sur la rive Sud de la Méditerranée.
Le tout introduit une forte dépendance des États européens envers les États de la région qui peuvent susciter du terrorisme en cas de besoin et faire des migrants un puissant moyen de pression.
La migration elle-même est l’expression de l’inachèvement de l’État dans un grand Moyen-Orient allant de l’Afghanistan au Maroc, sans compter celui de l’Afrique subsaharienne. Les migrants demandent ce qui leur a été refusé en 2011, des droits politiques, économiques et sociaux.
Un siècle après le chœur grec des observateurs de Toynbee, celui d’aujourd’hui continue ses lamentations et n’annonce toujours pas d’avenir radieux. Sa seule consolation réside dans la poursuite assurée du statut d’expert. Après tout Disraeli disait déjà en 1845 : « l’Orient est une carrière ».
1. « La violence dans l’Orient arabe » in Guy Richard, L’Histoire inhumaine, massacres et génocides des origines à nos jours, Paris, Armand Colin, 1992, pp. 155-171.
2. P. 3 : « They insisted (of course erroneously) that the immense effects which were being produced all the time in the East by Western action, must be the result of policy; it was inconceivable that they could be unintentional and unconscious. »
3. P. 39 « perhaps the chorus of spirits would be composed on impotent Western observers like myself ».
Violences politiquesau Moyen-Orient
Le legs perpétuellement reconstitué des inégalités mondiales
Eberhard KienleCERI (CNRS / Sciences Po Paris)
Contrairement aux idées reçues perpétuellement reproduites dans de nombreux médias et même dans une partie de la littérature scientifique, le Moyen-Orient ne se distingue pas par un recours à la violence en politique qui lui serait propre et qui, en fin de compte, refléterait sa différence intrinsèque, voire ontologique par rapport à d’autres parties du monde. Sans aucun doute, à certains moments et dans certaines périodes la violence politique – terme qui ici désigne toute tentative de contraindre par la force un acteur à soutenir un gouvernant ou un choix politique – peut marquer certaines zones géographiques plus que d’autres. Pourtant, même au cas où ces périodes couvrent des décennies ou des siècles entiers, il vaut mieux chercher l’explication dans les incompatibilités génératrices de conflits que dans des prédispositions particulières ou même « naturelles » d’acteurs qui parlent une langue ou pratiquent une religion donnée ; le recours au – mauvais – « esprit des lieux » sous forme de foyer ou de germoir qui de manière plus ou moins magique pousserait les individus, groupes et organisations à se faire la guerre est tout aussi intenable.
Certes, le recours à la violence en politique est loin d’être absent du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, zone géographique quelque peu incertaine dont on trace souvent les frontières de manière fort différente1. Ainsi on ne saurait ignorer les guerres successives qui ont opposé Israël à ses voisins arabes depuis l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU en 1947 du plan de partage de la Palestine. Souvent d’ailleurs la participation à ces guerres semblait au moins implicitement délimiter l’étendue de ce qu’on appelait le Proche ou du Moyen-Orient. On ne saurait pas non plus ignorer les autres formes de violence liées à ces guerres comme l’occupation militaire prolongée, sa contestation ouverte ou le recours imprévisible aux armes, généralement appelé terrorisme, contre des personnes, notamment des civils, et des objets.
Or, en portant le regard vers d’autres horizons, on s’aperçoit aisément que dans la même période l’Inde et le Pakistan se sont livré plusieurs guerres non moins coûteuses et déchirantes. Plus récemment, la guerre en Ukraine nous a rappelé que l’emploi massif de la puissance militaire n’est pas l’apanage des extra-Européens. En même temps, des « guerres civiles » ont opposé non seulement des Libanais à d’autres Libanais ou des Syriens à d’autres Syriens, mais également des Rouandais à d’autres Rouandais et des ressortissants de l’ancienne Yougoslavie à leurs anciens concitoyens. Ailleurs comme au Mexique, la criminalité endémique ou organisée, toujours armée, et sa répression font les mêmes ravages. Cette criminalité est éminemment politique du fait qu’elle prive la population de biens publics, y compris la sécurité physique, et qu’elle met au défi l’État, si elle ne s’exerce pas en coopération avec certains de ses représentants. En termes de victimes, tous ces exemples pâlissent devant les millions de morts de la Première et de la Deuxième Guerre mondiales et des camps nazis, tous victimes de décisions prises loin du Moyen-Orient2. S’y ajoutent les nombreuses formes de violence moins visibles qui marquent la vie politique à travers le monde telles que les rixes, les assassinats, les émeutes, les arrestations arbitraires ou le trucage du vote. Au moins dans l’histoire des XXe et XXIe siècles, le Moyen-Orient n’a pas eu le monopole du recours à la violence en politique, soit-il considéré comme légitime ou illégitime.
Les ressemblances entre le Moyen-Orient et le reste du monde en termes d’incidence ou de fréquence ne valent évidemment pas ressemblance à tous les autres niveaux sur lesquels peut porter l’analyse. Ainsi les formes de la violence peuvent varier d’un endroit à l’autre et d’une période à une autre, tout comme les instruments employés pour exercer cette violence ou les traits saillants des acteurs qui la pratiquent. Ceci dit, ces variations sont aussi fréquentes et importantes à l’intérieur même du Moyen-Orient dont il ne faut cesser de rappeler qu’il est une construction, non pas une « région » qu’on pourrait identifier par des traits culturels comme la langue, la religion, ou la cuisine. Par extension, évitons de considérer toute différence entre le Moyen-Orient et d’autres constructions, y compris l’Europe, comme une spécificité « orientale » avant d’avoir étendu la comparaison au monde entier – ce qui, évidemment, poserait des défis pratiques considérables.
Dans la plupart des cas, la violence politique inter- et intra-étatique au Moyen-Orient telle qu’elle s’est manifestée au moins depuis le milieu du XIXe siècle était le résultat direct ou indirect d’un rapport de forces inégal entre des acteurs politiques qui y étaient ou sont domiciliés et d’autres qui lui sont ou étaient extérieurs3. Par implication, les causes de cette violence politique ressemblent largement à celles de la violence politique dans d’autres zones géographiques anciennement colonisées ou, plus précisément, tombées sous la domination des forces vives de l’impérialisme historique.
Souvent aboutissant à l’occupation militaire - britannique en Égypte, en Iraq, en Palestine et en (Trans)Jordanie ; britannique et soviétique en Iran ; française au Liban et en Syrie ; japonaise en Corée ; « plurielle » en Chine, cette domination a également été imposée par bien d’autres moyens, y compris des accords commerciaux et des crédits bancaires. Ainsi l’accord de Balta Liman de 1838 entre la Grande-Bretagne et l’Empire ottoman empêchait ce dernier et ses composantes partiellement autonomes comme l’Égypte de prélever des tarifs douaniers protégeant leurs propres industries manufacturières naissantes. Quant aux crédits octroyés au XIXe siècle par les banquiers européens à l’Empire et à l’Égypte, ils étaient assortis de taux et de collatéraux usuriers qui conduisaient les gouvernements à la faillite. Ajoutons que les établissements éducatifs comme le collège de la Sainte Famille au Caire ou le Collège protestant, puis Université américaine, de Beyrouth ne permettaient pas seulement aux « élites » locales de se familiariser avec le monde extérieur, mais également au monde extérieur de trouver des alliés locaux.
Si la domination européenne s’était renforcée progressivement pendant les siècles marqués par le déséquilibre croissant entre l’Empire ottoman d’une part et les (autres) puissances européennes d’autre part, elle s’est accentuée au dernier quart du 19e siècle, notamment par l’administration « internationale » de la dette de l’Empire et de l’Égypte. Sur le plan politique dans le sens étroit du terme, cette domination s’est précisément soldée par l’occupation militaire.
Au-delà de la violence immédiate inhérente à l’occupation militaire, les puissances européennes se sont employées à créer de nouvelles entités politiques ou à remodeler les entités politiques qui existaient déjà. Dans le cas des mandats qu’elles se sont octroyés au Croissant Fertile, elles ont tracé les frontières et mis en place des institutions dans le sens large ou institutionnaliste du terme : des pouvoirs exécutifs et des assemblées aux prérogatives limitées ainsi que la législation afférente, donc in fine des régimes politiques. En Iraq et en (Trans)Jordanie la Grande-Bretagne créa de toutes pièces des monarchies, tandis qu’en Syrie et au Liban la France mit en place des régimes républicains, tous évidemment sous occupation et ainsi dépourvus d’indépendance réelle. Ailleurs comme en Égypte, les puissances européennes ont plus ou moins entériné les frontières en place, mais toujours fortement influencé le jeu institutionnel. Ainsi le khedive (souvent traduit par vice-roi) de l’Égypte se voyait imposer un Premier ministre, position créée sur la demande des créditeurs européens dans les années 1870, et la forte réduction des effectifs de son armée. En Lybie et en Algérie, les habitants étaient livrés aux humeurs des occupants sans les quelques garde-fous prévus par le régime mandataire.
En cas de désaccord ou d’opposition, les décisions prises dans les capitales européennes ainsi que par leurs représentants sur place furent imposées par la force, donc par la violence. Dès 1920 l’armée levée par l’éphémère gouvernement « arabe » de Damas fut écrasée par les Français à Maysaloun ; en Irak, les révoltes successives contre l’occupation britannique et la nouvelle monarchie hachémite furent également réprimées dans le sang. La mise en place de nouvelles lois et d’autres institutions nécessairement redéfinissait les droits et les devoirs des uns et des autres, redistribuait les ressources matérielles et symboliques, et validaient ou invalidaient des normes. Même si le processus confortait la position de certains, il nuisait aux intérêts d’autres qui le subissait comme une violence à leur encontre. Ceux qui l’opposaient par la désobéissance furent contraints par une violence plus forte, celle des armes, jusqu’au bombardement de leurs villages et de leurs villes comme celui de Damas en 1925 et une nouvelle fois en 1945.
Nées de la violence coloniale ou remodelées par elle, les entités politiques devenues indépendantes après la Deuxième Guerre mondiale (et non pas par les déclarations d’indépendance unilatérales antérieures des puissances européennes) étaient souvent contestées par une bonne partie de leurs populations. Si la contestation portait sur les lois et les mécanismes de prise de décision, elle portait aussi sur les frontières de ces entités et donc leur existence en tant que telles. Les uns se sentaient violemment séparés des leurs qui vivaient sous la loi d’un État voisin, les autres se sentaient violemment mélangés avec des personnes et des groupes qu’ils n’avaient pas choisis. Les tensions inter-étatiques se trouvaient souvent renforcées par les efforts de détourner les tensions intérieures contre de supposés ennemis extérieurs.
Reproduits dans la durée par les acteurs eux-mêmes tout comme par les observateurs et toujours facilement utilisables pour mobiliser des soutiens politiques, les marqueurs culturels comme la langue ou la religion participaient d’autant plus à la structuration des conflits et des coopérations que les populations avaient été relativement peu touchées par les transformations sociétales fortement liées au capitalisme avancé et notamment à la révolution industrielle qui en Europe encourageaient les processus d’individualisation des personnes et leur homogénéisation culturelle plus forte en « nations »4. En plus, les occupants européens avaient joué sur ces marqueurs, souvent privilégiant des « minorités » religieuses, particulièrement les ouailles des différentes Églises chrétiennes.
La loyauté et la solidarité étant le plus souvent – ce qui ne veut pas dire toujours – conçues en termes de tels marqueurs culturels, les dynamiques politiques postérieures ont fréquemment monté les uns contre les autres et se sont traduites par la domination– ou la marginalisation – de réseaux ou de groupes reconnaissables en termes de religion, de langue ou de liens familiaux. En Syrie, dans les années 1960 et 1970 une coalition d’officiers largement druzes, ismaéliens et alaouites a progressivement évincé des postes de pouvoir les officiers sunnites avant de mener à la prééminence de certains Alaouites, tous se réclamant du parti Ba’th et de sa version de nationalisme arabe. En Iraq, les Chiites se considéraient marginalisés sous la monarchie finalement renversée en 1958 et sous Saddam Husayn au pouvoir de 1979 à 2003, tandis que les Sunnites se sont considérés marginalisés après le renversement de ce dernier. Comme toute dynamique d’exclusion, ces processus étaient nécessairement violents et ressentis comme tels. Dans le meilleur des cas, ils limitaient l’accès des perdants aux ressources et aux positions, dans le pire des cas ils débouchaient sur des assassinats et des massacres. Par endroits, ils ont provoqué des tentatives de sécession plus ou moins poussées ; en témoignent l’émergence d’une région kurde largement autonome en Iraq depuis des décennies tout autant que l’autonomie de fait de la montagne libanaise et de Beyrouth-Est, largement maronites, pendant la guerre civile de 1975-90.
Si l’exercice autoritaire du pouvoir – l’autoritarisme – si répandu au Moyen-Orient se nourrit souvent de telles dynamiques, il reflète également le manque de ressources des États, manque que seulement les principaux producteurs d’hydrocarbures ont pu partiellement surmonter au cours des décennies. Au moment de leur indépendance, les États du Moyen-Orient ne disposaient que d’une fraction des moyens matériels de leurs anciens maîtres. Aujourd’hui encore, selon la classification de la Banque mondiale, la plupart des États sont des pays à revenu inférieur ou à revenu moyen inférieur ; seuls les principaux producteurs d’hydrocarbures ont pu rejoindre la catégorie des pays à revenu élevé. Par exemple, en 1960 (la première année des statistiques comparatives de la Banque mondiale) le produit intérieur brut (PIB) de l’Égypte fut inférieur à US $ 5 milliards, avec un PIB par tête de US $ 162 ; en 2021 son PIB ne dépassa pas les US $ 404 milliards, avec un PIB par tête de US $ 3876 (tous les chiffres en dollars courants)5.
Or, sur la scène internationale, ces États devaient et doivent défendre leurs intérêts contre des États plus anciens, de plus en plus consolidés au cours des siècles comme la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, capables de mobiliser des moyens bien plus conséquents. Ainsi en 1960 le PIB de la France s’éleva à US $ 62 milliards, avec un PIB par tête de US $ 1337 ; en 2021, le PIB attint US $ 2,93 trillions et le PIB par tête US $ 43.518 (toujours en dollars courants)6. Les différences en termes de PIB trouvent leur fidèle écho sur d’autres plans comme ceux des contraintes budgétaires et des capacités militaires. Plus faibles que les puissances européennes, les « nouveaux États » issus de la décolonisation ont dû intégrer, tardivement, le jeu international défini et façonné depuis longtemps par les premières, sur le plan des échanges économiques tout comme sur les plans diplomatique et militaire7.
Pour pallier la faiblesse extérieure souvent la violence intérieure semblait la réponse à apporter. La peur des ingérences extérieures et du retour de l’impérialisme servait à justifier la répression. Sur le plan économique, la volonté de mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines pour atteindre le niveau de « développement » des pays les plus industrialisés encourageait la répression des grèves et la prise de décisions sans participation, parfois agrémentée par des mesures sociales faussement considérées comme des « pactes sociaux ». Après l’épuisement, vers 1970, du modèle de développement centré sur le secteur public, la chasse aux transferts de rentes, crédits de survie et investissements extérieurs encourageaient les mêmes pratiques répressives et autoritaires pour plaire à ceux qui pouvaient mettre à disposition ces ressources8.
Dans les années 1950-1980, un certain nombre d’États du Moyen-Orient semblaient néanmoins commencer à se consolider, politiquement et économiquement. Grâce à la Guerre froide et au pétrole, ils jouissaient du soutien de l’une ou de l’autre des superpuissances et de leurs alliés, réussissaient à augmenter leurs revenus, ou les deux à la fois. Les États-Unis accordaient leur soutien à l’Iran et à l’Arabie saoudite, avant la révolution de 1958 également à l’Iraq. L’Union soviétique soutenait de plus en plus la Syrie, l’Égypte, et après 1958 l’Irak. En parallèle, des accords plus équitables avec les compagnies pétrolières, puis leur nationalisation, transformaient progressivement les pays du Golfe arabo-persique, la Lybie et l’Algérie en États rentiers capables d’investir encore davantage dans le développement, dans la cooptation de leurs fidèles par la création d’emplois publics et de programmes sociaux, et dans la répression de leurs opposants. Particulièrement courtisée par les grandes et les superpuissances, l’Égypte, au cours de la Guerre froide, profita pendant longtemps des rentes stratégiques accordées à la fois par l’Union soviétique et les États-Unis. L’aide soviétique lui permettait de construire le haut barrage d’Assouan et de financer d’autres infrastructures et usines. En même temps, l’aide alimentaire américaine lui permettait de nourrir sa population. Partout, les dynamiques enclenchées par la Guerre froide et l’augmentation des revenus pétroliers permettaient de renforcer les appareils militaires, sources au moins potentielles de violence.
Après l’augmentation considérable du prix du baril dans les années 1970, les principaux producteurs de pétrole étaient en mesure d’initier des politiques ambitieuses dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la création d’industries (ce qui ne revient pas nécessairement à une stratégie cohérente d’industrialisation), de la santé, de l’éducation et de l’armement qui les renforçaient au moins dans la perception, parfois dans la pratique. En 1920 un État « artificiel », après 1945 quasiment en cessation de paiement, l’Irak à partir de 1980 était en mesure de mener pendant huit ans une guerre contre l’Iran.
Or, à partir de la moitié des années 1980, la baisse du prix du baril commençait à affecter les pays producteurs tout comme les pays non producteurs de pétrole. À peu près en même temps, les difficultés économiques grandissantes de l’Union soviétique, puis la fin de la Guerre froide affaiblissaient les États proches de Moscou comme la Syrie qui désormais devait payer comptant ses fournitures en armes. Un peu partout, les dépenses programmées dans les années fastes et les habitudes afférentes ne rimaient plus avec les revenus, fortement en baisse; souvent basés sur la distribution de faveurs matérielles, les mécanismes de cooptation commençaient à se fragiliser. La tendance vers une relative convergence des moyens entre les États au Moyen-Orient et ceux en Europe occidentale et en Amérique du Nord commençait à s’épuiser, voire à s’inverser.
Les principaux pays producteurs de pétrole faiblement peuplés réussissaient à sauver la mise et plus tard à rebondir. Épuisé par la guerre avec l’Iran, l’Irak en 1990 occupa le Koweït pour renflouer ses caisses, mais en fut chassé rapidement par une coalition internationale sous commandement américain. Les pays sans grandes ressources en hydrocarbures, le plus souvent fortement peuplés, commençaient la descente plus ou moins lente vers des crises de change et fiscales répétées ou endémiques. Les pays pétroliers leur versaient de moins en moins d’aides financières et ne leur permettaient plus aussi facilement d’exporter leur main-d’œuvre surabondante ; par conséquent, les remises des travailleurs expatriés, source importante de devises, diminuaient également, le taux de chômage augmentait et ainsi la grogne sociale. Dès les années 1980, les recours aux prêts du Fonds monétaire international (FMI) se multipliaient ; les États proches de l’Union soviétique comme la Syrie copiaient ses programmes de stabilisation macroéconomiques, même si officiellement ils ne demandaient pas le secours du Fonds.
Si la consolidation, voire le renforcement, des États du Moyen-Orient au cours de la Guerre froide et de la première période glorieuse du pétrole les avait parfois encouragés à mener une politique extérieure agressive et de réprimer avec brutalité toute opposition intérieure, leur fragilisation croissante n’imposait de limites à cette violence que dans la mesure où le nouveau monde unipolaire réduisait leurs options ; la prééminence des États-Unis et de leurs alliés, leur défense, bien que sélective, des procédures démocratiques et des droits humains dans bien de cas rendaient l’emploi de la force contre-productif.
Forcés à s’adapter aux dynamiques de la globalisation économique accentuée par la fin de la Guerre froide, les gouvernements au Moyen-Orient cherchaient également à rendre leurs politiques économiques et sociales compatibles avec les principes et le langage dominants de l’époque qu’on a pris l’habitude d’appeler « néolibéral ». Tout en défendant tant que possible un secteur public fort et facilement contrôlable, ils encourageaient la croissance du secteur privé et soumettaient l’allocation des ressources à des logiques de marché là où ils n’avaient le choix. Cette évolution ne pouvait que se traduire par de nouvelles formes de violence structurelle et physique ou, si l’on veut, « infrastructurelle » et « despotique9 ». Ici les grèves des ouvriers licenciés ou appauvris furent brisées par la force, là les métayers et même les paysans endettés durent quitter leurs terres pour survire dans le secteur informel des grandes villes. Indépendamment de sa définition en termes de manque de moyens matériels ou d’opportunités, la pauvreté qui touche les deux tiers ou plus de la population des pays fortement peuplés du Moyen-Orient exerce elle-même une forte violence sur ses victimes.
Excellente illustration de la violence politique exercée par les acteurs extérieurs au Moyen-Orient, l’occupation de l’Irak par les États-Unis et leurs alliés en 2003, une douzaine d’années après la guerre du Koweït, a déclenché des dynamiques de violence qui ont marqué le pays jusqu’à nos jours. Dans un premier temps la violence centralisée pratiquée par les gouvernants irakiens a cédé à la violence des occupants, puis à celle, décentralisée, des nombreux acteurs irakiens – individus, groupes et organisations – qui profitaient de la destruction de ce qui restait de l’État après l’imposition des sanctions internationales en 1990 et la guerre de 1991. L’invasion, les bombardements en amont et les pillages en aval ont dévasté bon nombre de ministères et de leurs services subordonnés. La dissolution de l’armée et du Parti Ba’th ainsi que les purges des échelons supérieurs de l’administration ont certes permis de déraciner l’ancien régime. Pourtant, en même temps elles ont privé des millions d’Irakiens de leur gagne-pain et les nouveaux gouvernants censés prendre la relève des occupants des capacités de coercition et d’action politique propres à un État. Elles ont ainsi encouragé l’essor d’acteurs armés non étatiques qui le plus souvent se sont définis en termes religieux ou linguistiques. En dernier lieu, ce ne sont pas les solidarités basées sur la langue ou la religion qui ont scellé le destin de l’État, mais c’est la destruction exogène de ce dernier qui a conduit à la fragmentation politique, au repli identitaire et à la décentralisation de la violence.
S’il est vrai que le gouvernement balayé par l’invasion était largement dominé par des Sunnites ou plutôt par certains Sunnites, cet état des choses découlait au moins en partie de la création de l’entité politique irakienne par le Royaume-Uni qui s’appuyait largement sur une partie de la population sunnite et des dynamiques identitaires ainsi enclenchées ou renforcées. Les tentatives des occupants de rééquilibrer la distribution des ressources, des postes et du pouvoir en faveur des Kurdes et des Chiites nécessairement réduisaient la part des Sunnites qui se sentaient victimes de dépossession et donc de violence. La lente émergence de l’État islamique (EI) qui commença peu après l’invasion - et non pas après le printemps arabe - n’en était que la conséquence la plus visible.
Quant au printemps arabe, il démontre bien qu’au Moyen-Orient comme ailleurs les protagonistes d’un conflit ne recourent pas nécessairement tous à la violence. Le constat est d’autant plus important que les enjeux étaient de taille : la distribution plus équitable des ressources matérielles, la participation politique, le respect de la dignité des gouvernés, et, chemin faisant, le maintien au pouvoir des gouvernants. En Tunisie et en Égypte, la contestation était pacifique, bien que la répression fût parfois violente ; le président Bin Ali put partir en exil, le président Mubarak fut jugé mais in fine acquitté. Au Maroc et en Jordanie même la réponse gouvernementale aux manifestations restait largement pacifique.
En Syrie l’opposition restait pacifique pendant des mois, et ceci malgré la répression violente. Par la suite, la militarisation d’une partie de l’opposition et l’internationalisation des soutiens aux protagonistes, y compris le gouvernement, ont débouché sur ce qu’on appelle souvent une guerre civile. L’intervention ouverte de la Russie, puissance qu’on ne saurait appeler moyen-orientale, aux côtés du gouvernement en 2015 a exacerbé la violence ; ses efforts pour soutenir Bachar al-Asad ressemblent ainsi aux efforts américains pour renverser Saddam Husayn. En Libye la répression des manifestations fut certes violente ; pourtant l’intervention militaire, cette fois-ci sur initiative européenne, et la chute de Muammar al-Qadhafi ont perpétué la violence.
À ce jour, toutes les tentatives de reconstruire les États déchirés par la violence physique ou de « stabiliser » ceux affectés par des difficultés économiques endémiques se sont traduites par de nouvelles violences. Les nombreux efforts, le plus souvent sous la houlette du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, de pallier les déficits budgétaires et extérieurs d’États à revenus (moyens) inférieurs comme l’Égypte, la Jordanie, la Tunisie ou le Maroc n’ont jamais fondamentalement changé la donne et enclenché une croissance durable et inclusive. En revanche, les conditions régissant l’octroi des crédits et d’autres aides ont toujours et partout impacté la distribution des ressources matérielles – ou de richesses – de manière à créer non seulement des gagnants mais également des perdants. Plus nombreux que les premiers, les seconds ont subi la violence des pertes d’emploi ou de la baisse des subventions alimentaires, suivie de la violence physique en cas de contestation même pacifique. Considérer ces réformes comme inévitables n’enlève rien à leur férocité.
Dans les pays dévastés par la violence politique à grande échelle, les efforts de reconstruction physique ou matérielle, souvent peu consensuels, ont également engendré de nouvelles violences. Parfois initiés et menés par les vainqueurs (relatifs) des affrontements armés ou des entrepreneurs sachant saisir les opportunités, ces efforts ont en général bénéficié d’importants soutiens extérieurs financiers, techniques, politiques ou « moraux ». Après la guerre civile libanaise, la reconstruction de Beyrouth sous Rafiq Hariri faisait la part belle aux investissements privés, y compris étrangers, et ainsi ancrait le Liban fermement dans les circuits de la mondialisation économique et des représentations qui l’accompagnent. Dans le même ordre d’idées, la reconstruction tout aussi fragile de l’Iraq après 2003 partait d’abord du principe de la privatisation d’entreprises publiques, de la recherche d’investissements étrangers et d’autres mesures de libéralisation économique propagées par les principaux acteurs du capitalisme mondial ; par la suite, les immenses transferts de fonds publics en provenance des États-Unis et de leurs alliés ont de nouveau souligné le rôle d’acteurs extérieurs incontournables pour leur puissance financière. Quant aux efforts de reconstruction à peine entamés, modestes et balbutiants en Syrie, ils sont souvent portés par des investisseurs russes et iraniens proches de leurs propres gouvernements et ainsi capables de s’imposer localement ; les seuls acteurs syriens en lice sont le gouvernement largement insolvable et les entrepreneurs à sa botte qui grâce à leur position peuvent également évincer leurs concurrents et réaliser des profits sur le dos des ressortissants ordinaires.
Par le biais de la reconstruction matérielle et économique, les acteurs extérieurs participent également à refaçonner ou recomposer les rapports sociaux et politiques qui à bien des égards dépendent de la répartition des ressources. En Iraq, le régime politique a même été complètement remplacé par les décisions américaines prises dès 2003 et par la constitution de 2005, elles aussi fortement influencées par les néoconservateurs de l’époque. Nulle part, la reconstruction n’est l’œuvre d’un consensus entre les ressortissants du pays concerné ou de leurs représentants élus. Parfois euphémisé comme tel, l’accord de Taif signé en 1989 pour mettre fin à la guerre civile au Liban a été imposé par l’Arabie saoudite, la Syrie et les États-Unis. Les acteurs locaux associés à la reconstruction cherchent avant tout à exploiter la situation et percevoir une rente d’intermédiaire ou de dragoman dont les extérieurs ont besoin. Ils cherchent à peser sur les décisions politiques et à s’enrichir, largement par des processus d’accumulation primitive de capital. L’œuvre supposée bienveillante de la reconstruction de l’Irak n’est qu’un avatar de la création de cette entité politique par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Ajoutons que les efforts de reconstruction économique et politique n’ont pas été menés avec la même force, consistance et implication extérieure comme en Allemagne et au Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Conjugué à la trajectoire historique du pays, ce décalage ne permet pas d’espérer les mêmes résultats.
Le constat dressé sur les pages précédentes n’est pourtant pas censé inviter les acteurs extérieurs à s’abstenir de tout effort de reconstruction au Moyen-Orient ou ailleurs. Il se peut que la destruction physique, sociétale et politique empêche tout projet indigène à la hauteur des défis. Le dilemme est alors celui de choisir entre les dangers quasi congénitaux des projets venant de l’extérieur d’une part et les dangers d’une situation ou d’une dynamique délétère d’autre part. Les projets de reconstruction promus ou soutenus de l’extérieur risquent de répéter les erreurs d’interventions antérieures ; l’absence de reconstruction perpétue les violences générées par la destruction. Seule la reconstruction qui émane d’un consensus entre les acteurs sur place basé sur la délibération et la participation, et bien plus large et solide que ce que le jargon actuel désigne par le « ownership », permet d’échapper au dilemme ; tout soutien extérieur doit être encadré par des garde-fous qui garantissent la priorité de ce consensus.
Le constat sert avant tout à rappeler qu’au Moyen-Orient la violence politique qu’on observe implique des acteurs extérieurs à cette zone géographique qui sont plus influents et puissants que les acteurs locaux. Il ne prétend pourtant pas nier que le Moyen-Orient aurait pu être marqué par d’autres violences, si son histoire avait emprunté d’autres chemins.
1. Surtout, mais non exclusivement, pour les périodes plus récentes, voir Hamit Bozarslan, Le temps des monstres : le monde arabe 2011-2021, Paris, La Découverte, 2022.
2. Voir les statistiques du Correlates of War Project : https://correlatesofwar.org.
3. Pour l’histoire du Moyen-Orient depuis le 17e siècle, voir Henry Laurens, Les Crises d’Orient, t.1 :1768-1914 et t.2 : 1914-1949, Paris, Fayard, 2017 et 2019 ; Eugène Rogan, Histoire des Arabes, Paris, Tempus Perrin, 2016
4. Éric Hobsbawm, Nations et nationalismes depuis 1780, Paris, Gallimard, 1992.
5. Voir statistiques de la Banque mondiale, https://data.worldbank.org (consultées le 20/11/2022.
6. Voir statistiques de la Banque mondiale, https://data.worldbank.org (consultées le 20/11/2022.
7. Adham Saouli, The Arab State: Dilemmas of Late Formation, Abingdon, Routledge, 2012.
8. Pour l’économie politique du Moyen-Orient depuis le XIXe siècle, voir Roger Owen / Sevket Pamuk, A History of Middle East Economies in the Twentieth Century, London, I.B.Tauris, 1998 ; Melani Cammett / Ishac Diwan, Alan Richards / John Waterbury, A Political Economy of the Middle East, 4th edition, Abingdon / New York; N.Y., Routledge, 2018; Eberhard Kienle, ‘‘Economic Reform since the 1989: The Political Corollaries of a Political Project’’, in : Larbi Sadiki (dir.),