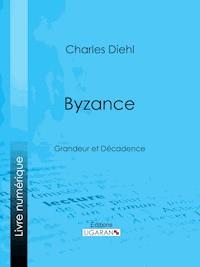
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le jour où Constantin fonda Constantinople et en fit la seconde capitale de l'empire romain, — ce jour-là, le 11 mai 330, — l'empire byzantin commença. Par sa situation géographique, au point où l'Europe se rencontre avec l'Asie, Constantinople était le centre naturel autour duquel pouvait se grouper le monde oriental."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’histoire de l’empire byzantin, malgré les travaux qui, en ces cinquante dernières années, l’ont presque renouvelée, demeure toujours cependant l’objet de tenaces préjugés. À beaucoup de nos contemporains elle apparaît toujours, telle qu’elle apparaissait à Montesquieu et à Gibbon, comme la continuation et la décadence de l’empire romain. En vérité Byzance fut tout autre chose. Quoiqu’elle se soit volontiers proclamée l’héritière et la continuatrice de Rome, quoique ses empereurs jusqu’au dernier jour se soient intitulés « basileis des Romains », quoique les ambitions des princes qui la gouvernèrent se soient souvent étendues au monde occidental et qu’ils n’aient jamais renoncé aux droits qu’ils réclamaient sur l’antique et glorieuse capitale de l’empire, en fait pourtant Byzance devint très vite et fut essentiellement une monarchie d’Orient. Il ne faut point la juger par comparaison avec les souvenirs écrasants de Rome : ainsi qu’on l’a dit justement, elle fut « un état du Moyen Âge, placé sur la frontière extrême de l’Europe, aux confins de la barbarie asiatique ». Mais, tel qu’il fut, cet état fut grand.
Par ailleurs, durant les mille années qu’elle a survécu à la chute de l’empire romain, Byzance n’est point, comme on le croit trop volontiers, descendue d’une marche ininterrompue vers la ruine. Aux crises où elle a failli succomber, bien des fois ont succédé des périodes d’incomparable splendeur où, selon le mot d’un chroniqueur, « l’empire, cette vieille femme, apparaît comme une jeune fille parée d’or et de pierres précieuses ». Pendant mille ans, Byzance a vécu, et pas seulement par l’effet de quelque hasard heureux : elle a vécu glorieusement. Elle a eu, pour la gouverner et conduire ses affaires, de grands empereurs, des hommes d’État illustres, des diplomates habiles, des généraux victorieux ; et, entre leurs mains, elle a accompli une grande œuvre dans le monde. Elle a été, avant les croisades, et avec plus de persévérance peut-être, le champion de la chrétienté en Orient contre les infidèles ; elle a été, en face de la barbarie, le centre d’une civilisation admirable, la plus raffinée, la plus élégante qu’ait longtemps connue le Moyen Âge. Elle a été l’éducatrice de l’Orient slave et asiatique ; son influence, enfin, s’est étendue jusque sur l’Occident, qui a appris infiniment à l’école de Constantinople. Et, sans doute, cet empire a eu ses faiblesses, ses défauts, ses vices, et il s’est finalement écroulé en 1453 sous les coups des Turcs. Pourtant, si l’on essayait, par une représentation graphique, d’exprimer l’évolution de son histoire millénaire, ce n’est point par une ligne droite, descendant sans arrêt vers l’abîme, qu’il la faudrait figurer, mais bien par une série de courbes, tour à tour ascendantes et descendantes. C’est là ce qu’il ne faut jamais perdre de vue si l’on veut comprendre l’histoire de l’empire byzantin, étudier les causes profondes de sa grandeur et de sa décadence : c’est pourquoi, avant d’entreprendre cette étude, et pour son intelligence, il est indispensable de rappeler, en un résumé rapide, les traits caractéristiques de cette longue histoire et l’évolution de cet empire millénaire.
De la fondation de Constantinople à la fin du IXe siècle (330-867).
La formation de l’empire oriental (330-565). – L’empire depuis la fondation de Constantinople jusqu’au commencement du VIe siècle (330-518). – Le jour où Constantin fonda Constantinople et en fit la seconde capitale de l’empire romain, – ce jour-là, 11 mai 330, – l’empire byzantin commença. Par sa situation géographique, au point où l’Europe se rencontre avec l’Asie, Constantinople était le centre naturel autour duquel pouvait se grouper le monde oriental. D’autre part, par l’empreinte hellénique qui la marquait, par le caractère nouveau surtout que lui donnait le christianisme, la jeune capitale, « la nouvelle Rome », différait profondément de l’ancienne et symbolisait les aspirations nouvelles et les caractères nouveaux du monde oriental. Et par là, quoique, pendant un siècle et demi encore, l’empire romain ait subsisté, – jusqu’en 476 – quoique, jusqu’à la fin du VIe siècle encore, en Orient même, la tradition romaine soit demeurée vivace et puissante, pourtant, autour de la ville de Constantin, la partie orientale de la monarchie s’aggloméra et prit en quelque sorte, conscience d’elle-même. Et aussi bien, dès le IVe siècle, sous le maintien apparent et théorique de l’unité romaine, plus d’une fois, en fait, les deux moitiés de l’empire se séparèrent, gouvernées par des empereurs différents ; et lorsqu’en 395 Théodose le Grand mourut, laissant à ses deux fils Arcadius et Honorius une succession partagée en deux empires, la séparation qui, depuis longtemps, tendait à isoler l’Orient de l’Occident, se précisa et devint définitive.
Durant la longue période d’histoire qui va de 330 à 518, deux crises graves, en ébranlant l’empire, achevèrent de donner à sa partie orientale sa physionomie propre. L’une fut la crise de l’invasion barbare. On put croire d’abord que Byzance ne la supporterait pas mieux que Rome, qu’elle ne résisterait pas au choc formidable que lui portèrent, au cours du Ve siècle, tour à tour les Wisigoths d’Alaric, les Huns d’Attila, les Ostrogoths de Théodoric. En fait, il en fut autrement. Tandis que, dans les lambeaux de l’empire d’Occident, des chefs barbares se taillaient des royaumes, tandis que le dernier empereur romain disparaissait en 476, l’invasion glissait le long des frontières de l’empire d’Orient et ne l’entamait que passagèrement : si bien que la nouvelle Rome restait debout, – comme grandie de toute la catastrophe où s’abîmait l’ancienne Rome, et par là, rejetée davantage encore vers l’Orient.
L’autre crise fut la crise religieuse. C’est en Orient que prirent naissance toutes les grandes hérésies qui troublèrent l’Église aux IV et Ve siècles, arianisme, nestorianisme, monophysisme, toutes ces discussions compliquées où s’opposèrent en un saisissant contraste l’esprit grec épris de subtile métaphysique théologique et le clair et sobre génie du monde latin, où se heurtèrent aussi en une lutte violente l’épiscopat d’Orient, souple et docile serviteur des volontés du maître, et la hauteur intransigeante, la fermeté ambitieuse des pontifes romains. Dès le second tiers du Ve siècle, le schisme séparait une première fois Rome et Byzance. Et, de plus en plus, apparaissait, au temps des Zénon, des Anastase, la conception d’un empire purement oriental, vivant d’une vie à part, et où se rencontraient déjà quelques-uns des traits caractéristiques de ce que sera l’empire byzantin : une monarchie absolue, à la façon des monarchies orientales ; une administration fortement centralisée ; une Église dont la langue était le grec et qui par là tendait à se constituer en un organisme indépendant, une Église qui, d’autre part, dépendait étroitement de l’État qui la gouvernait. L’évolution qui entraînait Byzance vers l’Orient semblait près d’être achevée.
Le règne de Justinien (518-565). – Le VIe siècle interrompit cette évolution qui semblait naturelle et nécessaire. L’empereur Justinien (518-565), dont la puissante figure domine toute cette époque, voulut être un empereur romain, et il fut, en effet, le dernier des grands empereurs de Rome. Ce paysan de Macédoine fut le représentant éminent de deux grandes idées, l’idée impériale, l’idée chrétienne, et c’est par là que son nom marque dans l’histoire. Héritier des Césars et tout plein des souvenirs de la grandeur romaine, il eut tous les orgueils et toutes les ambitions. Il rêva de reconstituer l’unité romaine, de restaurer les droits imprescriptibles que Byzance, héritière de Rome, gardait sur les royaumes barbares d’Occident ; et, en effet, il reconquit l’Afrique, l’Italie, la Corse, la Sardaigne, les Baléares, une partie de l’Espagne, et les rois francs de la Gaule acceptèrent sa suzeraineté. Continuateur des grands empereurs de Rome, il fut, comme eux, la loi vivante, l’incarnation la plus pleine du pouvoir absolu ; il fut le législateur impeccable, le réformateur soucieux du bon ordre de l’empire. Il voulut enfin parer sa grandeur impériale de toutes les magnificences : Sainte-Sophie, qu’il reconstruisit avec une merveilleuse splendeur, fut le monument incomparable où il voulut éterniser la gloire de son règne et de son nom. Et, aujourd’hui encore, à Saint-Vital de Ravenne, les mosaïques étincelantes qui flamboient dans l’abside solitaire évoquent, en une saisissante image, la pompe fastueuse dont s’entouraient les maîtres du Palais-Sacré de Byzance.
Justinien rêva davantage. Représentant et vicaire de Dieu sur la terre, il se donna pour tâche d’être le champion de l’orthodoxie dans le monde et de propager la vraie foi à travers l’univers. Mais peut-être, dans ses ambitions formidables, y eut-il plus de grandeur apparente que réelle, et Théodora peut-être, elle aussi une parvenue devenue impératrice, voyait plus juste que son impérial époux. Tandis que Justinien, se perdant dans les rêves d’une ambition grandiose et fumeuse, ne considérait que l’Occident et se flattait de soutenir l’empire romain reconstitué sur l’étroite alliance rétablie avec la papauté, elle, avec un sentiment plus net et plus exact des réalités politiques, tournait les yeux vers l’Orient. Elle eût voulu y apaiser les querelles préjudiciables à la puissance de l’empire, ramener, par d’opportunes concessions, les nationalités dissidentes, telles que celles de Syrie ou d’Égypte, et, fût-ce au prix d’une rupture avec Rome, reconstituer la forte et solide unité de la monarchie orientale. Et on peut se demander si l’empire qu’elle rêvait, plus ramassé, plus homogène, n’eût pas mieux résisté aux Perses et aux Arabes ; et on peut soutenir sans paradoxe que ce règne illustre de Justinien, en arrêtant l’évolution naturelle de l’empire d’Orient, en l’épuisant au service d’ambitions excessives, lui fit, malgré l’éclat dont il l’environna, plus de mal que de bien. L’Orient négligé allait se venger – de la façon la plus redoutable.
La transformation et l’organisation de l’empire oriental. – Pourtant, jusqu’ici, malgré les tendances qui l’entraînaient vers l’Orient, l’empire byzantin apparaissait encore comme le continuateur de Rome. Le latin y restait – si étrange que ce fût – la langue officielle ; la tradition romaine y était toute-puissante ; l’administration conservait les titres et les cadres que lui avaient légués les Césars. Du commencement du VIIe siècle au milieu du IXe, la transformation dans le sens oriental se précipita et s’acheva.
La transformation de l’empire au VIIe siècle (610-717). – L’empire paya cher les grandes ambitions de Justinien. Lui mort, la liquidation de son œuvre fut désastreuse. À l’intérieur, financièrement, militairement, la monarchie est lamentablement épuisée. Au dehors, la menace perse redevient redoutable, et bientôt, plus terrible encore, s’abat sur l’empire le torrent de l’invasion arabe. Les querelles religieuses aggravent l’anarchie politique. Dans l’histoire de Byzance, le VIIe siècle (610-717) est une des périodes les plus sombres, une époque de crise grave, un moment décisif où il semble que l’existence même de l’empire soit en jeu.
Sans doute, on y rencontre encore des figures intéressantes et hautes. Par un magnifique et tenace effort, Héraclius (610-641) contient et refoule les Perses victorieux ; à la tête des légions qu’il enflamme de son enthousiasme, il porte la guerre au cœur de l’Asie ; il triomphe à Ninive, il triomphe aux portes de Ctésiphon, il venge le christianisme des insultes des Perses, et il entre dans la légende comme le premier des croisés. Sa politique religieuse complète son œuvre militaire et s’efforce de rendre l’unité morale à la monarchie matériellement reconstituée. Mais de son vivant déjà, l’empire se démembre. Les Arabes conquièrent la Syrie, l’Égypte, l’Afrique du Nord, l’Arménie ; en Italie, les Lombards sont maîtres de plus de la moitié de la péninsule. Le territoire de l’empire se réduit à l’Asie Mineure, à la péninsule des Balkans, à l’exarchat de Ravenne, domaine restreint et partout menacé, par les Lombards, par les Slaves, par les Arabes, par les Bulgares. Jusque-là la monarchie était demeurée un empire romain de caractère universel : maintenant, elle devenait un empire proprement byzantin, dont toutes les forces se concentraient autour de Constantinople.
De tout cela résulte une transformation profonde. Transformation ethnographique d’abord : les Slaves s’installent dans les Balkans, Serbes et Croates au nord-ouest, Bulgares au nord-est. Transformation administrative : tous les pouvoirs se concentrent, pour les besoins de la défense, entre les mains des chefs militaires ; le régime des thèmes commence à s’organiser, qui durera aussi longtemps que l’empire. Transformation sociale surtout : l’élément hellénique prend une place chaque jour plus considérable, dans la langue où le latin disparaît devant le grec, dans la littérature qui s’inspire d’idées et se modèle selon des formes nouvelles, dans toutes les habitudes de la vie, en même temps que l’élément chrétien marque de plus en plus sa prédominance, par le rôle que joue l’Église dans les affaires publiques, par le développement croissant du monachisme. Transformation politique enfin : la rivalité avec Rome s’aigrit par d’incessants conflits, la rupture se prépare, qui détachera bientôt l’Occident de Byzance ; et par là, de plus en plus, l’attention des souverains se concentre sur l’Orient. Et, sans doute, cette transformation, qui renouvelle alors presque radicalement l’empire, n’a point été toujours, ni de tous points, heureuse. Aux progrès de la superstition correspond l’assauvagissement des mœurs ; les révoltes militaires incessantes attestent la démoralisation croissante, le manque croissant de loyauté et de fidélité. Mais, malgré la décadence de la monarchie, affaiblie au dehors, menacée sur toutes les frontières, troublée au-dedans par une anarchie de vingt années (695-717), un fait important, essentiel, apparaît au terme de cette trouble période de transformation et de gestation. Il existe un empire byzantin, diminué sans doute, mais plus ramassé, débarrassé du poids mort de l’Occident et du danger des séparatismes orientaux, un empire capable d’être fortement organisé et de vivre, dès qu’il se rencontrera une main vigoureuse pour le conduire.
L’œuvre de la dynastie isaurienne (717-867). – Cette main se rencontra. Les empereurs isauriens (717-867) furent les artisans glorieux de la réorganisation définitive de l’empire.
On juge souvent sévèrement – et fort mal – les empereurs iconoclastes. On se souvient surtout de leur politique religieuse, dont on comprend d’ailleurs imparfaitement l’intention et la portée. On oublie en quelle situation ils trouvèrent l’empire et quelle œuvre de réorganisation complète ils durent entreprendre. Léon III, Constantin V furent de très grands empereurs, violents, autoritaires, passionnés et durs, mais de grands généraux aussi, qui brisèrent l’élan de l’Islam et refoulèrent l’ambition des Bulgares, d’habiles administrateurs, qui accomplirent une grande œuvre législative, administrative et sociale, et à qui leurs adversaires mêmes ont parfois rendu justice.
Sans doute, leur politique a eu quelques conséquences fâcheuses. À l’intérieur, la querelle des images qu’ils déchaînèrent troubla l’Orient pendant cent vingt ans (726-842) ; au dehors, ce furent d’autres désastres, la rupture avec Rome, la perte de l’Italie, le rétablissement de l’empire pour Charlemagne (800) : toutes choses qui, au reste, achevèrent de rejeter Byzance vers l’Orient. Mais, d’autre part, sous la main vigoureuse des Isauriens, le pouvoir impérial, sorti victorieux de la lutte contre l’Église réclamant sa liberté, s’affermit prodigieusement ; et malgré les dangers extérieurs – le péril bulgare qui, au commencement du IXe siècle, menaça Constantinople même, la conquête de la Crète par les Arabes (826), qui ôta toute sécurité aux mers orientales – l’empire, vers le milieu du IXe siècle, était brillant et fort.
Sous le règne de l’empereur Théophile (829-841), la cour de Byzance, par la splendeur des constructions, le luxe du Palais-Sacré, l’éclat de la civilisation, rivalisait avec la Bagdad des Khalifes. Au sortir d’une longue période de troubles, la littérature et l’art semblaient retrouver une vigueur nouvelle, et déjà préludaient à une magnifique renaissance. L’Université de Constantinople, reconstituée par le César Bardas (vers 850), redevenait le centre d’une culture intellectuelle admirable. Et l’influence de l’empire se faisait au dehors sentir jusque dans le monde slave, auquel Cyrille et Méthode, « les apôtres des Slaves », apportaient, avec la foi orthodoxe, son alphabet et sa langue littéraire. Enfin, depuis 842, l’unité religieuse était rétablie dans l’empire, et l’Église grecque prenait de plus en plus une forme nationale, que soulignait et précisait le schisme de Photius.
Ainsi, au moment où s’achève cette période, il existe vraiment une nationalité byzantine, lentement formée à travers les évènements ; et l’empire, nettement oriental, prélude à l’apogée magnifique qui, entre la fin du IXe et le milieu du XIe siècle, lui vaudra cent cinquante années de splendeur, de prospérité et de gloire.
L’apogée de l’empire sous la dynastie de Macédoine (867-1081). – De 867 à 1025, l’empire byzantin a connu cent cinquante ans d’une incomparable splendeur. Pendant un siècle et demi, il a eu à sa tête une succession de souverains qui, presque tous, ont été des hommes remarquables. Basile Ier, le fondateur de la dynastie, Nicéphore Phocas et Jean Tzimiscès, usurpateurs glorieux qui gouvernèrent sous le nom des princes légitimes, Basile II enfin, qui régna tout un demi-siècle, de 976 à 1025, n’ont point été des empereurs de Byzance tels qu’on se plaît trop volontiers à les représenter. Ce sont des âmes énergiques et dures, sans scrupules souvent et sans pitié, des volontés autoritaires et fortes, plus soucieuses de se faire craindre que de se faire aimer ; mais ce sont des hommes d’État, passionnés pour la grandeur de l’empire, des chefs de guerre illustres, dont la vie se passe dans les camps, parmi les soldats en qui ils voient et aiment la source de la puissance de la monarchie ; ce sont des administrateurs habiles, d’une énergie tenace et inflexible, et que rien ne fait hésiter quand il s’agit d’assurer le bien public. Ils n’ont point le goût des dépenses inutiles, uniquement préoccupés d’accroître la richesse nationale : le faste éclatant du palais, la pompe vaine des cortèges et des cérémonies ne les intéressent qu’autant qu’ils servent leur politique et entretiennent le prestige du souverain. Jaloux de leur autorité, ils n’ont point – ceux-là du moins que j’ai nommés – de favoris : leurs conseillers sont le plus souvent des hommes obscurs qu’ils emploient et dont ils demeurent les maîtres. Épris de gloire, le cœur plein des ambitions les plus hautes, ils ont voulu faire de l’empire byzantin la grande puissance du monde oriental, champion tout ensemble de l’hellénisme et de l’orthodoxie ; et par l’effort magnifique de leurs armes, par la souple habileté de leur diplomatie, par la vigueur de leur gouvernement, ils ont réalisé leur rêve.
Depuis la fin du IXe siècle, et davantage encore à partir du premier tiers du Xe, hardiment, sur toutes ses frontières, l’empire reprend l’offensive. En Asie, les Arabes reculent de la ligne de l’Halys jusqu’au-delà de l’Euphrate, les armées impériales parcourent victorieuses la Cilicie, la Syrie, la Palestine, et Jean Tzimiscès pousse ses escadrons jusqu’aux portes de Jérusalem. En Europe, le puissant empire bulgare, dont les grands tsars Syméon et Samuel avaient fait dans les Balkans le rival redoutable de Byzance, s’écroule dans le sang sous les coups de Basile II, à qui la reconnaissance de ses sujets a décerné le surnom tragique de « Bulgaroctone », le massacreur de Bulgares. Contre les ravages des corsaires musulmans, les flottes byzantines font de nouveau la police des mers. Jusque dans l’Italie lointaine, la tradition toujours vivace des vieilles ambitions romaines réveille les prétentions jamais oubliées, et, en face des Césars du Saint-Empire romain germanique, les basileis byzantins, orgueilleusement, maintiennent les droits et le prestige de leur majesté séculaire.
Avec une extension qu’on ne lui avait plus connue depuis les temps lointains de Justinien, l’empire règne de la Syrie au Danube, de l’Arménie annexée à l’Italie du sud reconquise. Et tout autour de lui, son habile diplomatie groupe un cortège de vassaux, Italiens et Slaves, Arméniens et Caucasiens, par qui l’influence de Byzance se propage largement à travers le monde. Comme Rome autrefois, Byzance est la grande éducatrice des barbares : Croates, Serbes, Bulgares, Russes lui doivent leur religion, leur langue littéraire, leur art et les formes de leur gouvernement ; au rayonnement de la civilisation byzantine, tous se sont adoucis, apprivoisés, instruits. Au temps des empereurs de la maison de Macédoine, Constantinople est vraiment la cité reine, où se concentrent toutes les élégances, tous les raffinements du luxe et de l’art, les plaisirs délicats de l’esprit et les chefs-d’œuvre d’une industrie savante, les merveilles de l’architecture et les amusements du cirque et du théâtre ; c’est le « Paris du Moyen Âge », dont la richesse et la splendeur excitent, dans tout le monde barbare, la convoitise et l’admiration. Dans l’empire enfin, progressivement, sous la main de princes énergiques, l’ordre et la sécurité se rétablissent, gages de la prospérité ; l’édifice du pouvoir absolu se consolide ; et dans la monarchie orientale reconstituée, les empereurs de la maison de Macédoine ambitionnent, comme jadis Justinien, la double gloire de législateurs et d’administrateurs. Quand Basile II mourut en 1025, l’empire byzantin était à l’apogée de la puissance, de la prospérité, de la gloire. Son territoire avait été plus que doublé. L’orgueil des grands barons féodaux était abattu. Le trésor renfermait une réserve de plus d’un milliard. Et, dans tout l’Orient, la monarchie était environnée d’un prestige éclatant.
Pour maintenir ce prestige et cette puissance, il eût suffi de princes énergiques, continuant les traditions d’une politique habile et forte. Malheureusement, on eut des gouvernements de femmes ou de souverains médiocres et négligents. Et ce fut le point de départ d’une nouvelle crise. Sous des empereurs plus faibles, l’aristocratie abattue releva la tête ; et par crainte des soulèvements militaires, on laissa s’énerver la puissance de l’armée. On eut un gouvernement civil, de bureaucrates ou d’intellectuels : et bientôt ce fut l’anarchie. Anarchie dangereuse, car au dehors montaient à l’horizon deux périls graves, les Normands en Occident, les Turcs Seldjoucides en Orient. Ce n’est pas que ces ennemis fussent plus redoutables que tant d’autres que Byzance avait autrefois vaincus ; comme tant d’autres, Byzance aurait pu les helléniser, les soumettre à son influence, en faire ses vassaux. Mais l’empire maintenant était plus faible. Ajoutez le schisme, la rupture définitive avec l’Église romaine, qui fut une autre cause de troubles. Les Byzantins semblaient n’en prendre nul souci. Intrigues de cour et guerres civiles, révolutions à Constantinople et anarchie dans les provinces, voilà l’aspect qu’offre la monarchie pendant près de vingt-cinq ans. En 1081, trois empereurs se disputaient le pouvoir, et les Turcs, vainqueurs de Romain IV à la désastreuse journée de Mantzikiert (1071), campaient presque en face de Constantinople. On semblait à la veille de la ruine.
La renaissance de l’empire sous les Comnènes (1081-1204). – Et pourtant, une fois encore, l’empire connut une restauration inattendue. Ce fut l’œuvre de la dynastie des Comnènes (1081-1185). Comme les Capétiens en France, les Comnènes étaient une grande famille féodale, et leur avènement semblait marquer le triomphe de la grande aristocratie militaire. Comme les Capétiens, les Comnènes surent reconstituer l’autorité monarchique ébranlée. Quatre princes éminents se succèdent sur le trône : Alexis et Jean, grands généraux, administrateurs habiles, diplomates ingénieux ; Manuel, le plus séduisant de la race, tout ensemble brave jusqu’à la témérité et théologien subtil, élégant, fastueux, viveur et lettré, curieux mélange des qualités chevaleresques de l’Occident et de l’esprit traditionnel de Byzance, et qui fut peut-être, sur le trône impérial, le dernier des grands souverains de la monarchie, par les ambitions grandioses qu’il forma comme par l’effort qu’il tenta pour les réaliser ; Andronic enfin, le plus intelligent de la famille, qui, après avoir rempli le XIIe siècle du bruit de ses aventures romanesques et du scandale de ses vices, fit penser aux contemporains, une fois sur le trône, que par ses hautes qualités « il aurait pu être égal aux plus grands » : puissante et pittoresque figure, à la fois géniale et corrompue, tyran abominable et homme d’État supérieur, qui aurait pu sauver l’empire et ne fit que précipiter sa ruine. Ici encore, on le voit, les hommes ne manquèrent pas à Byzance. Et, sans doute, il était trop tard pour que les Comnènes rendissent à l’empire toute sa gloire passée : les Turcs étaient à Iconium, et ils y restèrent ; dans les Balkans, avec l’appui de la Hongrie grandissante, les peuples slaves se constituaient en états presque indépendants. Malgré cela, les Comnènes ont donné à l’empire un dernier rayon de splendeur et, dans le désastre des siècles suivants, les peuples, bien souvent, se sont souvenus du siècle des Comnènes comme d’une époque brillante et heureuse entre toutes.
Une fois encore, sur toutes les frontières, les armées byzantines apparaissent actives, souvent victorieuses : contre les Normands d’Italie, dont la convoitise s’étend vers l’Orient, et qu’elles repoussent ; contre les Turcs, qu’elles tiennent en échec ; et bientôt, la situation étant rétablie, contre les Serbes, contre les Hongrois, et jusqu’en Occident, contre les rois normands de Sicile et contre les empereurs allemands. La diplomatie impériale étend partout sa souple habileté et ses intrigues savantes, d’Iconium à Venise, en Hongrie, en Allemagne, en France, en Italie comme en Syrie ; dans le monde du XIIe siècle, Constantinople est un des centres principaux de la politique européenne. À l’intérieur, une grande œuvre s’accomplit de réorganisation administrative et sociale. La société byzantine du XIIe siècle apparaît merveilleusement élégante et raffinée, curieuse des choses de l’esprit, éprise des choses d’art. Et Constantinople est la capitale incomparable par sa splendeur et par sa richesse. Les voyageurs qui la visitent en font des descriptions merveilleuses et en gardent un souvenir ébloui, Eudes de Deuil comme Benjamin de Tudèle, Robert de Clari comme Villehardouin. Prospérité dangereuse au reste, par les convoitises qu’elle excitait qui allait perdre l’empire.
Un grave évènement marque en effet le siècle des Comnènes. C’est le moment où, par les croisades, Byzance orientale rentre en contact direct avec l’Occident. Si l’on considère les croisades du point de vue de l’empire grec, on pensera que ce grand effort de la chrétienté pour délivrer le Saint-Sépulcre fut plus nuisible qu’utile à la monarchie. En rapprochant deux mondes incapables de se comprendre, il aigrit entre eux les rancunes et les haines. En montrant aux gens d’Occident, aux Vénitiens surtout, la richesse de l’empire et le merveilleux terrain qu’il offrait pour les opérations de commerce, il alluma des convoitises inouïes. En obligeant les Grecs à prendre des précautions contre des hôtes inquiétants et hostiles (tour à tour Godefroy de Bouillon, Louis VII, Frédéric Barberousse songèrent à prendre de force Constantinople), il détourna les Byzantins de leur politique naturelle et les rendit plus faibles contre les Turcs. En mêlant enfin l’empire aux affaires d’Occident, il réveilla les vieilles ambitions et éloigna la monarchie de la voie normale et sage. L’impérialisme de Manuel Comnène inquiéta les Latins, tout en épuisant l’empire. Richesse et faiblesse, c’était assez déjà pour attirer sur l’empire grec la convoitise des Latins : les imprudences de la politique impériale, inquiétant, bravant l’Occident et justifiant par là sa haine, firent le reste.
Encore une fois, comme au temps de Justinien, l’empire, sous Manuel Comnène, avait eu de trop vastes ambitions. La liquidation de même fut difficile et désastreuse. Tandis que les nationalités balkaniques, les Serbes, les Bulgares, se réveillaient et se reconstituaient, l’hostilité des Latins devenait chaque jour plus redoutable, et une double menace venait des prétentions de la papauté, des âpres convoitises de Venise. À l’intérieur, c’était l’anarchie. Aux Comnènes succédaient les faibles empereurs de la maison des Anges ; entre leurs mains, à la fin du XIIe siècle, l’empire se décomposait. La conséquence était fatale : ce fut la quatrième croisade qui, partie pour délivrer le Saint-Sépulcre, aboutit à prendre Constantinople et, grâce à la diplomatie de Venise, avec la complicité tacite de la papauté, renversa l’empire grec et installa un comte de Flandre sur le trône des Comnènes, aux applaudissements de la chrétienté.
L’empire sous les Paléologues (1261-1453). – L’évènement de 1204 fut, pour l’empire byzantin, le coup dont jamais plus il ne se releva. Sans doute, l’empire latin de Constantinople fut éphémère et dès 1261 les Grecs rentraient dans leur capitale. Mais une multitude d’états latins subsistaient en Orient. Vénitiens et Génois y agissaient en maîtres, et sans cesse l’Occident tournait des regards ambitieux vers Byzance. Assurément aussi, la catastrophe de 1204 avait un moment réveillé chez les Grecs le sentiment national, dont les empereurs de Nicée (1204-1261) furent les représentants les plus illustres. Cependant, la dynastie des Paléologues, en reprenant pour deux siècles (1261-1453) possession du trône des basileis, ne régna plus que sur un empire territorialement réduit, financièrement épuisé, et qui se réduira et s’épuisera de jour en jour davantage. En face d’eux, grandissent les états chrétiens des Balkans, conscients de leur force, âpres à disputer à Byzance l’hégémonie de la péninsule, le second empire bulgare au XIIIe siècle, la Serbie d’Étienne Douchan au XIVe. En face d’eux, grandissent les Turcs, maîtres maintenant de l’Asie entière, et dont la capitale est à Brousse, presque aux portes de Constantinople, en attendant qu’ils la transportent en Europe, à Andrinople, vers le milieu du XIVe siècle. Peu importe alors qu’il y ait encore des hommes à Byzance, un Jean Cantacuzène, un Manuel Paléologue, « qui en des temps meilleurs aurait sauvé l’empire, si l’empire avait pu être sauvé ». L’empire ne pouvait plus être sauvé.
Que l’on considère ce qu’est alors l’état de la monarchie. Détresse financière, que les Latins aggravent par leur exploitation éhontée. Luttes civiles, où on fait, sans rougir, appel à l’étranger, au Serbe, au Turc. Luttes de classes, riches contre pauvres, aristocrates contre plébéiens, et dont l’âpreté apparaît dans la curieuse, tragique et sanglante histoire de la commune de Thessalonique au XIVe siècle. Luttes religieuses enfin : contre des empereurs politiques, désireux de se concilier l’appui de la papauté en négociant l’union des Églises, le sentiment national grec se révolte, et tout ce qui reste d’énergie s’use dans ces conflits lamentables. Plus d’armée, plus d’argent, plus de patriotisme. L’empire se rétrécit chaque jour : Constantinople cernée par terre ne communique plus que par mer avec les lambeaux qui constituent la monarchie. Le moment est proche où la ville sera à elle seule tout l’empire. Et la chute est désormais irrémédiable.
Et cependant, telle est encore la vitalité de cette civilisation, qu’une suprême renaissance littéraire et artistique pare d’un rayon de gloire mourante l’époque des Paléologues. Les écoles de Constantinople sont toujours florissantes, et des professeurs fameux, philosophes, orateurs, philologues, y semblent les précurseurs des grands humanistes de la Renaissance. Des écrivains de valeur apparaissent, historiens, moralistes, poètes, essayistes, savants même qui n’ont pas rendu à la science moins de services qu’un Roger Bacon en Occident. L’art byzantin se rallume une fois encore au contact ou du moins à l’émulation de l’Italie, art vivant, pittoresque, tour à tour ému, dramatique ou charmant. Trébizonde, Mistra, l’Athos sont les centres principaux de cette renaissance, à côté de Constantinople : et encore une fois, par là, l’influence de Byzance s’étend sur tout le monde oriental, chez les Serbes, chez les Russes, chez les Roumains.
Le 29 mai 1453, Constantinople était prise par les Turcs ; le dernier empereur tombait en héros, l’épée à la main, sur la brèche de sa capitale forcée. Mais n’est-ce pas une chose remarquable qu’à la veille de la chute, l’hellénisme ait rassemblé, pour jeter un dernier éclat, toutes ses énergies intellectuelles – comme pour évoquer les gloires d’autrefois, comme pour symboliser et annoncer l’avenir ? Dans Byzance mourante, il est singulier et significatif de voir brusquement reparaître les grands noms des Périclès, des Thémistocle, des Épaminondas, d’entendre évoquer le souvenir de ce que ces glorieux ancêtres firent jadis « pour la chose publique, pour la patrie ». Il est singulier et significatif de voir les hommes les plus éminents de l’époque adjurer l’empereur de prendre, au lieu du titre traditionnel et suranné de basileus des Romains, le nom nouveau et vivant de roi des Hellènes, « qui à lui seul suffira pour assurer le salut des Hellènes libres et la délivrance de leurs frères esclaves ». Illusions qui semblent vides de sens, au moment où Mahomet II est aux portes : fait remarquable pourtant que cette reprise de conscience de l’hellénisme qui ne veut pas mourir et qui prépare obscurément, au moment même de la catastrophe, un avenir meilleur.
Telle est, en un raccourci sommaire, l’évolution de l’histoire de Byzance, depuis la fondation de Constantinople en 330 jusqu’à sa chute en 1453. Entre ces deux dates, dans ces onze siècles, que de périodes glorieuses ! Au VIe siècle, avec Justinien, l’empire romain, une dernière fois, se reconstitue, et la Méditerranée devient de nouveau un lac romain. Au VIIIe siècle, les Isauriens brisent l’élan de l’Islam et réorganisent sur des bases nouvelles la monarchie absolue. Au Xe siècle, les grands empereurs de la maison de Macédoine font de Byzance la grande puissance de l’Orient. Au XIIe siècle, avec les Comnènes, l’empire grec fait encore brillante figure dans le monde européen. Il ne suffit donc pas de parler de décadence : on peut, on doit parler de grandeur aussi. Et il vaut la peine de chercher les causes profondes de cette grandeur, avant d’étudier les raisons de cette décadence. Et surtout, il ne faut pas oublier les services rendus par une civilisation qui fut longtemps la plus brillante du Moyen Âge ; il faut chercher ce que durent à l’empire byzantin l’Orient et l’Occident même, et quel héritage, aujourd’hui encore, Byzance nous a laissé.
Définir les causes multiples, permanentes ou passagères, de la décadence byzantine est chose relativement facile et qui a été tentée souvent. Il semble plus malaisé de déterminer les raisons de la grandeur de Byzance. Et pourtant, pour que l’empire ait duré, pour qu’il ait pu, pendant plus de mille ans, vivre, et non sans gloire, il faut qu’il ait enfermé en lui-même des éléments de puissance sans lesquels son existence – telle qu’elle fut – serait proprement inexplicable. Quelles sont les causes profondes et longtemps efficaces de cette grandeur ? C’est ce qu’on voudrait ici déterminer.
C’est d’abord, et essentiellement, un gouvernement absolu et fort, une des conceptions les plus puissantes qui se soient jamais rencontrées de l’autorité monarchique. Ce gouvernement est admirablement servi par une armée bien organisée, qui fut longtemps capable de défendre la monarchie ; par une administration fortement centralisée, qui sut donner l’unité à l’empire et la maintenir, et qui fut vraiment l’armature de la monarchie ; enfin, par une diplomatie habile, qui sut longtemps propager l’influence et entretenir le prestige de Byzance dans le monde. Par ailleurs, l’empire a longtemps connu une prospérité économique incomparable, et il a été le foyer d’une merveilleuse culture intellectuelle, deux choses qui ont fait de Constantinople l’un des centres les plus magnifiques et les plus raffinés de la vie civilisée. Et à l’élégance enfin de sa somptueuse capitale, l’empire a su joindre des qualités d’énergie et de force, dont les provinces – et l’Asie en particulier – ont été longtemps la source inépuisable.
Sans doute, selon les temps, ces causes ont été plus ou moins agissantes. L’empire a connu des époques où le gouvernement était faible, l’armée désorganisée, l’administration relâchée et corrompue, la diplomatie imprudente et maladroite. Mais longtemps, à ces dépressions passagères, des éléments de reconstitution se sont opposés. Et pareillement, la prospérité économique de l’empire a fini par fléchir, et la perte de l’Asie conquise par les Turcs a eu pour la puissance et l’équilibre de la monarchie des conséquences redoutables : deux grands faits qui ont préparé la décadence irrémédiable de l’empire à partir du XIIIe siècle. Mais Constantinople, jusqu’à la fin, est demeurée un admirable foyer de civilisation, comme un témoin de la grandeur passée de Byzance, et longtemps le prestige de la Ville a entretenu autour d’elle un suprême rayon de splendeur.
Et ceci trace le plan de cette étude : le Gouvernement ; l’Armée ; la Diplomatie ; l’Administration ; le Développement économique ; et, comme aux deux feuillets opposés d’un diptyque, Constantinople, foyer de richesse et de civilisation, l’Orient asiatique, force de l’empire.
Origines et caractère du pouvoir impérial. – Les formes extérieures de l’autocratie impériale. – L’étendue du pouvoir impérial. – Les limites du pouvoir impérial. – La vie impériale. – La force de l’institution impériale.
Peu de souverains ont été dans le monde plus puissants que le fut l’empereur de Byzance. Peu d’états, même au Moyen Âge, ont eu une conception plus absolue de l’autorité monarchique. Et ç’a été pour l’empire une très grande force.
Origines et caractère du pouvoir impérial. – C’est un très grand personnage, et assez compliqué à définir, que l’empereur byzantin. Héritier des Césars romains, il est comme eux l’imperator, c’est-à-dire tout ensemble le chef de guerre et le législateur. C’est en son nom que les généraux remportent les victoires ; c’est sa volonté souveraine et infaillible qui crée la loi, dont il est l’expression vivante. « Qu’y a-t-il de plus grand, écrit Justinien, de plus saint que la majesté impériale ? Qui pourrait avoir l’outrecuidance de mépriser le jugement du prince, lorsque les fondateurs mêmes du droit ont nettement, clairement déclaré que les décisions impériales ont la valeur de la loi ? » Rome, jadis, avait uni la gloire des armes à l’éclat du droit et fondé sur cette double base sa monarchie universelle. L’empereur byzantin continue la double tradition romaine. « Qui serait, écrit encore Justinien, capable de résoudre les énigmes de la loi et de les révéler aux hommes, sinon celui qui seul a le droit de faire la loi ? » Par définition la fonction impériale confère à celui qui en est revêtu le pouvoir absolu et l’autorité infaillible.
Au contact de l’Orient, l’empereur byzantin est devenu quelque chose de plus : il est l’autocrator, les despotes et, à partir du commencement du VIIe siècle, il devient, dans l’empire hellénisé, le basileus, c’est-à-dire l’empereur par excellence, l’émule et le successeur du Grand roi, dont la victoire d’Héraclius sur les Perses vient de consommer l’abaissement et la déchéance. Et, à l’image des chefs des monarchies orientales, auxquels il a emprunté le costume qu’il porte et le diadème dont il ceint sa tête, l’empereur de Byzance apparaît comme placé au-dessus de l’humanité : ce ne sont point des sujets qu’il a au-dessous de lui, mais des esclaves, ainsi qu’eux-mêmes se dénomment humblement ; c’est en se prosternant par trois fois jusqu’à terre, en lui baisant dévotement les mains et les pieds, que les plus grands personnages de la monarchie abordent le maître tout-puissant : la προσϰὐνησις qu’impose le protocole est, comme le mot l’indique, un acte d’adoration.
À tout cela, le christianisme a ajouté une consécration de plus. L’empereur est l’élu de Dieu, l’oint du Seigneur, le vicaire de Dieu sur la terre, son lieutenant à la tête des armées, et comme on dit à Byzance, l’isapostolos, le prince égal aux apôtres. C’est Dieu qui, dans toutes les circonstances de son gouvernement, inspire le basileus et l’assiste, qui multiplie en sa faveur les grâces et les miracles. « Ce n’est point, écrit Justinien, dans les armes que nous avons confiance, ni dans les soldats, ni dans les généraux, ni dans notre propre génie, mais nous rapportons toute notre espérance à la providence de la Sainte Trinité. » Et les acclamations officielles proclament : « Le Seigneur qui donne la vie élèvera votre tête, ô maîtres, au-dessus de l’univers entier ; il fera de tous les peuples vos esclaves, pour qu’ils apportent, comme autrefois les mages, leurs présents à Votre Majesté ». Champion de Dieu sur la terre – ses guerres contre les infidèles ont l’aspect de véritables guerres saintes, – chef suprême et défenseur de la religion, roi et prêtre tout ensemble ( ἀρχιερεὺς βασιλεύς, comme on le dit de Justinien), l’empereur byzantin est absolu et infaillible dans le domaine spirituel comme il l’est dans le domaine temporel.
Et de la combinaison de ces divers éléments, résulte un pouvoir qui ne se fonde pas seulement sur l’investiture politique, mais que l’Église et Dieu même consacrent et parent d’un prestige incomparable.
Les formes extérieures de l’autocratie impériale. – Les apparences extérieures sont soigneusement calculées pour symboliser ce caractère de la majesté impériale.
Les Byzantins ont volontiers pratiqué, à toutes les époques de leur histoire, une politique de prestige et de magnificence : ils ont cru – avec une psychologie peut-être un peu courte et une infatuation assez puérile – que tous les peuples qui les environnaient étaient des enfants faciles à éblouir, des barbares crédules, sensibles à la mise en scène, que ne pouvait manquer d’impressionner profondément le faste de la cour impériale. L’ostentation a été un des moyens favoris de la diplomatie byzantine, le luxe, un des ressorts coutumiers de sa politique. Byzance s’applique donc à présenter au monde le prince qui la gouverne dans un éblouissement, dans une apothéose, où il apparaît moins comme un homme que comme l’émanation vivante de la divinité.
Et c’est, dans ce but, la titulature magnifique et pompeuse que la phraséologie officielle accole au nom impérial. Comme Auguste, comme Trajan, Justinien est imperator, César, Gothique, Alamanique, Francique, Germanique, Vandalique, Africain, pieux, heureux, illustre, victorieux, triomphateur, toujours Auguste. Dans l’empire hellénisé, ses successeurs s’intitulent, comme si ces mots plus simples résumaient en eux toutes les formules d’autrefois, basileis fidèles en Christ notre Dieu et autocrates des Romains. C’est, pour le même dessein, le luxe du costume, la splendeur des insignes impériaux, le privilège des chaussures de pourpre, la complication de la mise en scène qui, pour chaque fête, pour chaque solennité, assigne au prince un habillement nouveau, tout éclatant de couleurs diverses et toujours éblouissant d’or et de pierreries. C’est l’étiquette, fastueuse tout ensemble et un peu puérile, qui isole le souverain du commun des mortels et, pour fortifier le respect de la majesté impériale, l’environne d’un rayonnement de splendeur. « Par la beauté du cérémonial, écrit Constantin Porphyrogénète, qui prit au Xe siècle un plaisir singulier à en codifier les rites, le pouvoir impérial apparaît plus splendide, plus entouré de gloire, et par là il frappe d’admiration les étrangers comme les sujets de l’empire ». C’est pour cela que, dans le palais impérial, ce ne sont que cortèges quotidiens, processions rituelles, dîners somptueux, où une hiérarchie sévère règle les rangs et les préséances, audiences solennelles, fêtes étranges et magnifiques. On a souvent décrit ces spectacles, où Byzance apparaît comme dans un flamboiement d’or, où au pittoresque chatoiement des uniformes, au luxe des appartements tendus de tapisseries et jonchés de fleurs, à la splendeur des orfèvreries se mêlent de véritables trucs de féerie, lions de bronze rugissant, oiseaux mécaniques chantant sur le platane d’or, et l’empereur enlevé dans les airs, balancé entre ciel et terre. Il n’est pas utile de les décrire à nouveau. Au milieu de toute cette pompe, l’empereur, gainé d’or, magnifique, éblouissant, apparaît sur son trône comme une icône sainte, comme un Dieu. Et aussi bien est « sacré » tout ce qui le touche, et l’art ceint d’un nimbe la tête des souverains – même d’une Théodora, même d’une Zoé – comme il fait pour les personnes divines et pour les saints.
L’étendue du pouvoir impérial. – Quelle est maintenant la réalité de ce pouvoir ?
La tradition romaine, recueillie par Byzance, met l’empereur au-dessus des lois (il est, comme on dit au VIe siècle, solutus legibus). Il exerce donc une autorité absolue sur les choses et sur les personnes, sur l’armée et sur l’administration civile, sur la justice et sur les finances, sur la politique comme sur la religion. Sa compétence est universelle. « Tout dépend, écrit Léon VI, de la sollicitude et de l’administration de la majesté impériale ». L’empereur a autorité même sur les mœurs, qu’il surveille et réforme, même sur les modes, où il détermine le costume et fixe des limites au luxe.
L’empereur exerce le pouvoir militaire. On le trouve souvent à la tête des armées, et les textes décrivent les retours triomphaux qu’il fait dans sa capitale après des campagnes heureuses. L’empereur a le pouvoir civil ; il fait et défait la loi. De Justinien aux Comnènes, tous les empereurs byzantins ont été de grands législateurs, comme l’attestent tour à tour le Code Justinien, l’Ecloga, les Basiliques et la multitude des novelles qu’ils ont promulguées. Il surveille exactement l’administration – qu’on se souvienne des grandes réformes de Justinien, des Isauriens, de Basile Ier – et il correspond directement avec les gouverneurs des provinces. Il est le juge suprême : le tribunal impérial jugeait aussi bien en première instance qu’en appel. Il a le grand souci de l’administration financière, si essentielle à l’empire. Justinien explique que le premier devoir des sujets est de payer exactement, intégralement, régulièrement, « en toute dévotion », l’impôt, car l’État « a plus que jamais besoin d’argent », et c’est par le bon état du trésor « que se produira une belle et harmonieuse concorde des gouvernants et des gouvernés ». Il nomme enfin et destitue à sa volonté tous les fonctionnaires, ministres, généraux, gouverneurs de province, il les fait avancer à son caprice dans la hiérarchie compliquée des dignités : tout dépend de lui, et l’histoire byzantine est pleine d’avancements scandaleux et de disgrâces éclatantes.
Mais le trait le plus caractéristique de l’autorité de l’empereur est son pouvoir religieux. « Votre puissance, proclament les acclamations officielles, empereurs fidèles en Christ et élus de Dieu, procède véritablement de Dieu et non des hommes ». Solennellement sacré par le patriarche sur l’ambon de Sainte-Sophie, l’empereur, ainsi marqué par l’onction sainte d’une investiture divine, règne par la grâce de Dieu et triomphe par l’appui du Christ. Sa vie est sans cesse mêlée à celle des prêtres, et lui-même est prêtre : seul il est admis à franchir avec les clercs la barrière sacrée de l’iconostase. Aussi gouverne-t-il l’Église comme l’État. Il désigne les évêques à élire, il leur donne l’investiture ; et de même qu’il les nomme, il les dépose, quand ils ne sont pas assez dociles à sa volonté. Il fait la loi en matière religieuse comme en matière civile, il convoque les conciles, dirige leurs débats, confirme leurs canons, est l’exécuteur de leurs décisions, et les rebelles à la volonté impériale deviennent ainsi les ennemis de Dieu même. Il légifère sur la discipline ecclésiastique et il ne craint pas de fixer le dogme : dans tout empereur byzantin, il y a un théologien savant et subtil, qui aime et sait discuter, qui, du haut de l’ambon de Sainte-Sophie, prononce de pieuses homélies, et qui impose toujours sa volonté. En matière religieuse, l’empereur est le justicier suprême, et il approuve ou casse les sentences des tribunaux ecclésiastiques. Il est le défenseur de l’Église, combattant vigoureusement l’hérésie, propageant l’orthodoxie à travers le monde (οἰϰουμένη) : mais en échange de sa protection, il lui impose sa volonté. Et devant lui se courbent les têtes les plus hautes, papes qu’il brutalise ou fait arrêter, patriarches qu’il destitue. Au VIe siècle, le patriarche Ménas déclare solennellement que « rien ne doit se faire dans la très sainte Église contre l’avis et les ordres de l’empereur ». « L’empereur, dit un prélat du XIIe siècle, est pour les Églises le suprême maître des croyances », et le pape Grégoire le Grand lui-même reconnaît que Dieu a donné à l’empereur « la domination, non seulement sur les soldats, mais aussi sur les prêtres. »
Les limites du pouvoir impérial. – Ainsi, le pouvoir impérial à Byzance est une autorité despotique et sainte. « Notre âme, disent les acclamations officielles, n’a pas d’autre devoir que de regarder vers vous, maîtres suprêmes de l’univers. » (δεσπόται τῆς οίϰουμένης) : car, au-delà des frontières de la monarchie, l’autorité du basileus s’étend à toute la terre habitée. Dans la constitution byzantine, rien ne fait équilibre ni obstacle à cette puissance suprême : elle ne connaît ni limites, ni contrôle. Sans doute, comme à Rome païenne, en face de l’empereur, il y a le Sénat et le peuple : et comme à Rome, la fiction constitutionnelle leur attribue dans l’État un rôle qui, parfois, au VIIe, au VIIIe siècle encore, semble avoir eu quelque réalité. Au total cependant, le Sénat n’est plus dans la monarchie qu’un conseil d’État, une assemblée de hauts fonctionnaires généralement à la dévotion du prince ; la noblesse sénatoriale n’est que la pépinière où se recrutent les agents de l’administration impériale. Et le peuple n’est qu’une plèbe qu’il faut nourrir et amuser et qui, toujours tumultueuse et factieuse, s’échappe parfois, malgré les efforts faits pour la domestiquer, en émeutes et en révolutions sanglantes.
Dans Byzance chrétienne, il y a en outre, en face de l’empereur, l’Église qui, si soumise qu’elle soit à l’autorité impériale, a tenté une fois au moins, au IXe siècle, de revendiquer sa liberté et a failli déchaîner à Byzance une autre querelle des Investitures. Et cette Église finit même par imposer à l’empereur, au moment du couronnement, un serment solennel, par lequel il s’engage à pratiquer l’orthodoxie, à respecter les décrets des sept conciles œcuméniques, et à ne pas toucher aux privilèges ecclésiastiques, et contre lui elle peut brandir à l’occasion l’arme redoutable de l’excommunication. En fait, pourtant, même dans cet état très chrétien, l’Église est peu de chose en face de l’empereur. Et ceux-là mêmes qui critiquent l’ingérence du prince dans les affaires religieuses, « comme s’il portait en lui le Christ même et avait été par lui divinement instruit de ses mystères », reconnaissent en somme l’étendue de cette autorité absolue. « La plupart des empereurs des Romains, écrit Nicétas, ne tiennent pas pour suffisant de régner en maîtres absolus, d’être couverts d’or, de faire usage de ce qui appartient à l’État comme d’un bien propre et d’en disposer comme il leur convient et pour qui il leur plaît, de commander enfin à des hommes libres comme à des esclaves : si on ne les tient, en outre, pour des sages, semblables aux dieux par la forme et aux héros par la force, pour des êtres inspirés par Dieu comme Salomon, docteurs ès sciences divines, canons plus sûrs que les canons et, en un mot, pour les interprètes infaillibles des choses divines et humaines, ils estiment qu’on leur fait tort. C’est pourquoi, tandis qu’ils devraient punir les ignorants et les audacieux qui introduisent des dogmes nouveaux dans l’Église ou bien les remettre à ceux dont c’est la fonction de connaître et de parler de Dieu, estimant qu’en cette matière même ils ne peuvent être inférieurs à personne, ils s’érigent en interprètes, en juges, en définisseurs des dogmes, et souvent ils châtient ceux qui sont en désaccord avec eux ». Il est intéressant de noter sons la plume d’un haut fonctionnaire ces réserves : elles montrent surtout pourtant combien en fait l’Église pouvait peu contre l’empereur.
Pour tenir en échec le pouvoir impérial, il n’y a donc que la force qui soit efficace, la force qui vient de l’armée et se traduit en soulèvements militaires, la force qui vient de l’aristocratie féodale et se manifeste en ambitions usurpatrices, la force qui vient du peuple et qui éclate en émeutes. On a pu dire justement qu’à Byzance, le pouvoir impérial est une autocratie tempérée par la révolution et par l’assassinat.
C’est qu’en effet ce pouvoir absolu a une faiblesse. Pas plus que dans la Rome impériale, Byzance, au moins jusqu’à la fin du IXe siècle, n’a eu de loi de succession réglant l’avènement au trône. Théoriquement, on devient empereur soit par l’élection que font le Sénat, le peuple et l’armée, soit par un acte de volonté de l’empereur régnant qui, de son vivant, désigne et installe à côté de lui un successeur, choisi d’après la naissance ou par voie d’adoption ou d’association. En fait, c’est l’usurpation brutale qui, le plus souvent, fait l’empereur : pendant longtemps, il n’y eut pas à Byzance de famille régnante, ni de sang royal. Ce fut l’œuvre des empereurs de la famille de Macédoine « de donner à l’autorité impériale des racines plus puissantes, pour en faire sortir les magnifiques rameaux de la dynastie ». Désormais, il fut plus difficile de renverser l’arbre aussi puissamment enraciné. Désormais, il y eut une famille impériale, dont les membres reçurent le nom de « porphyrogénètes », et l’on constate désormais un progrès croissant des idées de légitimité. Il y a des dynasties : les Macédoniens qui ont duré 189 ans, les Comnènes qui ont régné 104 ans, les Paléologues qui ont occupé le trône pendant 192 ans ; et les usurpateurs eux-mêmes ont le respect de la dynastie légitime. Il y a un attachement populaire à la famille régnante, un dévouement loyaliste. L’opinion publique professe maintenant que « celui qui règne à Constantinople finalement est toujours victorieux », ce qui fait de l’usurpation, non pas seulement un crime, mais – chose pire – une sottise. Et dans cette monarchie orientale, des femmes même ont régné – ce qui jamais n’est arrivé en Occident – et ces femmes, une Irène, une Théodora, une Zoé, ont été populaires.
La vie impériale. – Pour finir, considérons brièvement, pour bien nous rendre compte de ce qu’est un empereur byzantin, ce qu’est la vie impériale, entre le couronnement à Sainte-Sophie et les funérailles magnifiques aux Saints-Apôtres.
Le livre des Cérémonies, qu’a écrit au Xe siècle l’empereur Constantin VII, nous montre une vie toute représentative et, comme on l’a dit, vraiment « pontificale », où l’empereur, au milieu des cantiques, des acclamations rythmées, des cortèges et des pompes, passe, inutile et majestueux. Chaque acte de sa vie, chaque geste est réglé par l’étiquette, et cette vie est toute pleine de cérémonies vaines, fêtes religieuses et fêtes civiles, courses, audiences, dîners. Chaque matin, une procession solennelle se déroule à travers les appartements du palais ; à certains jours, ce sont des visites aux églises ; à la fin de l’année et au commencement de l’année nouvelle, se sont les fêtes magnifiques du δωδεϰαήμερον, etc. Et, sous cet aspect éclatant, on entrevoit quelque chose de singulièrement misérable.
Mais cette vie de représentation, de palais, de harem, cette existence vide n’est qu’une partie, et la moindre, de la vie d’un empereur byzantin. Il y a eu des souverains énergiques, qui se sont formés une autre conception de leurs fonctions et de leur existence. Il y a eu des empereurs guerriers, toujours à la tête des troupes, Héraclius et les deux premiers Isauriens, Basile Ier, Phocas, Tzimiscès, Basile II, si sobre, si ennemi du luxe, et Alexis et Jean et Manuel Comnène. Il y a des empereurs qui, au palais même, ont mené autre chose qu’une vie oisive. Justinien, malgré le goût qu’il avait de la pompe et de l’étiquette, passait les nuits au travail, et il a mérité qu’on l’appelât « l’empereur qui ne dort jamais ».
La force de l’institution impériale. – Ce sont ceux-là qui de l’institution impériale ont su tirer une des sources de la grandeur de Byzance. Sans doute, dans cet état, où tout remonte à l’empereur, il arrive inévitablement que l’entourage immédiat du prince exerce sur lui une trop puissante influence, et de la place que tient le palais dans la monarchie peut sortir un régime d’intrigues, un gouvernement de femmes et de favoris. Dans cet état où tout dépend du prince, c’est un danger constant aussi que la tentation donnée aux ambitieux de renverser le souverain, parce que la révolution est le moyen unique – et facile – d’obtenir le pouvoir. Dans un état enfin, où la volonté d’un seul homme règle toutes choses, c’est un péril redoutable que cet homme puisse être médiocre ou faible. Ce sont là les inconvénients de cet absolutisme monarchique. Mais quels avantages par ailleurs dans l’unité de direction, dans la continuité de politique, dans la fermeté de conception et d’exécution, qu’assure un prince qui gouverne tout en maître. Et si ce prince est un homme de valeur, qui sache utiliser les moyens de gouvernement dont il dispose, l’armée, la diplomatie, l’administration, quel profit pour l’empire que cette direction unique et forte. Il y a eu de tels souverains à Byzance, et plus qu’on ne croit : peu d’états dans l’histoire ont connu une plus belle succession de princes remarquables. Et c’est pourquoi il a suffi longtemps d’un empereur qui fût un chef pour que la fortune sourît à la monarchie byzantine.
La composition de l’armée. – Les qualités de l’armée byzantine et sa place dans la société. – Les défauts de l’organisation militaire. – L’armée des frontières et la défense du territoire. – La marine.





























