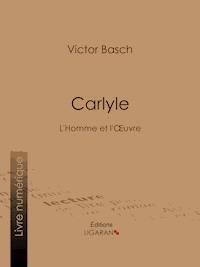
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il naquit, le 4 décembre 1795, à Ecclefechan, dans le Dumfries, en Ecosse. Mais il était de race anglaise et de race noble : les Carlyle, venus dans l'Annandale avec les Bruce, sous le roi David II, avaient été Lords. Race forte, rude, indomptable, avec d'étranges sautes d'humeur et d'inquiétantes bizarreries de caractère. Son grand-père et son père répandaient autour d'eux crainte et respect."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Si oublié aujourd’hui ! Plus oublié que ses antagonistes « radicaux » ! Si mouillés ses tonnerres, si dénués de résonances ses anathèmes, si usées ses défroques bibliques, si vaines ses attitudes prophétiques, ses pathétiques adjurations, ses visions apocalyptiques, ses hystériques invectives. « John Bull à Pathmos », diraient nos esthètes ironiques, ceux de France et, plus encore ceux d’Angleterre faisant du sur-Proust, du sur-Cocteau et du sur-Giraudoux, s’ils ouvraient Sartor Resartus et Past and Present, ce dont, d’ailleurs, ils se gardent. Imaginez un lecteur de Bernard Shaw, de Joyce, de Lawrence ou d’Aldous Huxley aux prises avec l’homme qui passa sa vie à exorciser Belzébuth et le Tophet. Il semble que sur l’œuvre de Carlyle ne se soit pas seulement étendu le crépuscule qui n’épargne aucun des grands dont la gloire a illuminé une génération. C’est l’habituelle revanche des jeunes que leurs aînés ont primés et opprimés que de laisser ceux-ci ensevelis dans leur linceul de gloire. Mais, au bout de ces années de purgatoire plus ou moins longues, les vraiment grands ressurgissent et, cette fois, pour ne plus sombrer dans les ténèbres. Je n’aperçois pas que, plus de cinquante ans après sa mort, Carlyle s’apprête à ressusciter.
Et cependant… Je viens de réétudier d’affilée son œuvre tout entière. L’impression esthétique est mélangée. Cela est, sans doute, souvent fatigant. Il y a des longueurs et surtout des redites. Au fond, une seule pensée, savamment modulée, court à travers ces lourds volumes. Et il est certain que ces gestes grimaçants, ces cris discords, ces contorsions, cette constante amertume, ces Pélions continûment amoncelés sur ces Ossas, dépassent ce que des nerfs moyens peuvent supporter. Mais, en revanche, si l’on n’est pas entièrement sourd à tout lyrisme, on est, malgré tout, saisi, emporté, ébranlé jusqu’au tréfonds. C’est une grande lame qui vous soulève, vous roule, vous aveugle et vous assourdit, mais qui vous fait participer à une force venue des dernières profondeurs, vous chante des hymnes où communient les voix, infernales et célestes, de la nature et de l’âme humaine et qui, sur la rive où elle vous jette, vous découvre tout l’infini de la voûte azurée.
Mais ce qui m’a frappé plus que cette prodigieuse éloquence, toute imprégnée du sublime biblique et faite de grandiose laideur et de véhémence barbare, c’est l’extraordinaire actualité de tant de pages de Carlyle. Voilà plus d’un siècle qu’ont été écrites celles de Signs of Time (1829). On les dirait d’hier. Les périls qu’il y signale pour la culture sont ceux-là mêmes que dénoncent aujourd’hui nombre de penseurs contemporains. Le mécanisme – ce mécanisme que le vingtième siècle a si diaboliquement perfectionné – triomphant du dynamisme : c’est la maladie de son temps que ne se lasse pas de diagnostiquer le solitaire de Craigenputtock. N’est-ce pas celle du nôtre ? Bien plus. Les maîtres-problèmes politiques et sociaux de l’heure, – la valeur intrinsèque de la démocratie et de ses méthodes : le parlementarisme et la sélection des gouvernants par le nombre – il les pose dans les mêmes termes que nous. Ne peut-on pas dire que l’initiateur idéologique des gouvernements incarnés dans des chefs, élevés sur le pavois par leur audace et maintenus par la force, a été l’auteur des Héros et du Culte des Héros ? D’autre part, en contradiction tout au moins apparente avec sa haine de la démocratie, il a été, durant toute sa longue carrière, hautement préoccupé par l’aménagement dans l’État des forces prolétariennes, il a dénoncé de toute sa brûlante éloquence les crimes de la grande industrie et l’abjecte tyrannie de l’argent. À lire tant de pages de Past and Present et des Letter Days Pamphlets sur la détresse des chômeurs des mines et des usines du textile et l’impitoyable égoïsme de la classe possédante, on se croirait transporté au milieu de la crise économique d’après-guerre. Sans doute, il y a des différences. Avant tout, il est un facteur – le facteur essentiel, aux yeux du visionnaire de Sartor Resartus – de la vie des sociétés et des individus, à savoir le facteur religieux, qui est presque entièrement absent de nos préoccupations. C’est lui qui donne à la pensée de Carlyle son sombre coloris et son timbre intense et profond. Mais il n’importe. La chair de Carlyle est notre chair et son sang, notre sang. Il est mélancolique de constater combien lente et entravée est la marche du génie de l’humanité. Un siècle écoulé et, en dépit de tant d’efforts, de tant de tentatives, de tant de révolutions politiques, sociales et intellectuelles, si peu de lumières nouvelles !
En tout cas, Carlyle n’est pas seulement un moment dans la trame des idées du dix-neuvième siècle qui n’aurait d’intérêt que pour l’historien. À le réétudier, je l’ai senti tout proche de nous. Il appartient à la grande lignée des Emerson, des Kierkegaard, des Ibsen, des Nietzsche qui, tous, sont à quelque degré, ses disciples. Et Renan lui-même, quelque loin que soit sa molle souplesse de Celte latinisé et catholicisé de l’inflexible roideur du puritain d’Écosse, s’apparente à lui. Vraiment, sa voix mérite d’être entendue à nouveau et d’être confrontée avec les nôtres.
Il naquit, le 4 décembre 1795, à Ecclefechan, dans le Dumfries, en Écosse. Mais il était de race anglaise et de race noble : les Carlyle, venus dans l’Annandale avec les Bruce, sous le roi David II, avaient été Lords. Race forte, rude, indomptable, avec d’étranges sautes d’humeur et d’inquiétantes bizarreries de caractère. Son grand-père et son père répandaient autour d’eux crainte et respect. Le père gagnait sa vie et celle de ses sept enfants – un huitième était mort au berceau – en travaillant la terre. Travail dur et qui rendait peu. La pénurie régnait dans le logis surpeuplé : les enfants allaient nu-pieds et vivaient de farine d’avoine, de lait et de pommes de terre. Et ce qui y régnait aussi, c’est le silence, ce silence auquel Carlyle élèvera des autels. Le maître était violent, « prompt des mains » et taciturne. Mais lorsqu’il parlait ou écrivait, sa langue, expression vraie d’une pensée vraie, jaillissait « brûlante de son âme non maîtrisée, forte, hardie, chatoyante de métaphores, avec d’intenses vibrations, mais, en même temps, nette, frappante, tranchante, vêtue, non de couleurs empruntées, mais de la pleine clarté blanche du soleil, et quand la colère la faisait trembler, lançait des flèches qui atteignaient en plein cœur ». Est-il étonnant que Thomas ait admiré ce Viking dont il dit qu’il n’a jamais rencontré d’homme plus remarquable, mais qu’il a dû se reprocher « de n’avoir pas osé l’aimer ». C’est de sa mère qu’il se sentait proche. Nul doute que de tous les êtres qui lui furent chers, l’admirable Jane Welsh non exceptée, ce ne soit elle qu’il a le plus et le mieux aimée.
Les Carlyle appartenaient à la secte des Burghers, lointains descendants de ces Caméroniens qu’on avait exterminés au 17e siècle, mais dont le sévère enseignement avait survécu à toutes les persécutions. C’est cet enseignement qui planait sur l’humble maisonnée d’Ecclefechan et l’illuminait. La Bible, dont il était directement inspiré, n’était pas pour ses habitants un livre, mais le pain de la vie, la coupe où s’étanchait cette soif de félicité qui brûle au cœur des plus déshérités. Le pasteur John Johnston apportait à ses fidèles, en compensation de ce que la vie leur refusait, les espoirs illimités et la certitude de communier avec le Très-Haut. « Je n’ai jamais rencontré », dit Carlyle des pasteurs dissenters, « parmi les protestants et les catholiques, des hommes si proches des évangélistes. Pauvres scholars et gentilshommes du Christ… Humble temple de mon enfance, rude, rustique, nu : mais il y avait des langues de feu authentiques qui embrasaient ce qu’il y avait de meilleur en nous ». Incessamment, son père et surtout sa mère s’appliquent à ne pas laisser s’éteindre cette flamme. « Oh Tom », lui écrit-elle, « profite de la saison d’or de la jeunesse et rappelle-toi ton Créateur dans les jours de ton adolescence. Cherche Dieu tant qu’il peut être trouvé. Appelle-le tant qu’il est proche. Implore sa présence et ses conseils qui puissent te guider. As-tu déjà achevé la lecture de la Bible ? Si oui, relis-là ».
L’instruction de Thomas fut plus poussée qu’on n’eût pu l’attendre de l’humble condition de ses parents. Après que sa mère lui eût appris à lire et son père à compter, il fut envoyé à l’école du village, puis à l’école de grammaire d’Annan où il acquit un peu de latin et de français, un peu de géométrie et passablement d’arithmétique et d’algèbre. À quatorze ans, il s’en fut suivre les cours de l’Université d’Édimbourg. Il y arriva à pied et seul, eut à trouver à s’installer et vécut de la farine d’avoine, des pommes de terre et du beurre salé que, toutes les semaines, lui apportait de la maison paternelle le courrier. Le cours d’études préparatoires à l’Université était de cinq ans. Il ne semble pas que Carlyle en ait grandement profité. Il goûta peu le cours de philosophie de Brown et ne travailla sérieusement que le latin et les mathématiques avec Leslie. Il ne cueillit aucun laurier, ne concourut qu’une fois à un prix et ne l’obtint pas : « il n’avait d’idées que seul ».
Le cycle préparatoire achevé, il s’agissait pour le jeune homme de choisir une carrière et de s’y préparer. Le vœu de ses parents était qu’il étudiât la théologie et devînt ministre. Sans s’y refuser expressément, il décida en lui-même de ne pas l’exaucer. Il avait déjà conscience qu’il n’avait pas « le moindre enthousiasme pour cette affaire » et que « même de graves doutes s’élevaient en lui ». Il se donna donc au professorat et fut appelé à enseigner les mathématiques à Annan. Mais il hait son métier et sait qu’il n’est pas fait pour lui. Il sent sourdre en lui des aspirations dont il ne démêle pas encore la voix. La seule chose qu’il sache, c’est que « depuis qu’il est capable de former un vœu, celui d’être connu était le plus fervent ». Mais quel chemin prendre pour se faire connaître ? En attendant de le discerner, il tente d’échapper à son dégoût en continuant à se cultiver. Il étudie les Essais de Hume et surtout commence à s’intéresser aux choses publiques. Aussi bien, le moment était-il singulièrement pathétique. Nous sommes en 1815, Napoléon venait de s’écrouler et c’est le drame titanesque de la Révolution et l’éclatante épopée de l’Empire qui venaient se profiler devant le regard pensif du petit maître d’école d’Annan. Il allait d’ailleurs quitter ce premier poste. Il est appelé à diriger un établissement secondaire à Kirkaldy où il eut l’extraordinaire bonne fortune de rencontrer un collègue, destiné à devenir illustre, Edward Irving, qui l’accueillit fraternellement. Carlyle ne fut pas insensible à cette chance, bien qu’il fût peu apte à savourer un sourire du destin : il était bien plus enclin à remâcher indéfiniment des infortunes réelles ou imaginaires. Et les soucis réels ne lui manquaient point. D’abord son père, qui avait quitté Ecclefechan pour Mainhill, lui mande que sa mère est atteinte de troubles mentaux et a besoin d’être mise, pendant quelque temps, sous surveillance : cette psychose, que nous constatons dans les familles de presque tous les grands individualistes et chez tant d’entre eux-mêmes, n’a pas épargné l’humble toit des Carlyle. Puis, le dégoût que lui inspire son métier devient invincible. Une lueur d’espoir – Margarete Gordon, la Blundine de Sartor – mais qui s’éteint. Il rompt alors toutes les amarres, renonce à son poste, quitte Kirkaldy en même temps que Irving et retourne à l’Université d’Édimbourg pour y faire son droit.
Il arrive dans la vieille cité écossaise dans un état physique et moral lamentable. Il trouve assez vite à subvenir à ses modestes besoins par des leçons et une collaboration à l’Encyclopédie du Dr Brewster. Mais c’est à ce moment qu’il sent les premières atteintes de cette dyspepsie qui sera la torture de sa longue existence et la croix de la vie de sa femme. Et il était si seul, si abandonné : « j’étais entièrement inconnu dans les cercles d’Édimbourg, solitaire, me rongeant le cœur, perdant presque ma santé, en proie à des luttes et des misères sans nom qui, aujourd’hui encore, m’inspirent, quand j’y resonge, une sorte d’horreur – trois semaines sans aucune espèce de sommeil dans l’impossibilité où j’étais de me libérer de mes soucis ». Et abandonné non seulement par les hommes. À réfléchir et à étudier les encyclopédistes, il avait senti vaciller les fondements sur lesquels avait été édifiée sa vie, se voiler la grande lumière qui avait illuminé la médiocre grisaille de son existence temporelle et les ténèbres de son âme. Il écrit à sa mère que s’il ne lit pas régulièrement « le meilleur des livres », comme elle le lui recommande, il a cependant « fourragé dans son cher Job ». Mais il lui cite aussi, parmi ses lectures, d’Alembert, « un honnête homme qui dit que ceux qui se vouent à la science doivent prendre pour devise : liberté, vérité, pauvreté ». Sa mère, que sa tendresse rend perspicace, aperçoit le danger : « Je te supplie de toute mon affection maternelle, d’étudier la Parole de Dieu. Il nous a fait la grâce de la mettre entre nos mains afin qu’elle puisse toucher puissamment nos cœurs et que nous la puissions discerner dans sa lumière de vérité ». Mais il était trop tard. Le doute avait envahi son intelligence qui ne pouvait se satisfaire de simulacres, mais avait soif de vérité vraie : « si c’était un péché de ne pas croire, c’en était un plus grand encore d’affecter une croyance qu’on n’avait plus ». Lorsqu’il vint passer ses vacances à Mainhill, la brisure était accomplie et il était certain aussi qu’il ne poursuivrait pas ses études de droit : le métier d’avocat, « perpétuellement tendu au gain » répugnait à cette âme hautaine, uniquement éprise de biens spirituels. Il se sentait voué à la pauvreté et avait pour les pauvres, ses frères, la plus ardente sympathie. Aussi, lors des troubles qu’avaient suscités, dans la région de Mainhill, la famine, se sentait-il plus proche des insurgés que des autorités militaires et civiles chargées de rétablir l’ordre. Et lorsqu’on voulut l’enrégimenter dans une garde de volontaires bourgeois, il ne refusa pas de se mêler à l’affaire, mais dit qu’il n’avait pas décidé encore de quel côté il se rangerait.
Puis il revint à Édimbourg. Il avait, à force de tendres ménagements, fait accepter aux siens sa rupture avec la lettre de la religion. Dès lors, il avait conscience profondément qu’il en avait conservé l’esprit. « Votre caractère et le mien », écrit-il à sa mère, « sont plus semblables que vous ne l’imaginez, et nos opinions aussi, bien que vêtues de tissus différents, sont, je le sais, apparentées quant au fond. Je respecte vos sentiments religieux, je vous honore de les éprouver plus que si vous étiez la femme du rang le plus élevé sans eux. Soyez rassurée, je vous en supplie, sur mon compte : le monde en usera avec moi mieux que jusqu’ici et, s’il n’en était rien, laissez-nous espérer que nous trouverons plus dans cette région d’en haut où toute ténèbre sera lumière, où la fièvre vaine de la vie sera abolie, où les manifestations de notre bonne volonté ne seront pas entravées par les infirmités de la nature humaine ». Et il était temps, vraiment, que le monde en usât mieux avec Carlyle, mais surtout que Carlyle en usât mieux avec lui-même. Il avait vingt-cinq ans et ne savait pas encore quelle serait sa tâche de vie. Il ne voulait être ni théologien, ni professeur, ni juriste, ni médecin. Mais alors que voulait-il, que pouvait-il être ? Il se le demandait sans trouver de réponse. C’est Edward Irving qu’il était allé voir et qui l’avait raccompagné à Édimbourg qui prononça la parole libératrice : Carlyle était né pour faire de la littérature et il devait commencer par essayer de collaborer à la Revue d’Édimbourg et au Blackwood’s Magazine. Et c’est ce même Edward Irving qui lui révéla un paradis que ses plus ambitieux espoirs n’auraient pas osé entrevoir et dont hélas, sa nature morbide lit un enfer pour la créature angélique qui lui en ouvrit les portes.
Le roman de Carlyle et de Jane Welsh a été narré bien des fois. Il constitue l’épisode le plus passionnant du pèlerinage de notre héros parmi les choses et les hommes.
Jane Welsh, née en 1801, était la fille d’un chirurgien distingué et aisé. Elle était remarquablement belle, vive, pétillante, amoureuse de la vie, de toutes ses fleurs et de tous ses fruits, faite pour être choyée, câlinée, précautionneusement maniée par les mains les plus fines et les plus délicates. Ses parents consacrèrent tout ce qui était en eux de tendresse, d’intelligence et de dévouement à donner à cette plante rare la culture capable d’en faire épanouir toutes les sèves. Ils eurent le bonheur d’avoir pour aide-jardinier Edward Irving qui, non seulement la comprit et l’admira, mais l’aima d’amour et fut aimé d’elle : engagé à une autre qui ne voulut lui rendre sa parole, il renonça, mais ne se consola jamais et eut le sentiment d’avoir gâché sa vie. Sous sa tutelle intelligente et affectueuse – Jane perdit son père à quatorze ans – la jeune plante humaine se développa magnifiquement. Elle était ouverte à tout et excellait en tout. Dux (cacique) en mathématique à l’école mixte de Haddington, elle s’enthousiasme en même temps pour Virgile et s’efforce de conformer sa vie aux austères principes des vieux Romains. Puis, elle s’essaie à une tragédie, prend conscience de ses dons littéraires et demande à les développer. Irving, n’ayant pas le temps de s’occuper d’elle, l’adresse à Carlyle.
Les voilà en présence, la fine et élégante patricienne, fleur de serre, avec cependant, grâce à sa libre éducation, les frais parfums d’une fleur des champs, et le fils de yeoman, rude, noueux, tordu comme un chêne. Qui eût jamais pu imaginer que cette plante exquise allait jeter ses bras graciles autour de ce tronc dévasté et en couronner la cime de ses hampes odorantes ?
Ce furent d’abord des relations toutes littéraires. Carlyle dirige les lectures de Jane, lui envoie des livres et les lui commente. Parfois elle vient de Haddington rendre visite à Édimbourg à l’un de ses oncles et profite de l’occasion pour voir son mentor et jouir de sa parole vivante. Elle admire sa science et n’est pas insensible, ne fût-ce que par contraste avec sa propre légèreté et souplesse aériennes, à ce qu’il y avait, dans ce jeune homme de vingt-six ans, de sérieux, de profond, d’inflexible et de pur. Il y avait, d’ailleurs, dans son âme polyphone, quelque chose qui – survivance de ses ancêtres parmi lesquels elle se glorifiait de compter John Knox, l’admirable champion de la réforme en Écosse – assonnait au timbre grave de cette âme puritaine. C’était donc une amitié qui se nouait, une amitié qui, de sa part à elle, ne s’attendrissait d’aucun sentiment plus doux. Quant à lui, il jouissait, en artiste, de pouvoir modeler, de ses mains robustes, cette tête exquise de jeune fille. Et il jouissait encore de pouvoir, en lui imposant ses idées, satisfaire un instinct de domination dont, jusqu’ici, il n’avait peut-être pas eu conscience. Et déjà ses visites étaient pour lui « l’île heureuse dans son existence sombre, vide et abandonnée de tous ».
Il avait cependant commencé à entrevoir sa voie. Il avait dit un adieu définitif aux mathématiques, s’était mis à apprendre l’italien et l’espagnol et à étudier sérieusement les penseurs français du XVIIIe siècle : d’Alembert, Diderot, Rousseau et Voltaire. De plus – et ce fut là le plus grand évènement de sa vie intellectuelle – il pénètre dans les parvis de la littérature et de la pensée allemandes. Il l’aborde par ses sommets : Schiller et Gœthe, avant d’en explorer les chaînes secondaires et les vallées. C’est Gœthe, dont il fut l’un des tout premiers à mesurer la taille, qui le captiva et le retint : il l’incorpora étroitement à son fond et en fit l’un des maîtres de son esprit. Aussitôt, il fait participer Jane Welsh à son voyage de découverte, non sans que Irving n’en ait conçu des craintes pour le christianisme de son élève toujours chérie. Il ne se doutait pas que ce sont les penseurs allemands qui ramèneront Carlyle lui-même au christianisme, non, certes, à celui de son enfance, à celui du bon pasteur John Johnston et de l’école du dimanche, mais à un christianisme spiritualisé, humanisé, purifié de toutes les gangues de la superstition, de toutes les supercheries miraculaires, de toutes les ankyloses du traditionalisme, de toutes les arguties de la scolastique, à un christianisme entièrement transmué en pure morale et en métaphysique. Ce fut là la fameuse crise de Leith Walk qu’il a décrite, en la transposant, en termes si pathétiques, dans Sartor Resartus, et au sortir de laquelle il avait retrouvé des raisons de vivre et d’espérer.
Après d’heureuses vacances à Mainhill où, plus que, depuis des années, il se sent en pleine communion d’âme avec ses parents, il est de retour à Édimbourg. Là, deux propositions l’attendent. Brewster, l’éditeur de l’Encyclopédie, lui demande, tout en continuant de travailler pour celle-ci, de traduire la géométrie de Legendre et, par l’entremise d’Edward Irving, la femme d’un grand juge des Indes, distinguée d’esprit et de cœur, Mrs Buller, lui propose de faire l’éducation de ses trois fils et de s’occuper spécialement de l’aîné, Charles. Carlyle hésite : son orgueil se cabre devant la relative servitude d’un préceptorat. Mais les conditions étaient convenables – il aurait son appartement et ses soirées seraient à lui – et la servitude assez dorée – deux cents livres par an. Or, la situation de son père était misérable et il s’agissait d’aider ses frères. Il n’avait pas le droit de refuser. Il accepte aussi la traduction de Legendre. Mais il brûle de donner sa mesure par une œuvre originale. Il songe à un essai sur Faust, à une histoire de la République anglaise, à une étude sur Milton, à un roman fait en collaboration avec Jane Welsh.
La correspondance entre les deux jeunes gens n’avait pas chômé. Carlyle essaie de lui donner un tour plus intime. Mais Jane freine et lui fait comprendre que leurs relations devaient rester fraternelles. C’était, en effet, le moment de la grande crise dans le destin d’Edward Irving. Nommé ministre à Hatton, il avait remporté, comme prédicateur, d’extraordinaires succès à Londres. C’est alors qu’il tente de fléchir miss Isabella Martin à laquelle il avait engagé sa foi, n’y réussit pas et se résigne, après de terribles combats contre lui-même, à l’épouser. Il tente de trouver un refuge dans sa foi, pousse son presbytéranisme jusqu’à ses conséquences extrêmes, prétend ressusciter le christianisme primitif, enseigne que le Royaume du Christ était proche, que, dans quarante ans, le Seigneur allait descendre sur terre dans toute sa splendeur, que, lui, Irving, allait fonder une communauté pour le recevoir dignement, est renvoyé par ses supérieurs en Écosse, ne s’incline pas, est exclu de l’Église comme hérétique et meurt, en 1834, abandonné et désespéré. Nul doute que Jane n’ait connu la tragédie dont elle était l’involontaire héroïne et n’ait partagé l’immense amour qu’elle avait inspiré à cette haute intelligence et à cette âme d’une si pure noblesse. Ce n’était pas l’heure de resserrer les liens qui l’unissaient à son rude ami.
Mais Carlyle n’était pas homme à se laisser décourager : il ignorait tout du drame qui s’était joué entre Jane Welsh et Irving et espérait qu’un jour le cœur fermé de la jeune fille s’ouvrirait à lui. En attendant, sa situation matérielle était excellente. Entre les Buller et lui s’étaient nouées des relations d’affectueuse confiance. Et cette éclaircie dans sa vie, jusqu’ici si sombre, libère les forces créatrices qui fermentaient en lui. Il écrit la Vie de Schiller, s’attelle à la traduction de Wilhelm Meister et déverse le trop plein de ses émotions dans des vers – vers épiques et surtout vers d’amour pour Jane. Celle-ci commence à être touchée par tant de constance. Elle se défend encore : « Je vous aime, lui écrit-elle, mais si vous étiez mon frère, je vous aimerais de la même façon. Je veux être votre amie, votre meilleure, votre plus dévouée amie, tant que j’aurai un souffle de vie. Mais votre femme, jamais ». Mais, en même temps, elle fait son testament dans lequel elle lègue, après sa mort et celle de sa mère, toute sa fortune à Carlyle.
Celui-ci, cependant, est repris par sa mélancolie. Bien qu’il mène à Kinnaird House, maison de campagne dans le Perthshire, où résident les Buller, une vie de travail, rendue facile par l’affectueuse bonne volonté de ses élèves, et d’agréable mondanité, il aspire à la liberté. En proie à une grave crise de neurasthénie, il est mécontent de tout et de tous et surtout de lui-même. Véritable écorché, tout contact avec les choses et les hommes le blesse et le meurtrit. Il a été repris par ses maux d’estomac qui lui font endurer « les tourments de l’enfer » « the pangs of the Tophet ». « Mon cœur », écrit-il à son frère John, qu’il avait malmené injustement, ce dont il se repent amèrement, « mon cœur brûle de fureur et d’indignation quand je songe que je suis entravé et enchaîné et torturé comme jamais homme ne le fut avant moi ».
Et voici que du fond de la détresse, lui sourit le plus magnifique espoir. Tandis que les Buller retournent à Londres, il reste à Kinnaird House pour achever son Wilhelm Meister, puis se rend à Édimbourg. C’est là que Jane vint le rejoindre. Sa mère l’avait mise en garde contre la rudesse et la violence de son ami. Mais elle ne l’écouta pas. Elle était venue à lui, ils s’étaient querellés, après quoi elle promit d’être sienne : pour le moment, leurs fiançailles demeureraient secrètes.
Sûr désormais de l’aimée, il se laisse porter par les flots de la vie. Il va rejoindre les Buller à Londres, s’y mêle à la gent littéraire, fait la connaissance de Mrs Montague, d’Allan Cunningham, de Thomas Campbel, et voit à Highgate, dans l’hospitalier logis des Gilmann, l’homme que, de tous ses contemporains, il avait le plus désiré approcher, ce Coleridge qu’il avait imaginé comme la superbe frégate qui, dans les mers infinies de la poésie et de la pensée, était allé à la découverte de nouveaux et merveilleux continents et qui n’était plus, hélas, en 1824, « qu’un vieux rafiau aux mâts, aux voiles et aux rames pourris ». Puis, il quitte définitivement, en toute correction, mais avec un grand soupir de délivrance, les Buller, va à Birmingham, « la cité de Tibal-Caïn », soigner son estomac auprès d’un spécialiste devenu ami, se rend ensuite, par Strattford et Oxford, à Douvres, où il retrouve une sœur de Mme Buller qu’il affectionnait et les Irving, et, de Douvres, à Paris où il passe douze jours que, « grâce à son esprit, de cire pour recevoir les impressions et d’acier pour les retenir », – comme dit Froude – il exploite admirablement et qui lui laissèrent un souvenir impérissable. Après quoi, il revient à Londres où l’attend l’immense joie d’une lettre de Gœthe.
Et de nouveau se pose à lui la question de son avenir, plus pressante, depuis qu’il y avait associé Jane Welsh. Le peu qu’il a vu de la vie littéraire à Londres l’a profondément dégoûté. Il ne consentira pas, écrit-il à Jane, « à déchoir jusqu’à cette misérable chose qui se nomme auteur dans une capitale et de bousilleur pour de l’argent dans les journaux ». Il a soif de campagne, de silence et de travail probe : il veut se faire fermier. Mais sa fiancée ne l’entend pas ainsi. Elle s’est laissée prendre par l’intelligence de Carlyle ; elle veut qu’il la fasse valoir là où elle pouvait le mieux se déployer et elle ambitionne de participer à son épanouissement. Elle ne lui cache pas que sa simple présence ne saurait la compenser pour tout le reste. « Je vous aime » lui écrit-elle, le 13 janvier 1825, « mais je ne suis pas amoureuse de vous ; cela veut dire que mon amour pour vous n’est pas une passion qui obscurcit mon jugement et absorbe toute considération de moi et des autres. C’est une affection simple, honnête, sereine, faite d’admiration et de sympathie et plus propre peut-être qu’aucune autre à fonder le bonheur domestique ». Lui, répond que, « sans grand sacrifice de notre part à nous deux, la possibilité d’une union entre nous est un simple rêve », entendant avec le plus naïf égoïsme lui laisser à elle la charge entière des sacrifices. « Mon cœur », répliqua-t-elle, « est capable (je sens qu’il l’est) d’un amour pour lequel nulle privation ne serait un sacrifice, un amour qui sauterait par-dessus toutes ces considérations de l’opinion que l’éducation et la faiblesse ont apprises à mon sexe ». Mais cet amour qu’elle avait éprouvé pour Irving, elle ne l’éprouve pas pour lui. Et voici qu’à Mainhill où, dégoûté de Londres, il s’était retiré pour achever un Essai sur les Romans allemands, il apprend d’un tiers indiscret que ce grand amour, plus fort que toute chose d’ici-bas, un autre – Edward Irving – le lui avait inspiré. Carlyle n’en veut rien croire, mais Jane, qui, jusqu’ici lui avait caché le drame de sa vie, le lui révèle en toute franchise. Alors, il lui rend sa parole : « elle ne le connaît pas, il a une étrange humeur sombre sur laquelle il n’a pas de contrôle ». Elle n’accepte pas, et, faisant visite à sa future belle-famille qu’elle conquiert par sa bonté et sa vive bonne grâce, elle rend leur engagement définitif. Lui était-elle plus attachée qu’elle ne se plaisait à le lui dire ? Est-ce pour lui et non pour elle qu’elle consentait à affronter son humeur, bien sombre et bien étrange, en effet ? Qui le sait ? Et lui, qu’aurait-il éprouvé, si elle l’avait pris au mot ? Il aurait, sans doute, souffert et dans son affection et, plus encore, dans son orgueil. Mais il est peu probable qu’il en aurait eu le cœur brisé à jamais comme Edward Irving. Les sources d’amour étaient en lui peu jaillissantes. Sans doute, les paroles désabusées que voici sont bien postérieures à ses orageuses fiançailles : « l’amour, ce que les gens appellent amour, est réduit à bien peu d’années de la vie de l’homme et à une fraction bien insignifiante de cette vie : même alors il est seulement une chose dont on doit s’occuper parmi beaucoup d’autres infiniment plus importantes. En réalité, autant qu’il l’a pénétré, tout l’intérêt pris à l’amour est une futilité si pauvre que, dans l’âge héroïque du monde, personne ne se soucie d’y penser et encore bien moins d’en parler ». Mais ce qui est plus significatif et plus grave, c’est que, dès le 27 septembre 1825, c’est-à-dire en pleine crise où toutes les énergies du jeune homme devaient être, semblait-il, tendues vers l’aimée, nous relevons, dans son Journal, cette note étrange : « Je désire secrètement compenser la faiblesse de mes sentiments – laxity of feeling – par l’intensité que je mettrai à les décrire – by intenseness of describing ». Il y a là un aveu d’impuissance sentimentale qui rappelle tant de cris désespérés de Kierkegaard et qui prouve que Carlyle était plus « gens de lettres » qu’il ne l’imaginait. Au demeurant, la situation était celle-ci. Le premier et irrésistible élan d’amour de Jane était allé vers cet Irving qui exerçait sur tous ceux qui l’approchaient une extraordinaire attirance : ç’aurait été vraiment l’homme de sa vie. Pour Carlyle, certes, elle l’aimait, mais d’un amour plus intellectuel que sentimental, d’une affection comme elle le confesse elle-même, fraternelle, calme, « domestique ». Quant à lui, il avait été, certes, attiré par elle tout entier. Mais aussi forte, plus forte, sans doute, que cet attrait, avait été la volonté de la conquérir, tel un de ces Vikings qui allaient ravir les belles vierges des pays du soleil. Et la racine de cet attrait était l’intuition que, dès l’abord, avait eue Carlyle que, de toutes les femmes qu’il aurait pu faire siennes, Jane Welsh était celle qui, le plus généreusement et le plus tendrement, sacrifierait toutes ses aspirations, tous ses talents, toutes ses habitudes de vie à l’homme qui ne lui inspirait pas d’amour, mais seulement de l’admiration et du respect.
Dès les fiançailles renouvelées, Carlyle met à de dures épreuves la patience et le dévouement de Jane. Pour ne pas écorner fortune de sa mère, elle propose qu’ils fassent maison commune avec celle-ci. Il refuse brutalement. Il ne veut pas « d’intrusions nauséeuses » « nauseous intrusions ». « C’est l’homme et non la femme qui doit avoir le gouvernement de la maison… C’est un axiome éternel, la loi de nature que les mortels ne sauraient enfreindre impunément… Je ne dois et ne peux vivre dans une maison dont je ne sois pas le chef… Il est dans la nature de l’homme de se sentir, quand il est contrôlé par qui que ce soit d’autre que sa propre raison, dégradé et incité, justement ou injustement, à la rébellion et à la discorde. Et il est dans la nature de la femme (car elle est passive et non active) de s’attacher à l’homme pour être aidée et dirigée par lui, de complaire à ses humeurs et de s’en sentir heureuse, de le conquérir non par sa force, mais par sa faiblesse, et peut-être, sorcière rusée, de lui commander en lui obéissant ». L’aveu est au moins franc et Jane savait au-devant de quoi elle allait. Ce qu’il voulait, lui, c’est de s’installer avec sa jeune femme dans une petite maison d’Édimbourg ou, par mesure d’économie, chez ses parents à Scotsbrig où ils avaient élu domicile après Mainhill. La mère de Jane consent à tout pourvu qu’elle ne soit pas séparée de son enfant. Mais les vieux Carlyle estiment que leur humble demeure n’est pas digne de Jane ni surtout de sa noble mère et Thomas en tombe d’accord. Il suggère alors une installation à Annandale. Mrs Welsh, pour mettre fin à ce long et pénible débat, loue et meuble à ses frais une maison à Édimbourg et la met à la disposition du jeune couple : le mariage accompli, elle se retirera chez son père à Templand. Carlyle était donc sorti victorieux de ce premier conflit, comme il sortira victorieux de tous ceux qui sillonneront leur vie conjugale, sans se douter – tant elle cache au fond d’elle-même sa détresse, – que chacune de ces victoires sera une meurtrissure pour l’âme tendre, délicate et frémissante dont le grand don inespéré, au lieu de l’avoir attendri, semble l’avoir raidi dans sa dureté.
À mesure, d’ailleurs, que le mariage approche, Carlyle se sent « spleenétique, malade, insomnieux, vide de foi, d’espérance et de charité ». Pour se revigorer, il lit 150 pages de la Critique de la Raison pure et s’encourage par des considérations bien singulières sous la plume d’un fiancé, à la veille de l’accomplissement de ce qui avait été son vœu le plus cher. « Après tout, je pense que nous prenons trop à cœur la cérémonie qui approche. Bon Dieu, beaucoup de gens ne se sont-ils pas mariés avant nous, ne s’en sont-ils pas tirés assez confortablement et n’ont-ils pas expérimenté que le mariage n’était – que le mariage » ?
Pour lui, il était cela, il n’était que cela. Mais elle, qu’avait-elle rêvé que serait le mariage, son mariage et comment la réalité allait-elle répondre à son rêve ? Certes, elle rendait hommage à ce qu’il y avait en son fiancé de grand, de noble et de pur. « On vous dira », écrit-elle en septembre 1826, peu de semaines avant son mariage, à l’une de ses tantes, « on vous dira qu’il est pauvre, qu’il est d’origine humble, qu’il manque de belles manières, qu’il ne paie pas de mine. Mais il y a cent chances contre une qu’on ne vous dira pas qu’il est parmi les hommes les plus doués de ce temps, et non seulement parmi les plus doués, mais les plus éclairés, qu’il possède toutes les qualités que j’estime essentielles dans mon mari : un cœur chaud et sincère pour m’aimer, une intelligence dominatrice pour me commander, un esprit de feu pour être l’étoile directrice de ma vie, je l’aime – cependant elle écrit : Ι like et non I love – du plus profond de mon âme ». C’est là un magnifique témoignage qui remplira Carlyle, lorsqu’il le connaîtra après la mort de sa femme, d’une joie mêlée d’amer remords. Mais si tout ce qui exalte Jane dans son fiancé était vrai, était-il cependant fait pour être un mari et pour rendre heureuse une femme, une femme comme la sienne ? Carlyle était un solitaire. Il ne pouvait penser et écrire que lorsqu’il était « chauffé à blanc » et cet état de surexcitation n’admettait pas de témoin. Seul il était dans son cabinet de travail, seul dans sa chambre à coucher. À sa femme, il appartenait de lui enlever tout souci matériel, de cuisiner, de laver, de repriser pour lui. C’est ainsi qu’avait fait sa mère et ainsi devait faire sa femme. Et elle se pliera à cet humble rôle de collaboratrice d’un grand homme, (car elle le sentait, elle le savait tel, bien des années avant que la renommée le proclamât, et c’est la conscience de cette grandeur qui lui permettra de ne pas succomber sous le faix du désespoir) qu’elle avait ambitionné d’être, elle deviendra sa servante.
Le mariage eut lieu le 17 octobre 1826, en toute simplicité. Il s’agissait maintenant pour Carlyle d’asseoir sa vie économique sur des bases solides. Il possédait, comme tout capital, 200 livres, ce qui lui permettait d’attendre, mais de n’attendre pas trop longtemps. Or, les perspectives qu’il avait vu s’ouvrir à lui lui échappaient une à une. Ni la Vie de Schiller ni la traduction de WilhelmMeister n’avaient marché comme il l’avait espéré. Aussi les éditeurs se faisaient-ils peu accueillants. Il songe à un « Annuaire littéraire », destiné « à mettre les lecteurs au courant des progrès de l’esprit en Angleterre et à l’étranger ». Mais il est obligé de renoncer à son projet, faute de pouvoir y intéresser des hommes capables de le financer. Un instant, il avait espéré obtenir une chaire à l’Université de Londres ou de St-Andrew, mais ne l’obtint pas. C’est alors qu’il décide de quitter Édimbourg et de s’établir à Craigenputtock, maison délabrée, avec une ferme, au milieu des marais, où était né le père de Jane et qui appartenait aux Welsh. Sa résolution prise, le destin se met tout à coup à lui sourire. Jeffrey, le tout-puissant directeur de la Revue d’Édimbourg, – le premier parmi les périodiques de langue anglaise – parent éloigné de Jane, s’intéresse au jeune couple, et bien que bon benthamien et, partant, à l’opposite du mysticisme et de l’idéalisme à l’allemande de Carlyle, commande à celui-ci un Essai sur Jean-Paul qui eut un grand succès. Son style laborieux, rocailleux, sourcilleux, continûment paroxystique, mais d’un si sombre éclat et d’une si profonde résonance (style que, d’après ses propres indications, il ne devait pas à Jean-Paul, mais, en partie, aux Puritains et Élisabethains et, avant tout, « aux mélodies intérieures du cœur et de la voix de son père et de sa mère ») avait frappé les lecteurs. Aussi Jeffrey lui ouvre-t-il toutes larges les portes de la Revue à laquelle il donnera successivement des études sur Zacharias Werner, le dramatiste mystique, l’Hélène du second Faust, Gœthe, Burns, Heyne, le philologue, et le Théâtre allemand. C’était là une voie qui s’ouvrait devant lui. Mais elle ne le fit pas renoncer à son étrange projet. D’une part, ce ne sont pas les articles qu’il écrivait avec tant de difficulté et parmi tant de transes qui pouvaient faire vivre le jeune ménage. À Craigenputtock, dont la ferme allait être conduite par l’un des frères de Carlyle, il était assuré de trouver les choses essentielles, nécessaires à la vie. De plus, Carlyle aspirait de toutes les forces de son être à un tel refuge. Il était fermement décidé à ne pas faire de sa plume la serve de ses besoins. Il n’écrirait que lorsqu’il aurait quelque chose à dire et à ce quelque chose il donnerait la forme la plus parfaite possible. À ce besoin de vérité et de beauté, il était prêt à sacrifier tout le reste, argent, ambition temporelle, satisfactions de vanité, et il était prêt à sacrifier aussi les plus légitimes aspirations de Jane à un minimum de bien-être, de vie sociale, de vie se rapprochant de celle à laquelle elle avait été habituée. Conscient qu’il était prêt à tous les holocaustes pour réaliser un haut idéal, il ne se croyait pas coupable de condamner sa jeune femme si vivante, si brillante, si avide de s’extérioriser, de se répandre, de se réaliser, à la solitude dans un désert. Pour lui, c’est cette solitude, dont il avait besoin pour créer, qui lui faisait apparaître Craigenputtock comme l’asile rêvé. Là, seul avec lui-même, il allait se chercher et espérait se trouver. Là, il n’aurait pas besoin du « nerf » qu’il sentait en lui « pour mettre dehors les visiteurs impertinents ». Et là, Jane Welsh allait vider jusqu’à la lie la coupe d’amertume que lui avait réservée le Destin.
Dans la plus belle de ses lettres – qui toutes sont admirables – elle a décrit avec un humour d’un extraordinaire pathétique, la vie qu’elle a menée dans la vieille maison que son mari et elle ont rendue illustre. Craigenputtock, dont le premier propriétaire connu fut John Welsh, le « conventanter » qui avait épousé une fille de John Knox, était un « triste trou maussade » à seize milles de tout fournisseur et d’un bureau de poste. De plus, le couple était pauvre et, malheur plus grand, Jane, brillante latiniste et excellente mathématicienne, était dépourvue de toute connaissance ménagère. Elle se mit tout d’abord à apprendre à coudre. « Les maris, j’étais choquée de le constater, percent leurs chaussettes et perdent tout le temps leurs boutons. J’étais censée d’avoir à veiller à tout cela. Il m’advint d’apprendre la cuisine, aucune bonne capable ne consentant à vivre dans un coin sis au bout du monde et mon mari avait une mauvaise digestion, ce qui compliquait terriblement mes difficultés. Avant tout, le pain apporté de Dumfries, surissait dans son estomac (oh ciel !) et mon devoir d’épouse chrétienne était de faire le pain à la maison. Je fis donc venir la Cottage Economy de Cobbet et me mis à fabriquer une miche de pain. Mais ne connaissant rien au procès de fermentation ni au chauffage d’un four, il advint que ma miche était dans le four à l’heure où je devais être au lit. J’étais la seule personne debout dans une maison située au milieu d’un désert. Il sonna une heure, puis deux, puis trois et j’étais toujours assise dans une immense solitude, tout mon corps brisé de fatigue, tout mon cœur oppressé par un sentiment d’abandon et de dégradation. Que moi, qui avais été si gâtée à la maison, dont le bien-être avait été la préoccupation d’un chacun, à qui l’on n’avait jamais demandé qu’à cultiver son esprit, j’aurais à passer toutes ces heures de la nuit à surveiller une miche de pain – qui peut-être ne serait pas du pain du tout ! Ces pensées me rendaient folle jusqu’à ce que je posasse ma tête sur la table et me misse à sangloter tout haut. C’est à ce moment que je me souvins de Benvenuto Cellini surveillant, toute la nuit, dans son fourneau, son Persée. Et je me demandais : Après tout, aux yeux des Puissances supérieures, quelle est la grande différence entre une statue de Persée et une miche de pain quand l’un et l’autre représentent le devoir. La volonté déterminée de l’homme, son énergie, sa patience, son talent sont les choses admirables dont la statue de Persée ne fut que l’expression fortuite. Si Cellini avait été une femme vivant à Craigenputtock, avec un mari dyspeptique, vivant à seize milles d’un boulanger et dont le pain fût mauvais, toutes ces mêmes qualités se seraient manifestées dans une bonne miche. Je ne puis exprimer quelle consolation ce germe d’une idée répandit sur ma vie si peu conforme à mes goûts et à mon éducation (uncongenial) durant les années que nous avons passées dans ce coin sauvage où mes deux prédécesseurs étaient devenus fous et le troisième s’était mis à boire… ».
Mais ce n’est pas impunément que l’on essaie de se consoler héroïquement d’une vie manquée. Déjà, à Édimbourg, la santé de Jane avait inspiré des inquiétudes à ses amis. Ils avaient averti son mari : « Veillez » lui écrit Jeffrey, « sur l’exquise créature qui s’est si entièrement fiée à vous ». Mais Carlyle était aveugle et sourd à tout ce qui n’était pas son labeur. C’est qu’aussi bien les années qu’il passa, solitaire, à Craigenputtock sont la période culminante de son activité littéraire. Il est en pleine, en magnifique ébullition créatrice. Il a pris conscience de lui-même, du Message qu’il était destiné à apporter à ses contemporains, et il en donne la première forme dans le célèbre Essai qu’il a intitulé Signs of Time (1829). Il achève son Essai sur Voltaire (1829) auquel se joindra, quatre ans après, celui sur Diderot. Il écrit une Histoire de la littérature allemande pour laquelle il cherche vainement un éditeur et qu’il se décide à « débiter en tranches » dans les Revues : Novalis (1829), Jean-Paul Richter (1830), Les Psaumes de Luther, Schiller, Les Nibelungen, La Littérature allemande à ses origines, Vue historique sur la Poésie allemande (1831), ESSAIS auxquels s’ajoutent, en 1832, Le portrait de Gœthe, La mort de Gœthe, Les Œuvres de Gœthe. Il fait suivre ses Signs of Time d’un Essai qu’il a appelé Characteristics (1831), de deux Essais sur l’Histoire (1830 et 1833) qui s’apparentent à l’un et à l’autre et d’un Essai sur les Corn Law Rhymes, qui est comme un avant-coureur de son étude sur le Chartisme et les Lettres Day Pamphlets. Et cette même année 1831, qui vit naître Characteristics, il met la dernière main à ce qui n’avait été d’abord qu’un article, étrangement intitulé Teufelsdröckh, qu’il n’avait pu placer, et qui devint un livre auquel il travaille de toute la passion dont il est capable, qui, de par son affabulation, semble directement inspiré de Jean-Paul et où cependant il a mis le plus de lui-même, qu’il a écrit comme avec le sang de ses veines, auquel il a incorporé toutes ses révoltes, tous ses doutes, tous ses cauchemars et toutes ses visions célestes, ses chutes et ses ascensions : Sartor Resartus.
Cette énorme production jaillit du sein de l’angoisse et elle s’en ressent. Le couple était tenaillé par de cuisants soucis matériels : le 7 février 1831, Carlyle écrit dans son Journal qu’il lui reste 5 livres pour affronter le monde et qu’il n’a rien à attendre d’autre pendant des mois. De tous les côtés, la mauvaise fortune assaille les solitaires de Craigenputtock. Les directeurs de Revues, qui apprécient hautement le talent du grand Écossais, mais redoutent son mysticisme et surtout ses prédilections germaniques, se font moins accueillants et paient mal ou ne paient pas les articles qu’ils finissent par accepter. La Revue d’Édimbourg, que Jeffrey lui avait si largement ouverte, se ferme à lui, au moins pour un temps, lorsque celui-ci en quitte la direction. Et c’est avec peine qu’il fait passer ses papiers dans la Foreign Quaterly Review, la Foreign Review et la Westminster. Ses frères qu’il avait généreusement pris à sa charge et avec lesquels il partageait ses derniers deniers, échouent tous deux dans leurs entreprises, John, le médecin, ne trouve pas de clients et essaie de faire du journalisme. Alick, qui avait pris la ferme de Craigenputtock, y laisse toutes ses économies et est obligé de l’abandonner, enlevant ainsi aux Carlyle, et surtout à Jane, le seul interlocuteur avec lequel il leur fût possible d’échanger des paroles amies. L’une de ses sœurs, Marguerite, la plus aimée et la plus aimable, est emportée par la tuberculose. Soucis humiliants, deuils, lourdes nuées sur l’avenir, solitude totale parmi les intempéries hibernales : c’est là l’atmosphère au milieu de laquelle Carlyle restait debout comme un roc, faisant front à la destinée et forgeant, sans relâche, les pages brûlantes de passion et étincelantes d’humour de ses articles et de ses livres. Quelques amis veulent l’aider, mais voient leurs efforts se briser à sa magnifique intransigeance. Jeffrey voudrait lui céder la direction de la Revue d’Édimbourg, à la condition qu’il renonçât à son idéalisme extravagant et à sa monomanie germanique : il refuse et c’est Napier qui s’assied dans le fauteuil directorial, capitonné de guinées. De même, il décline la rente qu’à plusieurs reprises lui offre du fond de son cœur, Jeffrey, et ne peut supporter la pensée que ce généreux ami, devenu Lord Avocate du ministère Grey-Brougham, ait fait un prêt d’argent à son frère John. Plus la pauvreté le presse, plus il se bande d’orgueil : tous les vraiment grands qu’il admire ont été voués à la vie la plus restreinte. Jeffrey, cependant, ne se laisse pas décourager : il s’offre à chercher à son ami une situation dans le Bureau des Longitudes, au British Museum ou auprès de quelque grand négociant. Carlyle, comme maté par l’infortune, ne dit pas non : mais il sait bien que ce sont là perspectives illusoires, qu’il est destiné à aller à travers la vie « sans emploi », without a trade et dans la pénurie. Pour comble de malheur, Jane, qui dépérit dans le désert glacé auquel elle est condamnée, est atteinte d’une diphtérie dont elle guérit, mais dont elle ressentira, toute sa vie, les suites.
La mesure était comble. Carlyle sent que c’en est fait de l’idylle de Craigenputtock. Il se décide à partir pour Londres, à essayer de placer Sartor et de trouver une petite situation qui lui permît de ne pas mourir de faim. Il ne réalisa, lors de ce premier séjour à Londres, qui dura d’août 1831 à mars 1832, ni l’un ni l’autre de ses deux desseins. Ni Murray ni Longman, les seuls éditeurs dont il pût être question, ne veulent mordre au morceau coriace qu’était pour le public anglais une œuvre comme Sartor. Et malgré les amicaux efforts de Jeffrey, aucun emploi ne put se trouver pour l’homme dont tout le monde reconnaissait les remarquables talents, mais qui n’était pas fait pour échanger sa liberté pour une fonction. Loin de se laisser abattre par ces échecs, Carlyle fait front héroïquement à la malchance. Son séjour, d’ailleurs, ne lui apporte pas que des déceptions. Il fait venir, en octobre, sa femme, s’installe avec elle dans un appartement meublé où il se plaît, et entre en rapports avec l’élite des littérateurs et des penseurs londoniens : Leigh Hunt, James Mackintosh, les Austin, Charles Lamb et, avant tout, John Stuart Mill. Les jeunes radicaux se groupent autour de lui comme autour d’un maître, bien qu’il y eût entre eux et lui des divergences essentielles qui ne tarderont pas à éclater : s’ils sont et demeurent d’accord avec lui dans la condamnation de la société présente, leur empirisme utilitaire ne pouvait se concilier avec l’idéalisme mystique dont il est le héraut. D’autre part, si les éditeurs refusent son livre, par trop fuligineux, pensaient-ils, pour le goût des lecteurs moyens, les Revues où il avait déjà écrit se rouvrent et d’autres, comme le Fraser’s Magazine et le New Monthly Magazine de Lytton Bulwer, s’ouvrent à lui. Napier, le nouveau directeur de la Revue d’Édimbourg, qui avait commencé par se défier de ce collaborateur peu commode, lui redemande de la copie et lui imprime les Characteristics qui furent hautement appréciés. Enfin, son frère John, qui avait été l’un de ses gros soucis et l’une de ses plus lourdes charges, devient, grâce à la recommandation de Jeffrey, le médecin particulier d’une riche aristocrate, et mis à même de rembourser son généreux créancier et de libérer Thomas d’une dette de reconnaissance cuisante à son orgueil. Carlyle était donc débarrassé, pour un temps, des préoccupations matérielles les plus pressantes. Et il aurait pu, somme toute, se déclarer satisfait de ces sept mois de détente et de contact pris avec les meilleurs de ses contemporains si, à l’orée de l’année, il n’avait perdu son père auquel il avait voué un respect et une admiration sans bornes.
Le 25 mars, les Carlyle quittent Londres pour l’Écosse. Lui, éprouvait le besoin de revoir sa famille que la mort de son chef avait désemparée. Elle, était désespérée. Sa santé était demeurée si fragile et sa répugnance de « s’emmurer » dans Craigenputtock si profonde que ses amis devinrent de plus en plus inquiets et de plus en plus révoltés contre Carlyle qui semblait aveugle. Il ne le semblait pas, il l’était effectivement pour tout ce qui n’était pas sa tâche. Dès son retour, il se remet au travail. Gœthe était mort et la reconnaissance envers le Dieu de la poésie qui, seul, parmi les contemporains, avait deviné et patroné le génie de Carlyle et l’avait traité avec une affection paternelle, lui faisait un devoir de dire au monde ce qu’il avait perdu en lui. Il prépare un article nécrologique et une grande étude d’ensemble sur son œuvre. Puis il commence une Étude sur Diderot, devant faire pendant à celle qu’il avait consacrée naguère à Voltaire. Comment, au milieu de cette fièvre de travail, aurait-il eu du loisir pour deviner ce qui se passait dans l’âme de sa compagne. Jane renfermait jalousement au fond d’elle-même sa détresse, sa terreur de la solitude, son horreur pour les basses besognes domestiques qui lui étaient imposées. Deux fois seulement, elle laisse échapper le secret de sa souffrance : dans une lettre à son beau-frère John et dans un poème adressé à Jeffrey dans lequel, en sa qualité de parent, elle voyait une sorte de protecteur, à propos d’une hirondelle qui était venue bâtir son nid sous l’auvent de leur maison, poème qui se terminait par la strophe que voici :
Et Carlyle, comment ayant perçu, à travers sa surdité, ce cri déchirant, écrit à son frère : « Jane est encore faible, mais je pense qu’elle est en train de se remettre. Sa vie, à côté de moi, qui suis incessamment occupé à écrire, est triste ; elle ne semble pas en désirer une autre ; elle a, en maintes choses, prononcé le mot Entsagen (renoncer) et regarde d’un cœur vaillant, sinon joyeux, dans le présent et l’avenir ».
Une diversion, cependant, allait être offerte à la séquestrée. Carlyle, ayant besoin de se documenter pour son Diderot, décide d’aller passer quelques mois à Édimbourg où ils arrivent en janvier 1833. Grâce à la riche bibliothèque des avocats, il peut achever son travail. Et voici que ses recherches sur les grands destructeurs de la fin du dix-huitième siècle l’amènent naturellement à la Révolution Française. Prendre corps à corps ce gigantesque ébranlement, expliquer cette éruption volcanique, écrire cette épopée, la plus prodigieuse qu’ait vécue l’humanité moderne et faire ressurgir ceux qui en avaient été les héros : voilà qui était à la taille de son génie apocalyptique. Mais cela ne le dépassait-il pas ? Ses mains étaient-elles assez robustes pour brasser, malaxer, organiser cette matière immense et, à ce moment, encore à peine entamée ? Stuart Mill lui envoie des Mémoires, des pamphlets et l’histoire de Thiers qui venait de paraître. Il hésite entre ce grand, mais peut-être trop grand sujet et une histoire de John Knox et la Réforme écossaise. C’est à Stuart Mill, dont les lettres pleines de sincérité et d’admiration sont, pendant des années, le grand réconfort de Carlyle, qu’il voudrait réserver le récit de la grande commotion française. En attendant, il continue son travail de documentation et va essayer de s’approcher du monstre par des monographies consacrées à quelques épisodes particulièrement pittoresques de la période pré-révolutionnaire : Cagliostro et le Collier de la Reine.
En dehors de son travail, Carlyle voit un certain nombre de personnes, parmi lesquelles la plus intéressante lui semble le philosophe William Hamilton. Ses rapports avec Jeffrey, qui résidait à Craigerook, propriété proche d’Édimbourg, s’étaient décidément refroidis. Lorsqu’une perspective s’ouvrit pour Carlyle d’obtenir une chaire à l’Université de Glasgow, l’« Avocat du Roi », dont l’influence sur la nomination était décisive, ne bougea pas. Cette déception nouvelle n’encouragea pas les Carlyle à prolonger leur séjour dans la capitale d’Écosse. « L’Athènes du Nord » n’avait pas fait à son illustre fils l’accueil auquel il aurait pu s’attendre après l’enthousiasme qu’il avait suscité, à Londres, parmi les mieux doués des jeunes penseurs. Aussi rejoignent-ils, dès le mois de mai, leur solitaire Craigenputtock.
Quelques heures de joie et de longs mois d’angoisse les y attendent. John, le médecin-voyageur vient faire escale auprès de son frère pendant plusieurs semaines. Fraser se décide à publier – au rabais – en dix tranches, dans son Magazine, l’implacable Sartor. Enfin, Craigenputtock reçoit la visite d’un jeune Américain, appelé Emerson, qui avait fait le long voyage du Massachusetts en Écosse, uniquement pour voir de ses yeux le grand essayiste « hanté de visions plus que divines », visite que Carlyle accueillit avec joie, ayant deviné que « ce jeune homme si pur, si calme, avec tant de bonté et de douceur, appartenait manifestement aux zones supérieures ». Voilà pour les heures de joie. Voici pour les longs mois d’angoisse. La santé de Jane demeurait chancelante et ce n’est pas le retour dans sa prison qui pouvait la revigorer. D’autre part, les directeurs de Revues, qu’avaient conquis le talent universellement reconnu de Carlyle et son extraordinaire don de conversation qu’ils avaient pu apprécier lors de son séjour à Londres, se font de nouveau réticents. Le grand article sur Gœthe avait été mal accueilli. Le Collier de la Reine est partout refusé. Quant à Sartor, si difficile à suivre, pour un lecteur moyen, même dans le livre, et devenu proprement incompréhensible, après avoir été déchiqueté en articles de Revue, il menaçait, au dire de l’éditeur, de ruiner le Magazine qui lui avait donné l’hospitalité. Enfin, une chaire d’astronomie s’étant trouvée vacante à l’Université d’Édimbourg, Carlyle, fort de ses études mathématiques d’antan, a l’intention de la solliciter s’il est soutenu par Jeffrey. Or, celui-ci non seulement refuse et réserve son influence pour l’un de ses anciens secrétaires, ayant pratiqué l’observation astronomique, mais encore motive son refus dans une lettre où, durement, il reproche à Carlyle son orgueil, son autoritarisme, ses extravagances de pensée et de parole. Cette fois, le courage de celui-ci fléchit. Le Journal de cette époque est un long cri de douleur et de révolte. Partout les portes se ferment à lui. Il ne demande qu’à vivre en toute modestie au prix du plus acharné labeur. Va-t-il être condamné à mourir de faim avec sa femme ?
Et alors, il prend une grande résolution. Alors que Londres ne lui offre aucune perspective, il décide de s’y établir. Il reconnaît enfin que la vie qu’il a menée et fait mener à Jane est « une sorte de la vie-dans-la-mort ou plutôt un-non-être-né ». Et il exécute son dessein. Les six années d’emmurement sont terminées, années pendant lesquelles Carlyle a continuellement grandi et Jane lamentablement dépéri. « En avant ! Il faut marcher ou périr… Tous nos vaisseaux sont brûlés » !





























