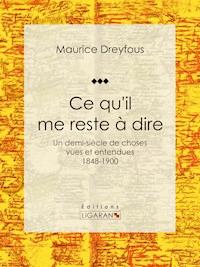
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Au temps de notre belle jeunesse, Zola, en ses moments de bonne humeur – et ils n'étaient pas rares – nous contait, moitié riant, moitié sérieux, le plan d'un roman qu'il rêvait d'écrire dès que les grands travaux auxquels il s'était voué lui en laisseraient la possibilité. Cela aurait été intitulé Simple vie d'augustine Landois."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050042
©Ligaran 2015
Un roman inédit de Zola : Augustine Landois. – L’histoire des gens qui n’ont pas d’histoire.
Au temps de notre belle jeunesse, Zola, en ses moments de bonne humeur – et ils n’étaient pas rares – nous contait, moitié riant, moitié sérieux, le plan d’un roman qu’il rêvait d’écrire dès que les grands travaux auxquels il s’était voué lui en laisseraient la possibilité. Cela aurait été intitulé Simple vie d’Augustine Landois.
Cette Augustine Landois était une jeune blanchisseuse qui, chaque matin, à sept heures cinquante-huit minutes, arrivait à l’atelier. À huit heures précises elle se mettait à l’ouvrage ; quand sonnait le premier coup de midi, elle prenait le chemin de son logis et là elle absorbait, chaud ou froid, selon la saison, le déjeuner qu’elle avait eu la précaution de préparer le matin avant de se rendre à son travail.
À une heure quatorze minutes elle était de retour à la blanchisserie et, sauf un arrêt de quinze minutes, au coup de quatre heures, elle ne démarrait pas de sa besogne avant que le coup de sept heures commençât à sonner. Au sortir de l’atelier, elle allait chez ses divers fournisseurs chercher le nécessaire pour son dîner du jour et aussi pour son déjeuner du lendemain. Elle achetait du même coup un numéro d’un journal qui publiait simultanément deux feuilletons, taillés toujours tous deux sur le modèle prévu et convenu et bien qu’il lui arrivât – comme à bien d’autres du reste – d’interchanger les personnages des deux ouvrages sans trop s’en apercevoir. Tout en lisant elle surveillait sa cuisine. Elle se couchait après son repas et finissait sa lecture avant de s’endormir.
Le lendemain matin, passé six heures, elle allait chercher deux sous de lait qu’elle chauffait sur son fourneau à pétrole, et, tout en savourant son lait et son sou de pain et en dégustant la suite de son roman, elle préparait son déjeuner du midi. Elle sortait de sa chambre à l’heure nécessaire pour être à l’atelier à sept heures cinquante-huit minutes, à midi neuf minutes elle était derechef dans sa chambre. Là elle consommait chaud ou froid selon la saison le déjeuner quelle avait préparé le matin et à une heure un quart elle reprenait sa besogne, à sept heures elle vaquait aux mêmes occupations que la veille. Six fois semaine elle faisait aux mêmes instants les mêmes gestes.
Chaque dimanche, ayant employé la matinée à mettre en ordre toutes ses petites affaires, elle allait passer son après-midi chez une tante à Montrouge. Et le lundi matin il en était de même que le lundi précédent, et les autres jours de la semaine étaient tous calqués sur le lundi ; et le dimanche qui les suivait était identique au dimanche qui les avait précédés.
Et cela eût duré toujours, toujours, toujours, ainsi qu’il advint à certains personnages des contes de fées et aux plus célèbres héros de Mac Nab et de Xanrof si le malheur n’eût voulu que la jeune et vertueuse Augustine Landois posât, un soir, sa boite d’allumettes ailleurs que sur la table de nuit, ce qui était sa place coutumière et logique. Pressée de se lever, elle était hâtivement sortie de son lit – ces choses-là arrivent aux plus illustres (vous n’y aviez peut-être jamais pensé) comme, aux plus humbles. Seulement les plus humbles n’ont pas de tapis et trop souvent leur chambre est carrelée. Tel était le cas de celle d’Augustine Landois. Ne trouvant point tout de suite ses pantoufles, elle se dirigea en hâte, pieds nus, de divers côtés de sa chambre, cherchant à tâtons ses allumettes. Le froid du sol soigneusement encaustiqué et fourbi, lui brûlait la plante des pieds et, en se remettant au lit, elle eut un petit frisson qui l’empêcha de se rendormir. Son insomnie, évènement très rare dans sa vie, n’empêcha point que, avant six heures, elle fût debout, ni qu’elle arrivât à l’atelier, comme toujours, à sept heures cinquante-huit. Me préserve le ciel de vous redire ce qu’elle fit à midi, et à une heure et à sept heures, non plus que ce qu’elle fit les jours suivants, dimanches compris. Je vous offre le plaisir de le deviner.
Seulement tout cela ne lui était plus aussi facile que par le passé. Elle avait d’abord toussotté, comme on disait à l’atelier. Elle ne s’en était pas autrement occupée. Puis elle avait toussé. Ça passera tout seul, avait-elle pensé. Mais cela ne passait pas tout seul et, la chaleur des fers à repasser aidant, et aussi le voisinage des microbes qui pullulent dans le linge mouillé faisant son œuvre, elle eut des quintes, à fendre l’âme sensible de ses camarades. Puis vinrent des quintes telles, que la locataire du logement contigu à sa chambre en avait porté plainte au propriétaire, qui avait menacé la pacifique blanchisseuse de lui donner congé si elle ne cessait de rompre le sommeil de ses voisins.
Il n’eut pas besoin de mettre sa menace à exécution. Épuisée par sa toux continuelle, elle dut aller se faire soigner à l’hôpital. Elle avait un tel air de brave fille que l’interne de service l’examina avec un intérêt particulier. Mais sa conclusion fut : « Rien à faire. Elle ne traînera pas. » En effet, au bout de quelques semaines la pauvre Augustine, tranquille comme si son ouvrage était désormais de tousser durant deux heures le matin et trois heures le soir, toussa sa dernière grosse quinte à l’instant habituel et rendit sa toute petite âme bien simple à son vieil ami le bon Dieu.
Toutes les camarades lui firent cortège jusqu’au cimetière de Bagneux, à pied, marchant derrière le petit corbillard fleuri par elles. Un char à banc les suivait, où la tante de Montrouge, à bout de force, avait pris place. Au sortir du cimetière toute la compagnie y grimpa pour s’en revenir vers Paris. À voix basse les camarades attristées parlaient d’elle et de rien autre que d’elle. La petite apprentie, la sœur aînée du louchon d’Augustine de l’Assommoir, peut-être, ne soufflait mot, mais cela lui était très pénible. Au bout d’un petit quart d’heure, elle sortit de sa poche une romance mélancolique, enjolivée d’une image, qu’elle avait achetée la veille ; elle la lut des yeux, cherchant à trouver dans le mystère des notes de musique, qu’elle ne comprenait pas, le souvenir de l’air qu’elle avait appris en suivant le chant du musicien ambulant au violon nasillard qui lui avait vendu l’autre jour dans la rue ce petit bout de papier noirci.
Petit à petit, s’animant à mesure qu’elle croyait retrouver l’air, ses lèvres commençaient à remuer puis elles chuchotèrent, puis elles chantèrent très bas. Alors sa voisine, regardant par-dessus son épaule, lut et chanta à son tour à bouche fermée ; une autre ouvrière qui avait, elle, aussi acquis la veille la même chanson, la retrouva au fond de sa poche et se laissa aller au rythme que la petite avait enfin retrouvé ; sa voisine l’accompagna à son tour. Parmi cette harmonie mélancolique et pour ainsi dire inconsciente, la tante de Montrouge, silencieuse dans son coin, enveloppée dans ses habits de grand deuil, affalée par la douleur, semblait ne rien voir de ce qui se passait autour d’elle. Elle s’appuyait à l’épaule du garçon de lavoir, qui, lui non plus, ne chantait pas et, tout au contraire, par mille gentillesses s’efforçait de la calmer.
Et comme ce char à banc transformé en une sorte de nid d’oiseaux chanteurs, où la tante faisait tache d’encre, déambulait dans l’avenue d’Orléans, une petite fille fit à haute voix cette réflexion puérile et saugrenue :
– Tiens ! la drôle de noce ! La mariée est habillée en noir !
À la hauteur de l’avenue du Maine on débarqua la tante, au grand regret du garçon de lavoir qui commençait à trouver son rôle de consolateur plutôt agréable, car la tante après tout n’était pas trop défraîchie. Petit à petit le répertoire de toute la blanchisserie se déroula par la grande ville, tant et si bien que lorsque le char à banc s’arrêta devant l’atelier où la place d’Augustine Landois restait encore vide on en était à chanter des choses qu’il est superflu de proférer sur la voie publique.
Et tout en chantant on se remit à l’ouvrage et les outils d’Augustine Landois furent repris par une nouvelle venue.
Telle était là toute la simple histoire d’Augustine Landois blanchisseuse. Je l’ai racontée à ma façon, au hasard du souvenir.
Je laisse aux critiques à l’esprit pénétrant, le soin et le plaisir de chercher dans quelle mesure l’idée première de la vie et de la mort de cette jeune blanchisseuse a pu influencer l’esprit de l’auteur de l’Assommoir. Et je garde à part moi le regret de ce que cet enfant de Paris, né d’une robuste Beauceronne, n’ait point tiré de là un de ces récits simples, sobres, unis comme la plaine de la Beauce aux ondulations à peine visibles, qui, dans le silence harmonieux des beaux soirs d’été, à l’heure où, dans les buées roses du soleil couchant, son horizon, qui se perd dans l’infini, ressemble à la mer étale et plane, parsemée d’îlots et de rochers coiffés de varechs et d’algues et de goémons.
Je songe alors à l’admirable fresque que Zola, digne de ses ancêtres vénitiens, eût faite en donnant à la plaine, calme et sans fin, toutes les nuances de ses reliefs invisibles, toutes les vibrations des lumières qui s’y jouent et jusqu’aux taches pareilles à des moisissures que font, sur l’émeraude des prés ou sur l’or des champs, les menus bouquets d’arbres éparpillés de-ci de-là. Je songe surtout à la merveilleuse synthèse qu’il nous eût donnée de la vie même, par le portrait d’une des créatures à qui il n’arrive rien qui n’arrive communément à toutes.
Plus je pense à la leçon qui serait sortie de cette Simple vie d’Augustine Landois et mieux je comprends l’intérêt qui s’attache à ces incidents de la vie courante qui, bien compris, tirent leur force de leur banalité même. Alors, faisant un retour sur moi, je me demande si dans un livre précédent je n’ai pas eu tort de traiter comme quantité négligeable le récit des impressions de ma première jeunesse. Non pas quelles vaillent grand-chose en elles-mêmes, mais elles ont, pour la plupart, été celles de mes contemporains autant que les miennes. Elles sont faites de tous les bruits que tous nous avons entendus et de tous les silences que nous avons dû subir. Elles ont constitué l’atmosphère de notre entrée dans la vie, l’origine de notre formation intellectuelle, l’essence de notre être moral, la source du caractère commun à nous tous.
Raconter mon enfance, c’est raconter celle des « autres », c’est-à-dire celle du « tout le monde » qui s’est développé au contact des mêmes évènements et des mêmes impressions. C’est pour cela que, profitant de l’enseignement que nous a donné Zola, je reviens sur mon idée première qui avait été de passer sous silence ces évènements et ces impressions. Je les note parce qu’elles sont la substance de l’Histoire des gens qui n’ont pas d’histoire, de ceux-là dont chacun n’est personne et dont l’ensemble s’appelle tout le monde.
Ayant, en un premier essai, exagérément écourté, ces notes je me ferai un devoir de n’en user ici qu’avec une extrême réserve, de ne leur point donner plus de place qu’elles n’en méritent, ni – autant que mon tact me permettra d’en juger – plus d’importance que le bon vouloir du lecteur en pourrait supporter.
Le 24 février 1848. – Les journées de Juin. – La mort du général Bréa. – Le Docteur Trélat. – Un grand aliéniste. – Un grand honnête homme. – Cinq ans au Mont Saint-Michel. – Les Carbonari. – Le Secret des Sergents de La Rochelle. – Le Deux Décembre et les rideaux de mon oncle. – Qui veut voir une tête de cochon ? – Le retour du marchand de moutarde. – Louis Napoléon à Saint-Cloud. – Madame la Grandeur et ses amis. – Napoléon III l’Homme-gibier.
Les plus lointains des souvenirs de mon enfance datent de la révolution de 1848. J’avais cinq ans seulement lorsque survint la journée du 24 février. Dans l’après-midi, des bandes passèrent devant chez nous en chantant sur l’air bien connu :
Comme un certain nombre de manifestants menaçaient de briser ses vitres, mon père, qui n’était point du tout révolutionnaire, s’avança jusqu’au seuil de notre maison et se déclara résolu à n’allumer aucun lampion ; puis, montrant une paire de petits pistolets, il déclara qu’il casserait la tête au premier qui tenterait de lancer une pierre dans ses fenêtres. Il faut croire qu’il n’avait pas l’air de rire et que sa haute taille, ses larges épaules, son air résolu de montagnard alsacien donnèrent à réfléchir aux tapageurs, car ils s’en allèrent tout penauds.
À partir de ce jour-là, ce furent chaque jour de nouveaux appels de tambour dont le ran-plan-plan réjouissait mes oreilles de marmot ami du bruit.
Lorsque vinrent les journées de juin, mon père dut aller prendre son service de sergent-major de la garde nationale aux alentours du Panthéon où l’on se battait pour de bon, ma mère boucla les courroies de son sac, et vaillamment elle l’aida à se mettre en route. C’est par un retour à cette scène des temps lointains que, lorsque dans la nuit du 20 décembre 1870, ce fut à mon tour de mettre sac au dos, pour aller prendre mon poste de combat, j’ai, alors que mes sœurs ajustaient les courroies du sac que je venais de hisser sur mon dos, vu reparaître devant moi ma mère, toute petite, se hissant sur la pointe des pieds pour boucler le sac de mon père, cependant que nous quatre tout petits enfants nous la regardions avec curiosité, les uns comprenant, les autres devinant, qu’il se passait à ce moment-là quelque chose de très grave. Et c’est sans doute à cette vision que j’ai dû de partir avec une absolue tranquillité.
Durant l’une de ces journées de juin – où l’on entendait, du matin jusqu’au coucher du soleil, mêlé aux chants des bandes qui s’en allaient au combat, le crépitement des fusillades, – il y eut un de ces orages formidables et tels que les auteurs tragiques en placent dans leurs drames pour en augmenter la force d’épouvante. Il se compliqua d’un véritable déluge ; les rues étaient transformées en marécages et, pour peu qu’elles eussent un peu de pente, il s’y formait un torrent à la course enragée. Telle était entre autres notre rue. Vis-à-vis de notre maison était l’entrée du vieux marché-aux-chevaux limité par un petit mur de trois à quatre pieds de hauteur. Le soir, la grande averse étant calmée, nous vîmes passer, le plus souvent un à un et parfois par deux, tout un chapelet de pauvres hères à la face et aux mains noircies par la poussière et par la poudre, se baissant presque à quatre pattes, rampant avec des gestes de rats mouillés, échappés de l’égout. C’étaient des insurgés fuyant droit devant eux, se croyant toujours poursuivis, rasant du plus près les maisons. Ils s’abritaient de leur mieux derrière le petit mur, ahuris, affolés, égarés par la peur de la fusillade réservée aux prisonniers que les soldats de l’ordre amenaient à l’autorité militaire. Oh ! cette répression de la guerre civile, horrible, basse, lâche, nous, des enfants, nous ne pouvions la soupçonner, mais nous ressentions comme des frissons inconscients à la vue de ces larves humaines se faufilant dans l’ombre de ce soir de juillet et semblant chercher quelque trou pour s’y engouffrer sous la terre et s’y faire introuvables.
À vingt-deux ans de là, j’ai vu la guerre contre l’étranger, mais jamais rien ne m’a laissé une impression plus lamentable que celle que ressentit, en juin 1848, mon pauvre petit entendement d’enfant de cinq ans.
Ce fut encore au cours de juin que nous eûmes une alerte émouvante. On se battait terriblement du côté de la barrière Fontainebleau, et la fusillade était si près de notre logis que de temps en temps, on entendait dans notre cour un bruit étrange, analogue à celui d’un gros caillou tombant perpendiculairement dans une mare. C’était le choc d’une balle morte qui venait s’aplatir sur le pavé de notre cour à quelques mètres des croisées basses qui s’ouvraient sur cette même cour. Elles étaient disposées de façon telle, que, tant que dura la bataille, on avait fait coucher les enfants à l’abri de cette sorte d’épaulement. Notre pauvre vieux chien, Turc, avait été pris de peur. On le fit entrer dans les chambres et il s’allongea comme nous derrière le petit mur, ayant probablement compris que le moment était venu de se faire le plus petit possible. Quand la pluie de balles mortes eut cessé, il nous fut permis enfin de nous dégourdir un peu les jambes, mais, à peine avions-nous recouvré notre liberté qu’on vint annoncer à notre mère que quelqu’un demandait à lui parler.
À ce moment, la situation était d’autant plus tragique que nous venions d’apprendre qu’un général venait d’être assassiné dans une sorte de guet-apens à la barrière Fontainebleau. Ma mère se rendit vers l’entrée de notre logis, et nous, les quatre petits, nous la tenions par ses jupes ayant comme une vague notion qu’elle marchait vers un danger et désireux d’y être à côté d’elle.
À quelques mètres de notre porte d’entrée nous nous trouvâmes en présence d’un homme tout seul, très grand, très maigre, revêtu d’une longue blouse blanche bien propre ; il avait l’aspect fantomatique, et son masque semblait plus blanc que sa blouse. Dès qu’il nous aperçut, il tendit vers ma mère un bout de papier déchiré, et lui dit d’une voix brisée par la fatigue : « Lisez ceci, madame. » Ma mère s’approcha et lut sur ce chiffon de papier ce seul mot : BRÉA, écrit au crayon.
Le pauvre diable à bout de forces demanda à s’asseoir. On le réconforta le mieux possible et au bout de quelques instants il retrouva le souffle. Il raconta alors ceci, qui vaut d’être pris en note par les chercheurs de petits faits historiques.
Le général Bréa était poursuivi par ses assassins et il allait être rejoint par eux, quand la porte d’une maison devant laquelle il passait s’ouvrit d’elle-même. Une voix lui chuchota : « Entrez », et il entra. Or, cette maison n’était autre que le magasin de réserve de mon père. Le malheur voulut qu’une petite fille l’ayant vu s’engloutir dans le magasin eut ce cri de joie : « Le général est sauvé ! »
La porte fut bientôt forcée, le magasin envahi, et le général Bréa cerné. À ce moment, l’homme que nous avions devant nous se trouvait à côté de lui et comme il avait bon visage Bréa lui dit : « Je vais être pris, portez mes remerciements aux braves gens qui ont tenté de me sauver. » Il avait commencé par son nom sa phrase de remerciements, et lorsqu’il fut saisi par les brigands qui en peu d’instants l’eurent massacré, il tendit le papier à l’homme à la longue blouse blanche. Et, fantôme inconscient, le visage plus blanc que sa longue blouse blanche, tel un pierrot sinistre, l’homme avait marché jusqu’à notre maison, et, sans savoir ni pourquoi ni comment, il était arrivé jusque devant nous ; sans savoir ce qu’il disait, il avait prononcé ces seuls mots : « Lisez, Madame ». Quand, le 22 décembre 1871, j’ai vu passer devant moi la civière où sous un grand manteau noir, gisait le cadavre du général Blaise, j’ai, par une sorte de réflexe dénué d’ailleurs de logique, pensé à la mort du général Bréa.
Durant toute l’insurrection de juin 1848, notre maison avait un aspect qui m’est demeuré présent à l’esprit. Au deuxième étage il y avait, en grand nombre, des fusils à piston couchés côte à côte sur le plancher d’un magasin ; au premier étage il y avait des paquets de cartouches cachés dans des commodes – ce qui faillit nous jouer un mauvais tour un matin que les insurgés vinrent pour essayer de perquisitionner chez nous. Enfin au rez-de-chaussée, – ô ironie des contrastes ! – tous, grands et petits, nous travaillions à fabriquer de la charpie pour les blessés des deux camps.
Voilà toute la révolution de 1848 racontée telle qu’elle a pu s’inscrire dans le cerveau d’un enfant de cinq ans.
Mais s’il ne m’est nullement possible de parler des évènements politiques de 1848, il m’est facile et il m’est très agréable de parler tout spécialement de l’un des personnages historiques de cette époque, qui fut le type accompli de ceux qu’on appelle encore aujourd’hui « Les Hommes de 48 ». Celui-là, je l’ai connu dès les premiers jours de ma vie.
Dans le quartier populeux où nous étions installés les relations mondaines étaient peu nombreuses ; elles se limitaient pour ma famille à un groupe des professeurs du Jardin des Plantes et à quelques industriels du voisinage, et également au personnel scientifique ou administratif de la Salpêtrière. À la tête du corps médical de l’hôpital se trouvait le Docteur Trélat qui se lia avec mon père d’une amitié profonde et ainsi se constitua une intimité qui dura jusqu’au dernier jour de la vie de Trélat. La place que Trélat a tenue dans l’histoire de son temps fut des plus importantes et l’exemple de sa vie vaudrait d’être présenté sans cesse aux jeunes générations si de tels exemples pouvaient servir à améliorer. Ce dont je doute très fort.
Républicain farouche, républicain de la première heure, longtemps affilié aux Carbonari, Trélat n’avait depuis sa jeunesse cessé de conspirer pour l’avènement de la République, il avait payé son dévouement à ses idées par de nombreuses années de prison. Il était de petite taille ; sa figure rasée, son teint jaunâtre, ses longs cheveux noirs et plats et qui restèrent noirs jusqu’à sa mort – et il mourut à quatre-vingt-quatre ans, – lui donnaient un aspect de quaker, un air dur, très sévère. La première impression qu’on ressentait en face de lui n’était guère engageante ; mais lorsqu’on avait entendu le son de sa voix, lorsqu’on avait bien regardé le fond de ses yeux, lorsqu’on avait provoqué le sourire de tendre bonté qui se cachait derrière ses airs d’homme grave, on lui était acquis de tout cœur et à tout jamais.
Trélat fut, pareil à Michel de Bourges, à Hippolyte Carnot, à Marie, à Albert, à beaucoup d’autres encore, le type accompli du dévouement, du désintéressement et de la simplicité. Médecin aliéniste dont l’autorité scientifique a survécu aux variations de la doctrine médicale à l’égal de celle de Pinel, son prédécesseur, il considérait la tâche de médecin des fous comme un apostolat, comme une œuvre d’adoucissement et de consolation bien plus encore que comme une œuvre médicale. Il avait eu, le premier, l’idée et le mérite d’organiser des concerts pour l’adoucissement du sort des aliénés ; il en usait comme d’un moyen curatif. Il fit plus, il organisa des bals de folles où les moins malades parmi les malheureuses confiées à ses soins faisaient assaut de coquetterie et se paraient chacune selon ses misérables ressources. Le souci de garder une bonne tenue au cours de ces petites fêtes atténuait ou souvent même suspendait pour quelques instants, la démence de la plupart d’entre elles. Il avait de même avec le concours d’amis personnels – l’un de mes oncles entre autres – organisé un orphéon de folles qui réussit fort bien.
Tour à tour, il employait à son service personnel des folles prises dans ses services ; il les remplaçait lorsqu’il avait étudié dans la vie courante de son ménage les moyens de les rapprocher d’un état mental aussi normal que possible.
Devenu ministre des Travaux Publics en 1848, il fut le type accompli de ces philosophes candides, incapables et désintéressés qui gouvernèrent la France jusqu’au jour où des malins politiques fermèrent les ateliers nationaux dont il avait la charge.
Il fut le type accompli de ces vieux de la vieille de la cause républicaine que des gens d’esprit ont appelés « vieilles barbes ».
Trélat était, comme tant d’autres des hommes de la même phalange, de ceux qu’aucune crainte n’arrête lorsqu’ils croient de leur devoir de faire respecter le droit et la justice ; c’est ainsi que, plaidant dans un procès politique devant la Cour des Pairs, et ayant osé dire que l’arrêt de mort prononcé par elle contre le maréchal Ney était un « assassinat », il fut condamné à cinq ans de prison. Durant ces cinq années, il ne vit aucun visage humain, hormis celui du geôlier qui lui apportait sa pitance. Ses seuls amis furent – tels ceux de Silvio Pellico, – des petites souris, et une certaine araignée dont, pendant de longues années, il avait conservé le souvenir ému !
Ces cinq années de cachot n’étaient pour lui qu’un souvenir du devoir accompli. Il n’en parlait jamais. Toutefois, un jour que ma famille revenait de Dieppe où l’on allait encore mi-partie en chemin de fer, mi-partie en diligence, ma mère ayant exprimé à Trélat l’émotion que lui avait causé la vue de la mer, elle poursuivit : « Vous connaissez d’ailleurs cela mieux que nous tous puisque vous avez vécu cinq ans au bord de l’océan ! »
« Détrompez-vous, madame, répondit Trélat, j’ai beaucoup entendu la mer, car elle battait les murs de mon cachot, mais, je ne l’ai jamais vue. On m’a emmené de Paris au Mont Saint-Michel dans une voiture fermée escortée de gendarmes, et, cinq ans plus tard on m’a fait sortir du Mont Saint-Michel dans une voiture fermée sans gendarmes. Jamais, durant mes cinq années de détention, il ne m’a été permis de rien voir, hormis les murs de ma cellule et ceux des cours extérieures de la prison.
– Mais, lui objecte-t-on, il nous semble vous avoir entendu dire que vous étiez allé à La Rochelle ?
– C’est un détail historique bien curieux que je puis dévoiler maintenant. Je faisais partie, comme vous le savez, de la secte des Carbonari, et j’avais été chargé d’aller à La Rochelle pour m’entendre avec quatre sergents, les fameux quatre sergents de La Rochelle qui devaient être les outils principaux d’une conspiration, et leur porter les dernières instructions à suivre. Par intermédiaire d’affiliés, rendez-vous avait été pris.
Je suis arrivé à La Rochelle par une nuit noire. Mes complices étaient au lieu du rendez-vous. Ils ont entendu le son de ma voix, ils n’ont jamais vu les traits de mon visage, je n’ai jamais vu les leurs. Ils n’ont jamais su qui j’étais, ni d’où je venais ; ni au cours du procès, ni en montant l’un après l’autre sur l’échafaud, aucun des quatre sergents n’a laissé entendre un mot qui pût dévoiler leurs complices. Il y avait là une raison bien simple et qui ne retire en rien, à mes yeux, de la beauté de leur héroïsme, il y avait la plus simple de toutes les raisons, c’est qu’ils ignoraient jusqu’au premier mot de ce que les juges tâchaient de tirer d’eux. »
Lors de la réunion du premier Conseil Municipal de Paris, Trélat, alors âgé de soixante-dix-sept ans, Trélat fut, à l’unanimité du Conseil nouveau, porté à la Présidence du Conseil. Il en fut ému comme du plus haut témoignage d’estime qu’un homme pût rêver.
En fait réel, sa vie politique s’arrête aux journées de juin ; sa vie scientifique, sa vie d’apôtre et de philanthrope attendri dura jusqu’au dernier jour de sa superbe vieillesse.
Vers 1850 nous quittâmes le quartier du Jardin des Plantes pour venir nous installer au centre de Paris, et j’avais à peine sept ans et demi quand je fus envoyé comme externe dans une petite école. À huit ans et demi, à la rentrée d’octobre 1851, je fus mis, comme on disait dans ce temps-là, « en pension tout à fait », rue des Fossés Saint-Victor – aujourd’hui rue du Cardinal-Lemoine. J’ai toujours gardé l’horreur des années d’internat, et chaque fois que j’en évoque le souvenir, ce que Sully Prud’homme appelait « l’odeur du supplice » me remonte aux narines. Je n’ai jamais senti une chandelle mal éteinte sans ce que cela réveillât en moi la sensation des veilleuses dans les dortoirs.
Après l’auteur des Solitudes, après le Charles Bovary de Flaubert, après le Petit Chose de Daudet, après d’autres pages inimitables je n’aurais garde d’essayer de tracer un tableau de ma vie de bagnard scolaire.
Un seul fait marquant me semble bon à noter.
Le 2 décembre, dès la première heure de la matinée, on vit arriver à la pension, soit les parents, soit les serviteurs de tous les élèves qui venaient les chercher en hâte et les emmenaient sans même leur laisser le temps de faire le petit bout de toilette des jours de sortie. Étonné, je me laissai docilement conduire par l’employé de mon père qui avait mission de me ramener chez nous, c’est-à-dire rue du Bouloi. Tout le long de la route, je ne vis rien qui me parût insolite. Le brave garçon qui m’accompagnait m’expliqua à sa façon qu’il y avait quelque chose comme une révolution et qu’il valait mieux pour moi me réfugier chez mes parents. Je remarquai assez vaguement qu’il n’avait (lui grand conteur d’histoires) ni son entrain, ni son assurance des autres jours. Il me sembla qu’il comptait ses paroles. Au débouché des halles, où subsistaient encore pittoresquement enchevêtrées les antiques maisons de bois aux auvents coiffés de tuiles qui constituaient l’ancien pilier des halles, nous aperçûmes au faite de l’église Saint-Eustache, sur une sorte de tourelle en bois construite au-dessus de la partie de l’édifice formant l’angle de la rue Montmartre, le télégraphe à bras, le vieux télégraphe de Chappe, faisant sans relâche des signaux. Pour la première fois de ma vie, et peut-être pour la première fois de la vie de mon guide, nous le vîmes fonctionner, levant, baissant, croisant ses longues antennes. Je demandai ce que pouvait être le manège que faisaient les montants de cet appareil étrange, et mon compagnon, rompant enfin ce silence qui ne lui était rien moins que coutumier, me confia, avec les apparences d’un grand trouble, que ces signaux devaient sans doute transmettre les ordres qu’on donnait à la troupe.
Ce fut seulement arrivé chez mes parents que j’eus une notion – assez vague d’ailleurs – de ce qui se passait. Dans une chambre placée au fond de l’appartement, des hommes faisaient entendre des paroles de colère ; les femmes, épouvantées, s’efforçaient de les faire taire, les suppliaient de parler plus bas, et l’on veillait à ce que toutes portes fussent bien closes.
La colère et l’effroi étaient d’autant plus terribles chez nous qu’on venait d’apprendre que l’appartement du frère cadet de mon père, situé boulevard Montmartre, juste en face la maison Sallandrouze, avait été traversé de part en part par des volées de balles, et que tout autour de sa maison, gisaient en masse les morts et les blessés. Quand, après l’éclaircie, nous sommes allés chez mon oncle, nous avons trouvé les grands rideaux de ses fenêtres criblés de trous.
Pendant bien des années j’ai eu sous les yeux ces mêmes rideaux où la place des balles avait été comblée mais non effacée par des pièces de la même soie gros bleu marquée de petits carreaux blancs. Et durant toute mon enfance chaque fois que j’ai revu ces pièces j’ai retrouvé intactes mes impressions du jour sinistré où elles étaient nées. Je me suis parfois demandé si cette impression qui m’est toujours restée présente de la journée du Deux-Décembre, n’a pas créé cet état de haine irréductible que j’ai gardée contre les auteurs du crime dont le souvenir est resté intact dans mon esprit.
Puis vinrent les jours de silence. Les générations venues à la vie loin de ces temps sinistres me semblent n’avoir pas la moindre idée de ce que fut le Deux-Décembre et moins encore se douter de l’état de terreur où l’on vécut longtemps ensuite. Après l’acte brutal, vinrent les internements, les déportations et le reste.
Il me semble que quiconque détient la notion directe, si vague qu’elle soit, de ce temps-là, a pour devoir d’en apporter le témoignage. N’étant qu’un enfant de moins de dix ans, je n’ai pas eu grande occasion de beaucoup voir, mais voici ce que j’ai vu : Chaque jeudi on nous conduisait à la promenade deux par deux, sous l’œil du pion. Or, comme nous marchions ainsi sur le terre-plein qui bordait le marché intitulé Marché aux Veaux, situé au carrefour Mouffetard, un de mes petits camarades, Armand L… mon cousin germain, âgé de douze ans environ, se tournant du côté de l’entrée du marché et montrant du doigt le buste officiel, en plâtre, de Louis-Napoléon, Président de la République, qui ornait le mur du fond, prononça cette simple phrase : « Qui est-ce qui veut voir une tête de cochon ? » Il n’en avait pas achevé le dernier mot que déjà la main d’un homme qui rôdait en flâneur autour de nous s’abattit sur son épaule, et ce mouchard, l’arrêtant proférait brutalement ces seuls mots : « Donne-moi l’adresse de ton père ! » Le pauvre petit garçon qui marchait côte à côte avec son jeune frère, d’un an moins âgé que lui, dut décliner son nom et donner l’adresse de ses parents, à Paris, rue de la Banque. L’homme sortit de sa poche un carnet et inscrivit le renseignement, puis il nous laissa continuer notre promenade. Dès lors, ni les enfants, ni même le pion, n’osèrent plus, le long de la route, proférer une parole. Personne de nous ne pouvait alors ignorer que la fantaisie d’un espion rôdant sur la voie publique pouvait envoyer notre père ou notre mère, aux pontons, à Cayenne ou à Lambessa.
Vis-à-vis de la place où mon pied s’est posé, à la minute même où j’ai vu le geste de ce mouchard arrêtant un enfant, se dresse aujourd’hui la statue d’Étienne Dolet, et chaque fois que je passe là, la silhouette d’Armand se dresse devant mes yeux et chaque fois, j’entends la phrase rude et brève : « Donne-moi l’adresse de ton père ! »
Un autre évènement a vivement frappé mon esprit d’enfant. J’étais devenu élève interne au collège Chaptal, lors de la rentrée d’octobre 1852. À peine étions-nous arrivés au collège que, le 16 octobre. – ceci est une date historique. – ordre fut donné à tous les établissements d’instruction publique d’envoyer en cortège leurs élèves pour qu’ils rendissent hommage au prince président Louis Bonaparte, qui rentrait à Paris, après une promenade triomphale à travers la France. Les villes avaient orné les arcs de triomphe sous lesquels il passait de devises telles que celle-ci : La Ville de Roanne se donne à Napoléon. À Strasbourg on lisait celle-ci : À Louis-Napoléon l’Alsace reconnaissante. Bien entendu, nous autres vagues potaches des petites classes, nous n’avions guère la notion de tout cela, nous savions seulement qu’on nous avait fait endosser nos tuniques neuves, qu’on allait nous conduire en bon ordre à la Madeleine, et que nous aurions un jour de congé le lendemain. On nous gratifia de bannières – avec ou sans inscriptions ; de cela je n’ai pas le plus vague souvenir. Mais ce qui m’est resté présent à l’esprit, c’est l’acharnement avec lequel j’ai refusé de porter l’une des bannières. Pourquoi ? Je n’aurais pas su le dire. Entrait-il dans mon refus tenace une certaine dose de rancune contre la fusillade qui avait ravagé les meubles de mon oncle, ou un reste de colère contre le mouchard qui avait arrêté mon petit camarade devant le Marché aux Veaux ? je n’oserais l’affirmer. Pourtant, si quelque liseur d’âmes m’attestait qu’une certaine part de ces impressions avaient déterminé mon geste, je n’en serais point étonné.
On nous aligna derrière les grilles de la Madeleine, et là, tout en attendant le passage du cortège annoncé, de nos voix grêles et tels que des oiseaux en cage, nous chantions ou plutôt nous répétions sans fin une scie lancée contre le prince président pour célébrer ironiquement le voyage tout récent qu’il venait de faire à Dijon :
Ah ! le voilà parti, le voilà parti l’marchand d’moutarde. Ah ! le voilà parti, le voilà parti l’marchand d’moutarde.
J’en demande bien pardon à S.I.(son immortalité) Jules Claretie, l’un des quarante, ancien Chaptal, mais je l’accuse, à tout hasard, d’avoir chanté comme les camarades cette ineptie, et d’avoir, avec nous, poussé sans relâche ce cri stupide mais à demi séditieux à pareille heure :
Vive la République et les pommes de terre frites ! Je dis à tout hasard parce que je ne suis pas certain que Claretie était déjà au collège Chaptal en octobre 1852. Il était alors de quelques années plus âgé que moi et j’étais au collège depuis trop peu de jours pour connaître les élèves des classes autres que la mienne. Depuis lors, chaque fois que nous nous retrouvons, chaque fois que je pense à la masse de besogne qu’il abat, à la merveilleuse activité qu’il déploie en toutes circonstances, à la vivacité toujours renouvelée de sa sensibilité et de sa verve, je constate, avec une quasi-certitude, que les rôles sont intervertis et que de nous deux, le plus jeune, – et de beaucoup – c’est Claretie.
Ce dont je suis bien certain, c’est que, parvenu à l’âge d’homme, il fut l’un des premiers à pousser le cri de révolte contre le Deux-Décembre. C’est Claretie, en effet, qui, en citant l’un des premiers, le livre de Ténot, La Province en décembre 1851, révéla à bon nombre d’entre nous, toute l’étendue du crime dont nous n’avions qu’une notion vague. Si ma mémoire est fidèle, Claretie fut même poursuivi correctionnellement et condamné pour avoir raconté le double assassinat du messager Martin dans le Var et les hauts faits du préfet Pastoureau, – cela d’après le texte de Ténot, dans un article du Figaro littéraire.
Si mon souvenir, un peu trouble, me fait commettre ici quelque erreur, Claretie me la pardonnera et la rectifiera si cela en vaut la peine.
Je passais le temps des vacances à Boulogne-sur-Seine, dans une maison de campagne louée par mes parents. Boulogne étant, comme chacun sait, placé entre Saint-Cloud et le Bois de Boulogne, on voyait chaque matin passer dans la Grande Rue, l’Empereur, qui se rendait à heure fixe aux Tuileries. Le plus souvent il conduisait lui-même son phaéton attelé d’une merveilleuse paire de chevaux baibrun, et s’il avait su conduire le char de l’État comme il savait mener ses deux grands carrossiers, il eût été le plus grand monarque de tous les temps. Avec sa tête penchée sur l’épaule droite, ses yeux d’un bleu glauque, de véritables yeux de poisson cuit, ils semblaient rouler au-dessus du vide, dans une façon de rêve. Tout le long du chemin, il saluait tantôt de droite, tantôt de gauche, d’un geste automatique et avec un certain air de reconnaître vaguement les mêmes visages qu’il revoyait chaque jour sur sa même route. On admirait généralement le calme et la simplicité avec lesquels il passait seul en apparence, tout ce long chemin où sa venue était inévitable et où les gens qui en voulaient à sa vie étaient avertis de son arrivée prochaine, par le rapide passage d’une voiture très légère, dite « araignée », attelée d’un cheval maigre, rapide comme un cheval de course. On y voyait, à côté d’un domestique qui conduisait la bête, Mocquart, le secrétaire particulier de l’Empereur. Entre Saint-Cloud et Paris, tout le monde connaissait bien le bonhomme étriqué, squelettique, roide, jaunâtre, rasé, ridé ; l’Empereur le suivait toujours de près. Puis, à quelques mètres en arrière du phaéton, apparaissait le coupé du chef de la police secrète particulière de Sa Majesté qui était déjà, si je ne me trompe, Hyrvoix.
La hardiesse de Napoléon III traversant cette zone dangereuse entre Saint-Cloud et Paris était plus apparente que réelle, car la route était pour ainsi dire pavée d’espions et de mouchards, hommes ou femmes. La majorité de ce personnel spécial tenait ses assises à Boulogne dans une sorte d’impasse dite « Impasse des Menus », située non loin de chez nous et qui formait une véritable Cour des Miracles. Parmi les mendiants difformes qu’on y rencontrait, on remarquait spécialement une certaine madame La Grandeur, amputée des deux jambes jusqu’au col du fémur ; son gros derrière carré reposait tel quel sur un tabouret. On l’y déposait le plus souvent, mais par une gymnastique difficile à expliquer, elle pouvait à la rigueur s’y hisser d’elle-même. Elle sautait du haut de son perchoir jusque par terre avec une adresse surprenante. Son seul moyen d’existence avoué était de raconter qu’elle avait un mouvement de montre dans le dos : on payait deux sous pour l’écouter. Mais là n’était point la profession de Mme La Grandeur ; la mansuétude impériale lui avait accordé l’autorisation d’installer son tabouret dans le parc de Saint-Cloud, et un sien ami la brouettait jusque-là ; les badauds s’assemblaient autour d’elle écoutant son boniment et s’offraient l’audition de son mouvement de montre dans le dos. Plusieurs de ses voisins de l’Impasse des Menus lui faisaient cortège, et se mêlant aux groupes des curieux qui s’assemblaient autour d’elle, provoquaient des bavardages, prenaient note de ce qu’on disait : cela constituait une admirable équipe d’espions politiques.
Nous autres, habitants de Boulogne, nous les reconnaissions ; mais malheur au bavard qui se laissait aller à mal parler du gouvernement devant eux. Ils changeaient assez souvent de costumes. Nous avions particulièrement remarqué un gaillard barbu qui était tantôt en uniforme de zouave, tantôt, en joueur d’orgue de Barbarie. Son orgue lui servait à créer des attroupements dans Boulogne aux mêmes fins que ceux que créait Mme La Grandeur.
Tout le long de l’avenue tracée en ligne droite qui va de Boulogne à Auteuil, il y avait, de deux en deux arbres, des sortes de cuvettes carrées destinées à recevoir les cailloux d’empierrement de la route.
Pendant plusieurs semaines, nous avons vu des individus couchés à plat ventre, dans chacun de ces trous. C’étaient, nous a-t-on affirmé de diverses parts – et avec toutes les chances possibles d’exactitude – des agents de la police politique, occupés à guetter des conspirateurs couchés dans d’autres cuvettes à pierraille et que l’on croyait prêts à tirer sur Napoléon III lors de sa quotidienne apparition.
Rien n’était curieux à voir comme le rapide passage de cet homme gibier entre ces deux rangs de chasseurs à l’affût.
À Boulogne, on racontait des histoires plus ou moins authentiques, plus ou moins amplifiées de ce qui se serait passé au Palais de Saint-Cloud, telle entre autres celle d’un cent-gardes qui aurait tenté d’assassiner l’empereur, qu’on aurait tué sans jugement, et dont on aurait fait disparaître le cadavre. Mais cela se chuchotait entre gens bien sûrs les uns des autres et à voix très basse.
La liberté de lire. – Les premiers journaux d’opposition. – L’assassinat de Victor Noir. – Louis Ulbach. – La tendresse de Ranc. – Deux majuscules. – En revenant de Neuilly. – Les cafés politiques du boulevard Montmartre. – La bombe sternutatoire.
À l’âge où nous étions déjà des grands garçons nous n’avions entendu que des histoires sans portée et sans consistance ; nous ignorions donc tout de ce qui s’était passé dans la vie publique de la France au-delà du règne de Napoléon Ier. Les cours d’histoire qu’on faisait dans les classes supérieures escamotaient la Révolution et s’arrêtaient à Waterloo. Pour tout ce qui pouvait éveiller en nous le sentiment de solidarité avec les autres humains, une seule impression m’est restée des premières années de l’Empire. C’est la conscience d’un vide absolu, c’est la notion d’un silence apeuré. Tout ce qui touche à la vie nationale, toutes les manifestations de la pensée libre, tout était supprimé. Les Chambres sont muettes, les corps savants sont muets, le monde de la pensée et de la science est à la merci de la police. Celle-ci donne le bon à paraître des journaux, elle éclabousse de ses estampilles les livres. Il est impossible de lire ce qu’elle défend de lire. L’exemple de Claretie poursuivi pour avoir rendu compte du livre de Ténot n’est pas une rareté ; ce livre formidable que sont les Châtiments de Victor Hugo a pu rester inconnu pendant plus de dix ans pour presque tous les jeunes gens de ma génération.
Personnellement, et quoique je fusse mêlé au monde des Lettres, je n’ai pu le lire que vers 1864 ou 1865, c’est-à-dire douze années environ après qu’il fut publié. Et encore n’était-ce que dans des conditions singulièrement périlleuses, sinon pour moi, du moins pour le camarade qui m’avait prêté son introuvable exemplaire. Ce camarade n’était autre que Stéphane Mallarmé, qui, tout en faisant des vers, enseignait – ou plus probablement, n’enseignait pas – l’anglais au collège de Tournus. Il avait eu, je ne sais comment, un exemplaire d’une édition des Châtiments sur papier pelure bleu, d’un format qui simulait une lettre de commerce et entrait dans une enveloppe comme une missive ordinaire. La poste me l’ayant apportée comme lettre de Tournus et Mallarmé ne cessait de m’en réclamer le retour comme lettre ; mais je m’acharnais à lui répondre que je ne lui ferais pas courir le risque d’une destitution, qui eût été certaine si quelque indiscret l’avait vu ouvrir ma soi-disant lettre, et je me refusais avec acharnement à lui rendre son cher petit volume autrement que de la main à la main, quand nous nous retrouverions au temps des vacances.
J’avais un précédent pour agir ainsi : mon père, officier ministériel expérimenté, ayant été en Belgique, y avait acheté Napoléon le Petit et au moment de retraverser la frontière de France, il avait eu à se débattre entre l’envie de terminer la lecture de ce livre introuvable et la crainte d’une révocation si quelque sbire le voyait ; et en dernier ressort il l’avait jeté par la portière du wagon en territoire belge.
Des exemples analogues ne seraient que trop faciles à trouver, mais je m’en abstiens. Ceux-là seuls dont j’ai été témoin ont suffi pour diriger ma conscience.
J’ai été mêlé dès ma première jeunesse à divers groupes d’hommes, jeunes comme moi, passionnément adonnés aux choses des lettres et pour qui la révélation, prodigieusement tardive, des évènements qui avaient fondé le second Empire avait été un sujet de révolte. Le silence qui s’était fait autour de ces évènements durant les années de leur formation intellectuelle, morale et politique leur apparaissait comme une injure sanglante, comme un mensonge insultant. À certaines heures, le silence est le plus cynique, le plus abominable des mensonges.
Et quand, au retour des proscrits de Décembre, les témoignages vivants, la tradition orale, vinrent compléter ce qu’il n’avait été possible d’écrire, alors ce fut pour quelques-uns d’entre nous, le coup de fureur qui nous jeta dans la mêlée du journalisme politique.
Le premier journal qui se fonda pour faire face à l’Empire fut le Rappel. Sa rédaction se composait des revenants de 1848 et de tout jeunes gens qui tous étaient nos camarades. Les hommes d’un âge intermédiaire, c’est-à-dire, ceux qui avaient atteint leur développement pendant la période de l’Empire étaient rares, très rares même, aussi bien au Rappel que dans les trois ou quatre autres journaux dont l’apparition suivit celle de l’organe que venaient de créer Victor Hugo, Vacquerie et Meurice.
Les hommes de cette période intermédiaire se tenaient dans une sorte de juste milieu, dans une opposition plutôt libérâtre que libérale, plutôt doctrinale et orléaniste que tout autre chose. Les grands chefs de ce parti étaient des écrivains de très grand talent et notamment ceux de la promotion de l’École normale : « Assolant, Taine, Weiss, Paradol, About, Sarcey. » Ils étaient tout prêts à passer dans le camp adverse ; About, Paradol, Weiss, en firent la preuve.
Après le Rappel, étaient venus, dans un ordre peu présent à ma mémoire, le Réveil dirigé par Delescluze retour de Cayenne, la Marseillaise dirigée par Rochefort et où travaillait mon compagnon de bohème, Bazire – ce même Edmond Bazire à qui j’avais intenté un procès en diffamation lorsqu’il m’avait dans cette même Marseillaise gratifié du titre de « Prince » et ce même Lavigne qui faisait partie d’une association de cinq malfaiteurs de lettres (dont j’étais l’un) ayant pour but d’alimenter les petits journaux de nouvelles à la main, bons mots, inepties et calembredaines tirés des recueils d’anas ou de nos propres cervelles et ne pouvant servir qu’à augmenter l’abrutissement d’un public déjà abruti. Mais le temps était fini de rire et Lavigne, « j’m’enfichiste » convaincu, était entré à la Marseillaise, bien moins pour y gagner quelque argent que parce qu’en cet endroit on cassait de la vaisselle. Tout au contraire, en digne petit-fils de mon vieux jacobin de grand-père qui, lorsque, soit mon père, soit d’autres, parlaient des « horreurs de la Révolution », ripostait avec une parfaite tranquillité : « Mes enfants, si vous aviez vécu en ce temps-là, vous en auriez probablement fait beaucoup plus », j’avais cherché ma place dans des journaux moins tapageurs, mais plus solidement armés contre l’Empire. Ce fut d’abord au Rappel, dont la vogue à ce moment était immense ; Vacquerie m’en ouvrait à grande porte et j’y travaillais par intermittence, en attendant une rubrique disponible. Puis Louis Ulbach ayant trouvé, de concert avec l’éditeur Le Chevalier, les fonds nécessaires pour transformer en un grand journal politique, sa petite brochure La Cloche, inspirée du type de pamphlet, créé par le russe Alexandre Herzen, ou, si vous préférez, analogue à La Lanterne de Rochefort, et Au diable à quatre de Lockroy, il m’y fut réservé une place.
Le journal La Cloche, tel qu’il était à la fin de l’Empire, mérite une mention spéciale, et il est curieux de passer, au-delà de quarante ans écoulés, la revue de ses collaborateurs. Voici d’abord, flasque et remuant, le patron Ulbach, un gros homme au nez pointu chaussé de lunettes toujours brillantes. Edmond About l’avait défini : « une burette d’huile dans laquelle on a mis du vinaigre ». Il avait du talent, des lettres, du savoir, une certaine bienveillance, mais il était perpétuellement rongé par un arriéré de dettes, d’origine tout à fait honorable sans doute, qui, faisant sans cesse boule de neige, le rejetaient chaque fois, à la recherche de son salut, dans des complications d’affaires de jour en jour plus impraticables. Il y perdait une partie de son esprit ; son talent même en souffrait, mais, contrairement à beaucoup de journalistes nouveau-jeu, il n’y perdait jamais, que je sache, ni l’indépendance de ses critiques, ni un atome de sa liberté ou de sa fidélité politiques.
Ulbach avait groupé autour de lui quelques hommes pour la plupart jeunes encore.
Le doyen de ses collaborateurs quotidiens était Ranc, celui-là même qui devint le bras droit de Gambetta. Auprès de lui travaillait Georges Périn qui occupa une place très importante au gouvernement de la Défense Nationale et joua par la suite, un rôle prépondérant à la Chambre des députés partout où se traitèrent les questions coloniales, alors toutes nouvelles dans le Parlement français. Steenackers, qui organisa le service des postes pendant la Défense Nationale, était aussi de la maison ; et de même Marcelin Pellet, encore un futur collaborateur de Gambetta à la République Française. Entré exceptionnellement jeune à la Chambre, il devint le gendre du directeur de la République Française, Scheurer-Kestner ; il occupa des postes diplomatiques très importants. Il est, à l’heure où j’écris, ministre à la Haye. Il y avait Gabriel Guillemot ; celui-là est oublié ; il n’était que journaliste, mais il l’était bien. À nous deux Guillemot nous occupions alternativement la même rubrique ; notre besogne consistait en des articles fantaisistes contre l’Empire que nous nous efforcions de rendre aussi féroces que nos moyens nous le permettaient.
L’homme gai de la troupe s’appelait alors Gaston Perrodeaud. Mais, après la Commune, il changea de nom, et pour cause. Il se fit alors dans la presse, sous son pseudonyme de Gaston Vassy, une assez jolie place de chroniqueur et d’informateur.
Comme il avait pris part aux aventures de la Commune sous son vrai nom, il avait cru prudent de retourner sa tunique, et était entré dans les journaux réactionnaires où il tapait de toutes ses forces sur ces affreuses canailles de communards. Il était né comme ça, il avait le goût des aventures et aurait tué père et mère pour faire une bonne blague. Tout lui était sujet de rire. C’est ainsi qu’il inventa et raconta en détaille suicide de je ne sais quel général, histoire de plaisanter ; mais le vieux militaire se rebiffa, si bien que Gaston Vassy fut poursuivi et pinça quelques mois de prison. Faute de place convenable dans d’autres prisons, il fut incarcéré à la Conciergerie. Pour se constituer prisonnier il fit atteler son phaéton à deux chevaux, car il avait équipage ; un domestique en livrée portait ses valises. Les gardiens de la prison, qui n’avaient jamais reçu de pensionnaire aussi distingué, s’empressèrent de prendre et de porter les colis élégants de ce client, et, tels les garçons d’un hôtel de premier ordre, ils les portèrent avec respect dans sa cellule.
L’amusement qu’il avait eu lors de cette entrée faisait oublier à Gaston Vassy l’ennui de sa réclusion ; chaque matin, sur le quai de l’Horloge, les deux chevaux et le phaéton défilaient, et leur maître placé devant l’une des baies du préau les saluait de la main.
Une seule fois dans toute sa vie, au printemps de 1870, Perrodeaud fut tout autre que le fantaisiste qu’il était sans relâche. Ce jour-là, dans la salle de rédaction de La Cloche, ni lui, ni personne n’avait la moindre envie de plaisanter, je vous l’assure ! Nous étions prêts à toutes les violences. Sortant de son cabinet et entrant dans la petite salle où nous travaillions, Ulbach nous était apparu la face blanche de rage et il avait crié, la voix assourdie par la fureur :
« Pierre-Louis Bonaparte vient d’assassiner Victor Noir ! ! »
Pour avoir une idée juste de la scène, il faut se rendre compte du lieu dans lequel elle se passait. Les bureaux du journal La Cloche n’étaient pas somptueux, il s’en faut de tout. Ils étaient installés rue Coq-Héron, n° 5, dans un entresol appartenant à la grande imprimerie de journaux de Dubuisson. On y accédait par un escalier très usé et où la caresse du balai n’avait pas passé depuis bien des années ; on y entrait par une petite porte donnant sur une sorte de vestibule large de deux mètres et long d’autant, lequel donnait accès sur la salle de rédaction meublée, en tout et pour tout, d’une table qu’entouraient des chaises d’occasion.
Elle était éclairée par des fenêtres basses et étroites donnant sur une cour sombre. L’unique garçon chargé de l’entretien du local était toujours en courses, si bien que la poussière chaque jour plus épaisse y demeurait tranquille, et n’était jamais dérangée que par les vêtements des rédacteurs qui s’y aventuraient. Sur le côté de cette salle se trouvait – un peu moins poussiéreux parfois, – le cabinet directorial, petite chambre meublée d’une pauvre table à tiroirs et d’un ou deux fauteuils. Le papier déteint qui tapissait les murs était caché par des caricatures d’André Gill, de Durandeau et de Carjat.
Nous étions tous dans la salle de rédaction occupés à nos besognes diverses, lorsque ce coup de tonnerre « Victor Noir vient d’être assassiné par Pierre Louis Bonaparte ! » éclata sur nous. Certes Louis Ulbach, gélatineusement ventru et la face barrée par ses besicles à gros verres, n’était pas beau d’habitude. Nul être humain n’était d’ordinaire moins imposant que lui. Mais à ce moment-là il eut une expression de révolte et de désespoir tels que le ridicule de sa personne physique se transformait en quelque chose de superbe, de shakespearien et de très noble. Ce poussah à lunettes eut en cette minute une allure épique. Sans un commentaire, sans un mot, il rentra dans son cabinet, et là, il écrivit un article d’une quarantaine de lignes tout au plus, tumultueux et brûlant comme une coulée de lave, et d’une beauté telle qu’il pourrait et devrait figurer dans les anthologies à côté du J’accuse de Zola.
Il faut se rendre compte bien exactement de notre stupeur et de notre rage, savoir quelle affection nous avions tous pour Victor Noir, ce grand gosse, – passez-moi cette expression malsonnante, elle est la seule qui définisse exactement. Ce colosse doux et bon, d’une ignorance touchante, était émouvant, à force de bon vouloir à apprendre toutes choses. Pour chacun de nous il était tout à la fois un jeune frère et un enfant gâté. Il n’avait guère que vingt-trois ans, sa taille et sa carrure étaient celles des cuirassiers de la grosse espèce. Malgré notre tristesse, nous ne pouvions retenir un sourire à l’idée de ses mains énormes prisonnières dans des gants, car, pour la première fois à notre connaissance, il avait mis des gants, voulant se présenter en homme du monde devant une Altesse impériale.
Je n’ai nulle envie de défendre Pierre Bonaparte, mais il est certain que l’apparition de Victor Noir chez lui a pu le troubler. Il y a lieu de supposer qu’en voyant Victor Noir et en entendant la grosse voix brutale et faubourienne de ce quasi-géant d’autant plus bizarre qu’il s’efforçait de paraître distingué, Pierre Bonaparte a été pris d’une folie passagère ; lui qui avait, notamment à l’affaire de la Zaatcha où il avait déserté devant l’ennemi, donné les plus belles preuves de lâcheté, aurait tiré par peur. Il n’en était pas d’ailleurs à son coup d’essai : dans sa jeunesse il avait été en Italie mêlé à des histoires très sombres, et ce n’avait pas été pour son seul plaisir qu’il avait longtemps résidé aux États-Unis, d’où il serait parti plus brusquement qu’il ne l’aurait souhaité.
Nous n’étions pas encore remis de notre première secousse quand Ranc entra dans la salle de rédaction en criant : « Vous savez la nouvelle, ils viennent d’assassiner Victor Noir ! ! ! »
Ranc occupait dans la presse républicaine de-dernières années de l’Empire une place toute particulière. Bien qu’il fût encore relativement jeune, il avait déjà à son actif plus de vingt années de dévouement et de misère qui nous inspiraient un grand respect.
Le bagne politique, l’évasion, la misère dans l’exil l’avaient rendu défiant à l’excès. C’était une façon de hérisson incapable de se laisser aborder même par les gens qui venaient à lui par respect et par sympathie ; mais à partir de cette minute-là, j’ai vu, une fois pour toutes, le véritable Ranc derrière le bourru, le bougon, le hérisson, qu’il feignait d’être. La tendresse, la bonté profonde pleuraient dans les mots de colère qu’il proférait en parlant du jeune enfant qui venait de tomber. Il semblait que deux sentiments se mêlaient dans la musique que l’état de son âme donnait à ses paroles : la douleur d’un grand frère de qui l’on venait de tuer le frère cadet, la douleur du patriote dont le cœur saigne devant l’abaissement et l’humiliation où est tombée la Patrie !
Et de ce jour-là, soit qu’il fût aimable, soit qu’il fût bougon, j’ai aimé également, profondément Ranc, et pour toute la vie. Je n’ai jamais d’ailleurs fréquenté un homme aussi peu aimable et qui eût groupé autour de lui autant de solides, de respectueuses, de tendres amitiés.
Les origines de l’assassinat de Victor Noir sont si mal connues que je crois utile de les rappeler, ne fût-ce que parce que mon camarade Lavigne y joua l’un des rôles principaux.
Ernest Lavigne, qui n’avait pas perdu le pli normalien, avait écrit, au bruit des fers à repasser de sa blanchisseuse et amie de la cité Bergère, une sorte d’histoire vraie de la famille Bonaparte et en particulier la biographie de Pauline, et l’avait fait paraître dans La Marseillaise. Votre serviteur, qui vivait souvent auprès de Lavigne, n’est pas absolument certain de n’y avoir point été pour quelque chose. De vieux bouquins retrouvés dernièrement l’incitent à se le rappeler très vaguement – peu importe d’ailleurs.





























