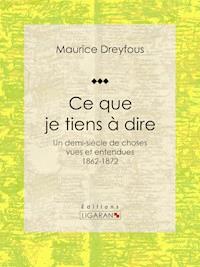
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "À l'heure où paraîtront ces lignes, j'aurai atteint ma soixante-dixième année. Je me croirai donc en droit d'être le vieux monsieur au masque brun, aux cheveux blancs et à la barbe blanche, qu'on voit chaque jour appuyé sur le parapet du pont des Arts, gravement et longuement occupé à contempler les pêcheurs à la ligne, s'intéressant à tout ce qui les intéresse."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335050028
©Ligaran 2015
Mon vieil Ami,
Dans la Préface que vous m’avez fait l’honneur très grand de composer, pour en enrichir l’un de mes plus récents ouvrages, vous écriviez ceci :
Au vu de ces lignes je vous ai, pour la première fois, confié que, déjà cédant à diverses incitations, souvent très anciennes et souvent répétées, j’avais rédigé, et en grande partie, ces mêmes Mémoires dont vous souhaitiez la publication.
Jusqu’alors je n’étais guère désireux d’en poursuivre l’achèvement et n’avais nulle envie de les remettre à l’imprimerie.
Depuis lors, j’ai résolu de mener à bonne fin ce travail dont, dans une certaine mesure, vous vous êtes rendu complice.
Vous en êtes, tant soit peu, responsable devant le public, et c’est la raison pourquoi je vous prie d’en accepter la dédicace.
Je vous l’offre comme un témoignage de mon admiration pour votre œuvre et de mon affection pour votre personne.
M. D.
Mai 1912.
PRÉSENTATION
À l’heure où paraîtront ces lignes, j’aurai atteint ma soixante-dixième année. Je me croirai donc en droit d’être le vieux monsieur au masque brun, aux cheveux blancs et à la barbe blanche, qu’on voit chaque jour appuyé sur le parapet du pont des Arts, gravement et longuement occupé à contempler les pêcheurs à la ligne, s’intéressant à tout ce qui les intéresse.
Parfois son attention est distraite par la venue d’un bachot à fond plat évoluant au milieu de la rivière et du haut duquel des mariniers privilégiés, accomplissant des miracles d’équilibre, lancent leur épervier. À chacun de leurs gestes, l’esquif pique du nez et semble prêt à les lancer à leur tour au fond de la Seine. Le filet ayant fouillé l’eau claire ou l’eau trouble, remonte, tantôt plein, souvent vide, et le vieux monsieur demeure pensif en face de ces gens qui, sans souci de la chute, s’acharnent à jeter dans la gueule du hasard ce filet, qui est tout à la fois et le symbole et le dispensateur de leur vie.
Parfois las d’observer, entraîné par la rêverie qui toujours – chez lui du moins – suit l’effort de l’observation, il lève la tête pour regarder en artiste son cher Paris.
Et, tel un capitaine allant et venant sur sa passerelle, il contemple pour la dix millième fois sous ses divers angles, et toujours avec une admiration nouvelle, le panorama qui se déroule devant ses yeux. Tout près de lui il voit le dôme solennel du Palais Mazarin et la silhouette contournée de sa façade aux terrasses garnies de lourds pots à feu, qui semblent autant de sentinelles montant la garde sur un rempart. Tout près de lui se dresse la bâtisse plate et pompeuse de la Monnaie, et, au loin, apparaissent le Palais de Justice, la Sainte-Chapelle, l’Hôtel-de-Ville, la tour Saint-Jacques, les clochers de dix églises. Les pignons bariolés de cent maisons géantes donnent une vie plus intense à l’ensemble de la vision.
Aux jours où la brume ferme, comme d’un rideau gris clair, l’horizon qu’elle rapproche, toutes ces merveilles semblent des silhouettes d’un gris très foncé découpées du bout d’un tranchet dans une surface sans apparence d’épaisseur. Tout au contraire, dans les jours de soleil, elles se développent en de vastes reliefs, et s’embellissent de la beauté des arbres qui leur servent de broderie ; elles se profilent sur l’émail bleu du grand ciel qui leur verse sa lumière douce, profonde et vibrante.
Et le vieux monsieur, encore qu’il jouisse chaque jour de ce même spectacle, embrasse une fois de plus la ville sacrée, bonne et superbe où il est né, où il a vécu de tous temps, dont il a partagé toutes les épreuves douces ou cruelles. Il la couve de ce regard qu’ont les petits enfants, pour dire à leur mère qu’ils voient en elle l’œuvre la plus belle et la plus profondément bonne de toute la création. Puis, sondant du regard l’horizon, il voit, et plus encore par la pensée que par les yeux, la théorie sans fin des bateaux qui viennent de là-bas où la rivière est encore jeune et la descendent d’une marche rapide et presque au fil de l’eau conduits par les remorqueurs traînant impérieusement derrière eux la longue jupe de moire verte, aux mille petits replis pailletés, de leur sillage.
Et lorsque vient le soir, il ne manque jamais d’aller s’appuyer de nouveau sur le parapet du pont des Arts et de contempler de là-haut, aussi longtemps que dure l’effet du soleil couchant, les vieux murs du vieux Louvre perdus dans la poussière d’or qui change en marbre rose les reliefs merveilleux des chefs-d’œuvre qui brodent son manteau de pierres noircies par les siècles, et les frondaisons puissantes des jardins des Tuileries et des Champs-Élysées qui émergent d’une atmosphère qui n’est plus qu’une fournaise, cependant que là-bas, là-bas, éclairés d’un jour pâle, qui bientôt se violace, puis tourne à l’orangé, puis à l’aigue-marine, les clochetons, les coteaux et les verdures qui bordent l’horizon du cœur de Paris s’effacent petit à petit sous le voile de la nuit qui monte.
Dans ce vieux monsieur que je suis, pacifique, solitaire, et toujours vivant son rêve, je retrouve l’image complète de ce que fut toute ma vie. Et c’est pourquoi je me présente ici au lecteur, afin qu’il sache par avance, à qui il a affaire et ce que peuvent valoir les propos que je lui offre d’entendre.
J’ai connu, j’ai pratiqué toutes les gloires que le soleil couchant du dix-neuvième siècle a glorifiées, et sanctifiées avant qu’elles entrent dans l’Ombre éternelle et dans l’Immortalité. Je les ai contemplées avec tendresse et avec respect. Leur regard me fut le plus souvent très doux et la déférence que j’avais pour elles a facilité maintes fois le bonheur que j’ai eu de mieux connaître les hommes en qui le sort les avait placées.
J’ai, de même, vu arriver du lointain, un à un, les hommes d’aujourd’hui et ceux de demain, légers de bagage et chargés d’ambition. Ils ont couru au fil de la vie vers le succès, vers le talent, vers ce grand horizon, où dans le soir des jours révolus, leurs anciens s’étaient effacés dans la splendeur du couchant. Je les ai vus revenir à contre-courant, et je n’ai pu m’empêcher de les comparer à ces bateaux que je voyais chaque jour de mon observatoire habituel, attachés aux remorqueurs et tout chargés de butin, ainsi que des pirates remontant la rivière. Le remorqueur, l’étrave dressée en fer de hache, pour fendre l’air, pour fendre l’eau, pour défoncer tout ce qui lui ferait obstacle, traîne en haletant et en mugissant le chapelet des péniches et de chalands reliés par des cordes, articulés en queue de cerf-volant. Je vois la théorie des esquifs s’avancer en serpentant. Je vois chaque bateau mettant bas cheminée ou mâture, s’engouffrer sous mes pieds dans le porche des arches, disparaître, reparaître. Et le train continue d’une allure de bataille sa marche en avant.
J’ai vu tous ceux qui se sont arrêtés sur la berge, pour y jeter modestement quelque bout de fil, et aussi tous ceux qui ont tenté les aléas du coup de filet dans l’eau, ceux qui sont arrivés, ceux qui ont disparu traînés sur leurs barques de toutes les formes et de tous les tonnages.
Jamais, quant à moi, je ne suis descendu de ma passerelle ni pour jeter l’épervier, ni pour monter sur quelque bateau que ce soit, ni pour chercher la renommée, ni pour rentrer en triomphateur dans la cité qui n’a cure de moi. Jamais je n’ai pétri des boulettes de glaise farcies de vermisseaux pour amorcer, comme tant d’autres, la pêche du lendemain.
Jamais je n’ai baissé ni le mât de ma péniche, ni la cheminée de mon remorqueur pour passer sous aucun pont. Aussi n’ai-je jamais rien pris ni dans l’eau claire, ni dans l’eau trouble, aussi n’ai-je jamais rien été qui soit en aucun monde ce qu’on y nomme bêtement quelque chose. Et c’est ma coquetterie à moi, une coquetterie à très bon marché et plus enviable que vous ne pensez, d’avoir commencé la vie avec tous les hommes qui ont été, depuis lors, ou la gloire des Lettres, ou la gloire des Arts, ou les plus hauts personnages de la vie publique, et d’être, jusque dans mes vieux jours, resté le camarade des survivants, sans avoir jamais cherché à prendre place sur leur route. C’est ma coquetterie aussi d’avoir tendu la main, d’avoir tendu parfois la perche aux hommes éminents de la génération nouvelle et d’avoir connu la douce notion de quelques remerciements, et le plaisir d’oublier bien des ingratitudes. Parmi mes vieux camarades, parmi les nouveaux venus qui ont été mes obligés, personne – vous m’entendez – personne ne peut dire que je me suis servi ni de lui, ni de quiconque à côté de lui, au profit d’une vanité quelconque, d’une ambition quelle qu’elle soit.
Je puis parler de ceci sans outrecuidance, n’ayant reçu de la nature aucun appétit de paraître, sachant par trop de choses vues ce que valent les titres et les chamarres de tant de gens dont la faiblesse a été de les rechercher et qui n’ont eu que trop souvent la bassesse indispensable pour les obtenir.
Certes tout cela ne vaudrait point d’être dit ; il serait même ridicule de le dire si ce n’était chose nécessaire pour affirmer, preuves en mains, que tout ce que j’ai connu, par la vue ou par le verbe, je le relaterai sans un atome d’envie, car personne ne m’a causé le plus petit déboire d’amour-propre.
Ayant assisté à beaucoup de faits, ayant côtoyé une foule d’hommes qui sont du domaine de l’Histoire, j’apporte à l’Histoire la contribution d’un vieux Parisien de Paris ayant pratiqué tous les détours de Paris et de la vie de Paris. Le témoignage désintéressé, impersonnel pour ainsi dire, que je puis déposer ici, pourra, je l’espère, servir à l’éclaircissement de menus points de détail concernant la vie de notre temps dont les curieux pourront tirer quelques menus petits profits.
J’aurai dans tous les cas cet avantage de ne jamais avoir à rien dire de moi-même, étant de ceux dont l’épitaphe, plus exacte que celle de Piron, pourra porter : « Il ne fut rien ».
Toute mon autobiographie tient dans cette seule phrase que voici : « J’ai utilisé vingt-cinq ans de ma vie à écrire des livres, j’ai gâché vingt-cinq ans de ma vie à publier les livres des autres. »
Du temps gâché je ne dirai point de mal, car il m’a fourni l’occasion d’exercer un métier que j’ai beaucoup aimé, dont la technique m’a passionné vivement et qui m’a fait vivre parmi des gens très divers, parfois supérieurs, presque toujours curieux et intéressants par quelques côtés spéciaux. Je reparlerai d’eux quelque jour.
Pour l’instant, je ne dirai rien du temps utilisé, car il n’est pas dans mon rôle de parler de mes ouvrages. Ça se fait assez souvent. C’est toujours de mauvais goût. Je me contenterai d’en loger ici, n’importe où, la liste. Les personnes curieuses y trouveront des indications bibliographiques.
Ce qui est suffisant.
Sur le chemin de la perdition. – Trois générations de Garcia. – La mère de la Malibran. – Le professeur Garcia. – L’ignorance de Thérésa. – Girard de Rialle. – La Pipe de Pantaléo. – Édouard Plouvier. – Les débuts littéraires d’un ouvrier corroyeur : – Les Comédiens et la Légion d’honneur. – Ovation sans lendemain. – Un grand peintre oublié, l’atelier et les soirées, Mme O’Connell. – Alexandre Herzen. – Le Père Enfantin et tant d’autres.
Ma première jeunesse a été celle de tous les hommes de ma génération, élevés dans un milieu de bourgeois d’aisance moyenne. Mes premières impressions d’enfant datent du 24 février 1848 et des journées de juin. Le Deux décembre m’est resté présent à l’esprit. J’ai connu la torture de l’internat et, pareil à tous ceux qui ont passé par là, j’en ai conservé l’horreur. Le bonheur qui m’a tiré de ce bagne m’a remis aux mains du plus admirable des éducateurs, Marguerin, le fondateur de l’enseignement primaire supérieur en France, le pédagogue que Gréard a le plus profondément admiré et dont j’ai été l’élève particulier. Il a ouvert mon esprit à toutes les belles, nobles et bonnes études auxquelles j’ai dû de traverser sans trop de souffrances les épreuves que la lutte pour la vie impose à chacun de nous. Je lui dois tout le meilleur de moi-même et il m’est doux de le pouvoir remercier. Tous ses anciens élèves ont autant que moi conservé le culte de sa mémoire.
Ma famille, uniquement composée de commerçants et d’industriels, me destinait à la carrière commerciale et m’y préparait. Après une année d’étude en Allemagne, j’entrai dans une maison de banque pour y apprendre les affaires.
Je m’y intéressais très sincèrement et très vivement. À l’âge où l’on n’est d’ordinaire qu’un petit commis, j’occupais un emploi qu’on ne confie d’habitude qu’à des hommes d’expérience. Je m’adonnai vivement à la partie technique du métier, mais je n’avais aucune des facultés qu’il faut pour traiter des affaires.
J’en fusse resté là sans doute, comme tant d’autres, si le hasard ne m’avait conduit dans un milieu dont je n’avais alors aucune notion et où je nouai des relations qui m’entraînèrent à leur suite dans le monde des arts, des lettrés, et bientôt après dans celui de la politique militante.
Si j’ai si mal tourné et si complètement déçu les espérances que j’avais pu faire naître, ce fut le plus simplement du monde.
Lorsque j’étais enfant, en une saison d’été, à Dieppe, ma mère et une de ses plus chères amies d’enfance et de jeunesse s’étaient rencontrées inopinément. Elles ne s’étaient point vues depuis longtemps et toutes deux éprouvèrent une grande joie à renouveler, ne fût-ce que pour quelques semaines, leur intimité de jadis.
L’amie retrouvée par ma mère n’était autre que la célèbre cantatrice, ou plus exactement, le célèbre professeur de chant Eugénie Garcia, la femme et l’élève de Manuel Garcia, illustre entre les plus illustres maîtres du chant, qui mourut plus que centenaire en 1906, et dont la centième année fut fêtée par l’envoi d’adresses de tous les grands chanteurs du globe et par la remise des décorations de la plupart des souverains de l’Europe.
Depuis nombre d’années, Garcia résidait en Angleterre et sa femme vivait en France. Il avait le plus souvent auprès de lui leurs deux fils, elle avait toujours avec elle leurs deux filles. L’aînée d’entre elles portait le prénom de Maria en souvenir de sa tante Maria-Félicia Garcia, immortalisée dans l’histoire de l’art sous le nom de son premier mari : Malibran. La fille aînée de Manuel Garcia, quoique très jeune encore, avait une voix si parfaitement exquise qu’on ne craignait point, autour d’elle, de la comparer à celle de sa tante Malibran. Elle ressemblait, en jeune et en joli, à la plus jeune sœur de son père, Pauline Garcia, – c’est-à-dire à Mme Viardot. Elle ne chantait jamais que lorsque nous étions dans l’intimité la plus stricte.
Comme sa tante Malibran, elle est morte avant trente ans, et comme sa tante elle est morte d’un refroidissement ! Comme sa tante aussi, elle a laissé derrière elle la trace ineffaçable d’un charme qu’on ne peut pas oublier et qui, dans le petit cercle d’amis où sa modestie l’a toujours jalousement gardée, reste comparable à celui que l’autre Maria Garcia a laissé parmi la foule de ses contemporains. La seconde fille de Mme Garcia était un peu plus âgée que moi. C’était le pire diable déchaîné qui se puisse inventer. Elle me faisait enrager et j’avais plaisir à me laisser faire.
Depuis notre rencontre à Dieppe, Mme Garcia me traitait comme une sorte de neveu honoraire, et quand je devins un petit jeune homme, en état d’aller dans le monde, elle m’invita aux réunions intimes qui avaient lieu chez elle tous les dimanches. Je n’avais garde d’y jamais manquer, un peu à cause d’elle qui était pour moi bonne et charmante, un peu à cause de sa fille aînée et peut-être bien aussi à cause de sa fille cadette. Ces soirées passées dans un monde d’artistes, dont je ne soupçonnais rien jusqu’alors, eurent pour conséquence imprévue de me détourner du but vers lequel toute mon éducation semblait devoir me conduire tout naturellement.
Tous les dimanches j’écoutais les élèves de Mme Garcia, aussi bien les étoiles qui déjà brillaient du plus grand éclat, que celles qui demain allaient s’illustrer sous le nom de Krauss ou de Nilsson. Et tant d’autres. Si, las de la musique, je m’asseyais dans le petit salon, j’y suivais la causerie des hommes de la plus haute valeur intellectuelle. Et ce m’était un délice, et aussi le plus souvent un éblouissement, d’entendre des gens – aujourd’hui bien oubliés sans doute – tels que le philologue Chavée, le poète Charles Coran, ou Eugène Crepet, l’auteur de cette anthologie des poètes français qui fait encore autorité de nos jours.
Quand j’allais chez Mme Garcia dans l’étroite intimité, le dimanche dans l’après-midi, j’y rencontrais parfois une vieille femme, aux cheveux gris, pas encore blancs, au masque rude de matrone espagnole, tourmenté, raviné d’une expression très volontaire, marqué d’un sourire empreint de dureté. Sa voix était presque mâle, son parler était tranchant, impératif. Elle parlait fort peu.
On s’est souvent moqué du goût particulier que j’eus de tous temps pour la société des vieilles femmes et pour leur causerie, et pourtant, quoique j’aie rencontré bien des fois cette vieille-là qui eût pu être intéressante, je n’ai pas la notion de lui avoir, en dehors de mes devoirs de stricte politesse, jamais adressé la parole. Au fond elle me faisait peur, cette vieille qui portait sur ses maigres épaules le poids d’un demi-siècle de gloire bien des fois renouvelée. Elle avait couru sur toutes les routes du monde, elle y avait cueilli, à pleine brassée, les lauriers verts et les lauriers d’or qui bordent la grand-route de l’Art. Côte à côte avec son mari, elle était allée de triomphe en triomphe. Elle avait chanté sur tous les théâtres du monde, elle avait été la créatrice, cette fois le mot n’est pas de trop, des rôles les plus célèbres, cependant que son mari, non content d’avoir écrit la partition de vingt opéras parmi lesquels plusieurs ont marqué leur souvenir, les interprétait à côté d’elle. Son nom, et parfois son portrait, figuraient sur les murs des salles des principaux opéras italiens de toute l’Europe. Pour tout dire d’un mot, cette vieille femme à l’air méchant était la veuve de Manuel Gracia. Telle « la Mère des Trois Dupin » qui, elle, n’était rien que cela, elle pouvait s’enorgueillir de ses trois enfants savoir : la Malibran, Mme Viardot, et le professeur Manuel Garcia. Sa bru était notre vieille amie Eugénie Garcia ; son gendre était le violoniste Charles de Bériot.
Jamais peut-être lignée de grands artistes, d’artistes uniques en leur genre, ne se trouva réunie autour d’une telle aïeule et, si rébarbative qu’elle fût, on éprouvait pour elle une sorte de vénération superstitieuse et craintive.
Elle habitait, à Montmartre, un modeste appartement, elle y vivait profondément ignorée de tout ce qui l’entourait. Elle ne trouvait de paroles tendres pour personne, hormis pour sa petite-fille Maria en qui, sans doute, revivait pour elle, la Malibran ; ses enfants expliquaient la dureté de son caractère par la rudesse de caractère de feu son mari Garcia l’ancien.
Elle n’avait pas dû s’amuser tous les jours, la pauvre vieille. Manuel Garcia l’ancien, était, dans les choses de son art, une sorte de sectaire, et, en cela, comparable aux moines espagnols. Rien ne résistait à son fanatisme, pas même son amour paternel. Lorsqu’il jouait Othello avec sa fille bien aimée, son élève chérie, Marie Malibran, il lui faisait des scènes farouches, estimant que lorsque Othello s’apprêtait à tuer Desdémone, la Malibran ne donnait pas une impression suffisante d’effroi, et, un soir, au moment d’entrer en scène, au dernier acte d’Othello, il renouvela, furieux, à sa fille les reproches qu’il lui avait faits à la représentation précédente. Si bien que, s’animant de plus en plus, et lui montrant l’arme qu’il avait sur lui, il l’en avait menacée. La Malibran ayant vu que c’était là une arme vraie, non une arme de théâtre, la pauvre Malibran, en le voyant lever son couteau, eut une telle frayeur qu’elle s’évanouit.
Je tiens ce récit de Mme Eugénie Garcia, qui professait pour Mme Malibran, « sa sœur » ainsi l’appelait-elle dans ses lettres à ma mère, un culte et une tendresse sans bornes.
Le proverbe : tel père, tel fils, était une vérité en cette illustre famille. Le professeur Manuel Garcia n’était guère plus aimable que son père. Au temps de sa jeunesse, sans aucun égard ni pour la beauté ni pour le sexe, il secouait terriblement ses élèves, les garçons aussi bien que les filles, et, pour un peu, il les eût battus. Lorsque les pauvrettes ne chantaient point comme il le voulait, il leur lançait des injures qui les mettaient en larmes, et alors il allait chercher une cuvette, il la mettait devant elles, leur disait : « Quand elle sera pleine, nous reprendrons la leçon. » Il est difficile de savoir dans quelle mesure de tels procédés lui ont servi à former et laisser après lui toute une pléiade de disciples hors de pair et dignes de son enseignement.
Manuel Garcia ne venait à Paris que très rarement et je ne l’ai vu qu’une seule fois et pendant quelques instants seulement ; il était accompagné de sa fille Marie devenue Mme Eugène Crepet, en qui il adorait et son propre enfant et l’image renaissante de sa sœur préférée. Comme nous causions sur le pas de la porte de la rue de Provence, vint à passer. Alary, le chef d’orchestre du Théâtre Italien. Après les premiers mots de bon accueil Manuel Garcia lui dit :
– J’ai fait hier soir une découverte extraordinaire. Pousse par la curiosité, je m’étais laissé mener dans un affreux café-concert et là j’ai entendu – chantant des choses ineptes et inutiles – une cantatrice prodigieuse. Je me demande où cette femme a appris le chant. C’est la pureté du style, c’est la splendeur de la méthode en personne. Ah ! mon cher, il faut aller l’entendre. Elle chante dans un établissement où l’on boit et où l’on fume, à l’Alcazar, rue du Faubourg-Poissonnière. Vous en reviendrez enthousiasmé. Cette inconnue n’a pas même un vrai nom. Elle s’appelle tout bonnement sur l’affiche Thérésa ».
Alary, Mme Crepet et moi-même nous dûmes faire savoir à Manuel Garcia quelle était la forme de la célébrité toute populaire de Thérésa.
À quelques années de là, me trouvant au foyer de la Gaîté, au cours d’une représentation de gala, je voulus m’offrir le plaisir de répéter à Thérésa ce que j’avais entendu dire de son talent par le maître suprême de l’art du chant. Thérésa m’écouta fort gentiment, mais en regardant au fond de ses bons gros yeux de vache étonnée, je vis qu’elle ne comprenait rien à mon discours. Cette cantatrice incomparable ignorait jusqu’au nom de Manuel Garcia.
Je reprends ma petite confession.
Peut-être n’eussé-je pas dévié de ma route, si je n’avais rencontré dans le salon de la rue de Provence deux jeunes gens de mon âge, alors inséparables, tous deux élèves de Chavée et amenés par lui. De l’un, je ne dirai rien, sinon qu’il a assez mal tourné, qu’il était, à l’origine, un charmant garçon mais fut de tous temps un triste sire. Autant il m’avait déplu au premier abord, autant son camarade m’avait attiré. Celui-là s’appelait tout bourgeoisement Julien Girard, il était instruit, travailleur simple.
Son père, qui jouissait d’une assez belle aisance, avait été quelque peu le factotum de Drouin de Lhuys, ministre des affaires étrangères de Napoléon III. Drouin de Lhuys, après avoir été utile au père, l’avait été au fils en le chargeant, bien qu’il fût très jeune, d’une sorte de mission diplomatique dans des provinces danubiennes. C’était, au fond, une façon de lui offrir un joli voyage aux frais de l’État. Julien Girard avait cru devoir – et c’était sans doute nécessaire à cette époque – se décerner une apparence de titre nobiliaire, et, comme sa mère était née Rialle (tout court), il avait adopté pour le monde des chancelleries ce nom de Girard de Rialle, sous lequel il s’est acquis une estimable notoriété par des travaux d’érudition accomplis soit seul, soit en collaboration avec son savant ami, mon excellent camarade Abel Hovelacque, qui déjà marquait sa place parmi les maîtres de l’anthropologie. Dans son âge mûr, Hovelacque est devenu président du Conseil municipal de Paris, puis député de la Seine, tout en poursuivant ses travaux scientifiques. La Ville de Paris pour consacrer la mémoire de cet homme irréductiblement et s’il le fallait brutalement honnête, loyal, dévoué, désintéressé, a donné son nom à l’une des rues de l’arrondissement qu’il avait représenté et où il avait su se faire aimer de tous.
En ce temps-là, Girard de Rialle, puisque tel est le nom sous lequel il a vécu dans sa carrière de savant et de diplomate (il est mort ministre de France, au Chili), Girard de Rialle, bien qu’il passât une partie de sa vie à mesurer des crânes avec Broca, avec Topinard, avec Hovelacque, ou à étudier les langues indo-européennes sous la direction de Chavée, avait un goût prononcé pour les choses de théâtre. Il avait fondé une petite revue théâtrale dont je m’occupais un peu avec lui ; elle nous passionnait vivement. De plus il était accouché d’un vaudeville intitulé : La Pipe de Pantaléon, œuvre cocasse, pour laquelle il avait comme collaborateur un autre futur homme grave, le philosophe Paul Laffite. Ça se jouait sur le théâtre des Batignolles dirigé par Larochelle. Et, quand par la suite Girard avait qualité d’Excellence et portait un bel habit chamarré d’or, se coiffait d’un claque à plumes d’autruche et marchait tout constellé de tous les sautoirs, de tous les crachats, de toutes les étoiles et de toutes les croix de toutes les puissances du monde, cela m’amusait de lui dire : « Mon bon Julien, quand votre Excellence nous offrira-t-elle une reprise sensationnelle de La Pipe de Pantaléon ? »
Au fond, je crois qu’il eut plus d’une fois le regret de ne pouvoir faire cette douce plaisanterie.
La vie nous avait tirés chacun d’un autre côté, mais partout où l’on se retrouvait, il semblait, au bout de quelques instants, qu’on ne s’était jamais quitté. Et il est allé mourir bêtement à Santiago du Chili ! On a ramené ici le cercueil, et, par une suite d’incidents de la banalité la plus parfaite, j’ai connu trop tard le jour de son incinération.
C’est tout de même bien triste, la disparition des camarades que l’on a aimés !
Elle n’aurait rien du tout d’intéressant, cette Pipe de Pantaléon, si elle n’était en quelque sorte la caractéristique de l’état d’esprit, de l’ambition intellectuelle, des meilleurs et des mieux doués parmi les jeunes hommes arrivés à la vie un peu après 1860. Ni dans les familles bourgeoises, ni dans les lycées ou les collèges, on n’avait guère entendu, comme on dit vulgairement, remuer des idées.
En dehors des revues purement littéraires et des petites publications d’espèce analogue, cette jeunesse n’avait rencontré aucun aliment intellectuel.
Le garde-chiourme qui se posait en garde-fou de la pensée publique soumise à ses caprices, se tenait sans répit le fouet levé sur les penseurs, sur les écrivains, à tout instant exposés aux amendes ruineuses, à la contrainte par corps et à la prison. Le seul lieu de réunion libre, le seul endroit où l’on entendait parler à haute voix, était le théâtre, si bien que pendant nombre d’années, il servit de refuge aux jeunes gens curieux de vivre intellectuellement
Dans le groupe où le hasard m’avait placé, nous nous occupions de voir, de juger les choses de la scène et naturellement nous nous improvisions plus ou moins heureusement auteurs dramatiques.
Comme Julien et moi, nous avions ébauché une collaboration, nous y fûmes affectueusement encouragés par un dramaturge consacré par le succès, notre aîné de vingt ans au moins, Édouard Plouvier. Nous étions très heureux et non moins fiers de sa grande bienveillance. En comparaison de nos relations purement littéraires, Plouvier était pour nous un homme célèbre. Les titres tout au moins de quelques-uns de ses ouvrages lui ont survécu, telles ses chansons, émues et gracieuses : Le chevalier Printemps ou Les quatre âges du cœur ou ses pièces telles que : L’ange de minuit. – Trop beau pour rien faire et d’autres.
Son grand chagrin était de n’avoir reçu aucune instruction dans sa prime jeunesse, sa modestie l’empêchait de comprendre la valeur des dons qu’il avait reçus de la nature et qu’il avait su cultiver sans l’aide de personne.
Il était un peu comme ces bergers qui apprennent l’astronomie en gardant leurs moutons et qui inscrivent dans leur cervelle une carte céleste dont se contenteraient certains astronomes.
Souvent, dans son enfance, il avait accompagné son père, conducteur de diligence, qui faisait la navette entre Arras et Paris ; puis il avait appris le métier de corroyeur qu’il vint bientôt exercer dans la capitale.
À ses heures libres, il composait des chansons à la manière de celles de Pierre Dupont ou de Darcier, très poétiques, très sentimentales, très rêvées, où s’exaltait l’orgueil du travail et elles se répandirent rapidement dans les milieux ouvriers. À l’atelier, au cabaret, on les chantait à pleine voix ; quelques-unes furent imprimées ; elles lui rapportèrent de petites sommes qui, renforçant son salaire quotidien, lui permirent d’acheter quelques livres instructifs et de se payer quelques places de poulailler dans les théâtres littéraires. Le succès des chansons et la fréquentation des théâtres éveillèrent de plus hautes ambitions, si bien que ce grand et beau jeune homme qui gagnait son pain, chaussé de sabots et bardé du dur tablier de peau de bœuf, prit sur ses heures de sommeil le temps d’écrire une pièce de théâtre, une sorte de féerie en prose poétique. Il la déposa chez le seul directeur aux suffrages duquel il osait prétendre. Ce directeur avait nom Comte, et sa troupe était uniquement composée d’enfants qui jouaient des petites pièces pour l’amusement d’autres enfants ; sa salle de spectacle était passage Choiseul. C’est aujourd’hui, à peine modifiée, celle du théâtre des Bouffes.
Comme les semaines se succédaient sans qu’il reçût aucun avis de ce qu’était devenu son œuvrette, Plouvier, de guerre lasse, s’étant fait le plus beau possible, pour paraître devant M. Comte, sans avoir trop l’air maladroit d’un ouvrier endimanché, s’en alla demander au directeur sa décision. Il lui répondit par un refus très net. Plouvier remit sous son bras le petit rouleau de papier, fruit de tant d’efforts et de tant de privations, objet de tant d’espoirs qui, depuis des mois, hantaient à toute heure sa juvénile imagination. Il s’achemina vers le jardin du Palais-Royal et là, les jambes cassées par le chagrin, il s’assit sur un banc et se prit à songer, sa pénible songerie continua, bien triste, bien triste, deux grosses larmes tombèrent sur sa main qui machinalement tenait le manuscrit, désormais chose morte !
Que faire de cette paperasse ? la remonter là-haut à Belleville, dans la petite chambre, comme un témoin de l’insuffisance qui condamnera son auteur à n’être rien qu’un faiseur de rêves sans issue. Vraiment c’était trop dur. La jeter, n’y plus penser ? jamais ! Qui sait ? Pourtant à quoi bon la jeter ?
Alors Plouvier, qui n’était pas de ceux qui capitulent devant un échec, se leva et sans bien se rendre compte, ni de ce qu’il faisait, ni de ce qu’il pensait, il descendit machinalement vers les galeries du Palais Royal, rejoignit la rue Richelieu, et là, franchissant la petite porte poudreuse et mal jointe qui donnait accès à l’administration de la Comédie-Française, il entra chez le concierge du théâtre. Sur le rouleau il y avait son nom et son adresse ; il dit donc simplement : « Monsieur, voici pour le Directeur. » Le concierge répondit un banal : « C’est bien, on le lui remettra. » Et Plouvier, de plus en plus triste, et tel qu’une femme qui vient de poser son enfant chétif et nu dans le tour des enfants trouvés, reprit le chemin de l’atelier, chaussa ses sabots et ajusta son dur tablier de cuir de bœuf, et finit sa journée devant son établi.
De loin en loin, il se souvenait vaguement d’avoir, sans trop savoir ni comment ni pourquoi, remis sa pièce au concierge de la Comédie-Française.
Un beau matin ce fut son concierge, à lui, qui lui remit une lettre portant le timbre de la Comédie. Sûrement ce ne pouvait être qu’un refus poli. Néanmoins, le cœur battant la breloque, il ouvrit l’enveloppe… et, avant de la comprendre, il lui fallut relire dix fois la lettre qui lui annonçait que le Comité de lecture de la Comédie-Française, à l’unanimité, venait de recevoir la pièce en trois actes d’Édouard Plouvier : Le songe d’une Nuit d’Hiver. L’auteur était invité à se rendre auprès du directeur pour s’entendre avec lui afin de commencer les répétitions.
Le jeune ouvrier corroyeur s’habilla de son mieux afin de paraître congrument devant l’académicien qui le convoquait. Avant de franchir le seuil de l’illustre théâtre, Plouvier, par une sorte de superstition touchante, traversa à nouveau le Palais-Royal. Il s’assit à la même place où, à quelques semaines de là, il avait pleuré. Et il pleura.
Le directeur de la Comédie à la vue de ce jeune homme inconnu, sincère, naïf, eut une agréable surprise.
Le songe d’une Nuit d’Hiver fut un succès et à défaut de la pièce elle-même, le titre de l’ouvrage est demeuré notoire dans l’histoire du théâtre. Toutes les mains se tendirent vers le nouveau venu, très confus de se sentir, lui, simple ouvrier, étranger à la vie mondaine et à la vie littéraire, traité avec tant d’amitié par tant d’hommes connus ou célèbres. D’illustres amitiés le prirent alors dont il resta toujours très heureux et très fier ; la maternelle tendresse de George Sand, entre autres, fut l’une des grandes douceurs de sa vie.
Plouvier, qui a, pendant vingt ans, alimenté les théâtres de mélodrames, de pièces qui faisaient rire et pleurer les spectateurs naïfs, était de cette école où les auteurs croyaient « que c’était arrivé » et pleuraient et riaient en écrivant leurs pièces. Et c’est pour cela qu’ils émouvaient leur public. Le grand Dumas était de cette école-là et il n’était pas plus bête que les gens qui s’en moquent.
Alexandre Dumas fils m’a raconté qu’un matin, étant arrivé chez son père, il le trouva tout sanglotant.
« Qu’est-ce que tu as, père ? » lui demanda-t-il.
Et le grand Dumas, la voix assourdie par les larmes, de lui répondre :
« Ah ! mon garçon, je viens de tuer Porthos. Tu ne sais pas comme je l’aimais, cet animal-là ! »
Une telle sincérité, une telle simplicité nous avaient attachés à Plouvier, et puisque, dans l’air que respirait la jeunesse d’alors, il ne se rencontrait guère que des idées de théâtre ou de versification, il n’était pas étonnant que nous nous fussions passionnés pour les questions relatives au théâtre. Or, il advint que l’une d’elles se présenta, moins spéciale, moins locale que tant d’autres. Le célèbre comédien Samson s’apprêtait à prendre sa retraite de sociétaire de la Comédie-Française tout en restant professeur au Conservatoire et son ami Legouvé, en des sortes de lettres ouvertes, publiées dans les journaux, demandait pour lui la croix de la Légion d’Honneur.
Négligeant les mérites incontestables du comédien. Legouvé se présentait quelque peu en suppliant ; il plaidait pour le professeur, et même un peu aussi pour l’auteur dramatique qu’était Samson ; piètre poète, du reste, et qui partageait avec Legouvé le don que Banville a défini : « Le don de ne pas rimer. »
Un peu honteux de vivre avec des jeunes gens qui tous avaient déjà produit quelques pages, alors que je n’avais guère jamais produit que quelques lignes imprimées, je me lançai dans l’exécution d’une brochure où j’entendais plaider non point la cause particulière de ce très brave homme, et tout plein de talent, qui avait nom Isidore Samson, mais celle de la très respectable corporation des comédiens jusqu’alors traités à la façon des parias.
Lorsque j’eus terminé mon manuscrit, je repris tout naturellement le chemin de ma vieille École et demandai son avis à Marguerin. Il me fit des observations d’une admirable justesse et j’en tins compte.
Je portai mon opuscule à Dentu qui avait pour spécialité de publier des brochures, fort à la mode à ce moment-là. Il me fit un excellent accueil, à mon texte également, mais tout aussitôt se posa la question très grave de savoir s’il était passible du timbre.
Une demande de décoration adressée au gouvernement, cela pouvait, selon le bon plaisir des fonctionnaires, être ou ne pas être taxé de politique. En ce dernier cas, il ne me restait qu’à supprimer mon travail, mes moyens ne me permettant pas de solder les frais du timbre.
Après suppression de quelques mots que le fisc aurait pu trouver passibles de l’estampille dont il salissait le papier imprimé, la brochure parut, signée d’un pseudonyme.
Elle fit dans le monde des arts, un effet assez sérieux pour que l’Association des Artistes dramatiques, que présidait le baron Taylor, décidât de m’adresser une délégation chargée de me porter ses remerciements. Elle comprenait quelques-uns de ses membres les plus illustres, entre autres Bataille, l’élève préféré de Garcia, le créateur inoubliable du rôle de Pierre le Grand, de l’Étoile du Nord de Meyerbeer, Delaunay, de la Comédie-Française, et d’autres.
La décision du Comité me fut apportée par Plouvier. C’était dans le courant de l’été, et ma famille étant à la campagne, il me fallut lui annoncer l’évènement puisqu’il entraînait la nécessité d’ouvrir l’appartement pour recevoir la délégation. Ses membres firent une grimace amusante lorsqu’ils virent que l’auteur auquel ils venaient gravement présenter les hommages de toute leur corporation était un gamin de dix-neuf ans. Pour un temps je devins le Benjamin des gens de théâtre.
À quelque temps de là j’étais invité à l’Assemblée de la Société qui avait lieu dans la salle de spectacle du Conservatoire ; réunion hermétiquement fermée à quiconque n’était pas sociétaire. On m’installa dans une loge, au milieu du balcon, et, de là-haut, je contemplais les profils ou les dos de tous les fils et de toutes les filles de Melpomène ou de Thalie venus là pour jouir du plaisir d’écouter un rapport sur l’exercice de l’année écoulée, fort bien rédigé et fort bien lu par un traître de mélodrame à la voix caverneuse et qui répondait au nom symbolique d’Omer. Quand il en vint à parler de la question de la décoration des comédiens et procéda à l’apologie du jeune écrivain qui, sous le pseudonyme de Nothing, l’avait réclamée au nom des comédiens, et pour l’art des comédiens, ceux qui étaient venus en délégation portèrent alors leurs regards vers ma loge : l’un d’eux battit des mains, toute la salle l’imita, et pendant une demi-minute, tout ce que Paris possédait d’acteurs ou d’actrices connus ou inconnus battit des mains.
C’est la seule fois de ma vie que j’ai su ce qu’était une ovation. J’ignore encore si ce fut par énervement ou si ce fut par un précoce scepticisme que j’eus besoin de retenir un accès de fou rire. Désormais je pus croire que j’avais fait mon entrée dans le monde des arts.
Mon ami Julien Girard (de Rialle) étant déjà très répandu parmi la jeunesse lettrée, et, moi, vivant, travaillant même avec lui, je me trouvai bientôt mêlé à une bande de jeunes gens qui depuis lors ont presque tous laissé dans les lettres, dans les arts ou dans la politique trace de leur passage. Les cadets n’avaient pas vingt ans, les aînés n’en avaient pas certainement vingt-cinq. Notre lieu de réunion préféré était l’atelier d’une femme peintre célèbre à cette époque, Mme Frédérica O’Connell. Elle ne se contentait point d’avoir beaucoup de talent comme artiste-peintre, elle était douée d’une intelligence générale hors de pair, servie par une instruction qui étonnait et charmait les savants qu’elle avait le don d’attirer chez elle.
Son atelier, situé place Vintimille, était l’un des plus beaux du Paris d’alors ; les murs n’avaient d’autre ornement que des tableaux de la maîtresse de la maison et quelques-uns étaient des plus remarquables.
Je me demande très souvent par quelle injustice de la renommée l’œuvre d’une artiste de la valeur de Mme O’Connell peut demeurer si injustement oubliée. À ma connaissance aucun de ses tableaux ne se trouve dans un de nos musées. La Comédie-Française possède un de ses plus beaux dessins représentant Rachel sur son lit de mort, et un grand portrait peint de la même Rachel en costume de ville qui est l’une des meilleures toiles de sa collection.
Mme O’Connell donnait des leçons à tout un essaim de jeunes filles du meilleur monde et, chaque samedi, elle les réunissait dans son atelier, accompagnées bien entendu de leurs familles. Ces petites soirées intimes étaient largement complétées par la présence d’amis et d’amies de la maîtresse de la maison, parmi lesquels on comptait nombre de personnages célèbres. Le plus souvent ceux-ci causaient et les jeunes gens les écoutaient volontiers. Il y avait là une tradition qui semble disparue. Heureux les gens qui ont encore eu la bonne chance de la connaître !
Presque chaque semaine, on rencontrait chez Mme O’Connell un homme de haute taille, de forte corpulence, au teint coloré, à la face large, aux yeux l’un bleu très clair ; sa bouche aux lèvres épaisses et d’un beau rouge était encadrée d’une barbe blonde mêlée de poils blancs, taillée en fer à cheval. C’était Alexandre Herzen, le fondateur du journal russe la Cloche. Le premier, il avait sonné le tocsin de cette révolution russe qui ne devait commencer à s’éveiller qu’un demi-siècle plus tard. Herzen avait le parler lent, doux, très grave. Il exerçait sur tous une attraction très douce, très profonde. Bien que, à moins de connaître à fond ses interlocuteurs, il ne parlât des choses de son pays qu’avec une extrême réserve, il gardait jusque dans son silence même, le grondement de sa pensée secrète. Il s’exprimait en un français très pur et sans le moindre accent russe.
Certains soirs, nous avions un plaisir inoubliable à nous grouper autour du père Enfantin, grand vieillard, à la parole lente, grave, ailée, lourde comme un vol de ramier, et dont la voix prenante avait ensorcelé les plus nobles esprits de son siècle. En lui, vibrait encore et toujours l’âme de la secte des Saint-Simoniens. Ses disciples avaient essaimé sur le monde moderne, chacun y cherchant son profit ; lui était resté immuablement attaché à ses idées désintéressées de rénovateur. Avec sa belle prestance et sa longue barbe taillée soigneusement en carré, il avait déjà – pour parler comme Ruy-Gomez de Silva :
… l’air d’une statue à mettre sur sa tombe.
Et, bien qu’il fût habillé d’une banale redingote, on avait l’illusion de le voir encore revêtu de sa longue tunique de drap ou de velours violet lacée dans le dos conformément à la doctrine des ermites de Ménilmontant. Il n’avait cependant rien de solennel ; il était presque gai. Il disait toutes choses avec une éloquence si limpide, avec une si noble hauteur de vues qu’on ne se lassait ni de le regarder tant il était beau, ni de l’écouter, ni de l’inciter à parler des hommes et des choses que son génie avait fait éclore.
Pour notre malheur, l’hiver où nous le rencontrâmes pour la première fois fut le dernier hiver de son existence si pleine et si diverse.
Ces soirées de Mme O’Connell avaient ceci de particulier que, faute de domestiques, c’étaient les invités, jeunes ou vieux, qui étaient chargés du service des rafraîchissements ; service facile d’ailleurs, car il ne comportait guère que des carafes, des sucriers, et, dans les jours de grands galas, quelques bouteilles de sirop. Une forte cruche d’eau fraîche permettait aux gens de bonne volonté de laver convenablement les verres quand besoin était. Les jeunes s’y employaient de préférence, mais les moins jeunes ne s’offensaient pas de faire leur part de besogne.
Parmi ceux-ci, Champfleury se distinguait par son zèle et aussi par une myopie dangereuse pour la verrerie. Son lorgnon qui torturait son pauvre nez lui faisait faire une grimace tout à fait cocasse. Soit par l’absence de dents, soit par la conformation de ses os maxillaires, il avait toujours l’air de mâcher des noisettes. Il en mâchonnait encore en parlant ; et cela lui donnait un aspect quelque peu simiesque qui décuplait la drôlerie des histoires qu’il contait, en bon ironiste qu’il était. Ses propos étaient incomparablement supérieurs à ses livres.
Dix ans plus tard, j’ai eu l’occasion de voir quelle difficulté Champfleury avait à écrire, et rarement j’ai rencontré un auteur qui peinât aussi consciencieusement, aussi durement. Il refaisait un nombre invraisemblable de fois sur ses épreuves toutes ses phrases.
Il n’était ni jeune, ni beau, ni élégant, Champfleury, sa célébrité n’était pas de bon aloi, Champfleury, c’était le réaliste, Champfleury, c’était le défenseur passionné de l’école de Courbet, – ce pelé, ce galeux de Courbet. – Il ne faisait point grand effet sur les jeunes filles, et encore moins sur leurs estimables mères.
Et d’ailleurs, comment eût-il pu lutter de grâce avec celui qui, pareil au Garat de Victorien Sardou, que jouait en ce moment Déjazet, pouvait s’intituler : « l’enfant chéri des dames » ? Elles se l’arrachaient littéralement celui-là, on n’entendait dans les groupes du sexe charmant que des : « Monsieur Flammarion » par-ci, « Monsieur Flammarion » par-là. Et, courant des unes aux autres, le jeune Camille Flammarion, à la chevelure ébouriffée, bouclée, agitée, à la barbe frisante et flottante, se faisait autant d’amies qu’il rencontrait d’interlocutrices. Ces dames, ces demoiselles voyaient une sorte de quasi-sorcier en ce jeune homme sans cesse en mouvement et parlant de ce qui pourrait bien être l’au-delà de notre monde. Elles en raffolaient si bien que son allure vis-à-vis des autres jeunes hommes qui se rencontraient là, avec lui, avait un petit air de dédain qui ne nous plaisait guère. Mme O’Connell voyait en ce jeune astronome une variété d’astrologue et cela lui plaisait d’autant mieux que, progressivement, son vaste esprit s’enfonçait dans l’étude des sciences occultes.
Elle cultivait en particulier le spiritisme. Je lui dois d’avoir entendu une table frappant, lettre par lettre, le nom d’une femme qui venait de quitter l’atelier alors que j’y entrais. C’était une belle personne fort connue alors sous le nom de Blanche de Tourbet. Elle s’appelait en réalité Detourbet, en un seul mot, mais jugeant – suivant la doctrine formulée plus tard dans Le Roi – que la main gauche anoblit, elle avait profité de la main gauche du prince Plonplon pour fêler son vrai nom au bon endroit.
Mme O’Connell faisait à cette époque son portrait et il était des plus beaux. Qu’est-il devenu ? Les amis ou les héritiers de Mme de Boyne seuls pourraient nous le révéler.
Après une courte éclipse, Mme de Tourbet reparut sous un deuxième nom sous lequel des écrivains l’ont offerte en exemple aux snobinettes vertueuses. Paix à sa cendre. Elle est morte en état de sainteté, ce qui valut à son dernier ami, qui la pleurait un peu bruyamment, cette réplique :
« Comment ! vous, homme croyant, vous pleurez ainsi ? Résignez-vous, homme de foi hésitante. Vous savez bien que vous la retrouverez sûrement dans un demi-monde meilleur. »
On m’a dit que Mme O’Connell avait, par suite de ses études de l’au-delà, subi quelques troubles du cerveau. Cela n’est pas impossible, mais je n’ai jamais rien constaté de pareil.
Il n’est nullement prouvé pour moi que ses premiers succès mondains n’ont pas eu sur la formation de l’esprit de Camille Flammarion une influence capitale. Sans eux il eût peut-être été ce même savant qu’il est devenu, mais il n’eût peut-être pas eu l’originalité, l’imagination, l’art de parler pour tous, qui lui ont valu sa popularité. Accaparé par sa petite cour d’adoratrices, il s’y est laissé adorer. Il n’était point libre de se prodiguer hors de leur cercle.
Tout autre était le cas de deux gaillards qui ne se quittaient pas et regardaient du haut de leur grandeur tout ce qui n’était pas eux. L’un était le musicien Victorien Joncières, l’autre était Henri Becque ; ils n’avaient encore rien fait ni l’un ni l’autre, mais déjà ils se lamentaient sur l’injustice du siècle. Tout ce qu’on pouvait en voir et en savoir, c’est qu’ils se procuraient mutuellement la joie de pouvoir baver sur leurs contemporains. Ils préludaient verbalement à ce qu’ils allaient faire leur vie durant, la plume à la main. Ils attendaient toujours des admirateurs bénévoles et ne pardonnaient point au monde entier de n’en pas regorger. Becque en a trouvé quelques-uns et ils ont fait de lui une façon de grand méconnu. Ils ont peut-être eu raison. Je n’en suis pas personnellement convaincu.
Le musicien Joncières n’a guère été notoire que par ses feuilletons musicaux. Comme compositeur, il a vécu sur l’insuccès relatif de son Sardanapale et sur la promesse d’autres opéras restés inconnus.
Un bal costumé. – Présentations réciproques. – Nina Gaillard et Emmanuel des Essarts. – Le salon de Nina. – Verlaine vers les vingt ans. – Les trois frères Cros. – Invention du téléphone. – La découverte de la pâte de verre colorée. – Le Rhinocéros en mal d’enfant. – Camille Pelletan et Edmond Lepelletier. – Les cabrioles de Raoul Rigault. – Rigault commissaire de police. – Le fugace Anatole France. – Le timide Valade. – Mérat « le cigare dédaigneux ». – Villiers de l’Isle-Adam. – Conseils aux jeunes arrivistes.
Chaque année Mme O’Connell organisait un bal costumé qui était, et à juste titre d’ailleurs, un des évènements mondains de chaque hiver. C’est dans un de ces bals que notre petit groupe d’amis s’augmenta d’un autre petit groupe, et que se fonda une sorte d’association intellectuelle qui décida de la vie de plus d’un parmi nous.
Par un phénomène d’attraction spontanée, nous nous trouvâmes réunis autour d’une jeune fille d’aspect très frêle, toute maigre, toute menue, et plutôt laide, d’une laideur si intelligente, si éveillée, si distinguée, qu’elle la rendait plus attrayante que les plus belles jeunes filles qui fussent là, et il y en avait de fort jolies – notamment la fille de Decamps.
Et puis la laideur est-elle chose possible avec les deux plus merveilleux yeux noirs qui jamais aient éclairé une figure, avec le plus grand air d’intelligence qui jamais ait fait vibrer un masque ? Elle s’appelait tout banalement Nina Gaillard. Le soir où, d’un geste, elle lia en gerbe toute la jeunesse que sa grâce attira pour jamais, elle portait un costume d’Algérienne de fantaisie. Il l’immatérialisait à proprement parler. Avec sa jupe courte, ses jambes fines et nerveuses, avec ses pieds tout petits frémissant dans la fine prison de leurs escarpins et qui semblaient créés pour courir sur la pointe des herbes diamantées par la rosée les effleurant, en compagnie d’Ariel, de Puck et de Caliban, avec les couleurs chatoyantes de ses jupes pailletées, et de sa ceinture de soie bariolée, avec l’éclat de ses yeux brillants comme des soleils et noirs comme la nuit, elle semblait un être de rêve, un feu follet, un oiseau-mouche, un papillon, un petit être de féerie dont le rôle serait d’éveiller, d’animer tout autour de lui des envolées de rêves et d’idées.
Et telle fut en effet sa destinée.
Derrière elle se tenaient deux vieilles femmes, dont l’une était sa mère, le nez chaussé d’un lorgnon qui faisait grimacer son masque noirâtre et ridé, les gestes empreints d’une vivacité doublée d’un peu d’ahurissement. L’autre dame mûre et conservant des restes d’une grande beauté, était la femme du correspondant parisien d’un des grands journaux quotidiens de Londres, Edward Yapp, un homme charmant tout à fait supérieur, et très accueillant pour nous tous.
Devant elle étaient ses deux filles qui étaient l’une et l’autre les plus purs modèles de la beauté des jeunes Anglaises très belles.
La présentation, chez Mme O’Connell, s’était faite avec une aisance extraordinaire, que justifiait relativement la liberté d’un bal costumé. Nina se tournant vers les deux jeunes Anglaises les avait priées de me présenter à elle, ce qu’elles firent le plus naturellement du monde. Mais comme elles ne me connaissaient pas, elles prièrent Nina de vouloir bien à son tour me présenter à elles, maintenant qu’elle était en règle avec les convenances vis-à-vis de moi. Et de ce moment-là nous eûmes tous quatre la sensation d’être bons amis depuis toujours et pour toujours. Et si bien qu’un de leurs jeunes camarades, Emmanuel des Essarts, venant à passer, elles nous mirent aussitôt la main dans la main. Et ce fut le début d’une amitié profondément fraternelle, qui désormais lia pour la vie Emmanuel des Essarts et moi.
Il n’était pas d’aspect imposant, mon cher Emmanuel ; il était de petite taille, trop gros pour sa hauteur et surtout pour son âge, il bredouillait en parlant. Sa réputation de poète commençait à poindre, et il lisait ou récitait volontiers ses poèmes, mais il les assassinait par des excès de cadence, par des roulements d’yeux imploratifs et mélancoliques, par une gesticulation d’escarpolette, par le retournement cocasse de ses mains accompagnant la courbe de ses bras trop courts. Une myopie excessive eût achevé de le rendre ridicule si on n’avait point su par avance quel homme de valeur, quel vaillant esprit et quel brave cœur on avait devant soi.
Bientôt nous nous retrouvions dans l’appartement occupé rue Chaptal par Nina Gaillard et sa mère. De M. Gaillard, nous ne savions rien, sinon que c’était un ancien avocat, jouissant d’une assez belle fortune et qui, par horreur du bruit et de l’excessive fantaisie de sa femme et de sa fille, avait loué pour son usage personnel, dans la même maison, trois étages plus haut, un appartement où il restait invisible pour nous tous.





























