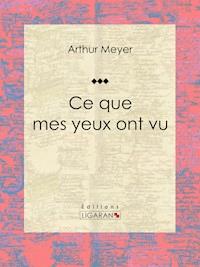
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le Gaulois du Dimanche évoquait récemment les témoins de l'année terrible ! De ceux-là, il en est que je ne connais pas, il en est aussi qui sont nos adversaires politiques ; mais je les aime tous d'avoir caressé les mêmes espérances, d'avoir subi les mêmes déceptions, les mêmes cruautés de la Fortune, d'avoir enfin vécu depuis 1870 dans un même rêve de réparations toujours attendues et toujours reculées."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076448
©Ligaran 2015
À MA FEMME
ARTHUR MEYER
À MES LECTEURS
Au mois de septembre 1910, après mon premier article, je reçus un matin, à Aix, le spirituel billet que voici :
Mon cher ami,
Si j’étais directeur du Gaulois, je ferais venir un nommé Arthur Meyer et je lui dirais : « Il ne s’agit pas de nous raconter qu’un jour ou l’autre vous nous offrirez vos mémoires, c’est immédiatement qu’il faut vous y mettre. »
BARRÈS.
Charmes, 7 septembre 1910.
J’ai fait venir « immédiatement le nommé Arthur Meyer », qui n’était pas très loin. Je lui ai montré le mot de l’illustre académicien. Il n’avait pas, au début, d’aussi mauvais desseins. Mais de telles invitations sont des ordres ; Arthur Meyer s’est incliné : c’est de cet acte de déférence qu’est né ce petit volume. Si vous regrettez de l’avoir feuilleté, relisez bien vite une des œuvres de M. Maurice Barrès, et les heures exquises que vous trouverez dans cette lecture vous feront lui pardonner le pernicieux conseil qu’il a donné à l’auteur des pages qui vont suivre.
A.M.
Je n’ai pas les mêmes opinions politiques que M. Arthur Meyer. Je suis républicain depuis un demi-siècle et n’ai jamais songé à changer d’opinion. Je n’en suis, ou je ne me sens, que plus à l’aise et pour dire tout le plaisir que les souvenirs de M. Arthur Meyer m’ont donné et pour les apprécier avec ma liberté et ma tranquillité ordinaires.
Les souvenirs de M. Arthur Meyer sont toute une histoire, rapide, légère et à vol d’aéroplane, de la troisième république française. Ils partent de 1870, ils viennent jusqu’à 1910. Il s’est passé beaucoup de choses pendant ces quarante années ; mais, parce que ces souvenirs ne sont pas, évidemment, écrits sur notes et sur fiches, les grands évènements seulement y apparaîtront, étant ceux qui accaparent la mémoire et qui éliminent tous les autres. Et c’est ainsi que ces souvenirs portent presque exclusivement sur la Commune, sur la chute de Thiers, sur le principat de Mac-Mahon, sur l’avènement et la chute de Grévy, sur le Boulangisme, sur le Panamisme, sur le Dreyfusisme.
L’insurrection de la Commune qu’il eût été, je crois, assez facile de prévenir, fut une erreur de Thiers et de son entourage. Thiers et son entourage (sauf Ernest Picard), et il faut dire aussi la grande majorité de l’Assemblée nationale, ne connaissaient rien de Paris. Thiers, en particulier, savait l’Europe ; mais il connaissait la France moins que l’Europe et Paris beaucoup moins que la France. Il prit des mesures qui devaient exciter le mécontentement de la classe populaire à Paris. Ce mécontentement devint une insurrection ; cette insurrection devint la plus épouvantable des guerres civiles. À la vérité (l’historien devant enregistrer avec impassibilité les immoralités de l’histoire), les conséquences de cette erreur et de cet affreux malheur furent bonnes. Thiers était, à cette époque, très nécessaire à la France. Or, il n’eût pas conservé six mois la confiance de l’Assemblée nationale ; il n’eût pas été, quelques mois après la Commune (31 août 1871), de simple « chef du pouvoir exécutif », nommé par l’Assemblée « président de la République française », s’il n’avait, par la répression de la Commune, obtenu la confiance, longtemps hésitante, toujours mêlée d’arrière-pensée, mais enfin la confiance de l’Assemblée nationale.
Thiers, servi – et encouragé – par la mort de Napoléon III, tomba par suite d’une impatience un peu sénile qu’il avait de constituer la République, de faire une Constitution républicaine, ce qui m’a toujours semblé inutile à cette époque, en tant que prématuré et incertain, et ce qui était très dangereux. Il tomba. Le duc d’Aumale fut nommé président de la république française. Le public ne s’en est pas aperçu ; mais il fut nommé président de la république française et sur un mot de lui, qui était tout un programme et qui était très beau : « Je veux bien être une transaction ; je ne serai pas une transition. » Cela voulait dire : « Quelque chose d’intermédiaire entre la république et la monarchie, je veux bien l’être ; un moyen de passer de la république à la monarchie, non ! » Le comité directeur des droites avait nommé le duc d’Aumale sur ce programme. Il fut président de la république une nuit. Au matin, les bonapartistes – si peu nombreux qu’ils fussent, ils comptaient – vinrent dire que si le duc d’Aumale était maintenu président, il ne fallait pas compter sur leur concours. On abandonna le duc d’Aumale et l’on choisit le maréchal de Mac-Mahon.
L’impossibilité d’arriver à une fusion entre les orléanistes et les légitimistes accula l’Assemblée à faire cette Constitution républicaine qu’elle avait refusée à Thiers. Après quoi elle se retira.
Désormais, de par la Constitution, il y avait deux Chambres La Chambre des députés nommée après la dissolution de l’Assemblée nationale, fut en majorité républicaine ; le Sénat, en majorité, encore conservateur. Mac-Mahon pouvait rester ; il resta. Mais, après le renouvellement pour un tiers, le Sénat lui-même devint presque républicain. Mac-Mahon ne pouvait plus rester. Il démissionna. Jules Grévy fut nommé Président le 30 janvier 1879. La République républicaine était fondée.
Thiers avait dit : « La République sera conservatrice ou elle ne sera pas. » La République n’a pas été conservatrice et elle a été. Thiers n’en avait pas moins absolument raison. La République a été continuellement en butte à des assauts et en proie à des orages auxquels elle a failli succomber et qui l’ont laissée, au bout de quarante ans, extrêmement faible et sentant tellement sa faiblesse qu’elle en est encore à s’appuyer sur des partisans exigeants qui la compromettent, qui l’épuisent et qu’elle exècre en les redoutant.
Le premier assaut livré à la République fut le boulangisme. Le boulangisme était la conjonction spontanée de tous les mécontentements ; mais c’était surtout la réaction contre la curée du « Panama ». Comme dans toute république démocratique, les parlementaires besogneux, accablés de dépenses électorales et mal payés, s’étaient précipités sur les millions de la Compagnie du Panama et avaient fait rétribuer largement le concours qu’ils donnaient ou promettaient à cette Compagnie. Le boulangisme fut le sursaut de colère d’une partie de la nation contre ces pratiques auxquelles elle n’était pas encore habituée. Ce fut, très exactement, le même mouvement d’opinion qui s’était produit un siècle auparavant contre le Directoire. Ce qu’une partie considérable de la nation désira alors passionnément, ce fut une République consulaire, une République gouvernée par un homme énergique. Les paysans de la Charente, que je fréquentais alors, n’avaient tous qu’un mot : « Il nous faut un homme ! » Ils donnaient là la formule même de la monarchie indéterminée, de la monarchie avec n’importe quel monarque, de la monarchie républicaine, même, mais de la monarchie, et c’est-à-dire d’un régime où l’on ne fût pas gouverné par une troupe, et par une troupe besogneuse, intrigante et suspecte.
M. Arthur Meyer fut au nombre des tout premiers boulangistes. Mais il y avait des boulangistes consulaires et il y avait des boulangistes monkistes, c’est-à-dire qui voyaient dans Boulanger, non une transaction, mais une transition et qui pensaient qu’à un moment donné il donnerait la main à une restauration royaliste. M. Arthur Meyer était de ces derniers. C’était exactement la même idée qu’avaient eue vers 1798 beaucoup de bonapartistes-royalistes, qui pensaient que Bonaparte serait le Monk de Louis XVIII. Seulement, et moi qui ne fus ni boulangiste consulaire, ni boulangiste monkiste, je puis le dire avec impartialité, les boulangistes monkistes voyaient plus juste que les boulangistes consulaires. Les boulangistes consulaires voyaient dans Boulanger l’étoffe d’un premier consul ; les boulangistes monkistes, jugeant l’homme à sa véritable valeur, estimaient qu’il ne pouvait être qu’une doublure et qu’une fois au pouvoir, le retournant, on montrerait à la France, et avec succès, l’étoffe royale.
Quoi qu’il en fût, deux comités, que je ne vois pas qui aient jamais eu aucune entente entre eux, se constituèrent, l’un consulaire, l’autre monkiste, où la duchesse d’Uzès, M. Dillon, M. Arthur Meyer figuraient au premier plan et travaillaient avec activité. La République chancela. À Paris et en province, Boulanger eut de tels succès électoraux que tout autre homme que Boulanger eût fait sauter les neuf cents par les fenêtres. Il était nul. Consulaires et monkistes s’étaient, non pas également, mais les uns et les autres, trompés sur lui. Il n’était pas capable d’être un Bonaparte ; mais il n’était même pas capable d’être un Monk. Il était un quinquagénaire amoureux, un Antoine. La Belgique fut son Égypte.
La République, avec l’alliance russe, se releva de ce grave échec ; car d’avoir été ébranlé par Boulanger, restait un échec considérable, ou tout au moins une forte dépréciation. L’alliance russe fut certainement une chose bonne en soi, quoique, depuis qu’elle existe, nous ayons rendu à la Russie beaucoup plus de services qu’elle ne nous en a rendus ; encore c’était une chose bonne en soi ; mais il ne faut pas non plus se dissimuler qu’à un certain point de vue elle nous a fait un assez grand mal. Je parle d’un mal moral. Jusqu’à elle, diminuant d’année en année, mais toujours subsistant et ayant eu sa part importante dans le boulangisme lui-même, l’espérance de réparer les désastres de 1870 était vivace au cœur des Français. À partir d’une alliance dont on ne connaissait pas les termes, mais qu’on savait sûrement qui n’était que défensive, on comprenait plus ou moins distinctement que cette alliance c’était la diminution de la France acceptée par nous, non pas seulement devant le vainqueur, mais devant un tiers, consacrée par un acte de caractère européen et en quelque sorte la signature de la Russie ajoutée au traité de Francfort. C’était la Russie disant à l’Europe : « Nous acceptons le traité de Francfort, la France aussi ; mais nous nous opposerions à ce qu’on la mutilât davantage. » Or, cela fut compris, plus ou moins, par tout le monde et une sécurité exclusive des grands espoirs et un peu, par conséquent, des grands efforts, devint l’état d’esprit de la plupart des Français. Je fais remonter à l’alliance russe, sinon comme à sa date initiale, du moins comme à une de ses dates essentielles, le fléchissement, momentané, je l’espère, du patriotisme en France. Encore une fois, l’acte fut bon ; car, comme dirait le bon sens populaire, « il vaut toujours mieux avoir des alliés » ; mais il eut indirectement certains résultats qui ne sont pas bons.
À peine respirant, la République subit une nouvelle bourrasque qui faillit la faire sombrer. Un mouvement d’esprit tout nouveau, absolument inconnu en France depuis trois siècles, s’était manifesté environ depuis 1885 : c’était l’antisémitisme. Le chapitre de M. Arthur Meyer sur l’antisémitisme est excellent. Il montre, et quoique beaucoup moins passionné que lui, je lui donne presque entièrement raison, que c’est la république qui a créé l’antisémitisme. La république des républicains, comme nous eût dit M. Thiers, la république anticatholique, et qui se croit forcée d’être anticatholique parce qu’elle s’appuie sur cette portion de la nation qui n’a pas d’autre idée politique que d’être anticatholique, la république des républicains a, naturellement, en dehors de la plèbe anticatholique, cherché des soutiens chez les juifs et les protestants. Elle les a flattés, adulés, favorisés, préférés dans ses choix, protégés par tous les moyens en son pouvoir. De là, et chez les catholiques sacrifiés et chez les indifférents mêmes, non favorisés, une grande animosité contre ces gens à qui allaient comme leur étant dus toutes les places et tous les honneurs. Le juif et le protestant (confondu avec le juif et très souvent pris pour en étant un) furent l’homme qui est bien avec le gouvernement et « l’homme qu’il n’y en a que pour lui ». Ils furent jalousés et détestés. Des haines religieuses qu’on croyait à jamais éteintes reparurent. Elles étaient nées de la haine que manifestait le gouvernement pour les chefs moraux de très honnêtes gens (les catholiques) qui étaient au moins une minorité très considérable dans le pays. Comme dit très bien M. Arthur Meyer, l’antisémitisme est une fondation de la troisième république française.
Or, au moment justement le plus aigu du mouvement antisémitique, l’affaire Dreyfus éclata et le Dreyfusisme se constitua. Il faut distinguer, et M. Arthur Meyer distingue très bien. Il y a eu les Dreyfusiens et les Dreyfusistes. Il y a eu les hommes qui ont cru qu’on avait condamné injustement ou au moins irrégulièrement le capitaine Dreyfus ; et il y a eu les hommes qui ont saisi cette occasion pour montrer l’armée à la foule comme un objet de colère, de haine et de mépris, et – l’Église ayant immédiatement compris la solidarité qui l’unit, elle, force sociale, à l’armée force sociale – pour dénoncer également l’Église à la foule comme objet de colère, de mépris et de haine.
Les Dreyfusiens furent nombreux ; mais les Dreyfusistes le furent incomparablement davantage et, en trois mois, j’en ai très bien fait le compte, de protestation contre un jugement particulier, le Dreyfusisme devint, pour n’être plus que cela, le groupement de tous les anarchismes. Encore une fois, la république chancela. Il lui était indifférent qu’on sapât l’Église ; mais elle ne tenait pas du tout à ce qu’on ruinât le prestige et l’autorité de l’armée, de son armée ; que, par le mépris qu’on versait sur elle, on développât l’antimilitarisme et l’antipatriotisme. Pourquoi n’y tenait-elle pas ? Parce qu’elle était un gouvernement, cependant, faisant figure en Europe, ayant une alliance, en préparant d’autres, et qu’un peuple qui a des alliances les perd immédiatement quand on sait qu’il n’a pas d’armée ou qu’il a une armée non fidèle à l’armée, ce qui revient au même. En conséquence, le gouvernement hésita beaucoup. Il fut d’abord très nettement antidreyfusiste. Il dessaisit une chambre de la Cour de cassation, chambre qu’on savait favorable à la révision du procès Dreyfus, pour saisir de l’affaire la Cour de cassation tout entière. Il se montra antidreyfusiste pendant environ un an.
La révision s’imposant, par suite d’un « fait nouveau » très considérable, M. Dreyfus fut jugé par un second conseil de guerre et condamné une seconde fois. À ce moment le gouvernement était devenu dreyfusiste, et cette seconde condamnation le gêna très fort. Il gracia M. Dreyfus et espéra que toute cette affaire se calmerait par cette mesure.
Il n’en pouvait rien être, le dreyfusisme ayant tellement grandi qu’il était une opinion, qu’il était un parti et un grand parti, et qu’aux yeux de beaucoup d’esprits, quoique à tort, il se confondait avec le républicanisme lui-même. Le gouvernement crut devoir faire procéder à une seconde révision du procès Dreyfus ; et on peut le dire en historien, sans aucune crainte d’erreur, cette fois, pour en finir, il fit comprendre à la Cour de cassation qu’il désirait que le jugement condamnant M. Dreyfus une seconde fois fût cassé sans renvoi devant un troisième conseil de guerre, appréhendant que ce troisième conseil de guerre ne condamnât M. Dreyfus comme les deux premiers. La Cour de cassation fut de cet avis et cassa sans renvoi, mais fut forcée, pour cela, de présenter l’article 445 du code d’instruction criminelle d’une façon absolument antijuridique, cet article ne lui permettant pas de casser sans renvoi dans la situation où se trouvait M. Dreyfus, et elle s’appuyant sur cet article même pour casser sans renvoyer. L’affaire Dreyfus était finie.
– Elle était précisément condamnée par cet arrêt à ne jamais finir, répond avec beaucoup de raison M. Meyer. Désormais, en effet, il est admis par la Cour de cassation que tout conseil de guerre devant qui eût été renvoyé M. Dreyfus l’eût condamné ; et il est avoué par la Cour de cassation qu’elle n’a pu casser l’arrêt qu’en ne se conformant pas au texte précis de la loi ; de sorte que, si l’affaire Dreyfus c’est une partie de la nation en animosité contre l’armée, une partie de la nation en animosité contre la magistrature, l’arrêt de la Cour de cassation, non seulement laisse ces deux armées en présence, mais encore les excite et leur donne des munitions. Il y a des manières peut-être douteuses d’entendre l’apaisement.
Aussi, quoique, par simple lassitude, l’affaire Dreyfus soit moins aiguë aujourd’hui qu’il y a cinq ans, encore est-il qu’il y a beaucoup de vrai – je ne dis pas que tout soit vrai – dans cette page vigoureuse de M. Arthur Meyer :
« Je n’ai aucun goût pour le pays des ombres. Je ne m’attarderai donc pas sur l’affaire Dreyfus ; mais, malheureusement, le dreyfusisme est vivant, et c’est son œuvre néfaste qu’il faut combattre et détruire, et à ce combat on peut appeler indistinctement tous les bons Français, quels qu’aient été leur sentiment et leur opinion de la première heure.
Qu’ils regardent avec moi et qu’ils voient ce qu’est le dreyfusisme ; qu’ils mesurent le gouffre béant qu’il a creusé sous nos pas.
C’est le dreyfusisme qui a hissé au pouvoir MM. Loubet et Fallières, qui a fermé les frontières de la France à de bons citoyens comme MM. Déroulède, Buffet et de Lur-Saluces, mais qui a ouvert les portes du pouvoir aux socialistes ; qui nous a désarmés en face de l’ennemi, en confiant les deux ministères de défense nationale à MM. André et Pelletan ; qui a avili notre magistrature ; qui a jeté les citoyens les uns contre les autres ; qui a « éteint les étoiles au ciel » et supprimé la « vieille chanson » ; qui a violé les sanctuaires et fracturé les couvents ; qui a amené l’alliance monstrueuse de certains défenseurs du capital et de la propriété avec ses pires ennemis pour opposer ensuite l’ouvrier au patron impuissant ; qui nous a humiliés à Tanger, devant les forts, et exaltés devant les faibles, lors du voyage de M. Loubet à Rome. C’est le dreyfusisme qui, en couvant le pacifisme, a créé l’antipatriotisme, et l’antimilitarisme en enseignant l’indiscipline et le mépris des officiers. C’est enfin le dreyfusisme qui, en détruisant la religion et l’armée, a supprimé les deux barrières posées devant la révolution. Voilà l’œuvre du dreyfusisme. »
Il est très vrai que l’affaire Dreyfus a laissé dans les esprits de très funestes ferments. Chez un grand nombre, l’habitude de ne pas respecter l’armée et de considérer le corps des officiers comme une congrégation cléricale et l’armée elle-même comme une institution surannée ; chez un grand nombre, d’un autre côté, l’habitude de considérer le juif comme un personnage au-dessus des lois et devant qui les lois s’inclinent et par suite une haine violente contre le juif, l’aristocratie juive, l’argent juif ; aux yeux de tous une diminution morale de la magistrature : voilà, à les réduire au minimum, les conséquences graves de cette affaire, qui d’un bout à l’autre a été menée de la façon la plus inhabile du monde. Il ne faut ni la grossir ni l’exténuer ; mais il est incontestable qu’elle fut néfaste.
Depuis l’affaire Dreyfus à demi endormie, la République ne s’est guère appliquée sérieusement qu’à son éternelle œuvre anticléricale, comme elle l’appelle, et c’est-à-dire qu’à l’abolition du christianisme en France. Elle s’y est appliquée d’une part avec violence par l’expulsion des ordres monastiques, d’autre part avec une persévérance silencieuse et cauteleuse en encourageant les instituteurs à ne rien enseigner, à très peu près, si ce n’est la défiance à l’égard de toute religion ; d’autre part enfin, à mon avis, avec une prodigieuse maladresse, en séparant les Églises de l’État. – Comme tous mes livres en font foi, j’ai toujours été partisan de la séparation des Églises d’avec l’État ; d’abord parce que je n’admets pas que le gouvernement temporel soit, à aucun degré, gouvernement spirituel, et il l’est dès qu’il paye les prêtres et dès qu’il prend part à la nomination des évêques ; ensuite parce que je crois, comme Lamennais, comme bien d’autres moins célèbres, que l’Église n’est forte que quand elle est libre et que par conséquent elle ne devient forte que du jour où elle est séparée d’avec l’État. C’est donc, à mon avis, un partisan de l’État qui doit être pour l’association de l’État avec l’Église, et ainsi raisonnait Voltaire ; et c’est un partisan de l’Église ou un homme sympathisant avec elle qui doit vouloir la séparation. Or, c’est par haine de l’Église que la République française a transformé l’Église française dépendante de l’État en Église libre. Et j’estime que, à son point de vue même, c’est très maladroit.
Ce n’est pas maladroit du tout, à une condition, c’est qu’après avoir séparé l’État de l’Église, le gouvernement continue la guerre contre l’Église et, soit peu à peu, soit d’un seul coup de force, la supprime. C’est ce que ses partisans lui conseillent vivement ou ce dont ils le somment, lui disant : « Maintenant que vous avez libéré l’Église, tuez-la ; car, si après l’avoir faite libre, vous ne la tuez pas, vous ne l’avez faite que plus forte. » À cette sommation le ministère actuel ne semble pas du tout disposé à obéir ; mais il est assez probable que le ministère d’après-demain y obéira.
Tel est l’historique que M. Arthur Meyer a tracé, d’un crayon abandonné en apparence et réellement très surveillé. La République française telle qu’il l’a peinte, et il est loin de la peindre faussement, a toujours été et n’a jamais voulu être, sauf quelques accalmies, comme celle à laquelle le bon Spuller a laissé son nom, qu’un gouvernement de combat. Elle se croit faite pour détruire, tant qu’il en demeurera un reste, ce qui fut l’âme idéaliste de la France. À cette œuvre elle revient toujours, croyant que c’est pour elle une question de vie ou de mort et que, du jour où elle cesserait de combattre l’idée chrétienne, étant abandonnée de ses partisans, elle serait perdue. Elle n’a jamais voulu entendre qu’elle pût être un gouvernement indépendant des partis et d’un parti et ne cherchant qu’à bien administrer, ce qui, à mon avis, lui rallierait les dix-huit vingtièmes de la nation.
On me dira que, précisément, il est impossible, en république, que le gouvernement soit supérieur, ni même extérieur aux partis et qu’il ne peut être qu’un parti qui gouverne, et qu’il n’y a qu’un roi qui puisse être indépendant des partis, pour cette cause qu’étant éternel il n’a aucunement besoin d’eux. Il y a beaucoup de vérité dans cette théorie et je l’ai exposée moi-même plusieurs fois.
Mais, en l’exposant, j’ai dit qu’un roi peut très facilement être indépendant des partis ; je n’ai pas dit – et c’est très certainement ce qui me sépare de M. Meyer – qu’il n’y eût qu’un roi qui en fût capable. Un gouvernement républicain pourrait très bien se borner au rôle véritable de tout bon gouvernement, c’est-à-dire à bien administrer, c’est-à-dire à travailler pour le pays tout entier et à le rendre sain, robuste et fort. Il n’y a aucune raison pour que le gouvernement d’une république soit dans l’impuissance de se conduire de la sorte.
– Si bien ; parce qu’il dépend de la majorité électorale et que la majorité électorale est un parti et que, pour vivre, il n’a qu’une chose à faire : obéir aux passions de ce parti et le gorger.
– J’entends bien ; mais je crois que s’il se bornait à être un bon gouvernement, il se créerait immédiatement une majorité formidable, devant laquelle les partis ne seraient que trois ou quatre minorités imperceptibles.
– Vous croyez donc le pays intelligent ?
– Non ; mais de gros bon sens très sûr relativement à ses intérêts. Il est possible que je me trompe.
Quoi qu’il en soit, je reconnais qu’il serait très difficile à la République française d’être le gouvernement que j’indique qu’elle devrait être, parce qu’elle a établi une tradition qu’il lui serait malaisé de remonter. Gouvernement de combat contre l’idée chrétienne et tout ce qui s’y rattache, gouvernement de combat contre les idées hiérarchiques et contre tout ce qui contrarie l’égalité : voilà la définition de la troisième République dans l’esprit et de la plupart de ses partisans et de la plupart de ses ennemis. On sort très difficilement de la définition qu’on a longtemps donnée de soi-même. Quand on le fait, il arrive, d’abord qu’on n’est pas reconnu et qu’on est méconnu et qu’on se trouve un peu seul. La transition d’un caractère qu’on a eu à un nouveau caractère qu’on veut prendre ne laisse pas, assez longtemps, d’être malaisée… Il est probable que la République continuera à être ce qu’elle a été, ou ramenée à être ce qu’elle a été depuis trente et un ans et par conséquent continuera à être touchée des mêmes secousses dont elle a été si souvent assaillie.
Tels sont les faits et telles sont les idées à travers lesquels M. Arthur Meyer s’est promené avec aisance et élégance, avec, aussi, une très heureuse inégalité de ton, tantôt très vif, souvent, plus souvent, d’une bonhomie nonchalante désabusée et spirituelle, toujours intéressant comme un témoin qui fut très attentif et dont la mémoire est très amusée en même temps qu’elle est très fidèle.
On sent en M. Arthur Meyer un homme qui fut très passionné, de tout temps, pour les idées conservatrices, qui n’a jamais eu la moindre confiance dans « la Révolution avec toutes ses conséquences », comme disait Gambetta, et qui en même temps, ce qui est sa marque originale, a été infiniment curieux de toute nouveauté et d’œil et d’oreille ouverts à tous les spectacles et à tous les bruits de ce monde ; qui a été homme d’action jusqu’à être un peu, à l’occasion, conspirateur ; extrêmement honnête homme du reste, dans le sens actuel du mot et dans le sens que le mot avait au dix-septième siècle et dans tous les sens ; serviable, fidèle, de procédés délicats et de courtoisie extrêmement surveillée ; devenu, au moment où nous sommes, d’une indulgence générale, où il est entré beaucoup de bonté et où il reste un peu de raillerie ; un type, enfin, fort curieux et fort sympathique, d’homme politique net, énergique et décidé et de très grand journaliste ; – le tout dans un homme aimable.
ÉMILE FAGUET,
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE.
MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE,
Vous avez institué, dans la Vie Heureuse, une enquête intéressante sur « l’Idéal des enfants ». Vous voulez bien me demander d’interroger mes souvenirs afin d’y retrouver le rêve d’avenir de mes dix ans.
J’ai eu naturellement dix ans, comme tout le monde… ou à peu près. Je n’ai jamais eu d’enfance. C’est une grande tristesse ! Seules, les enfances heureuses font les âmes apaisées. Aussi les parents sont-ils coupables de ne pas mettre, autant qu’ils le peuvent, du sourire dans les yeux de leurs chers enfants, alors que la vie se charge si vite d’y mettre tant de larmes.
Je n’ai pas connu ma mère : elle est morte quelques mois après ma naissance. Mon père était le fils aîné d’un petit rabbi d’Alsace, sans aucun bien. Il avait dû, à la mort de son propre père, prendre la sacoche du colporteur et commencer son tour de France. Le hasard des grands chemins le conduisit au Havre. La ville lui plut et le retint. À force d’économies, il avait amassé quelque argent : il loua, pour un mois, une boutique et y installa un déballage ; la boutique prospéra et devint un magasin ; le magasin allait devenir un comptoir de pacotilles. Je suis né entre les deux premières étapes : le déballage et le magasin. Mon père, tout à sa vie de travail, que n’égayait aucune distraction, n’avait pas trouvé le temps de s’instruire ; il était trop intelligent pour ne pas en souffrir : il voulut, au moins, m’épargner cette amertume, et, comme un peu de vanité lui était venu, avec un peu de fortune, il se mit à souhaiter que je ne prisse pas la suite de son commerce. C’était le temps où Scribe, abandonnant ses « colonels », venait de mettre à la mode le parfait ingénieur ; tous les pères rêvaient des héros de Scribe et de Feuillet. Mon père dut caresser ce rêve. En attendant qu’il se réalisât, il me fit entrer au collège de la ville. J’étais un bambin de sept ans. Bénie soit sa mémoire pour cette touchante ambition ! Je lui dois le peu que je suis devenu. Mon père m’aimait d’ailleurs à sa manière, c’était la manière biblique ; il ne s’appelait pas pour rien Abraham. En me faisant donner une instruction, qui lui avait douloureusement manqué, il s’estimait quitte envers moi. Je me mépriserais de lui faire grief de m’avoir privé de toute éducation. À quel moment eût-il appris la chose ? Qui même lui eût enseigné le mot ? Chaque soir, je quittais le collège où j’étais simple externe pour retourner à l’appartement modeste que mon père occupait au-dessus de son magasin. Fidèle à ses habitudes d’économie, il n’employait qu’une domestique, et, pour ne pas la surmener, en l’obligeant à me veiller, il m’emmenait avec lui au théâtre : c’était son seul plaisir. Je m’y endormais régulièrement dès le premier acte. Il y en avait généralement une douzaine ! Je ne saurais compter le nombre de comédies, de drames et d’opéras variés que j’ai ainsi dormis pendant deux ou trois ans. Ce régime de « carcere theatrico » aurait dû m’inspirer le dégoût de la littérature et de la musique. Ma bonne étoile me permit d’y échapper. Chacun a sa destinée.
Lors de mes grandes et petites vacances, aussi bien qu’aux dimanches et jours de fête, mon père m’abandonnait à son unique bonne, qui m’abandonnait à ma fantaisie, et ma fantaisie était de gaminer par les rues avec les petits vauriens de mon âge ; nous jouions en plein air, aux billes, à la marelle, à saute-mouton ; ce que nous préférions, c’était de faire, avec l’eau et la boue des ruisseaux, de grands pâtés et de petites maisons ; ce furent, jusqu’à dix ans, mes premiers, mes seuls châteaux en Espagne.
Je me souviens cependant – et c’est un souvenir que je suis heureux de vous dédier, monsieur et cher confrère… un jour de carnaval, nous vagabondions à travers la ville, selon notre coutume ; nous courions après tous les masques, leur jetant, avec mille cris assourdissants, tout ce que nous pouvions ramasser le long du chemin, sans soupçonner que nous devancions l’heure des confetti. Tout à coup, au détour d’une rue, un grand diable d’homme nous barre la route. Nous ne songions pas d’ailleurs à nous sauver, nous étions comme pétrifiés devant cet être fantastique. Ce que je me rappelle vaguement du personnage, après tant d’années écoulées, c’est qu’il ne ressemblait en rien aux bonshommes dessinés sur les images que nous admirions aux étalages des libraires ! Ce dont je me souviens nettement, c’est que l’homme tenait, à la main, une grande ligne à laquelle était suspendue une pêche, en manière d’hameçon. Nous étions des enfants ; à cet âge, les impressions s’effacent vite, et nous n’avions pas plus tôt aperçu la ligne et la pêche que nous avions oublié le bonhomme. Nous n’avions plus qu’une idée : c’était d’attraper la pêche. Mais alors la ligne, d’un mouvement rapide, s’enlève de terre et virevolte au-dessus de nos têtes, puis elle vient raser le sol. Nous nous précipitons, elle reprend son vol dans l’air, nous cingle le visage, comme une banderilla, trempe dans le ruisseau, nous frôle ; nous nous ruons, nous nous battons pour atteindre la pêche miraculeuse. Elle nous fuit et trompe toutes nos ruses. Ce fut, deux heures durant, une course folle, du vertige. Nous ne nous lassions pas. L’homme à la ligne pas davantage. Seule la pêche s’était lassée. Il n’y avait plus de pêche. S’était-elle déchiquetée et réduite à néant, dans sa course folle ? l’avions-nous dépecée au vol ? Ce fut le secret de l’homme qui ne nous le dit pas. Je me plus néanmoins à croire que nous nous en étions tous régalés et que j’avais eu mon morceau du festin. Le soir, encore tout époumonné et tout ému, je rentrai au logis où je racontai mon aventure. « Oh ! le petit vaurien, – dit la fidèle Véronique, – une pêche qui est allée dans le ruisseau. Vous n’avez pas honte d’y avoir mordu après tout le monde ! »
Mais me redressant fièrement, je répondis : Non, Véronique, car j’ai mordu où personne n’avait touché. Ma nature venait de se révéler dans ce cri enfantin. Depuis, j’ai continué à courir après toutes les pêches que la Destinée malicieuse me tendait au bout de sa ligne, et j’ai toujours eu la prétention de mordre où personne n’avait touché. À ce jeu, j’ai usé quelques dents. Je ne m’étais pas assez méfié du noyau.
Aix-les-Bains, 4 septembre 1910.
Le Gaulois du Dimanche évoquait récemment les témoins de l’année terrible ! De ceux-là, il en est que je ne connais pas, il en est aussi qui sont nos adversaires politiques ; mais je les aime tous d’avoir caressé les mêmes espérances, d’avoir subi les mêmes déceptions, les mêmes cruautés de la Fortune, d’avoir enfin vécu depuis 1870 dans un même rêve de réparations toujours attendues et toujours reculées.
Heureuses les générations qui nous ont succédé, car elles ne voient dans la guerre de 1870, dans le désastre de Sedan, dans la capitulation de Paris, dans les crimes de la Commune, que des faits historiques, lointains, presque effacés, comme l’étaient pour nous la Terreur et Waterloo ! Elles n’ont pas assisté à l’amputation de la patrie. On n’a pas arraché sous leurs yeux un lambeau de leur chair !
Heureux ceux qui nous ont succédé, car l’Alsace-Lorraine, qui fut pour nous la terre perdue, peut être pour eux la terre promise, s’ils veulent s’unir dans une même pensée, dans un effort énergique et persévérant.
L’année 1870 s’était levée dans une apothéose : l’Empire rajeuni était devenu l’Empire libéral. Certains esprits surannés estimaient bien qu’en s’allongeant d’une épithète, l’Empire s’était affaibli, mais l’opposition elle-même avait désarmé et un de ses chefs les plus qualifiés, M. Thiers, avait approuvé cette évolution en déclarant que ses opinions étaient sur les bancs du ministère. Le plébiscite allait enfin, avec l’éloquence de ses chiffres, donner une réplique triomphale à ces esprits chagrins, en affirmant par huit millions de suffrages sa foi dans l’Empereur et sa confiance dans l’Empire libéral. À ce propos, je me vois encore, modeste secrétaire et seul survivant du grand comité du plébiscite, accompagnant aux Tuileries son vice-président, le duc d’Albuféra, et son secrétaire général, M. Janvier de La Motte, qui allaient porter à l’Empereur les premiers résultats du scrutin.
Dissimulé derrière mes chefs, je pouvais à loisir contempler Napoléon III. Le marbre et la couleur ont popularisé ses traits. Mais aucun peintre, aucun sculpteur n’a pu rendre son regard. Ce regard ne fixait pas, il enveloppait, et chacun, cependant, se sentait réchauffé par son rayonnement. De toute sa personne émanait une bonté universelle, et cependant chacun sentait qu’il en pouvait prendre sa part. L’Empereur écoutait debout. Son masque impassible s’éclaira subitement d’un sourire de fierté. Ce n’était pas de la fierté personnelle ; je pourrais dire, si je l’osais, qu’elle m’apparaissait plutôt deux fois paternelle, pour son fils que le peuple venait de sacrer à ses côtés, pour le peuple qu’il aimait, comme un fils, jusqu’à la faiblesse ; il dit simplement : « Merci, messieurs », puis, soulevant le prince impérial, il ajouta : « Saluons ensemble notre petit Empereur ! »
Pauvre petit Empereur qu’allait frapper cruellement la destinée et qui, des privilèges impériaux, ne devait plus connaître que l’exil !
Un ver s’était glissé sous les fleurs ; l’armée – une armée prétorienne, au dire de l’opposition – avait déposé dans les urnes du plébiscite 45 000 non sur 220 000 votants. 45 000 soldats ralliés à l’opposition ! C’était beaucoup 220 000 hommes figurant à l’effectif ! C’était peu.
Dans l’ivresse de son triomphe, le gouvernement n’avait pas été frappé par ces chiffres inquiétants qui éclairaient les partis d’opposition sur leurs forces politiques, et M. de Bismarck, notre vigilant ennemi, sur notre faiblesse militaire. Cette défection d’une partie de notre armée eut d’immédiates répercussions.
Ce fut d’abord la « manifestation » des blouses blanches, qui préludaient à l’émeute par des combats d’avant-garde et durent être refoulées dans les faubourgs ; Henri Rochefort, sa Lanterne à la main, menait l’assaut contre la personne même de l’Empereur, aux applaudissements de la bourgeoisie amusée ; enfin, après la mort de Victor Noir, la foule essayait ses forces contre l’armée et, cette fois, venait s’y briser.
Pendant que les premières fissures apparaissaient dans l’armature impériale, des craquements, sinistres précurseurs des grandes secousses, se faisaient entendre à nos frontières de l’Est.
M. de Bismarck, escomptant, d’après les chiffres du plébiscite, les défaillances de notre armée, comprenant, d’autre part, qu’il trouverait dans ceux qui troublaient et compromettaient la paix des rues ses meilleurs alliés, eut la vision claire de la fragilité de la nouvelle Constitution impériale, et jugea que l’heure était venue d’abattre la dernière carte de la partie qu’il avait entamée en Danemark et continuée dans les plaines de Sadowa.
Il lança la candidature du prince de Hohenzollern au trône d’Espagne. La nouvelle n’émut pas tout d’abord l’opinion ; pour la troubler, il fallut l’interpellation de M. Cochery, le choc des partis, au Parlement, si malheureusement restauré, enfin la polémique des journaux ; et ce fut une vision assez inattendue ! Pendant que les journaux, défenseurs de l’Empire, conseillaient la paix dans la dignité, certains organes de l’opposition, spéculant, je veux croire, inconsciemment, sur les chances des combats, préconisaient la guerre, et c’étaient ceux-là mêmes qui avaient applaudi aux Gaietés du Sabre, sœurs aînées du Pioupiou de l’Yonne.
Notre ami Robert Mitchell, alors rédacteur en chef du Constitutionnel, fut pris comme tête de Turc avec M. Paul de Cassagnac, le jeune et vaillant directeur du Pays, par leurs confrères de l’opposition, épris tout à coup de l’amour des combats. La veille, ils prêchaient le désarmement et accusaient le maréchal Niel de vouloir faire de la France une caserne ; puis, quand ils soupçonnèrent que la guerre était évitée, ils redoublèrent de sarcasmes et d’injures, en criant bien haut que le ministère Ollivier était devenu « le cabinet Pétaud » et qu’entre les mains de Napoléon III l’épée d’Austerlitz n’était plus que « la batte d’Arlequin ».
J’entends encore le prince Poniatowski raconter que, faisant son service à Saint-Cloud, il avait introduit de grand matin l’ambassadeur d’Espagne, M. Olazaga, auprès de l’Empereur, que la conférence avait duré plus d’une heure et qu’en le reconduisant, le souverain avait embrassé le diplomate en lui disant : « Dieu soit loué, c’est la paix ! » Puis Napoléon III avait chargé le prince Poniatowski de porter cette bonne nouvelle au prince Richard de Metternich, alors ambassadeur d’Autriche à Paris.
Le prince Poniatowski ajoutait : « Jamais je n’avais vu l’Empereur aussi heureux ; il ne ressentait plus le mal dont il souffrait. »
M. Émile Ollivier, qui avait réprimé avec une remarquable énergie le mouvement quasi révolutionnaire dont les funérailles de Victor Noir avaient été le prétexte, se montrait également soucieux d’une solution pacifique.
Je puis l’affirmer, car je fus le témoin d’une scène qui a été souvent racontée, mais qu’il me faut rééditer pour démontrer péremptoirement quelle était la véritable mentalité de M. Émile Ollivier.
C’était le 16 juillet 1870. La séance de la Chambre venait de s’ouvrir, les députés frissonnants attendaient à leurs bancs la réponse à la note du duc de Gramont. Les tribunes étaient bondées. La salle des Pas-Perdus, si grouillante d’habitude, était presque déserte. Un seul groupe s’y montrait. Le baron de Plancy, député, et M. Léonce Détroyat, directeur de la Liberté, échangeaient leurs impressions sur la question angoissante du jour.
Je les écoutais fiévreusement. Tout à coup nous apercevons M. Émile Ollivier débouchant des bureaux qui donnent sur la place du Palais-Bourbon. M. Émile Ollivier semblait radieux.
Pour entrer dans la salle des séances par la porte tambour – qui y donne accès – il lui fallut passer devant nous. Il reconnut son collègue M. de Plancy, il s’arrêta pour lui serrer la main. Je l’entends encore répondre de cette voix chaude et sonore qu’on lui connaît :
« Ah ! oui, je suis heureux et vous le serez avec moi et la France le sera avec vous lorsque vous saurez ce que j’ai là sur moi », et il nous montrait la poche intérieure de son vêtement.
Ce qu’il avait sur lui était en effet bien précieux, c’était la fameuse dépêche, la dépêche de renonciation du prince de Hohenzollern.
La salle des Pas-Perdus n’était plus absolument vide. Un journaliste était entré et avait suivi notre conversation. M. Zaban, qui signait du pseudonyme bien connu de Castorine des articles financiers au Charivari, s’était vivement rapproché de nous : « Pardonnez-moi mon indiscrétion, nous dit-il, que vous a dit le Président ? »
Léonce Détroyat, tout joyeux de la bonne parole du ministre, lui rapporta fidèlement la réponse de M. Émile Ollivier.
M. Zaban ne fit qu’un bond jusqu’à sa voiture et se fit conduire à la Bourse. Là, il commença par faire une importante opération à la hausse, puis il colporta adroitement la nouvelle. Elle se répandit comme une traînée de poudre ; la Rente monta de deux francs.
Comme l’Empereur, comme M. Émile Ollivier, le monde des intérêts avait estimé que la renonciation du prince de Hohenzollern assurait définitivement la paix.
La rue, travaillée par les journaux de l’opposition, montrait moins d’enthousiasme.
L’Empereur devait trop écouter les bruits de la rue, mais c’est là la fatalité de tous les régimes qui sont nés uniquement de la popularité ; ils obéissent à tous les caprices de l’opinion, ils ne gouvernent que pour elle et par elle. Déjà, pour la flatter, Napoléon III avait fait la guerre d’Italie ; déjà, pour ne pas l’affronter, il s’était entêté dans l’expédition du Mexique qui, arrêtée à temps, n’eût été qu’une erreur, mais qui, continuée désespérément, tourna au désastre. Je l’ai dit, Napoléon III pouvait, il devait résister au courant de l’opinion et accepter malgré elle et contre elle comme un succès la renonciation du prince de Hohenzollern au trône d’Espagne. Guillaume II parlait le langage de la vérité, quand il disait dans son récent discours de Kœnigsberg qu’il faut pour gouverner se montrer indifférent aux manières de voir du jour. L’Empereur Guillaume parlait en monarque héréditaire. Napoléon III n’était qu’un empereur populaire : il céda aux manières de voir du jour.
Il y céda avec une tristesse profonde, et dans la proclamation officielle, lorsque la guerre fut déclarée, il laissa entrevoir que ses résolutions ne s’accordaient pas avec ses sentiments ; son tort d’avoir cédé s’en augmente.
Les évènements se précipitaient. Après la dépêche d’Ems, savamment altérée, faussée par M. de Bismarck, la guerre était inévitable ; elle fut déclarée. Ce fut une ivresse dans toute la France : on pavoisa, on illumina, on acclama les petits soldats qui traversaient Paris ; on les accompagnait à la gare en criant : « À Berlin ! » On obligeait les artistes les plus aimés du public, Faure, Capoul, Mme Marie Sasse, à chanter dans la rue la Marseillaise, jusque-là interdite, désormais autorisée.
J’assistais, à l’Opéra, dans la loge de mon maître et ami, Émile de Girardin, à la représentation de la Muette de Portici.
C’était le 21 juillet 1870. Paris était en pleine effervescence patriotique. Le public venait de bisser le duo :
Amour sacré de la patrie…
lorsqu’un cri s’éleva de toutes parts : « La Marseillaise, la Marseillaise ! » Alors, fendant la foule qui venait sur la scène de se soulever à l’appel de Masaniello, Marie Sasse apparaît, toute drapée de blanc et brandissant le drapeau tricolore. Un immense hourra l’empêche d’abord de se faire entendre : « Debout, Messieurs », crie une voix au parterre. Toute la salle s’est levée et écoute l’hymne redevenu national, dans un silence recueilli.
Après le dernier couplet, l’enthousiasme est devenu indescriptible ; hommes et femmes reprennent en chœur le dernier refrain, et tout à coup j’entends devant moi Girardin, comme électrisé, s’écrier : « Vive l’armée ! » et la salle entière répond : « Vive l’armée ! »
Les souvenirs de Malakoff et de Magenta flottaient dans l’air ; nos victoires avaient malheureusement créé dans le peuple la légende de notre invincibilité.





























