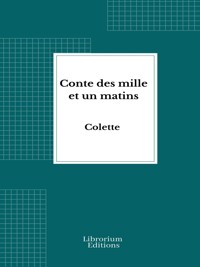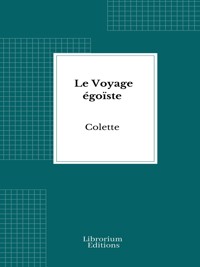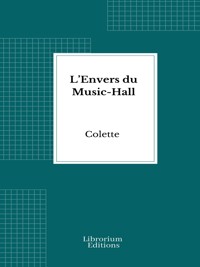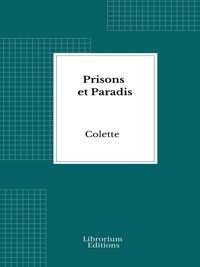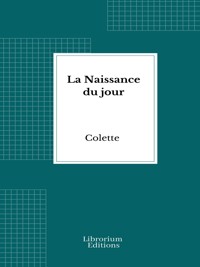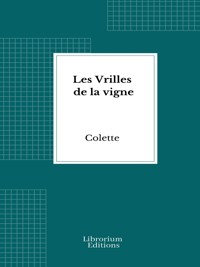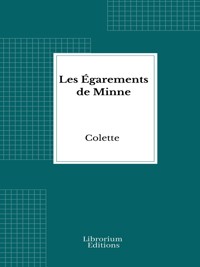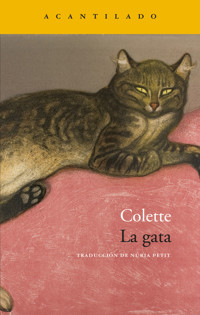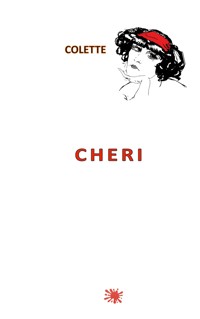0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il est parti ! Il est parti ! Je le répète, je l’écris, pour savoir que cela est vrai, pour savoir si cela me fera mal. Tant qu’il était là, je ne sentais pas qu’il partirait. Il s’agitait avec précision. Il donnait des ordres nets, il me disait : « Annie, vous n’oublierez pas… » puis, s’interrompant : « Mon Dieu, quelle pauvre figure vous me faites ! J’ai plus de chagrin de votre chagrin que de mon départ ! » Est-ce que je lui faisais une si pauvre figure ? Je n’avais pas de peine, puisqu’il était encore là.
À l’entendre me plaindre ainsi je frissonnais, repliée et craintive, je me demandais : « Est-ce que vraiment je vais avoir autant de chagrin qu’il le dit ? c’est terrible ! »
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Colette
CLAUDINE S’EN VA
Journal d’Annie
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385748746
Claudine s’en va(Journal d’Annie)
Il est parti ! Il est parti ! Je le répète, je l’écris, pour savoir que cela est vrai, pour savoir si cela me fera mal. Tant qu’il était là, je ne sentais pas qu’il partirait. Il s’agitait avec précision. Il donnait des ordres nets, il me disait : « Annie, vous n’oublierez pas… » puis, s’interrompant : « Mon Dieu, quelle pauvre figure vous me faites ! J’ai plus de chagrin de votre chagrin que de mon départ ! » Est-ce que je lui faisais une si pauvre figure ? Je n’avais pas de peine, puisqu’il était encore là.
À l’entendre me plaindre ainsi je frissonnais, repliée et craintive, je me demandais : « Est-ce que vraiment je vais avoir autant de chagrin qu’il le dit ? c’est terrible ! »
À présent, c’est la vérité : il est parti ! Je crains de bouger, de respirer, de vivre. Un mari ne devrait pas quitter sa femme, quand c’est ce mari-là, et cette femme-là.
Je n’avais pas encore treize ans, qu’il était déjà le maître de ma vie. Un si beau maître ! un garçon roux, plus blanc qu’un œuf, avec des yeux bleus qui m’éblouissaient. J’attendais ses grandes vacances, chez grand-mère Lajarisse – toute ma famille – et je comptais les jours. Le matin venait enfin où, en entrant dans ma chambre blanche et grise de petite nonne (à cause des cruels étés de là-bas, on blanchit à la chaux, et les murs restent frais et neufs dans l’ombre des persiennes), en entrant, elle disait : « Les fenêtres de la chambre d’Alain sont ouvertes, la cuisinière les a vues en revenant de ville. » Elle m’annonçait cela tranquillement, sans se douter qu’à ces seuls mots je me recroquevillais, menue, sous mes draps, et que je remontais mes genoux jusqu’à mon menton…
Cet Alain ! je l’aimais, à douze ans, comme à présent, d’un amour confus et épouvanté, sans coquetterie et sans ruse. Chaque année, nous vivions côte à côte, pendant tout près de quatre mois (parce qu’on l’élevait en Normandie dans une de ces écoles genre anglo-saxon, où les vacances sont longues). Il arrivait, blanc et doré, avec cinq ou six taches de rousseur sous ses yeux bleus et il poussait la porte du jardin comme on plante un drapeau sur une citadelle. Je l’attendais, dans ma petite robe de tous les jours, n’osant pas, de peur qu’il le remarquât, me parer pour lui. Il m’emmenait, nous lisions, nous jouions, il ne me demandait pas mon avis, il se moquait souvent, il décrétait : « Nous allons faire ceci, vous tiendrez le pied de l’échelle ; vous tendrez votre tablier pour que je jette les pommes dedans… » ; il passait son bras autour de mes épaules et regardait autour de lui d’un air méchant, comme pour dire : « Qu’on vienne me la prendre ! » Il avait seize ans, et moi douze.
Quelquefois – c’est un geste que j’ai fait encore hier, humblement – je posais sur son poignet blanc ma main hâlée et je soupirais : « Comme je suis noire ! » Il montrait ses dents carrées dans un sourire orgueilleux et répondait : « Sed formosa, chère Annie. »
Voici une photographie de ces temps-là. J’y suis brune et sans épaisseur, comme maintenant, avec une petite tête un peu tirée en arrière par les cheveux noirs et lourds, une bouche en moue qui implore… « je ne le ferai plus », et, sous des cils très longs plantés en abat-jour, droits comme une grille, des yeux d’un bleu si liquide qu’ils me gênent quand je me mire, des yeux ridiculement clairs, sur cette peau de petite fille kabyle. Mais puisqu’ils ont su plaire à Alain…
Nous avons grandi très sages, sans baisers et sans gestes vilains. Oh ! ce n’est pas ma faute. J’aurais dit « oui », même en me taisant. Souvent, près de lui, au jour finissant, j’ai trouvé trop lourde l’odeur des jasmins, et j’ai respiré péniblement, la poitrine étreinte… Comme les mots me manquaient pour avouer à Alain : « Le jasmin, le soir, le duvet de ma peau que caressent mes lèvres, c’est vous… » ; alors, je fermais ma bouche, et j’abaissais mes cils sur mes yeux trop clairs, dans une attitude si habituelle qu’il ne s’est jamais douté de rien, jamais… Il est aussi honnête qu’il est beau.
À vingt-quatre ans, il a déclaré : « Maintenant, nous allons nous marier », comme il m’aurait dit, onze ans auparavant : « À présent, nous allons jouer aux sauvages. »
Il a toujours si bien su ce que je devais faire, que me voici, sans lui, comme un inutile joujou mécanique dont on a perdu la clef. Comment saurai-je, à présent, où est le bien et le mal ?
Pauvre, pauvre petite Annie égoïste et faible ! Je me lamente sur moi en pensant à lui. Je l’ai supplié de ne pas partir… en peu de paroles, car son affection, toujours retenue, craint les expansions vives : « Cet héritage, ce n’est peut-être pas grand-chose… nous avons assez d’argent, et c’est chercher bien loin une fortune peu certaine… Alain, si vous chargiez quelqu’un… » L’étonnement de ses sourcils a coupé ma phrase maladroite ; mais j’ai repris courage : « Eh bien, alors, Alain, emmenez-moi. »
Son sourire plein de pitié ne m’a pas laissé d’espoir : « Vous emmener, ma pauvre enfant ! délicate comme vous l’êtes, et… si mauvaise voyageuse, soit dit sans vous blesser. Vous voyez-vous supportant la traversée jusqu’à Buenos Aires ? Songez à votre santé, songez – c’est un argument qui vous touchera, je le sais – à l’embarras que vous pourriez m’être. »
J’ai abaissé mes paupières, ce qui est ma façon de rentrer chez moi, et j’ai maudit silencieusement mon oncle Etchevarray, tête brûlée qui disparut, il y a quinze ans, sans donner de nouvelles. Le déplaisant toqué, qui s’avise de mourir riche dans des pays qu’on ne connaît pas, et de nous laisser des, quoi ?… des estancias où l’on élève des taureaux, « des taureaux qui se vendent jusqu’à six mille piastres, Annie ». Je ne me rappelle même pas combien cela fait, en francs…
La journée de son départ n’est pas encore finie que me voici écrivant en cachette dans ma chambre, sur le beau cahier qu’il m’a donné pour que j’y tinsse mon « Journal de son voyage » et relisant l’« Emploi du temps » que m’a laissé sa ferme sollicitude.
« Juin. – Visites chez Mme X…, Mme Z…, et Mme T… (important).
« Une seule visite à Renaud et Claudine, ménage réellement trop fantaisiste pour une jeune femme dont le mari voyage au loin.
« Faire payer la facture du tapissier pour les grandes bergères du salon et le lit canné. Ne pas marchander, car le tapissier fournit nos amis G… et pourrait clabauder.
« Commander les costumes d’été d’Annie. Pas trop de “genre tailleur”, des robes claires et simples. Que ma chère Annie ne s’entête pas à croire que le rouge ou l’orange vif lui éclaircissent le teint.
« Vérifier les livres des domestiques chaque samedi matin. Que Jules n’oublie pas de dépendre la verdure de mon fumoir, et qu’il la roule sous poivre et tabac. C’est un assez bon garçon, mais mou, et il fera son service avec négligence, si Annie n’y veille elle-même.
« Annie sortira à pied dans les avenues, et ne lira pas trop de fadaises, pas trop de romans naturalistes ou autres.
« Prévenir à l’“Urbaine” que nous donnons congé le 1er juillet. Prendre la victoria à la journée pendant les cinq jours qui précéderont le départ pour Arriège.
« Ma chère Annie me fera beaucoup de plaisir en consultant souvent ma sœur Marthe et en sortant souvent avec elle. Marthe a un grand bon sens et même du sens pratique sous des dehors un peu libres. »
Il a songé à tout ! Et je n’ai pas, même une minute, la honte de mon… de mon incapacité ?… inertie serait peut-être plus juste, ou passivité. La vigilance active d’Alain absorbe tout et m’ôte le moindre souci matériel. J’ai voulu, la première année de notre mariage, secouer ma silencieuse oisiveté de petite pays-chaud. Alain eut tôt fait de rabattre mon beau zèle : « Laissez, laissez, Annie, c’est fait, je m’en suis occupé… » « Mais non, Annie, vous ne savez pas, vous n’avez aucune idée… ! »
Je ne sais rien – qu’obéir. Il m’a appris cela, et je m’en acquitte comme de la seule tâche de mon existence, avec assiduité, avec joie. Mon cou flexible, mes bras pendants, ma taille un peu trop mince et qui plie, jusqu’à mes paupières qui tombent facilement et disent « oui », jusqu’à mon teint de petite esclave,… me prédestinaient à obéir. Alain me nomme souvent ainsi « petite esclave », il dit cela sans méchanceté, bien sûr, avec seulement un léger mépris pour ma race brune. Il est si blanc !
Oui, cher « Emploi du temps », qui me guidez encore en son absence et jusqu’à sa première lettre, oui, je donnerai congé à l’« Urbaine », je surveillerai Jules, je vérifierai les livres des domestiques (hélas !), je ferai mes visites et je verrai souvent Marthe.
Marthe, c’est ma belle-sœur, la sœur d’Alain. Quoiqu’il la blâme d’avoir épousé un romancier, pourtant connu, mon mari lui reconnaît une intelligence vive et désordonnée, une lucidité brouillonne. Il dit volontiers : « Elle est adroite. » Je n’arrive pas à démêler très bien la valeur de ce compliment.
En tout cas, elle joue de son frère avec un doigté infaillible, et je crois bien qu’Alain ne le devine pas. Avec quel art elle sauve le mot risqué qu’elle vient de laisser échapper, avec quelle maîtrise elle escamote un sujet de conversation dangereux ! Quand j’ai fâché mon seigneur et maître, je reste là toute triste, sans même implorer ma grâce ; Marthe, elle, rit à son nez, ou admire à propos une remarque qu’il vient de faire, dénigre à coups de mots drôles un raseur particulièrement odieux – et Alain déplisse ses durs sourcils.
Adroite, certes, de l’esprit et des mains. Je la regarde ébahie, lorsque, en bavardant, elle fait éclore sous ses doigts un adorable chapeau, ou un jabot de dentelle, avec le chic d’une « première » de bonne maison. Marthe n’a rien pourtant du trottin. Assez petite, potelée, la taille serrée et très mince, une croupe avenante et mobile, elle porte droite une tête flambante de cheveux roux doré (les cheveux d’Alain) éclairée encore par de terribles yeux gris. Une figure de petite pétroleuse – au sens communard du mot – qu’elle arrange très joliment en minois XVIIIe siècle. De la poudre de riz, du rouge aux lèvres, des robes bruissantes en soies peintes à guirlandes, le corsage à pointe et les talons très hauts – Claudine (l’amusante Claudine qu’il ne faut pas trop voir) l’appelle souvent « marquise pour barricades ».
Cette Ninon révolutionnaire a su asservir – là encore je reconnais le sang d’Alain – le mari qu’elle a conquis après une courte lutte. Léon, c’est un peu l’Annie de Marthe. Quand je pense à lui, je l’appelle « ce pauvre Léon ». Pourtant il n’a pas l’air malheureux. Il est brun, régulier, joli garçon, la barbe en pointe et l’œil en amande, avec des cheveux doux et plats. Un type parfaitement français et modéré. On lui voudrait plus de saccade dans le profil, plus de carrure dans le menton, de brusquerie dans l’arcade sourcilière, moins de condescendance dans ses yeux noirs. Il est un peu – c’est méchant ce que j’écris là – un peu « premier à la soie », prétend cette peste de Claudine qui l’a nommé un jour : « Et-avec-ça-Madame ? » Et l’étiquette est restée à ce pauvre Léon, que Marthe traite en propriété de rapport.
Elle l’enferme régulièrement trois ou quatre heures par jour, moyennant quoi il fournit, m’a-t-elle confié, un bon rendement moyen d’un roman deux tiers par an, « le strict nécessaire », ajoute-t-elle.
Qu’il y ait des femmes douées d’assez d’initiative, de volonté quotidienne – et de cruauté aussi – pour édifier et soutenir un budget, un train de vie, sur le dos penché d’un homme qui écrit, qui écrit, et qui n’en meurt pas, cela me dépasse. Je blâme quelquefois Marthe, et puis je l’admire avec un peu d’effroi.
Constatant son autorité masculine qui a su exploiter la docilité de Léon, je lui ai dit, un jour de grande hardiesse :
« Marthe, toi et ton mari vous êtes un ménage contre nature. »
Elle m’a regardée stupéfaite, et puis elle a ri à s’en trouver mal :
« Non, cette Annie, elle vous a des mots ! Tu ne devrais jamais sortir sans un Larousse. Un ménage contre nature ! Heureusement que je suis toute seule pour t’entendre, par les modes qui courent… »
Mais Alain est parti tout de même ! je ne peux pas l’oublier longtemps dans mon bavardage intime. Que faire ? Ce fardeau de vivre seule m’accable… Si j’allais à la campagne, à Casamène, dans la vieille maison que nous a laissée grand-mère Lajarisse, pour n’y voir personne, personne jusqu’à son retour ?…
Marthe est entrée, balayant de ses jupes raides, des sabots de ses manches, mes beaux projets ridicules. J’ai caché mon cahier, très vite.
« Toute seule ? Viens-tu chez le tailleur ? Toute seule dans cette chambre triste ! La veuve inconsolée, quoi !… »
Sa plaisanterie mal venue – sa ressemblance aussi avec son frère, malgré la poudre, le chapeau Trianonet la haute ombrelle – m’arrachent de nouvelles larmes.
« Bon, ça y est ! Annie, tu es la dernière des… épouses. Il reviendra, je te dis ! J’imaginais, moi simple, moi indigne, que son absence te donnerait (les premières semaines du moins) une impression de vacances, d’escapade…
— D’escapade, oh ! Marthe…
— Quoi, oh ! Marthe ?… C’est vrai que ça sonne le vide, ici », dit-elle en tournant par la chambre, ma chambre, où le départ d’Alain n’a pourtant rien changé.
J’essuie mes yeux, ce qui prend toujours un peu de temps parce que j’ai beaucoup de cils. Marthe dit en riant que j’ai « des cheveux au bout des yeux ».
Elle est appuyée des deux coudes à la cheminée, me tournant le dos. Elle porte, un peu tôt pour la saison, je trouve, une robe de voile bis à petites roses démodées, une jupe montée à fronces et un fichu croisé qui sont de Mme Vigée-Lebrun, avec des cheveux roux, dégageant la nuque, qui sont d’Helleu. Cela crie un peu, pourtant sans disgrâce. Mais je garderai ces remarques pour moi. D’ailleurs, quelles sont les remarques que je ne garde pas pour moi ?…
« Qu’est-ce que tu examines si longtemps, Marthe ?
— Je contemple le portrait de monsieur mon frère.
— D’Alain ?
— C’est toi qui l’as nommé ?
— Qu’est-ce que tu lui trouves ? »
Elle ne répond pas tout de suite. Puis elle éclate de rire et se retournant :
« C’est extraordinaire, ce qu’il ressemble à un coq !
— À un coq ?
— Oui, à un coq. Regarde. »
Suffoquée d’entendre une telle horreur, je prends machinalement le portrait, une photo tirée en sanguine, qui me plaît fort :
Dans un jardin d’été, mon mari est campé ; nu-tête, ses cheveux roux en brosse, l’œil hautain, le jarret bien tendu… Il se tient ainsi habituellement. Il ressemble… à un beau garçon solide, qui a la tête près du bonnet, l’œil prompt ;… il ressemble aussi à un coq. Marthe a raison. Oui, à un coq roux, vernissé, crêté, ergoté… Désolée comme s’il venait de partir une seconde fois, je refonds en larmes. Ma belle-sœur lève des bras consternés.
« Non, vrai, tu sais, si on ne peut même pas parler de lui ! Tu es un cas, ma chère. Ça va être gai d’aller chez le tailleur avec ces yeux-là ! Est-ce que je t’ai fait de la peine ?
— Non, non, c’est moi toute seule… Laisse, ça va passer… »
Je ne peux pourtant pas lui avouer que je suis désespérée qu’Alain ressemble à un coq, et surtout que je m’en sois aperçue…
À un coq ! Elle avait bien besoin de me faire remarquer cela…
*
« Madame n’a pas bien dormi ?
— Non, Léonie…
— Madame a les yeux battus… Madame devrait prendre un verre de cognac.
— Non, merci. J’aime mieux mon cacao. »
Léonie ne connaît qu’un remède à tous les maux : un verre de cognac. J’imagine qu’elle en expérimente journellement les bons effets. Elle m’intimide un peu parce qu’elle est grande, de gestes décidés, qu’elle ferme les portes avec autorité et qu’en cousant dans la lingerie, elle siffle, comme un cocher qui revient du régiment, des sonneries militaires. C’est d’ailleurs une fille capable de dévouement, qui me sert depuis mon mariage, depuis quatre ans, avec un mépris affectueux.
Seule à mon réveil, seule à me dire qu’une journée et une nuit se sont écoulées depuis le départ d’Alain, seule à réunir tout mon courage pour commander les repas, téléphoner à l’« Urbaine », feuilleter les livres de comptes !… Un collégien qui n’a pas fait ses devoirs de vacances ne s’éveille pas plus morne que moi, le matin de la rentrée…
Hier, je n’ai pas accompagné ma belle-sœur à l’essayage. Je lui en voulais, à cause du coq… J’ai prétexté une fatigue, la rougeur de mes paupières.
Aujourd’hui, je veux secouer ma prostration et – puisque Alain me l’a ordonné – visiter Marthe à son jour, bien que la traversée, sans appui, toute seule, de ce salon immense, sonore de voix féminines, me soit toujours un petit supplice. Si je me faisais, comme dit Claudine, « porter malade » ? Oh ! non, je ne peux pas désobéir à mon mari.
« Quelle robe que Madame a besoin ? »
Oui, quelle robe ? Alain n’hésiterait pas, lui. D’un coup d’œil, il eût consulté la couleur du temps, celle de mon teint, puis les noms inscrits au « jour », et son choix infaillible eût tout contenté…
« Ma robe en crêpe gris, Léonie, et le chapeau aux papillons… »
Des papillons gris aux ailes de plumes cendrées, tachées de lunules orange et roses, qui m’amusent. Enfin ! il faut constater que mon grand chagrin ne m’enlaidit pas trop. Le chapeau aux papillons bien droit sur les cheveux lisses et gonflés, la raie à droite et le chignon bas, les yeux bleus gênants et pâles, plus liquides encore à cause des larmes récentes, allons, il y a de quoi faire pester Valentine Chessenet, une fidèle du salon de ma belle-sœur, qui me déteste parce que (je sens cela) elle trouverait volontiers mon mari tout à fait de son goût. Une créature qu’on a plongée, dirait-on, dans un bain décolorant. Les cheveux, la peau, les cils, tout du même blond rosâtre. Elle se maquille en rose, se poisse les cils au mascaro (c’est Marthe qui me l’a dit) sans arriver à tonifier sa fadasse anémie.
Elle sera à son poste chez Marthe, le dos au jour pour masquer ses poches sous les yeux, à bonne distance de la Rose-Chou dont elle redoute l’éclat bête et sain, elle me criera aigrement, par-dessus les têtes, des rosseries auxquelles je ne saurai rien répondre ; mon silence intimidé fera rire d’autres perruches, et on m’appellera encore « la petite oie noire » ! Alain, autoritaire Alain, c’est pour vous que je cours m’exposer à tant de douloureuses piqûres !
Dès l’antichambre, à ce bruit de volière, ponctué, comme de coups de bec, par les chocs des petites cuillers, mes mains se refroidissent.
Elle est là, cette Chessenet ! Elles sont toutes là, et toutes jacassent, sauf Candeur, poétesse-enfant, dont l’âme silencieuse ne fleurit qu’en beaux vers. Celle-là se tait, tourne avec lenteur des yeux moirés et mord sa lèvre inférieure d’un air voluptueux et coupable, comme si ce fût la lèvre d’une autre…
Il y a Miss Flossie, qui dit, pour refuser une tasse de thé, un « Non… », si prolongé, dans un petit râle guttural semblant accorder toute elle-même. Alain ne veut pas (pourquoi ?) que je la connaisse, cette Américaine plus souple qu’une écharpe, dont l’étincelant visage brille de cheveux d’or, de prunelles bleu de mer, de dents implacables. Elle me sourit sans embarras, ses yeux rivés aux miens, jusqu’à ce qu’un frémissement de son sourcil gauche, singulier, gênant comme un appel, fasse détourner mon regard… Miss Flossie sourit plus nerveusement alors, tandis qu’une enfant rousse et mince, blottie dans son ombre, me couve, inexplicablement, de ses profonds yeux de haine…
Maugis – un gros critique musical –, ses yeux saillants avivés d’une lueur courte, considère le couple des Américaines de tout près, avec une insolence à gifler, et grognonne presque indistinctement, en remplissant de whisky un verre à bordeaux :
« Quéqu’ Sapho, pourvu qu’on rigole ! »
Je ne comprends pas ; j’ose à peine regarder tous ces visages subitement figés dans une immobilité malveillante à cause de ma robe qui est jolie. Que je voudrais m’enfuir ! Je me réfugie près de Marthe qui me réchauffe de sa main solide et petite, de ses yeux d’audace, braves comme elle-même. Comme je l’envie d’être si brave ! Elle a la langue vive et impatiente, elle dépense beaucoup, il n’en faut pas tant pour qu’on potine autour d’elle sans bonté. Elle le sait, court au-devant des allusions, empoigne les amies perfides et les secoue avec l’entrain et la ténacité d’un bon ratier.
Aujourd’hui, je l’embrasserais pour sa réponse à Mme Chessenet, qui crie à mon entrée :
« Ah ! voici la veuve du Malabar !
— Ne la taquinez pas trop, riposte Marthe. Après tout, quand un mari s’en va, ça laisse un vide. »
Derrière moi, une voix pénétrée acquiesce, en roulant des r fresnois :
« Cerrrtainement, un vide considérrrable… et doulourrreux ! »
Et toutes partent d’un éclat de rire. Je me suis retournée, confuse, et ma gêne augmente en reconnaissant Claudine, la femme de Renaud. « Une seule visite à Renaud et Claudine, ménage trop fantaisiste… » La circonspection que leur témoigne Alain me rend sotte et comme coupable en leur présence. Pourtant, je les trouve enviables et gentils, ce mari et cette femme qui ne se quittent pas, unis comme des amants…
Comme j’avouais à Alain, un jour, que je ne blâmais point Claudine et Renaud de se poser en amants mariés, il m’a demandé, assez sec :
« Où avez-vous pris, ma chère, que des amants se voient plus et mieux que des époux ? »
Je lui ai répondu sincèrement :
« Je ne sais pas… »
Depuis ce temps nous n’échangeons plus, avec ce ménage « fantaisiste », que de rares visites de politesse. Cela ne gêne point Claudine, que rien ne gêne, ni Renaud qui ne se soucie guère que de sa femme au monde. Et Alain professe une parfaite horreur des ruptures inutiles.
Claudine ne paraît point se douter qu’elle a déchaîné les rires. Elle mange, les yeux baissés, une sandwich au homard, et déclare posément après que « c’est la sixième ».
« Oui, dit Marthe gaiement, vous êtes une relation ruineuse, l’âme de Mme Beulé a passé en vous.
— Son estomac seulement, c’est tout ce qu’elle avait de bon à prendre, rectifie Claudine.
— Méfiez-vous, ma chère, insinue Mme Chessenet, vous engraisserez à ce régime-là. Il m’a semblé, l’autre soir, que vos bras prenaient une agréable, mais dangereuse ampleur.
— Peuh ! réplique Claudine, la bouche pleine, je vous souhaite seulement d’avoir les cuisses comme j’ai les bras, ça fera plaisir à bien du monde. »
Mme Chessenet, qui est maigre, et s’en désole, avale cette rebuffade péniblement, le cou si tendu que je crains un petit esclandre. Mais elle toise seulement, avec un mutisme rageur, l’insolente aux cheveux courts, et se lève. J’esquisse un mouvement pour me lever aussi, puis je me rassieds afin de ne pas sortir avec cette vipère décolorée.
Claudine attaque vaillamment l’assiette aux petits choux pralinés et m’en offre (si Alain nous voyait !…). J’accepte et je lui chuchote :
« Elle va en inventer des horreurs sur vous, cette Chessenet !
— Je l’en défie bien. Elle a déjà sorti tout ce qu’elle pouvait imaginer. N’y a plus que l’infanticide qu’elle ne m’a pas attribué, et encore je n’oserais pas en répondre.
— Elle ne vous aime pas ? questionné-je timidement.
— Si ; mais elle le cache.
— Ça vous est égal ?
— Pardi !
— Pourquoi ? »
Les beaux yeux havane de Claudine me dévisagent :
« Pourquoi ? Je ne sais pas, moi. Parce que… »
L’approche de son mari interrompt sa réponse. Souriant, il lui indique la porte d’un signe léger. Elle quitte sa chaise, souple et silencieuse comme une chatte. Je ne saurai pas pourquoi.
Pourtant, il me semble que ce regard enveloppant qu’elle lui a jeté était bien une réponse…
Je veux partir aussi. Debout au milieu de ce cercle de femmes et d’hommes, je me sens défaillir d’embarras. Claudine voit mon angoisse, revient vers moi ; sa main nerveuse agrippe la mienne et la tient ferme pendant que ma belle-sœur m’interroge.
« Pas encore de nouvelles d’Alain ?
— Non, pas encore. Je trouverai peut-être un télégramme en rentrant.
— C’est la grâce que je te souhaite. Bonsoir, Annie.
— Où passez-vous vos vacances ? me demande, tout doucement, Claudine.
— À Arriège, avec Marthe et Léon…
— Si c’est avec Marthe !… Alain peut naviguer tranquille.
— Croyez-vous que, même sans Marthe… »
Je sens que je rougis ; Claudine hausse les épaules et répond, en rejoignant son mari qui l’attend, sans impatience, près de la porte :
« Oh ! Dieu non, il vous a trop bien dressée ! »
*
Ce message téléphonique de Marthe m’embarrasse beaucoup. « Impossible d’aller te cueillir à domicile pour essayer chez Taylor. Viens me prendre à quatre heures chez Claudine. »
Une image outrageante ne m’eût pas plus troublée que ce papier bleu. Chez Claudine ! Marthe en parle à son aise ; l’« Emploi du temps » dit… Que ne dit-il pas ?
Le rendez-vous donné par Marthe, dois-je le considérer comme une visite officielle à Renaud-Claudine ? Non… Si… Je m’agite, je cherche à biaiser, craignant de fâcher ma belle-sœur, redoutant Alain et ma conscience ; mais ma conscience débilitée, et d’ailleurs si peu au fait du chemin à suivre, cède à l’influence la plus proche, elle cède surtout au plaisir de voir cette Claudine qu’on me défend, comme un livre libre et trop sincère…
« Rue de Bassano, Charles. »
J’ai revêtu une sombre robe modeste, voilé mon visage de tulle uni, ganté mes mains de suède neutre, préoccupée d’enlever à ma « démarche » tout « caractère officiel ». Je sais me servir de ces mots-là, avertie par l’expérience d’Alain qu’une démarche doit ou ne doit point revêtir un caractère officiel. Lorsque je les prononce en pensée, ces mots-là, ils accompagnent, en guise de légende, un dessin, baroque et naïf, de rébus… La Démarche, petit personnage aux membres filiformes, tend ses bras vers les manches offertes d’un habit d’académicien, brodé finement au collet de « caractèrofficielcaractèreofficielcaract… » En guirlande délicate… Que je suis sotte d’écrire tout cela ! Ce n’est qu’une toute petite divagation. Je ne noterai jamais les autres : à les relire, ce cahier me tomberait des mains…
Au palier de Claudine, je consulte ma montre : quatre heures dix, Marthe sera sûrement arrivée, assise et croquant des sucreries dans cet étrange salon qu’à mes premières visites je vis à peine, tant la timidité me suffoquait…
« Mme Léon Payet est arrivée ? »