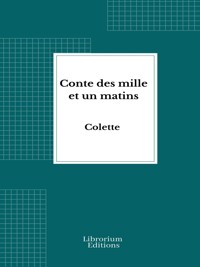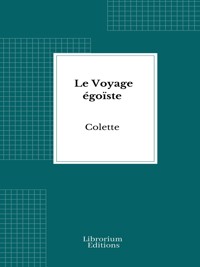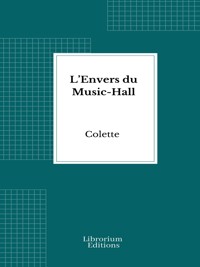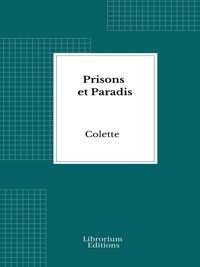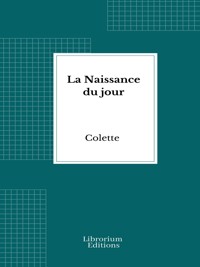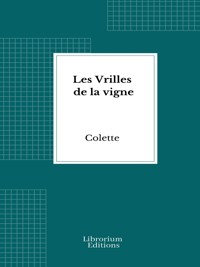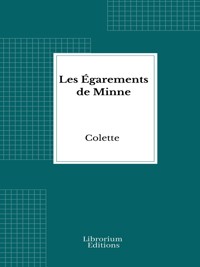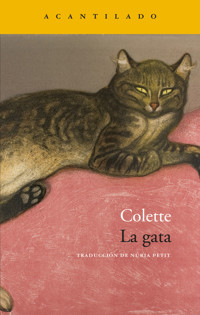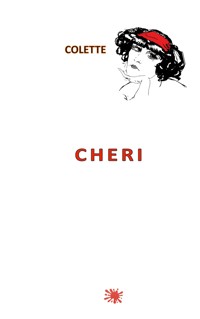0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Tout ce qui se dit d’une forêt est vrai, ou le devient. Mais il faut que ce soit une très grande forêt, assez vaste pour résorber, à l’aube, ses secrets nocturnes en même temps que sa frange de bêtes sauvages qui outrepassent ses lisières pendant la nuit. Il faut qu’elle soit à la mesure de cacher ses étangs, rassurer ses hardes, renouveler les étonnements de ses braconniers, affermir la réalité de ses propres fantômes. Ainsi de la forêt qui cerne Rambouillet. Battue en tous sens, mordillée, étoilée de pattes d’oie et d’écriteaux indicateurs, pourtant elle nous égare selon que le veulent le temps et la saison. Elle se disperse en brouillards, se taille en baguettes de pluie, reploie méconnaissables ses pins et ses houx sous une fourrure de neige et nous pouvons toujours croire qu’à l’extrémité d’un tunnel de futaie, sous le couvert arrondi en arcade romane, une silhouette s’est tenue debout sur deux pieds indistincts, ou sur quatre jambes, et qu’elle a fondu juste au moment où elle nous apparaissait… L’eussions-nous rejointe à cheval ? Rien n’est moins sûr. L’ornière peu foulée est verte d’herbe rase, de fin gazon forestier, et ne garde guère d’empreintes… Il n’a passé qu’un fantôme de plus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
En pays connu
Colette
© 2025 Librorium Editions
ISBN : 9782385749194
En pays connu
La maison proche de la forêt
Le Désert de Retz
Paradis terrestre
Hirondelles…
Découvertes
Province de Paris
Amertume
Ma Bourgogne pauvre
Au coin du feu
EN PAYS CONNU
LA MAISON PROCHE DE LA FORÊT
T
out ce qui se dit d’une forêt est vrai, ou le devient. Mais il faut que ce soit une très grande forêt, assez vaste pour résorber, à l’aube, ses secrets nocturnes en même temps que sa frange de bêtes sauvages qui outrepassent ses lisières pendant la nuit. Il faut qu’elle soit à la mesure de cacher ses étangs, rassurer ses hardes, renouveler les étonnements de ses braconniers, affermir la réalité de ses propres fantômes. Ainsi de la forêt qui cerne Rambouillet. Battue en tous sens, mordillée, étoilée de pattes d’oie et d’écriteaux indicateurs, pourtant elle nous égare selon que le veulent le temps et la saison. Elle se disperse en brouillards, se taille en baguettes de pluie, reploie méconnaissables ses pins et ses houx sous une fourrure de neige et nous pouvons toujours croire qu’à l’extrémité d’un tunnel de futaie, sous le couvert arrondi en arcade romane, une silhouette s’est tenue debout sur deux pieds indistincts, ou sur quatre jambes, et qu’elle a fondu juste au moment où elle nous apparaissait… L’eussions-nous rejointe à cheval ? Rien n’est moins sûr. L’ornière peu foulée est verte d’herbe rase, de fin gazon forestier, et ne garde guère d’empreintes… Il n’a passé qu’un fantôme de plus.
Je remercie à présent chacun des contretemps qui m’empêchèrent d’approfondir ma connaissance de la forêt rambolitaine : la paresse, l’âge, le penchant à procrastiner, et aussi le plaisir que j’eus d’habiter — trop peu de temps — un de ses sommets adoucis au-dessus d’une jolie petite ville, derrière les bosquets d’un chemin de ronde. Les routes qui se croisent là-haut s’arrangent pour retrouver la forêt proche. Mais, sauf les cueillettes rituelles, annuelles, qui ne souffrent ni omission ni retard, telles que l’anémone et la jacinthe sauvages, le muguet, la fraise, les grandes digitales, j’accompagnais de l’œil seulement ces aimables routes jaunes, craquantes sous le pied, qui s’élancent vers des étangs, de secrètes bruyères, des combes spongieuses, des sous-bois tendus d’arums envahissants.
Sur une trentaine de kilomètres je n’ignorais rien de leur parcours et de leurs inflexions. Je savais où elles rencontraient le lieu privilégié, l’oasis des bouleaux, leur ombre légère sur un sol sonore, cendreux, qui filtre la pluie et brille au soleil comme une vitre pulvérisée. Terre friable, bien odorante, douce au pied nu : c’est celle que les citadins nouent dans un mouchoir et répandent, en guise de panacée, sur le pot de capucines et la caissette de pâles bégonias…
Une maison me tenait hors de la forêt proche, et m’appelait quand je retournais à Paris. C’est une erreur touchante que de croire qu’une courte distance est négligeable, lorsqu’elle nous sépare d’un lieu dont nous goûtons l’agrément avec vivacité. Il n’est pas plus commode d’habiter Saint-Cloud que Montfort-L’Amaury, tant que le centre de nos travaux est à Paris. Les meilleures voitures n’y apportent pas de remède sensible, bien au contraire. J’en tombe d’accord avec Monsieur de La Palice : il n’y a qu’un moyen d’habiter la campagne, c’est de s’y retirer.
J’ai éprouvé que l’équilibre est difficile, sinon illusoire, entre le labeur parisien et le divertissement rural qui chaque soir, ou chaque samedi soir, prétend lui succéder. Trop paresseuse, — ou trop entraînée à travailler — je n’ai pu me former à devenir libre du seul fait que je gagnais les champs. Je n’ai pu oublier ceux-ci en réintégrant Paris, par une belle matinée qui continuait sans moi sur la ronde éminence de la forêt, devenait sans moi le glorieux milieu d’une belle journée, sans moi penchait vers un beau crépuscule, et loin de ma vue et de tous mes sens se revêtait du bleu nocturne, salué par la chouette rieuse et le crapaud flûtant sous le seuil. J’aurais fait un mauvais bureaucrate londonien, tirée que j’étais à hue et à dia.
La maison forestière justifiait-elle tant d’exigence ? Elle ne ressemblait à aucune de ces légères bâtisses qu’une forêt domaniale suscite à son entour, qui vieillissent vite et changent facilement de maître. Deux hectares l’environnaient, vierges de culture potagère. La primevère en trois couleurs, l’orchis pourpré, le polygala bleu et le muscari à odeur de prune lui venaient tout naturellement, à même sa prairie, avant les grandes marguerites et les boutons d’or. Je n’eus qu’à tailler ses rosiers amaigris, ses buis inégaux. Au centre d’une des façades, — elles étaient deux, coudées — un œil-de-bœuf inattendu, agréable, regardait le pré entre deux marronniers gros et gras à fleurs rouges. Qui sait comme l’Île-de-France planter le marronnier, auvent contre la pluie, ombrelle contre le soleil ? Seule la maison du Midi sait jouer en virtuose de sa paire de platanes, et de l’opaque mûrier guidé, aménagé en forme de roue au moyen d’une charpente légère, dissimulée dans son feuillage…
L’œil-de-bœuf, dis-je, envisageait placidement l’herbage, l’étroit bosquet qui longeait la route, et dont les mulots, puissants renforts des taupes, avaient miné le sol au point qu’un arbre, de temps en temps, s’inclinait, chargeait du poids de sa tête ses racines dénudées, et se couchait pour mourir avec nonchalance…
Non loin des marronniers jaillissait une cépée de pruniers à bois noir. Au printemps ils soutenaient dans l’air une nue de fleurs, qu’août changeait en prunes mielleuses. Par beau temps la maison ouvrait au ras du sol ses petites pièces qui parlaient de confiance, de retraite, de feux de bois… Je m’étais vite prise à son muet langage d’accueil. Il me reste bien encore un petit pli du cœur pincé dans les gonds d’une double porte, là-haut… N’empêche que l’huis, le chapeau de tuile noire, l’œil ovale et bienveillant, me tinrent des propos moins cohérents et moins simples que je ne les eusse souhaités. D’où, de qui venait la maison ? Quel goût « artiste » entachait, d’ailleurs adroitement, son authenticité ? Je lui disais, quand nous étions seules : « Pousse-toi un peu, vire sur ta base, ainsi tu nous préserveras, toi et nous, des souffles venus du Nord et qui te glacent. La place ne manquait pas, comment ton premier architecte n’y a-t-il pas songé ? Dirige ton gros œil bovin vers le couchant et ses aménités, il ne lui manque que de rougeoyer aux feux du Sud. Et que nous sert cette cheminée à hotte, par laquelle tu nous promets chaleur, flammes, sécurité d’hiver, puisqu’elle fume dès que j’y mets les copeaux et l’allumette… Tu as un puits, couronné de cymbalaire et de potentille ; mais juin le vide, et tout l’été nous séchons devant cet accessoire fleuri… »
Ainsi progressivement je suspectai les mains inconnues qui avaient sacrifié au décor, et je grommelais des mots comme « fausse paysanne » et « bergère de grande banlieue », encore que la maison proche de la forêt me donnât des plaisirs certains. Quand je ne citerais à son actif que l’empressement des mésanges, la familiarité des bergeronnettes, les constantes hirondelles… Le fait est qu’elles furent servies les premières, et pourvues de nids quand nos lits n’étaient pas encore dressés. Pour les mésanges, il y eut les nichoirs classiques, en tronc de bouleau satiné, non écorcé, percés d’une entrée ronde. Je les avais fait venir d’Auxerre, où l’on savait loger à leur gré les oiseaux libres, et mouler l’argile à souhait pour les hirondelles. Une mésange bleue entre autres nous regarda faire, mon homme-de-journées et moi. C’est tout juste si la miraculeuse créature, peinte de bleu céleste, rehaussée de vert saule et de jaune jonquille, eut la patience d’attendre que le nid fût cloué au tronc d’un orme, que l’échelle fût retirée. Elle s’élança, s’attacha verticale à la bûche de bouleau, hésita brièvement, interrogea le ciel et nos présences… Puis elle se jeta dans le nid la tête la première, sortit, rentra, sortit, appela sa compagne… Je n’ai guère retrouvé l’occasion d’admirer une si impétueuse compréhension, une acceptation aussi complète du risque… Tout cela me fut donné un chaleureux matin de mai — car les mésanges sont tardives à aimer et à pondre — par la maison proche de la forêt, dont j’étais trop prompte à discuter les mérites et les grâces…
Des allées de beau sable ocreux et fin serpentaient, pour le plaisir de serpenter, à travers la prairie. Une sablière le fournissait généreusement. Mais sous le sable gisait l’argile, qui tuait mes plantations d’arbustes dits d’agrément.
Un fils de la Chatte, âgé d’environ six semaines, disparut un matin, à l’heure où il avait coutume de s’étonner de toutes choses, de vouloir prendre les mouches en posant une patte dessus, de loucher sur les ombres mouvantes et d’exploiter le sable jaune au profit de sa connaissance, neuve, du plat-à-chat.