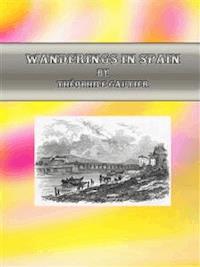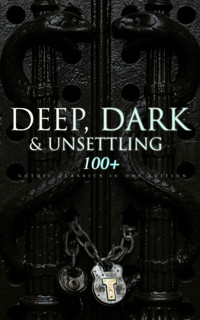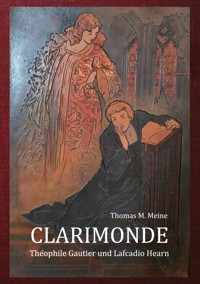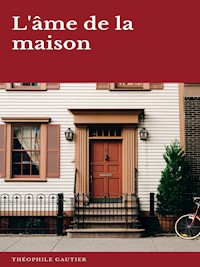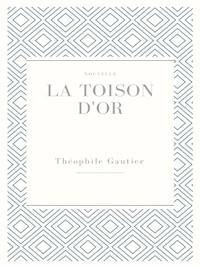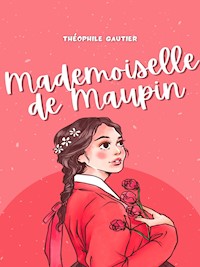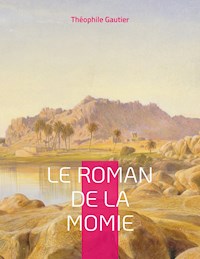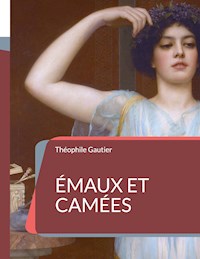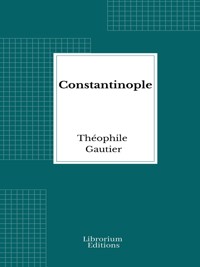
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
« Qui a bu boira, » assure le proverbe ; on pourrait modifier légèrement la formule, et dire avec non moins de justesse : « Qui a voyagé voyagera. » — La soif de voir, comme l’autre soif, s’irrite au lieu de s’éteindre en se satisfaisant. Me voici à Constantinople, et déjà je songe au Caire et à l’Égypte. L’Espagne, l’Italie, l’Afrique, l’Angleterre, la Belgique, la Hollande, une partie de l’Allemagne, la Suisse, les îles grecques, quelques échelles de la côte d’Asie, visitées à plusieurs époques et à diverses reprises, n’ont fait qu’augmenter ce désir de vagabondage cosmopolite. Le voyage est peut-être un élément dangereux à introduire dans la vie, car il trouble profondément et cause des inquiétudes semblables à celles des oiseaux de passage prisonniers au moment des migrations, si quelque circonstance ou quelque devoir vous empêche de partir. On sait que l’on va s’exposer à des fatigues, à des privations, à des ennuis, à des périls même, il en coûte de renoncer à de chères habitudes d’esprit et de cœur, de quitter sa famille, ses amis, ses relations, pour l’inconnu, et cependant l’on sent qu’il est impossible de rester, et ceux qui vous aiment n’essayent pas de vous retenir et vous serrent silencieusement la main sur le marchepied de la voiture. En effet, ne faut-il pas parcourir un peu la planète sur laquelle nous gravitons à travers l’immensité, jusqu’à ce que le mystérieux auteur nous transporte dans un monde nouveau pour nous faire lire une autre page de son œuvre infinie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
THÉOPHILE GAUTIER
CONSTANTINOPLE
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385742232
CONSTANTINOPLE
I EN MER
II MALTE
III SYRA
IV SMYRNE
V LA TROADE, LES DARDANELLES
VI LE PETIT CHAMP, LA CORNE-D’OR
VII UNE NUIT DU RAMADAN
VIII CAFÉS
IX LES BOUTIQUES
X LES BAZARS
XI LES DERVICHES TOURNEURS
XII LES DERVICHES HURLEURS
XIII LE CIMETIÈRE DE SCUTARI
XIV KARAGHEUZ
XV LE SULTAN A LA MOSQUÉE. — DINER TURC
XVI LES FEMMES
XVII LA RUPTURE DU JEUNE
XVIII LES MURAILLES DE CONSTANTINOPLE
XIX BALATA. — LE PHANAR. — BAIN TURC
XX LE BEÏRAM
XXI LE CHARLEMAGNE. — LES INCENDIES
XXII SAINTE-SOPHIE. — LES MOSQUÉES
XXIII LE SÉRAIL
XXIV LE PALAIS DU BOSPHORE. — SULTAN MAHMOUD. — LE DERVICHE
XXV L’ATMEÏDAN
XXVI L’ELBICEI-ATIKA
XXVII KADI-KEUÏ
XXVIII LE MONT BOUGOURLOU. — LES ILES DES PRINCES
XXIX LE BOSPHORE
XXX BUYUK-DÉRÉ
CONSTANTINOPLE
I EN MER
« Qui a bu boira, » assure le proverbe ; on pourrait modifier légèrement la formule, et dire avec non moins de justesse : « Qui a voyagé voyagera. » — La soif de voir, comme l’autre soif, s’irrite au lieu de s’éteindre en se satisfaisant. Me voici à Constantinople, et déjà je songe au Caire et à l’Égypte. L’Espagne, l’Italie, l’Afrique, l’Angleterre, la Belgique, la Hollande, une partie de l’Allemagne, la Suisse, les îles grecques, quelques échelles de la côte d’Asie, visitées à plusieurs époques et à diverses reprises, n’ont fait qu’augmenter ce désir de vagabondage cosmopolite. Le voyage est peut-être un élément dangereux à introduire dans la vie, car il trouble profondément et cause des inquiétudes semblables à celles des oiseaux de passage prisonniers au moment des migrations, si quelque circonstance ou quelque devoir vous empêche de partir. On sait que l’on va s’exposer à des fatigues, à des privations, à des ennuis, à des périls même, il en coûte de renoncer à de chères habitudes d’esprit et de cœur, de quitter sa famille, ses amis, ses relations, pour l’inconnu, et cependant l’on sent qu’il est impossible de rester, et ceux qui vous aiment n’essayent pas de vous retenir et vous serrent silencieusement la main sur le marchepied de la voiture. En effet, ne faut-il pas parcourir un peu la planète sur laquelle nous gravitons à travers l’immensité, jusqu’à ce que le mystérieux auteur nous transporte dans un monde nouveau pour nous faire lire une autre page de son œuvre infinie ? N’est-ce pas une coupable paresse d’épeler toujours le même mot sans jamais tourner le feuillet ? Quel poëte serait satisfait de voir le lecteur s’en tenir à une seule de ses strophes ? Ainsi chaque année, à moins d’être cloué sur place par les nécessités les plus impérieuses, je lis un pays de ce vaste univers qui me paraît moins grand à mesure que je le parcours et qu’il se dégage des vagues cosmographies de l’imagination. Sans aller précisément au Saint-Sépulcre, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à la Mecque, je fais un pieux pèlerinage aux endroits de la terre où la beauté des sites rend Dieu plus visible ; cette fois je verrai la Turquie, la Grèce et un peu cette Asie hellénique où la beauté des formes s’unit aux splendeurs orientales. Mais terminons là cette courte préface (les moins longues sont les meilleures), et mettons-nous en route sans plus tarder.
Si j’étais un Chinois ou un Indien arrivant de Nanking ou de Calcutta, je vous décrirais avec soin et prolixité le chemin de Paris à Marseille, le railway de Châlons, et la Saône, et le Rhône, et Avignon, mais vous les connaissez aussi bien que moi, et d’ailleurs, pour voyager dans un pays, il faut être étranger : la comparaison des différences produit les remarques. Qui de nous noterait qu’en France les hommes donnent le bras aux femmes, particularité qui étonne un habitant du Céleste empire ? Supposez donc, sans transition, que je suis sur le port, et que le Léonidas chauffe en partance pour Constantinople. Le Midi se déclare déjà par un gai soleil qui tiédit les dalles et fait pépier des centaines d’oiseaux exotiques dans les cages exposées à la devanture de deux marchands oiseleurs : les aras réjouis débitent leur répertoire, les bengalis battent des ailes, se croyant chez eux ; les ouistitis gambadent légèrement, se grattent l’aisselle, vous regardent de leurs yeux presque humains, et vous tendent amicalement leurs petites mains fraîches à travers les barreaux, insoucieux encore de la phthisie qui les fera tousser sous la ouate aux froids salons parisiens ; il n’est pas jusqu’aux mornes tortues qui ne se démènent dans leur carapace et ne se raniment à ce rayon vivificateur ; en quarante heures j’ai passé de la pluie torrentielle au bleu le plus pur. J’ai laissé l’hiver derrière moi, et je trouve l’été ardent et splendide ; je vais prendre une glace, idée qui m’eût fait frissonner avant-hier sur le boulevard de Gand ; j’entre au café Turc : je me dois cela à moi-même, puisque je pars pour Constantinople ; c’est un très-beau café, ma foi. Cependant je ne vous en parlerais pas, malgré son luxe de miroirs, de dorures, de colonnettes et d’arcades, sans une charmante salle à l’entre-sol, décorée de peintures d’artistes exclusivement marseillais : c’est un musée local très-curieux et très-intéressant. Les boiseries sont divisées en panneaux représentant divers sujets abandonnés à la fantaisie du peintre. — Loubon, dont on a admiré à Paris les paysages poudroyants de soleil et les grands troupeaux cheminant sur des terrains de pierre ponce, a fait là son chef-d’œuvre, et un chef-d’œuvre, — une Descente de Bufles par un ravin aux approches d’une ville d’Afrique. La lumière brûle la terre blanche sur laquelle se projette l’ombre bleue des bêtes difformes qui suivent la pente dans des poses de raccourci, se déhanchant, heurtant leurs genoux cagneux, levant leurs mufles baveux et lustrés pour humer l’air torride ; les retardataires sont pressés par l’aiguillon d’un sauvage pasteur hâve et bistré. Au fond, les murs de craie de la ville, se détachant sur un fond de ciel indigo, ferment nettement l’horizon. C’est libre, ferme et franc. Decamps ne ferait pas mieux. M. Brest, qui avait exposé, il y a deux ans, au Salon, un bel intérieur de forêt, a peint deux paysages d’une couleur charmante et d’une délicieuse fantaisie : un étang au milieu d’un bois d’arbres exotiques reflétés par les eaux endormies, sur le bord desquelles stationnent, au haut de leurs longues pattes, des phénicoptères aux ailes roses, guettant le passage d’un poisson ou d’une grenouille. Une allée de parc avec un premier plan d’architecture, un perron à colonnes et à balustres, par où descendent des dames et des seigneurs qu’attendent des chevaux de main tenus par des servants ; — pour rappeler la dénomination du café, M. Lagier a représenté un Turc faisant le kief après avoir fumé l’opium ou le hachich, et voyant danser dans la vapeur bleue une foule de houris infiniment plus séduisantes que celles du Paradis de Mahomet de M. Schopin. Il y a aussi une espèce de Conversation orientale, de M. Reynaud, à costumes éclatants et capricieux, qui se passe devant une muraille blanche à moitié drapée d’un manteau de verdure et de fleurs d’un ton superbe, et des marines d’un artiste dont le nom m’échappe malheureusement, mais qui sont très-remarquables et pourraient se soutenir à côté d’Isabey, de Durand Brager, de Gudin et de Melby. Le nom qui me fuyait en écrivant la ligne précédente me revient maintenant, par une de ces bizarreries de mémoire qu’on ne saurait s’expliquer ; c’est Landais que s’appelle cet habile peintre. N’oublions pas deux paysages de M. Maggy, solides de dessin et robustes de ton, entremêlés d’animaux que ne désavouerait pas Palizzi. Il serait à désirer que cette galerie marseillaise, perdue dans un café, fût lithographiée et publiée. Cet exemple de décoration intelligente devrait bien être suivi à Paris, où l’on abuse un peu trop du luxe bête des glaces, des dorures et des étoffes.
Vous avez lu sans doute les spirituelles plaisanteries de Méry sur l’altération de Marseille et la tristesse des fontaines, qui, à force d’architecture, tâchaient de faire oublier qu’elles manquaient d’eau. Les travaux de détournement de la Durance sont achevés, et chaque bastide s’enorgueillit aujourd’hui d’un bassin et d’un jet d’eau. Il en est qui poussent la fatuité jusqu’à la cascade. Marseille va être entourée bientôt d’une foule de Versailles, de Marly et de Saint-Cloud en miniature ; avant peu, j’en ai bien peur, ces magnifiques terrains calcinés de lumière, ces beaux rochers couleur de liége et de pain grillé seront revêtus de végétation, et le vert-épinard, joie des propriétaires, terreur des paysagistes, fera disparaître cette étincelante aridité.
L’ancre est levée ; les roues frappent l’eau ; nous voilà sortis du port ; on longe des côtes escarpées, décharnées, effritées, pareilles à celles de l’autre côté de la Méditerranée. Je ne sais pas si on l’a remarqué, Marseille et ses environs sont beaucoup plus méridionaux que leur latitude ne semble le comporter. Vous avez là des aspects africains d’une âpreté aussi chaude qu’en Algérie, et la physionomie du Midi s’y dessine d’une façon très-violente. Des contrées situées deux ou trois cents lieues plus au sud ont souvent l’air plus septentrional : ces roches ravinées, dont la base plonge dans une mer du bleu le plus foncé, s’ouvrent quelquefois et laissent apercevoir une ville lointaine, entourée de ses bastides qui tachètent la campagne de leurs mille points blancs.
L’on rencontre çà et là quelques navires aux voiles gonflées, se dirigeant vers le port où ils espèrent arriver avant la nuit ; puis la solitude se fait, les côtes disparaissent dans l’éloignement, la houle du large se fait sentir ; on ne voit plus que le ciel et l’eau. Quelques légers moutons floconnent sur le bleu pâturage de la mer. Un poëte antique y aurait vu les troupeaux de Protée. Le soleil, que n’accompagne aucun nuage, plonge à l’occident comme un boulet rouge et semble fumer en entrant dans l’eau. La nuit arrive, nuit sans lune ; une rosée saline s’abat sur le pont et pénètre les vêtements de son âcre humidité ; les cigares tombent lentement en cendre, aspirés par des lèvres où la nausée se déciderait au premier coup de tangage un peu fort. Les passagers descendent un à un et s’accommodent comme ils peuvent dans les tiroirs qui servent de lit. Pour être bercé par la vague plus régulièrement que jamais enfant ne le fut par sa nourrice, on n’en dort pas mieux, et l’on fait des rêves extravagants entrecoupés par la cloche qui pique l’heure et marque le quart aux matelots.
Dès l’aube on est sur pied ; rien encore que ce cercle de deux ou trois lieues dont le vaisseau est le centre, et qui se déplace avec lui, et qu’on est convenu d’appeler l’immensité de la mer et l’image de l’infini, je ne sais trop pourquoi, car l’horizon qu’on découvre du haut de la moindre tour ou de la montagne la plus ordinaire est cent fois plus vaste.
Il fait jour tout à fait, et sur la gauche le capitaine signale une terre, qui est la Corse. Je ne vois, même avec une lorgnette, qu’une légère brume à peine discernable des pâles teintes du ciel matinal. Le capitaine avait raison. Le bateau marche : la vapeur grisâtre se condense, se raffermit ; des ondulations de montagnes se dessinent, quelques points s’éclairent, des touches jaunes marquent les escarpements dénudés, des plaques noirâtres, les forêts et les endroits recouverts de végétation. Là-bas au nord, vers cette pointe, doit être l’Isola-Rossa ; plus loin, cette blancheur crayeuse qui se confond avec la terre, c’est Ajaccio. Mais on passe trop au large, ce qui me contrarie beaucoup, pour discerner aucun détail. On côtoie ainsi toute la journée à distance cette Corse énergique et sauvage, aux mœurs poétiquement féroces, aux vendettes éternelles, que le progrès rendra bientôt semblable à la banlieue de Paris, à Pantin ou à Batignolles. — Ce serait peut-être ici le lieu de placer un morceau brillant sur Napoléon ; mais j’aime mieux éviter ce lieu commun facile, et je me bornerai à remarquer en passant quelle influence les îles ont eue sur la destinée de ce héros presque fabuleux déjà, et dont nous voyons se former la légende sous nos yeux : une île lui donne naissance ; tombé, il repart d’une île et meurt dans une île, tué par une île ; il sort de la mer et s’y replonge. Quel mythe l’avenir bâtira-t-il là-dessus, lorsque l’histoire fugitive aura disparu pour laisser la place au poëme éternel ? Mais l’on aperçoit les sept moines, écueils formés de roches, ayant en effet l’apparence de capucins encapuchonnés et rangés à la file ; l’on approche du passage étroit qui sépare la Corse de la Sardaigne du côté de Bonifaccio.
Grèce qu’on connaît trop, Sardaigne qu’on ignore.
Un canal extrêmement étroit divise les deux îles, qui visiblement n’ont dû en faire qu’une avant les cataclysmes diluviens et les soulèvements volcaniques ; on voit très-distinctement la rive de chaque pays : ce sont des collines montagneuses assez escarpées, mais sans grand caractère ; quelques rares maisons aux murs jaunes, aux toits de tuiles, parsèment le rivage, qui sans cela semblerait celui d’une île déserte, car on n’y découvre aucune trace de culture ; deux ou trois barques à la voile latine voltigent comme des mouettes d’un bord à l’autre.
Du côté de la Sardaigne, on nous fait remarquer, ce qui est la principale curiosité de l’endroit, une agrégation bizarre de roches sur le sommet d’une colline, qui dessinent très-exactement, par leurs angles et leurs sinuosités, la forme d’un gigantesque ours blanc des mers polaires ; on distingue, sans y mettre la moindre complaisance, comme cela arrive souvent pour ces sortes de prodiges, l’échine, les pattes, la tête allongée de l’animal : le port, l’allure, la couleur, tout y est. A mesure qu’on approche, les profils se perdent, les formes se confondent ou se présentent sous une incidence défavorable. L’ours redevient rocher. Le passage est franchi. L’on suivra dans toute sa longueur la côte de Sardaigne qui fait face à l’Italie, comme dans la journée on a longé la côte de Corse qui regarde vers la France. Malheureusement la nuit vient, et nous serons privés de ce spectacle ; la Sardaigne passera près de nous comme un rêve dans l’ombre. Je ne connais rien au monde de plus contrariant que de traverser de nuit un site qu’on désire voir depuis longtemps. Ces mésaventures arrivent fréquemment, maintenant que le voyageur n’est que l’accessoire du voyage, et que l’homme est soumis comme un objet inerte au moyen de transport.
Au réveil, la mer déserte est d’un bleu dur faisant paraître le ciel pâle. Quelques marsouins jouent dans le sillage du navire, nageant avec une rapidité qui devance la vapeur et semble la défier ; ils se poursuivent, sautent les uns par-dessus les autres et passent dans l’écume de la proue, puis ils restent en arrière et disparaissent après quelques cabrioles. — A la gauche du vaisseau, à quelque distance, se montre un énorme poisson de couleur plombée, armée d’une nageoire dorsale noirâtre et pointue comme un aiguillon. Il plonge et ne reparaît plus : ce sont là, avec l’apparition lointaine de trois ou quatre voiles poursuivant leur route en divers sens, les seuls événements de la journée. Le temps est assez frais ; l’on hisse les voiles de foc et la misaine, qui accélèrent notre marche de quelques nœuds. Le soir, on signale le cap Maritimo, à l’une des pointes de cette île que les anciens nommaient Trinacria, d’après sa forme, et qui s’appelle maintenant la Sicile. Nous passerons encore dans l’obscurité le long de ce rivage antique et pittoresque, mais demain nous serons à Malte de jour.
Vers les deux heures, sous une bande de nuage zébrés, je discerne une strie un peu plus opaque, c’est l’île de Goze. Bientôt la silhouette se découpe plus nettement. D’immenses falaises à pic, au pied desquelles la mer bouillonne tumultueusement, s’élèvent du sein des eaux, comme le sommet d’une montagne noyée à sa base ; on dit que ces grands rochers blancs peuvent se suivre du regard à plusieurs centaines de pieds sous la transparence de l’azur dont ils sont baignés, ce qui produit un effet assez effrayant pour ceux qui les rasent dans une frêle barque, en donnant en quelque sorte l’étiage de l’abîme. Le long de ces escarpements dressés comme des murailles de forteresse, des pêcheurs suspendus à une corde, à la façon des Italiens qui badigeonnent les maisons, jettent des lignes et prennent du poisson. La rupture d’un cordage, un nœud mal fait, les précipiterait brisés au fond du gouffre. — Nous avançons ; des ondulations un peu moins abruptes permettent quelque culture : de petites murailles de pierre, qui de loin ressemblent à des raies tracées à l’encre sur un plan topographique, enclosent et séparent les champs ; les nuages ont disparu, une belle couleur chaude et mordorée revêt les terrains d’un manteau d’or. Un tas de pains de blanc d’Espagne, sur lequel s’arrondissent quelques dômes, poudroie sous un soleil aveuglant au haut d’une colline ou plutôt d’une montagne. C’est Goze, la capitale de l’île. Les curiosités de Goze sont des cavernes creusées au bord de la mer, à l’entrée desquelles tourbillonnent des nuées d’oiseaux aquatiques qui y font leur nid ; un écueil où pousse une espèce de champignon particulière très-estimée, dont les chevaliers de Malte s’étaient réservé le monopole, et la saline de l’Horloger, bizarre phénomène hydraulique, dont voici la briève explication. Un horloger maltais, ayant eu l’idée de pratiquer des salines du côté de Zebug, où il possédait des terres près du rivage, fit creuser la roche pour faire évaporer l’eau salée ; mais la mer, ayant miné en dessous, s’élança par ce puits comme une trombe ou comme un de ces volcans d’eau de l’Islande, à une hauteur de plus de soixante pieds, et faillit noyer tout le pays. On boucha à grand’peine l’ouverture, et de temps en temps le volcan marin fait des essais d’éruption. — Je n’ai pas vu la saline de l’Horloger. Je raconte simplement ce qu’on m’a dit.
Goze et Malte sont situées exactement comme la Corse et la Sardaigne ; une passe étroite les sépare, et dans les temps primitifs elles ne devaient former aussi qu’une seule île. L’aspect des côtes de Malte est semblable à celui des côtes de l’île de Goze : c’est la continuation évidente des mêmes roches, des mêmes terrains, et les stratifications géologiques se poursuivent d’une île à l’autre.
Le climat a beaucoup changé depuis la veille ; le ciel prend des tons d’outremer. Le souffle brûlant de l’Afrique voisine se fait sentir. Malte produit des oranges ; le figuier d’Inde et l’aloès y prospèrent ; l’on commence à apercevoir les fortifications de la cité Valette, que signalent deux moulins à vent en forme de tours avec huit ailes faisant la roue, disposition bizarre et commune à tout l’Orient, et qui mériterait que Hoguet, le Raphaël des moulins à vent, fît le voyage tout exprès, tant les ailes, multipliées comme les rayons d’une roue sans jantes, ont une physionomie originale. L’eau de bleue devient verte par l’approche de la terre ; l’on double la pointe Dragut. Le bateau à vapeur fait un demi-tour et pénètre dans le goulet du port, en passant dans le château Saint-Elme et le fort Ricazoli.
Les fortifications, avec leurs angles précis et leurs arêtes vives, éclairées d’une lumière splendide, se dessinent presque géométralement entre le bleu foncé du ciel et le vert cru de la mer. Les moindres détails du rivage ressortent nettement : à gauche s’élève une pyramide à la mémoire du colonel Cavendish et se découpent les pointes de la cité Victorieuse et du bourg de la Sangle ; à droite, s’étage en amphithéâtre la cité Valette ; le port, qui porte le nom local de Marse, s’enfonce dans les terres par une échancrure bifurquée à son extrémité comme le fond de la mer Rouge ; des navires anglais, sardes, napolitains, grecs, de toutes nations, sont à l’ancre à différentes distances du bord, suivant leur tirant d’eau. Sur le quai, du côté de la cité Valette, l’on distingue des soldats anglais avec l’habit rouge et le pantalon blanc de rigueur, et quelques haquets aux grandes roues écarlates, rappelant les anciens corricoli de Naples ; tout cela se détachant sur des murailles d’une éclatante blancheur. Sans que les positions soient les mêmes, il y a dans ce luxe de fortifications, dans ce type britannique mêlé au type méridional, quelque chose qui fait penser à Gibraltar ; cette idée se présente naturellement à tous ceux qui ont vu ces deux possessions anglaises, clefs qui ouvrent ou ferment la Méditerranée.
On nous a aperçus du rivage. Une flottille de canots se dirige à toutes rames vers le bateau à vapeur ; nous sommes entourés, cernés, envahis, un abordage pacifique à lieu ; le pont se couvre en une minute d’une foule de canailles variées piaillant, criant, hurlant, jargonnant toutes sortes de langues et de dialectes ; on se croirait à Babel le jour de la dispersion des travailleurs. Avant de savoir à quelle nation vous appartenez, ces drôles polyglottes essayent sur vous l’anglais, l’italien, le français, le grec, le turc même, jusqu’à ce qu’ils aient rencontré un idiome dans lequel vous puissiez leur dire intelligiblement : « Vous m’assommez ! allez-vous-en à tous les diables ! » Les domestiques de place, les garçons d’hôtel, vous poursuivent, vous harcèlent, vous assassinent d’offres de service. On vous fourre des cartes dans vos mains, dans votre gilet, dans le gousset de votre pantalon, dans la poche de votre paletot, dans la coiffe de votre chapeau ; les bateliers vous tiraillent à droite et à gauche, par le bras, par le collet de l’habit, par la basque de la redingote, au risque de vous écarteler, détail dont ils se soucient peu ; ils se querellent et se battent à travers vous, vociférant, gesticulant, trépignant, se démenant comme des possédés ; mais, en somme, tant tués que blessés, il n’y a personne de mort, et cette scène de tumulte peut s’appeler, comme la pièce de Shakespeare, « beaucoup de bruit pour rien. » Le vacarme s’apaise, les voyageurs sont distribués en plusieurs lots, et chaque batelier s’empare de sa proie. Aux bateliers et aux domestiques de place se joignent les marchands de cigares, qui en vous offrent des paquets énormes à des prix fabuleusement minimes : il est vrai qu’ils sont exécrables.
Je remarquai parmi cette foule bigarrée des types assez caractéristiques. Des têtes brunes à cheveux noirs lustrés et roulés en courtes spirales, à bouches épaisses, à regards étincelants, d’un type presque africain sur un fond de régularité grecque, se présentaient fréquemment, et me parurent appartenir en propre à la race maltaise. Ces têtes implantées sur des cous nerveux et des bustes solides n’ont pas été reproduites par la peinture, et fourniraient des modèles nouveaux. Quant au costume, il est des plus simples : un pantalon de toile serré aux hanches par une ceinture de laine, une chemise bouffante, un bonnet rouge penché sur l’oreille, ni bas ni souliers.
Pendant que les passagers, pressés de descendre à terre, encombraient l’échelle, je regardais les barques ameutées au flanc du navire comme de petits poissons autour d’une baleine, et j’en notais les particularités de construction et d’ornement. Destinées au service du port, où l’eau est ordinairement tranquille, ces barques n’ont pas de gouvernail, la proue et la poupe sont marquées par une membrure relevée ayant de la ressemblance avec le bec d’une gondole de Venise auquel on n’aurait pas encore adapté cette clef de fer dentelé qui simule un manche de violon ; à la proue s’ouvrent deux yeux grossièrement peints, comme aux chaloupes de Cadix et de Puerto ; à côté de ces yeux, une main, étendant le doigt indicateur, semble désigner la route. Est-ce un symbole de vigilance, un préservatif contre la jettatura et le mauvais œil ? C’est ce que je ne saurais précisément vous dire ; mais ces yeux ainsi placés donnent à ces barques un vague aspect de poisson nageant à fleur d’eau assez étrange. Sur le dossier de la proue sont peintes les armes d’Angleterre, avec le lion et la licorne, leurs supports héraldiques en couleurs crues et violentes, ou bien un féroce hussard fait cabrer un cheval impossible dû à la fantaisie de quelque peintre-vitrier. Des embarcations plus modestes se contentent d’un simple pot de fleurs largement épanouies.
La foule diminue ; j’entre dans un canot, je descends à terre, je passe sous une porte assez obscure. Une rue en escalier se présente à moi : je grimpe au hasard, selon mon habitude de marcher sans guide dans les villes inconnues ; d’après certains instincts topographiques qui me trompent rarement, et, après quelques zigzags, je débouche sur la place du Gouvernement, juste à l’heure où allait sonner la retraite anglaise. Cette retraite mérite une description particulière : les tambours, la grosse caisse, le fifre, se rangèrent silencieusement à un bout de la place ; je n’ai aucune envie de jeter du ridicule sur l’armée anglaise, mais je ne suis pas encore sûr que cette musique ne fût pas empruntée à quelque orgue de Crémone : à un signe du master, les tambours levèrent leurs baguettes, la grosse caisse son tampon, le fifre son turlutu, mais avec un mouvement si sec, si mécanique, si régulièrement pareil, qu’il semblait produit par des ressorts et non par des muscles. Huit jambes de pantalons blancs se relevèrent et retombèrent sur un pas géométrique, et un sauvage ouragan de discordances se déchaîna.
La grosse caisse grognait comme un ours en colère, les tambours sonnaient le fêlé, et le fifre, grimpé à des hauteurs impossibles, battait des trilles extravagants ; mais les musiciens, malgré toute cette furie, n’en gardaient pas moins des figures immobiles, inertes, glacées, sur lesquelles la brise du midi n’avait pu fondre le givre du nord. Arrivés à l’autre extrémité de la place, ils se retournèrent brusquement et refirent le même chemin en émettant le même charivari. — Vous avez sans doute vu de ces jouets d’Allemagne pourvus d’une manivelle qui agace un fil de laiton avec un tuyau de plume et fait sortir d’une guérite un soldat prussien au son d’une aigre petite musique ; le soldat s’avance par une coulisse jusqu’au bout de la boîte, fait volte-face et revient à son point de départ. Grandissez et multipliez ce jouet d’Allemagne, et vous aurez l’idée la plus exacte de la retraite anglaise. Je n’aurais jamais cru que l’homme pût arriver à singer si parfaitement le bois peint. C’est un beau triomphe pour la discipline.
En redescendant vers la mer, je vois flamboyer un reflet de cierges à travers la porte d’une église. J’entre. Des tentures de damas rouge galonné d’or enveloppent les piliers. Sur l’autel tout plaqué d’argent scintillent des soleils de filigrane et de strass. Quelques lampes répandent un mystérieux demi-jour dans les chapelles latérales. Devant une Madone grillée sont pendus des ex voto en cire et en argent ; des tableaux farouches, à la manière de l’Espagnolet ou du Caravage, se discernent vaguement à la lueur des bougies ; il me semble être dans une église d’Espagne, en plein catholicisme convaincu et fervent.
De petits garçons, accroupis par file sur des bancs de bois, psalmodient gutturalement un cantique dont un vieux prêtre leur donne le ton. — Je me retire plus édifié de l’intention que de la musique. La nuit est tombée tout à fait. Des fanaux brillent aux angles des rues devant les images des madones et des saints. Les boutiques de marchands de comestibles et de rafraîchissements sont éclairées par des veilleuses qui chatoient parmi la verdure des étalages comme des vers luisants sous l’herbe. Des femmes encapuchonnées de la faldette montent et descendent les escaliers des rues, rasant mystérieusement les murailles, chauves-souris du crépuscule d’amour. — Je crois, Dieu me pardonne, que je viens d’entendre frissonner les plaques de cuivre d’un tambour de basque ; une main exercée tape sur le ventre d’une guitare en effleurant les cordes du pouce. — Suis-je à Malte (possession anglaise), ou à Grenade, dans l’Antequerula ? Il y avait longtemps que je n’avais entendu racler le jambon en pleine rue, et je commençais à croire, malgré les souvenirs de mes trois voyages d’Espagne, que la chose n’avait lieu que dans les vignettes de romances. Cela m’a rajeuni le cœur de quelques années, et je remonte dans ma barque pour regagner le Léonidas, fredonnant le moins faux qu’il m’est possible le motif que je viens d’entendre. Demain, je reviendrai voir, à la pure lumière du jour, ce que j’ai démêlé dans l’ombre du soir, et je tâcherai de vous donner une idée de la cité Valette, ce siége de l’ordre de Malte, qui a joué un rôle si brillant dans l’histoire, et qui s’est éteint, comme toutes les institutions qui n’ont plus de but, quelque glorieux qu’ait été leur passé.
II MALTE
J’ai retrouvé, à Malte, cette belle lumière d’Espagne dont l’Italie même, avec son ciel si vanté, n’offre qu’un pâle reflet. Il y fait véritablement clair, et ce n’est pas là un de ces crépuscules plus ou moins blafards qu’on décore du nom de jour dans les climats septentrionaux. Le canot me dépose sur le quai, et j’entre dans la cité Valette par la porte Lascaris, Lascaris-gate, comme le dit l’inscription écrite au-dessus de l’arcade. Ce nom grec et ce mot anglais, soudés par un trait d’union, font un effet bizarre. Toute la destinée de Malte est dans ces deux mots ; sous la voûte, au passage comme à la porte du Jugement à Grenade, il y a une chapelle à la Vierge, grillée, au fond de laquelle tremblote une veilleuse, et dont le seuil est obstrué de mendiants, qui, pour la beauté du haillon, ne seraient pas déplacés parmi des gueux de l’Albaycin ; les pays chauds dorent les guenilles et les roussissent à souhait pour la palette des peintres. Par cette porte, va et vient une foule bigarrée et cosmopolite ; des Tunisiens, des Arabes, des Grecs, des Turcs, des Smyrniotes, des Levantins de toutes les échelles dans leur costume national, sans compter les Maltais, les Anglais et les Européens de différents pays.
Je me rappelle un grand nègre enveloppé, pour tout vêtement, d’une couverture de laine où il se drapait majestueusement, coudoyant une jeune femme anglaise d’une mise aussi correcte et aussi strictement britannique que si elle eût foulé le gazon vert d’Hyde-Park ou le trottoir de Piccadilly ; il avait l’air si tranquille, si sûr de lui-même dans sa loque pouilleuse, qu’à coup sûr il n’aurait pas voulu la changer contre le frac tout neuf d’un dandy du boulevard de Gand. Les Orientaux, même des classes inférieures, ont une dignité naturelle surprenante ; il passait là des Turcs dont toute la défroque ne valait pas un aspre et qu’on eût pris pour des princes déguisés. Cette aristocratie leur vient de leur religion, qui leur fait regarder les autres hommes comme des chiens : des haquets peints en rouge fendaient la foule, se croisant avec des voitures bizarres dont les roues sont rejetées très-loin de la caisse toute portée en avant, et qui rappellent un peu, pour la disposition du train, les équipages de Louis XIV dans les paysages de Van der Meulen. Je crois ce genre de voiture particulier à Malte, car je n’en ai pas vu ailleurs. Leur circulation est, du reste, restreinte à quelques rues principales, les autres étant taillées en escaliers ou en rampes abruptes.
En dedans de la porte de Lascaris se trouve un marché très-vivant, très-animé, sous des tentes et des baraques avec chapelets d’oignons, sacs de pois chiches, monceaux de tomates et de concombres, paquets de piments, corbeilles de fruits rouges, et toutes sortes de comestibles pleins de couleur locale, pittoresquement étalés. Une belle fontaine à bassin de marbre surmonté d’un grand Neptune de bronze, s’appuyant sur un trident dans une pose cavalière, et rococo, produit un effet charmant au milieu de ces boutiques. — Parmi les cafés, les cabarets, les gargotes, l’on rencontre çà et là une taverne anglaise, placardée de sa pancarte de porter simple et double, d’old scotish-ale, d’East India pale beer, de gin, de whisky, de brandwine et autres mixtures vitrioliques à l’usage des sujets de la Grande-Bretagne, qui contraste bizarrement avec les limonades, les sirops de cerises et les boissons glacées des vendeurs de sorbets en plein vent. Les policemen, armés d’un court bâton aux armes d’Angleterre, comme ceux de Londres, parcourent d’un pas réglé cette foule méridionale, et y font régner l’ordre. Rien n’est plus sage, sans doute ; mais ces hommes graves, froids, convenables dans toute la force du mot, impassibles représentants de la loi, font un singulier effet entre ce ciel lumineux et cette terre ardente. Leur profil semble fait expressément pour se découper sur les brouillards d’High-Holborn et de Temple-Bar.
La cité Valette, fondée en 1566 par le grand maître dont elle porte le nom, est la capitale de Malte ; la cité de la Sangle, la cité Victorieuse, qui occupent deux pointes de terre de l’autre côté du port de la Marse, avec les faubourgs la Floriana et la Burmola, complètent la ville, entourée de bastions, de remparts, de contrescarpes, de forts et de fortins à rendre tout siége impossible. A chaque pas qu’on fait, on se trouve face à face avec un canon lorsqu’on suit une des rues qui circonscrivent la ville, comme la Strada-Levante ou la Strada-Ponente. Gibraltar lui-même n’est pas plus hérissé de bouches à feu. L’inconvénient de ces ouvrages multipliés est qu’ils embrassent un très-grand rayon et qu’il faudrait, pour les défendre en cas d’attaque, une garnison nombreuse, toujours difficile à entretenir et à renouveler loin de la mère patrie.
Du haut de ces remparts on découvre, à perte de vue, la mer bleue et transparente, gaufrée de moires par la brise et piquée de voiles blanches. Des sentinelles rouges montent la garde de distance en distance ; l’ardeur du soleil est si forte sur ces glacis, qu’une toile, tendue par un châssis et tournant sur un piquet, fait de l’ombre aux soldats, qui, sans cette précaution, rôtiraient sur place.
En montant vers la seconde porte, on trouve une église de style jésuite et rococo, dans le goût des églises de Madrid, qui n’offre rien de curieux à l’intérieur. Cette porte, où l’on arrive par un pont-levis, est surmontée du blason triomphal d’Angleterre, et son fossé, transformé en jardin, est obstrué d’une luxuriante végétation méridionale d’un vert métallique et vernissé : limons, orangers, figuiers, myrtes, cyprès, plantés pêle-mêle dans un désordre touffu et charmant. Au-dessus de l’enceinte, dépassant les terrasses des maisons, s’ouvrent sur le bleu du ciel une suite d’arcades blanches encadrant la promenade de la piazza Regina, située au haut de la ville, et d’où l’on jouit d’une vue magnifique.
La cité Valette, quoique bâtie sur un plan régulier et pour ainsi dire tout d’un bloc, n’en est pas moins pittoresque. La déclivité extrême du terrain compense ce que le tracé exact des rues pourrait avoir de monotone, et la ville escalade par des paliers et des degrés la colline, qu’elle recouvre en amphithéâtre. Les maisons, très-hautes, comme celles de Cadix, pour jouir de la vue de la mer, se terminent en terrasses de pouzzolane. Elles sont toutes en pierre blanche de Malte, une sorte de tuf très-facile à tailler, et avec lequel on peut, sans grands frais, se livrer à des caprices de sculpture et d’ornementation. Ces maisons rectilignes portent admirablement et ont un air de grandeur et de force qu’elles doivent à l’absence de toits, de corniches et d’attique. Elles tranchent nettement en équerre sur l’azur du ciel, que leur blancheur fait paraître plus intense ; mais ce qui leur donne un caractère original, ce sont les balcons en saillie, appliqués sur leurs façades comme des moucharabys arabes ou des miradores espagnols. Ces cages vitrées, garnies de fleurs et d’arbustes, et qui ressemblent à des serres projetées hors de la maison, portent sur des consoles et des modillons en volutes, en créneaux denticulés, en feuillages tordus, en chimères ornementales de la fantaisie la plus variée.
Les balcons rompent heureusement les lignes des façades, et, vus du bout de la rue, présentent les plus heureux profils ; les ombres qu’ils découpent par leurs fortes saillies tranchent à propos sur le ton clair des façades. Les brindilles des pois d’Alger, les étoiles rouges du géranium, les fleurs de porcelaine des plantes grasses, qui débordent de leurs vitrines ouvertes, égayent de leurs vives couleurs le bleu et le blanc, ton local du tableau. C’est dans ces miradores que les femmes de la classe aisée de Malte passent leur vie, guettant le moindre souffle de la brise de mer, ou affaissées sous les énervantes influences du sirocco. On aperçoit de la rue leur bras blanc accoudé, et l’on voit briller le coin de leur noire prunelle, ce qui vous distrait agréablement de vos contemplations architecturales. — Les Maltaises, chose rare parmi les femmes qui se laissent diriger dans leur toilette plutôt par la mode que par le goût, ont eu le bon esprit de conserver leur costume national, du moins dans la rue. Ce vêtement, appelé faldetta, consiste en une espèce de jupon d’une coupe particulière et dont on s’encapuchonne en élargissant ou en rétrécissant l’ouverture, maintenue par une petite baguette de baleine, selon que l’on veut plus ou moins laisser voir son visage.
La faldetta est uniformément noire comme un domino, dont elle a tous les avantages, plus une grâce refusée aux informes sacs de satin qui gazouillent en carnaval au foyer de l’Opéra ; on cache une joue et un œil du côté de la personne dont on veut ne pas être vu, on rejette la faldetta en arrière ou on la remonte jusque sur le nez, suivant les circonstances. C’est le bal masqué transporté en pleine rue. Sous ce capuchon de taffetas noir, assez semblable aux thérèses de nos grand’mères, on porte habituellement une robe rose ou lilas à grands volants. Autant que j’en ai pu juger lorsqu’un souffle propice faisait voltiger le voile mystérieux, les Maltaises se rapprochent du type oriental par leur grand œil arabe, leur teint pâle et leur nez généralement aquilin. Comme je n’ai pas vu un visage complet, mais la prunelle de celui-ci, le nez de celui-là, la joue de tel autre, et pas un seul menton (excepté aux fenêtres, en raccourci plafonnant), car la faldetta les recouvre, je ne porte pas un jugement définitif, et je livre mon observation pour ce qu’elle vaut.
Les Guides du Voyageur et les ouvrages spéciaux de géographie prétendent que les Maltaises ont l’humeur coquette et le cœur faible. Je ne suis pas un don Juan assez transcendental pour m’être assuré par moi-même de la vérité de cette assertion dans un séjour de quelques heures ; mais les maisons ont deux ou trois étages de miradores, les femmes portent uniformément sur la tête un jupon qui est l’équivalent de l’ancien masque vénitien et de la mantille espagnole actuelle, le sirocco souffle trois jours sur quatre, il fait ordinairement vingt-huit degrés de chaleur, on joue de la guitare dans les rues, le soir, et les offices sont très-suivis. Il est d’ailleurs bien difficile d’être puritainement glacial entre la Sicile et l’Afrique. Cette facilité de mœurs est attribuée, toujours par les mêmes livres sérieux, à la corruption des chevaliers de Malte ; mais les pauvres chevaliers dorment depuis maintes années sous leurs tombes de mosaïque, dans l’église de Saint-Jean, et la faute, si faute il y a, est tout entière au soleil. Tout ce que je puis dire, c’est qu’elles m’ont paru très-piquantes ainsi fagotées et mettant le nez à la fenêtre par l’ouverture de cette jupe.
En courant au hasard, je rencontre des coins de rue charmants et qui feraient le bonheur d’un aquarelliste. Les balcons enveloppent l’angle et forment plusieurs étages de tourelles ou de galeries, suivant leur dimension. Une madone ou un saint de grandeur naturelle, la tête sous un baldaquin de pierre, les pieds sur un énorme socle en gaîne à volutes tirebouchonnées, se présentent inopinément à l’adoration des personnes pieuses et au crayon des faiseurs de croquis ; de grandes lanternes, soutenues par des potences de serrurerie compliquée, éclairent ces dévotes images et fournissent de jolis motifs de dessin. Je ne m’attendais pas à trouver des carrefours si catholiques dans la Malte anglaise. Au bas de la plupart de ces statues sont écrites, sur des cartouches contournés, des inscriptions du genre de celle-ci : « Mgr Fernando Mattei, évêque de Malte, ou Son Excellence révérendissime don F. Saverio, accorde quarante jours d’indulgence à tous ceux qui diront un Pater, un Ave et un Gloria devant les images de la très-sainte Vierge ou de saint François Borgia, posées là par leurs soins. » Puisque j’ai parlé de sculpture sacrée, je placerai ici un détail assez bizarre que j’ai remarqué sur le portail d’une église.
Ce sont des têtes de mort cravatées d’ailes de papillon. Cet hiéroglyphe, funèbrement pompadour, de la brièveté de la vie m’a paru associer d’une façon neuve les emblèmes du boudoir aux ornements de la tombe. On ne saurait être plus galamment sépulcral, et l’idée a dû être caressée par un joli petit abbé de cour. Si le sens de ce rébus funèbre a été clair pour moi, il n’en a pas été de même d’un petit bas-relief que j’ai vu au-dessus de la porte de plusieurs maisons, et qui représente, avec de légères variantes, une femme nue plongée dans les flammes jusqu’à la ceinture, et levant les bras au ciel. Une banderole porte ce mot gravé : Valletta. Un Maltais, que je consulte, m’explique que la rente des maisons ainsi désignées revient à la confrérie des âmes du Purgatoire après la mort de leurs propriétaires, pour lesquels on dit des prières et des messes. Cette femme nue symbolise l’âme.
Le palais des grands maîtres, aujourd’hui palais du gouvernement, n’a rien de bien remarquable comme architecture. Sa date est récente, et il ne répond pas à l’idée qu’on se fait de la demeure des Villiers de l’Ile-Adam, des Lavalette et de leurs successeurs. Cependant il a une prestance assez monumentale et produit un bel effet sur cette grande place, dont il occupe un des pans. Deux portes à colonnes rustiques rompent l’uniformité de cette longue façade ; un immense miradore, faisant galerie intérieure, et porté par de fortes consoles sculptées, circule à la hauteur du premier étage à peu près, et donne à l’édifice le cachet de Malte. Ce détail tout local relève ce que cette architecture pourrait avoir de plat. Ce palais, vulgaire dans sa magnificence, devient ainsi original. — L’intérieur, que j’ai visité, offre une suite de vastes salles et de galeries renfermant des peintures représentant des batailles de terre et de mer, des siéges, des abordages de galères turques et de galères de la Religion (c’est ainsi que l’on appelle collectivement l’ordre de Saint-Jean), de Matteo da Lecce. — Il y a aussi des tableaux du Trevisan, de l’Espagnolet, du Guide, du Calabrèse et de Michel-Ange de Caravage.
Le cicerone vous fait promener dans de grands appartements aux planchers couverts de nattes fines, aux colonnes de stuc ou de marbre, aux tapisseries de haute lisse d’après Martin de Voos ou Jouvenet, aux plafonds de bois losangés ou quadrillés, accommodés, avec plus ou moins de goût, à la destination actuelle : les blasons et les portraits des grands maîtres rappellent çà et là les anciens habitants de ce palais chevaleresque, devenu résidence anglaise ; j’ai été surpris de trouver là un portrait de Lawrence, un Georges III ou IV, tout de satin blanc et d’écarlate, faisant face à un Louis XVI assez bien peint, quoique moins miroité de reflets nacrés que le monarque anglais. Une des plus énormes salles, lorsque je passai à Malte, était disposée en salle de bal, et à l’une des colonnes pendait la carte imprimée des valses, des polkas et des quadrilles ; ce détail, bien naturel pourtant, nous fit sourire ; il égayerait les ombres des jeunes chevaliers s’il leur plaisait de revenir la nuit dans leur ancienne demeure : les vieux rébarbatifs s’en offenseraient seuls, car ces moines soldats menaient assez joyeuse vie, et leurs auberges ressemblaient plus à des casernes qu’à des monastères. Le trône d’Angleterre, avec son dais, ses armoiries et ses lambrequins, s’élève orgueilleusement à la place du fauteuil qu’occupait le grand maître de l’ordre, et les portraits en lithographie coloriée de la nombreuse progéniture du prince Albert et de la reine Victoria, ainsi que cela doit être chez tout loyal sujet, sont appendus aux murailles étonnées de cet asile du célibat.
J’aurais désiré visiter le musée des armures, toucher ces casques rayés par les lames de Damas, ces cuirasses bosselées par la pierre des catapultes, et sous lesquelles ont battu tant de nobles cœurs : ces boucliers blasonnés de la croix de l’ordre, et où s’implantaient en tremblant les flèches sarrasines ; mais, après une heure d’attente et de recherche, on me dit que le gardien était allé à la campagne et avait emporté les clefs avec lui. A cette réponse superbe, je me crus encore en Espagne, où, assis devant la porte d’un monument quelconque, j’attendais que le concierge eût fini sa sieste et voulût bien m’ouvrir. Il fallut donc renoncer à voir ces héroïques ferrailles et diriger ma course ailleurs.
Pour en finir avec les chevaliers, je me dirigeai vers l’église Saint-Jean, qui est comme le Panthéon de l’ordre. La façade, à fronton triangulaire, flanquée de deux tours terminées par des clochetons de pierre, n’ayant pour tout ornement que quatre piliers couplés et superposés, et percée d’une fenêtre et d’une porte sans sculpture et sans arabesque, ne prépare pas le voyageur aux magnificences du dedans. La première chose qui arrête la vue, c’est une immense voûte peinte à fresque qui tient toute la longueur de la nef ; cette fresque, malheureusement détériorée par le temps, ou plutôt par la mauvaise qualité de l’enduit, est de Mattias Preti, dit le Calabrèse, un de ces grands maîtres secondaires qui, s’ils ont moins de génie, ont quelquefois plus de talent que les princes de l’art. Ce qu’il y a de science, d’habileté, d’esprit, d’abondance et de ressources dans cette colossale peinture, dont on parle à peine, est vraiment inimaginable.
Chaque division de la voûte renferme un sujet de la vie de saint Jean, à qui l’église est dédiée, et qui était le patron de l’ordre. Ces divisions sont soutenues, à leurs retombées, par des groupes de captifs, Sarrasins, Turcs, chrétiens ou autres, demi-nus ou couverts de quelque reste d’armure brisée, dans des poses humiliées et contraintes, espèces de cariatides barbares bien appropriées au sujet. Toute cette partie de la fresque est pleine de caractère et de ragoût, et brille par une force de couleur rare dans ce genre de peinture. Ces tons solides font valoir les tons légers de la voûte, et font fuir les ciels à une grande profondeur. Je ne connais d’aussi grande machine que le plafond de Fumiani, dans l’église de Saint-Pantaléon, à Venise, représentant la vie, le martyre et l’apothéose du saint de ce nom. Mais le goût de la décadence se fait moins sentir dans l’œuvre du Calabrais que dans celle du Vénitien. Si l’on veut connaître à fond l’élève du Guerchin, c’est à Malte, à l’église Saint-Jean, qu’il faut venir. En récompense de cette œuvre gigantesque, Mattias Preti eut l’honneur d’être reçu chevalier de l’ordre, comme le Caravage.
Le pavé de l’église se compose de quatre cents tombes de chevaliers, incrustées de jaspe, de porphyre, de vert antique, de brèches de toutes couleurs, qui doivent former la plus splendide mosaïque funèbre ; je dis doivent, car, au moment de ma visite, elles étaient recouvertes par ces immenses nattes de sparterie dont on tapisse les églises méridionales ; usage qui s’explique par l’absence de chaises et l’habitude de s’agenouiller par terre pour faire ses dévotions. Je le regrettai vivement ; mais les chapelles et la crypte contiennent assez de richesses sépulcrales pour vous dédommager. Ces chapelles, extrêmement ornées d’arabesque, de volutes, de rinceaux et de ramages de sculpture entremêlés de croix, de blasons, de fleurs de lis, le tout doré en or de ducat, surprennent par leurs richesses ceux qui ne connaissent que les églises de France, d’une nudité si sévère et d’une mélancolie si romantique. Cette profusion d’ornements, ces dorures, ces marbres variés, semblent à des Français convenir plutôt à la décoration d’un palais ou d’une salle de bal, car notre catholicisme est un peu protestant.
Le tombeau de Nicolas Cotoner, un des grands maîtres qui ont le plus contribué à la splendeur de l’ordre, et qui ont dépensé leur fortune particulière à doter Malte de monuments utiles ou luxueux, n’est pas d’un très-bon goût, mais il est riche et composé de matières précieuses. Il consiste en une pyramide appliquée au mur, que surmonte une boule croisetée qu’accompagnent une Renommée sonnant de la trompette et un petit génie tenant le blason des Cotoner. Le buste du grand maître occupe le bas de la pyramide au centre d’un trophée de casques, de canons, de mortiers, de drapeaux, de boucliers, de haches d’abordage et de piques. Deux esclaves agenouillés, les bras liés derrière le dos, et dont l’un se retourne avec un air de révolte, supportent la plinthe et forment le piédestal. J’ai décrit ce tombeau en détail, car il est comme le type des autres, où les emblèmes de la foi se mêlent aux symboles de la guerre, comme il convient à un ordre à la fois militaire et religieux. Il faut jeter aussi un coup d’œil sur le mausolée du grand maître Rohan, très-magnifique et très-coquet, et sur celui de don Ramon de Perillas, grand maître espagnol, dont les armes parlantes sont entremêlées de croix et de poires.
J’ai regardé toutes ces tombes sans autre impression que la tristesse respectueuse que donne toujours à un être vivant et pensant la pierre derrière laquelle est caché un être qui a vécu et pensé comme lui. Mais quelle n’a pas été mon émotion en rencontrant au détour d’une arcade un marbre signé Pradier, avec ces caractères demi-grecs, demi-français, et ce sigma hétéroclite auquel il voulait à toute force donner la valeur d’un epsilon ! Les dernières lignes que j’avais écrites en France, deux heures avant mon départ, déploraient la mort subite de cet artiste aimé, qui pouvait encore faire tant de chefs-d’œuvre. Je retrouvais inopinément à Malte une de ses statues les plus gracieusement mélancoliques, où il avait su conserver dans la mort tout le charme de la jeunesse, celle de l’infortuné comte de Beaujolais, que l’on a tant admirée au Salon, il y a une dizaine d’années. Le mort récent m’était rappelé par un tombeau déjà ancien, si les tombeaux ont un âge et si la pyramide de Chéops est plus vieille que la fosse fermée d’hier au Père-Lachaise. Heureux cependant celui qui lègue son nom à la plus dure matière qui soit, et s’assure par de belles œuvres l’immortalité relative dont l’homme peut disposer !
Une chapelle souterraine, assez négligée, renferme les sépultures de Villiers de l’Ile-Adam, de la Valette et d’autres grands maîtres couchés dans leurs armures sur des cippes armoriées, soutenues par des lions, des oiseaux et des chimères ; les uns en bronze, les autres en marbre ou en quelque autre matière précieuse. Cette crypte n’a rien de mystérieux ni de funèbre. La lumière des pays chauds est trop vive pour se prêter aux effets de clair-obscur des cathédrales gothiques.
Avant de quitter l’église, n’oublions pas de mentionner un groupe de Saint Jean baptisant le Christ, du sculpteur maltais Gaffan, placé sur le maître-autel, plein de talent, quoique un peu maniéré, et un tableau d’une férocité superbe, de Michel-Ange de Carravage, ayant pour sujet la décollation du même saint. A travers la poussière de l’abandon et la fumée du temps, on démêle des morceaux d’un réalisme surprenant, des cambrures truculentes et un faire d’une énergie extraordinaire.
L’heure s’avance, et le bateau à vapeur n’attend pas les retardataires. Parcourons encore une fois la rue de Saint-Jean et de Sainte-Ursule la pittoresque, avec leurs paliers étagés, leurs balcons saillants, les boutiques qui les bordent, la foule qui monte et descend perpétuellement leurs escaliers, la Strada-Stretta, qui avait autrefois le privilége de servir de terrain aux duellistes de l’ordre, sans qu’on pût les inquiéter ; jetons un coup d’œil, du haut des remparts, sur cette campagne fauve, divisée par des murs de pierre, sans ombre et sans végétation, dévorée par un âpre soleil ; regardons la mer du haut de la piazza Régina, émaillée de tombeaux anglais ; traversons en canot la Marse, parcourons la grande rue de la Sangle, et remontons à bord avec le regret de ne pouvoir emporter une paire de ces jolis vases en pierre de Malte, que les habitants taillent au couteau de la façon la plus ingénieuse et la plus élégante.
Il est quatre heures et demie, et le bateau lève l’ancre à cinq heures. — Un divertissement tout à fait local nous est réservé comme bouquet de notre trop court séjour à Malte. De petites barques nous entourent chargées de gamins tout nus. Les Maltais nagent comme les canards au sortir de l’œuf, et sont excellents plongeurs. — On jetait du haut du bord une pièce d’argent à la mer ; l’eau est si limpide dans le port, qu’on la voyait descendre jusqu’à une vingtaine de pieds de profondeur. Les gamins guettaient la chute de la monnaie, plongeaient aussitôt après elle et la rattrapaient trois fois sur quatre, exercice non moins favorable à leur santé qu’à leur bourse. Vous m’excuserez de ne pas vous parler des catacombes, de la colline Bengemma, des restes du temple d’Hercule, de la grotte de Calypso, car les savants prétendent que Malte est l’Ogygie d’Homère : je n’ai pas eu le temps de les voir, et ce n’est pas la peine de copier ce que d’autres en ont dit.
Demain, dans la matinée, nous apercevrons les rivages de Grèce. Je ne suis pas un classique forcené, tant s’en faut, cependant cette idée me trouble. On éprouve toujours quelque appréhension à voir se formuler dans la réalité une terre entrevue dès l’enfance à travers la brume des rêves poétiques.
III SYRA
Demain, dans la journée, nous serons en vue du cap Matapan, nom barbare qui cache l’harmonie de l’ancien nom, comme une couche de chaux empâte une fine sculpture. Le cap Ténare est l’extrême pointe de cette feuille de mûrier aux profondes découpures étalée sur la mer qu’on nomme aujourd’hui la Morée et qui s’appelait autrefois le Péloponèse. Tous les passagers étaient debout sur le pont, regardant à l’horizon, dans le sens indiqué, trois ou quatre heures avant qu’il fût possible de rien distinguer. Ce nom magique de Grèce fait travailler les imaginations les plus inertes ; les bourgeois les plus étrangers aux idées d’art s’émeuvent eux-mêmes et se ressouviennent du dictionnaire de Chompré. — Enfin, une ligne violette se dessina faiblement au-dessus des flots : — c’était la Grèce ; une montagne sortit sa hanche de l’eau, comme une nymphe qui se repose sur le sable après le bain, belle, pure, élégante, digne de cette terre sculpturale. « Quelle est cette montagne ? demandai-je au capitaine. — Le Taygète, » me répondit-il avec bonhomie, comme s’il eût dit Montmartre. A ce nom de Taygète, un fragment de vers des Georgiques me jaillit instantanément de la mémoire :
… Virginibus bacchata Lacænis
Taygeta !
et se mit à voltiger sur mes lèvres comme un refrain monotone, mais qui suffisait à ma pensée. Que peut-on dire de mieux à une montagne grecque qu’un vers de Virgile ? — Quoiqu’on fût au milieu du mois de juin et qu’il fît assez chaud, le sommet de la montagne était argenté de lames de neige, et je songeais aux pieds roses de ces belles filles de Laconie qui parcouraient en bacchantes le Taygète, et laissaient leur empreinte charmante sur les sentiers blancs !
Le cap Matapan s’avance entre deux golfes profonds, qu’il divise de son arête : le golfe de Coron et celui de Kolokythia ; c’est une pointe de terre aride et décharnée, comme toutes les côtes de Grèce. Quand on l’a dépassé, on vous montre, sur la droite, un bloc de rochers fauves, fendillés de sécheresse, calcinés de chaleur, sans l’apparence de verdure ou même de terre végétale : c’est Cerigo, l’ancienne Cythère, l’île des myrtes et des roses, le séjour aimé de Vénus, dont le nom résume les rêves de volupté. Qu’eût dit Watteau avec son embarquement pour Cythère tout bleu et tout rose, en face de cet âpre rivage de roche effritée, découpant ses contours sévères sous un soleil sans ombre et pouvant offrir une caverne à la pénitence des anachorètes, mais non un bocage aux caresses des amants : Gérard de Nerval a du moins eu l’agrément de voir sur la rive de Cythère un pendu enveloppé de toile cirée, ce qui prouve une justice soigneuse et confortable. Le Léonidas passait trop loin de terre pour que ses passagers pussent jouir d’un détail si gracieux, quand même toutes les potences de l’île eussent été garnies en ce moment.