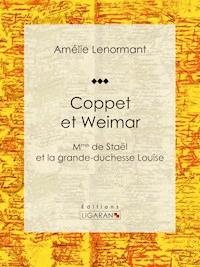
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Il est dans l'histoire des peuples certaines époques brillantes où le génie et les talents abondent et où, dans tous les genres à la fois, les facultés de l'homme semblent atteindre leur plus complet développement. Cette glorieuse littéraire a commencé pour l'Allemagne vers la fin du XVIIIe siècle, et a duré jusqu'à la première moitié du XIXe."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335076356
©Ligaran 2015
Les Anglais ont toujours excellé à mettre en commun leurs intérêts. De là résulte chez eux ce puissant esprit d’association qui leur assure le commerce du monde ; bien plus, ils doivent à cette disposition de leur caractère les libertés dont ils sont fiers à si juste titre.
La seule chose que les Français aient de tout temps aimé à mettre en commun, c’est leur esprit. Le besoin impérieux de causer, l’amour du dialogue, la faculté d’échanger ses pensées en paroles rapides, a été jusqu’ici un des traits de notre caractère national.
Cet esprit de sociabilité avait créé chez nous une véritable puissance, celle des salons ; et l’on est fondé à dire qu’en France les salons ont souvent exercé une réelle influence sur le gouvernement, lui ont quelquefois résisté, et dans le siècle dernier, maîtres absolus d’une société généreuse et frivole, ont puissamment contribué à changer notre état social.
Le philosophe Ballanche, étudiant les transformations successives des sociétés humaines, a dit : L’initié tue toujours l’initiateur. Cet axiome a été une vérité quant à ce qui concerne la prépondérance des salons ; ils ont fait ou aidé à faire la Révolution, la Révolution les a détruits.
S’il est en effet, pour parler le langage actuel, un fait accompli, c’est bien celui de la disparition parmi nous de cette forme de l’esprit de société qui si longtemps a distingué la France et qui, en nous donnant le besoin, que dis-je ! la passion de la conversation, en avait si fort développé le talent.
Les salons où l’on causait se sont successivement fermés. On se réunit encore, on donne des fêtes splendides ; on ne cause plus.
Un volume ne suffirait pas à déduire toutes les raisons de ce changement survenu dans les mœurs et les goûts de la nation française. Il n’est, au reste, qu’une conséquence toute naturelle de la transformation de notre état social ; et si jamais un écrivain de talent était pris de la fantaisie de nous raconter l’histoire des salons, puissance civilisatrice et politique, ce ne serait ni la moins piquante, ni la moins curieuse étude parmi celles que l’on peut faire des grandeurs déchues.
Ce qui est certain, c’est que la conversation ne saurait avoir tout l’agrément, tout le charme, tout l’éclat dont elle est susceptible, que dans un cercle relativement restreint et par là même exclusif, où chacun se connaît ; entre gens dont les pensées ne sont point absorbées par des affaires ou des intérêts matériels ; en un mot, le loisir est nécessaire pour goûter les plaisirs de l’esprit. Et qui donc, en l’an de grâce 1861, est dégagé des préoccupations d’affaires ou des soucis d’intérêts ? Qui donc a du loisir ?
D’ailleurs, les fortunes en France sont devenues si mobiles, les richesses y changent si souvent de mains, que notre société ne se compose plus guère que de parvenus. Et les familles mêmes chez lesquelles une longue suite d’héritages ont perpétué les grands biens, en présence de toutes les révolutions qui pouvaient les leur faire perdre, ont pris comme une teinte des travers des enrichis.
De là ce luxe effréné, grand obstacle à l’agrément de la société, car on reçoit, le plus souvent, pour faire montre de ses magnificences et non point pour s’amuser ou pour plaire. Et remarquez que l’élégance des mœurs a perdu tout ce que le luxe a gagné. Non que nous voulions proscrire le luxe ou la magnificence extérieure, surtout s’ils consistent à s’entourer des chefs-d’œuvre des arts ; mais ce n’est là que le cadre de l’élégance des mœurs, ce n’est point ce qui la constitue : on n’y arrive pas d’un bond, et les plus heureuses spéculations de Bourse ne la donnent point. Elle est le résultat de l’éducation, des traditions, de la délicatesse du langage, de l’urbanité des manières ; elle suppose l’élévation des sentiments, quoiqu’elle s’en soit quelquefois passée.
Dans ces soupers où Mme Scarron suppléait au rôti par une anecdote finement racontée, la bonne chère ne comptait pour rien ; autre était l’attrait qui groupait dans le salon d’un pauvre infirme tout ce que la cour de Louis XIV avait de plus brillant et de plus aimable. Nous ne parlerons pas des soupers de Mme du Deffant, car elle était gourmande et devait avoir un bon cuisinier ; mais ce qui faisait affluer chez elle, malgré sa cécité, la compagnie la plus illustre et la plus lettrée du siècle, c’était sa conversation à la fois piquante et sensée.
Et quand Mlle de Lespinasse, élevant autel contre autel, quitta Mme du Deffant et voulut avoir son salon, elle ne possédait ni beauté, ni fortune, ni naissance ; mais elle avait un esprit supérieur, et cela suffit pour donner au salon qu’elle ouvrait l’importance d’un cercle d’élite où les grands seigneurs coudoyaient les beaux esprits.
Rien de semblable serait-il possible aujourd’hui ? Dieu nous garde cependant de dire ou de penser qu’il y ait en France moins d’esprit sous le nouveau que sous l’ancien régime. Il se produit autrement, c’est tout ce que nous voulons établir. Depuis que la prodigieuse multiplicité des journaux a donné à l’esprit une valeur commerciale, aucun homme doué d’une intelligence vive et d’un certain éclat dans le langage ne consent à mettre dans la circulation, gratis et en restant anonyme, les idées neuves, les fines plaisanteries, les aperçus ingénieux qui lui viennent à l’esprit ; il fait ce que Mme de Genlis avouait ingénument qu’elle pratiquait pour sa correspondance : s’il lui arrive une idée piquante, un tour heureux, il les met en réserve afin de les employer dans un de ses plus prochains articles de journal ou de revue.
C’est autant d’enlevé à la conversation.
Enfin, l’importation la plus fatale à l’esprit de société et l’une des choses qui ont certainement beaucoup contribué à faire disparaître le goût et ce que nous appellerons l’art de la conversation en France, ce sont les cercles. À l’heure qu’il est, l’habitude du cigare aidant, toute la jeunesse préfère mille fois le sans-gêne d’une réunion d’hommes à la compagnie des honnêtes femmes, même les plus jeunes et les plus jolies ; et certes, ce sont là de mauvaises écoles de bonne grâce et de savoir-vivre.
Nos voisins d’outre-Manche, auxquels nous aurions pu emprunter mieux que cette manie des clubs, ont l’humeur taciturne ; le besoin d’expansion leur est pour ainsi dire inconnu. Les conceptions de leurs poètes brillent par la force et l’audace ; mais, sauf quelques ravissantes créations, le génie qui les anime est rude. Le lien conjugal en Angleterre est entouré d’une admirable auréole de tendresse et de respect ; mais en dehors de la vie à deux, en tirant un Anglais de cet Éden, il n’existe entre lui et le reste des hommes que des rapports assez froids. L’intimité dans les relations de famille est fort rare en Angleterre ; ces belles et profondes amitiés communes chez nous, et qui lient indissolublement les âmes, y sont presque sans exemple ; aussi les Anglais n’ont-ils eu de salons qu’à une seule époque. Ce ne fut chez eux qu’une mode passagère apportée de France et qui coïncida avec un grand relâchement de mœurs et une profonde corruption morale. C’est sous le règne de Charles II, au milieu de cette cour galante dans laquelle on aurait eu peine à trouver une femme chaste et un gentilhomme honorable, que le goût de la conversation et l’habitude des réunions brillantes, mais peu nombreuses, présentent chez nos voisins quelque chose d’analogue à nos salons. Depuis cette époque, la bonne compagnie anglaise, quand elle sort du sanctuaire domestique, ne connaît guère que des assemblées immenses, qui ressemblent fort à des cohues. L’esprit n’a rien à voir dans de telles fêtes.
Mais il est temps de nous résumer sur une question et un sujet que le nom de Mme de Staël faisait naturellement apparaître à nos yeux, car cette femme illustre personnifie en quelque sorte l’éloquence de la conversation dans le pays où ce don brillant devait être le plus vivement apprécié.
Aussi bien peut-on dire que la vie des salons et la conversation deviennent impossibles aux époques où de grandes questions sociales, politiques ou religieuses, après avoir divisé la société en plusieurs camps ennemis et irréconciliables, se traduisent en émeutes dans la rue.
Un homme d’esprit disait : « Il ne peut y avoir de discussion qu’entre gens de même avis. » Rien de plus vrai que ce mot dont la forme paradoxale étonne au premier abord. La discussion n’existe réellement, elle n’est utile et ne peut faire naître la conviction que lorsqu’elle porte sur des nuances et non sur les fondements mêmes de tous les principes et de toutes les idées. Autrement il n’y a ni conversation, ni discussion ; il n’y a qu’un duel de paroles où chacun cherche à blesser son adversaire sans s’inquiéter de demeurer dans les limites de l’urbanité ; où les amours-propres s’aigrissent, et où, bien loin de se convaincre, on s’affermit de plus en plus par la lutte dans ses propres opinions. Voilà pourquoi les grandes époques de la conversation en France ont été celles où la société, poussée par un besoin instinctif de réformes, se sentait entraînée vers un but encore enveloppé dans les nuages de l’inconnu sur lequel tout le monde croyait être d’accord ; époques où l’on prenait encore pour des nuances d’une même opinion les divergences destinées plus tard à devenir des séparations marquées par des abîmes infranchissables.
Au XVIe siècle, dans ce temps qui offre avec le nôtre de si remarquables analogies, il y eut certainement à l’aurore de la Renaissance française, autour de François Ier, de la reine Marguerite de Navarre, de Henri II et de Catherine de Médicis, de véritables salons où les beaux esprits du moment se livraient aux tournois de la parole, absolument comme on l’a fait dans le XVIIe et dans le XVIIIe siècle. Brantôme nous a laissé le tableau des réunions qui se tenaient chaque jour chez Catherine de Médicis, dans les belles et encore paisibles années qui précédèrent l’édit d’Écouen. « Là, dit-il, il y avoit une foule de déesses humaines les unes plus belles que les autres ; chaque seigneur et gentilhomme entretenoit celle qu’il aimoit la mieux, tandis que le Roy (Henri II) entretenoit la Reyne, madame sa sœur, la Reyne Dauphine (Marie Stuart) et les princesses avec ces seigneurs et princes qui étoient assis près de lui. »
C’est que le mouvement qui aboutit à la réformation agitait alors toutes les intelligences, que son véritable caractère et ses conséquences n’apparaissaient bien distincts aux yeux de personne, et que ceux-là mêmes qui demeurèrent les plus fidèles aux principes de l’ancienne monarchie et à la vieille foi catholique se sentaient intérieurement travaillés par une aspiration vague de réforme et de rénovation. Mais avec le règne de François II tout changea. La conspiration d’Amboise fit passer le mouvement des idées du domaine de la spéculation pure dans celui des faits ; dès lors la vie des salons devint impossible ; la division des esprits était trop profonde. Ce ne fut plus sous les regards des femmes et dans des conversations élégantes et polies, mais sur les champs de bataille, sous le buffle et la cuirasse du soldat, que se débattirent les grandes questions de l’avenir ; et pour les hommes qui, n’adoptant pas la vie des camps, continuèrent à se servir de la parole et de la plume, emportés par la passion du moment, ils devinrent de trop mortels ennemis pour pouvoir se rencontrer et discourir courtoisement ensemble comme par le passé ; les pacifiques instruments de leurs études se changèrent entre leurs mains en armes plus redoutables que l’épée. Le pamphlet, l’invective véhémente et la prédication politique remplacèrent la conversation.
Ainsi arriva-t-il dans les années qui précédèrent la Révolution française. La conversation fleurit et régna en souveraine aussi longtemps que les tendances vers une réforme de la société et de la constitution du pays se maintinrent dans le domaine de la théorie ; mais aussitôt que ces questions d’équilibre et d’ordre social vinrent à passer dans le domaine des faits, on ne tarda pas à revoir le spectacle qui s’était déjà produit au temps de la Renaissance.
Il ne fut même pas besoin que la proscription se fût étendue à toutes les sommités de la société et que l’échafaud se dressât en permanence sur la place de la Révolution. Le premier sang versé, dès 1789, rompit la digue de ce fleuve terrible qui divise la France en deux camps depuis trop longtemps hostiles et irréconciliables.
Il va sans dire que les salons disparurent dans la tempête. Le témoignage de tous les contemporains de la fin du XVIIIe siècle a proclamé le charme incomparable, l’intérêt puissant, l’exubérance de vie qui animaient les cercles de cette époque : alors que, gardant encore le langage, les formes et la grâce de l’ancien régime, des esprits enthousiastes et généreux soulevaient hardiment les questions les plus essentielles et discutaient les conditions d’une nouvelle ère sociale.
Quand l’ordre et la sécurité essayèrent de renaître après l’orage qui avait tout renversé en France, les personnes élevées dans l’époque antérieure, chez lesquelles s’étaient conservés le besoin et le goût de la conversation, se trouvèrent singulièrement isolées au sein de générations nouvelles qui ne concevaient même plus qu’imparfaitement l’idée des salons d’autrefois. Une femme entre les autres fut naturellement appelée à servir de centre à tous ces éléments épars de l’ancienne société. Mme de Staël appartenait, par ses relations, le rang de son mari, le rôle important qu’avait joué son père, au monde de l’aristocratie, en même temps que le libéralisme très avoué et l’ardeur de ses convictions politiques lui faisaient faire cause commune avec la France nouvelle. Elle eut bientôt groupé autour d’elle les hommes éminents des divers partis, et son salon ne tarda pas à acquérir une véritable importance.
Napoléon, que l’instinct de son ambition éclairait sur tout ce qui pouvait faire obstacle à son élévation ou gêner sa puissance, proscrivit impitoyablement ce salon qui l’importunait, comme un censeur chagrin et incorruptible. Enfin l’espèce d’empire qu’une éclatante beauté assurait à une femme d’un caractère inoffensif, mais indépendant, inspira la même défiance et la même rigueur pour Mme Récamier : l’exil lui fut infligé comme à Mme de Staël. Si ces deux personnes célèbres furent les derniers modèles de la grâce et de la séduction de l’esprit français, elles furent aussi les plus éclatantes victimes de la persécution dont un pouvoir absolu et jaloux devait poursuivre l’influence des salons.
Mme de Staël n’a pas été seulement un écrivain et un penseur du premier ordre ; chez elle les qualités morales se montrent au niveau du talent, et ce talent lui-même n’a été que l’expression de sentiments et de convictions toujours ardentes et sincères. Aussi la lecture des écrits qui gardent l’empreinte vive de cette nature élevée et originale inspire-t-elle le désir de pénétrer plus avant ; après avoir admiré l’auteur, on désire connaître mieux la personne.
Si quelque chose peut aider à se former l’idée vraie d’un caractère, s’il est un moyen d’apprécier la grandeur morale ou les faiblesses d’un personnage célèbre, assurément c’est dans sa correspondance qu’il faut le chercher.
Mme de Staël a ouvert avec tant de franchise et de bonne foi, aux personnes qu’elle honorait de son amitié, le fond même de son âme ; la disposition de son caractère la portait à exprimer avec un tel abandon ses vives et souvent mobiles impressions, que plus qu’aucune autre elle se peint dans sa correspondance. Nous croyons que l’intérêt et le respect qu’inspire la mémoire de cette femme célèbre gagneront à la lumière que ses lettres à la Grande-Duchesse de Saxe-Weimar répandent sur son caractère. Les circonstances qui les ont inspirées, l’importance du personnage à qui elles sont adressées, leur donnent un intérêt en quelque sorte historique.
Mais on ne saurait porter un jugement équitable sans tenir compte du milieu dans lequel est née la personne que l’on veut apprécier. En effet, les hommes qu’une individualité puissante parvient à soustraire complètement à l’influence de leur temps sont de fort rares exceptions. La fille de M. Necker, malgré l’énergie et l’originalité de sa nature, reçut une forte empreinte du monde philosophique qui entoura sa jeunesse. Cependant le scepticisme de cette philosophie sèche et railleuse répugnait invinciblement à l’ardeur et à la loyauté de son âme, et chez Mme de Staël toutes les convictions prirent, au contraire, l’intensité et l’ardeur de la foi.
D’ailleurs, la société élégante, incrédule et facile du XVIIIe siècle, qui portait en son sein de si redoutables forces de destruction, renfermait aussi des germes de vie non moins féconds, et devait étonner le monde par de sublimes exemples de dévouement, de patriotisme et de courage. C’est par ce côté généreux de rénovation que Mme de Staël appartenait à l’ancienne société française.
Mûrie par l’expérience, guérie des enivrements et des illusions de la jeunesse, elle fut de plus en plus ramenée aux croyances chrétiennes, dont les préceptes se liaient dans son cœur aux émotions de la tendresse filiale.
Ce mouvement progressif d’une âme qui s’élève et se purifie est extrêmement attachant, à suivre. Les lettres de Mme de Staël nous en offrent le tableau, et elle y révèle avec une grâce et un naturel charmants toutes les nuances de sa pensée.
En publiant ce volume, dont les éléments sont tous empruntés aux papiers que la volonté suprême de Mme Récamier a remis entre nos mains, nous avons cru obéir à l’inspiration de celle qui, n’ayant vécu que pour l’amitié, avait fait de la gloire de ses amis la passion dominante de sa vie. Nous avons écrit avec la ferme intention d’être sincère, et nous ne supposons pas que la malveillance eût été aux yeux du public une plus sûre garantie de véracité et d’indépendance que le respect.
Nous ajouterons encore que nous n’avons fait usage des correspondances de Mme de Staël qu’avec l’autorisation expresse de sa famille. Indépendamment de toutes les raisons de convenances qui nous faisaient attacher du prix à cette autorisation, la jurisprudence constante de nos tribunaux imposait à l’éditeur des lettres de cette femme illustre l’obligation de s’en assurer.
Plusieurs arrêts ont, en effet, établi que le secret des lettres est sous la protection d’un pacte tacite, qui interdit de les livrer à la publicité sans le consentement des familles intéressées. Dans un temps où les moindres détails de la vie privée des personnes célèbres sont trop souvent jetés en pâture à une curiosité indiscrète ou maligne, tout le monde est intéressé à faire respecter par son propre exemple cette doctrine tutélaire.
Les héritiers de Mme de Staël se sont imposé la règle de n’autoriser aucune publication de ce genre. Ils ne s’en sont écartés, par une exception unique, que parce que la publication actuelle, appuyée sur des documents authentiques, leur a paru de nature à rectifier les erreurs commises par plusieurs biographes sur une personne que, malgré son génie, l’esprit de parti n’a pas toujours épargnée.
Les originaux des lettres adressées par de Staël à la Grande-Duchesse Louise sont soigneusement conservés dans les archives de Weimar, et le Grand-Duc régnant, fidèle aux nobles traditions de sa race, s’honore de l’amitié respectueuse qu’un écrivain éminent comme Mme de Staël avait vouée à son auguste grand-mère.
Ce prince, visitant Paris en 1845, eut le désir de connaître Mme Récamier et M. de Chateaubriand ; il se fit conduire plusieurs fois à l’Abbaye-aux-Bois. Retourné à Weimar, il fit faire sous ses yeux une copie des lettres de l’illustre personne dont Mme Récamier l’avait entretenu avec une vive émotion.
C’est cette copie offerte à Mme Récamier par le Grand-Duc qui a servi à notre publication.
Quant à la correspondance de Mme de Staël avec sa belle et fidèle amie, les originaux en sont tous entre nos mains.
Il est dans l’histoire des peuples certaines époques brillantes où le génie et les talents abondent et où, dans tous les genres à la fois, les facultés de l’homme semblent atteindre leur plus complet développement.
Cette glorieuse floraison littéraire a commencé pour l’Allemagne vers la fin du XVIIIe siècle, et a duré jusqu’à la première moitié du XIXe.
Klopstock et Kant, Lessing, Herder, Wieland et Winckelmann, Tieck, Goethe et Schiller, Guillaume et Alexandre de Humboldt, les deux Schlegel, Werner, Niebuhr, Hermann et Boeckh, Rauch, Rietschel, Overbeck, Cornélius, Kaulbach : quelle belle liste de poètes, de philosophes, de critiques, de savants et d’artistes ! et combien pourtant de noms illustres y manquent encore ! Et moins d’un siècle les renferme tous !
L’aurore de ce grand mouvement du génie allemand fut contemporaine de la domination de l’école philosophique en France, et, tandis que chez nous l’omnipotence irréligieuse des gens de lettres aboutissait à un bouleversement social, la poésie, les sciences et les arts poursuivaient, en Allemagne, leur pacifique évolution, sous le patronage de souverainetés féodales.
Ce phénomène ne fut nulle part plus frappant qu’à Weimar. Certains contes de fées nous montrent des empires soumis à un enchantement qui suspend pour un temps les conditions de la vie ; on serait tenté de croire qu’il en était ainsi dans ce petit État.
La plus vieille dynastie de l’Europe disparaît dans une tempête, une égalité sanglante passe son niveau sur la société française ; un homme, en qui semble s’être incarné le génie de la guerre, renverse et refait des rois, sans que les fêtes intellectuelles de cette miniature de royaume s’interrompent ou se ralentissent : c’est la fascination des Muses.
L’influence, les goûts aimables d’une femme contribuèrent puissamment à ce miracle.
La Princesse Anne-Amélie de Brunswick resta, en 1758, veuve à dix-neuf ans du Duc Ernest-Auguste-Constantin de Saxe-Weimar.
Elle était belle, douée d’un esprit supérieur, et sa rare intelligence, que dominait l’amour des lettres, la rendit apte à tous les détails d’un excellent gouvernement. Elle administra dix-sept ans le petit État de son fils, et ne se montra pas moins occupée du bonheur de ses sujets que du désir d’immortaliser son nom par la protection qu’elle accordait aux arts et aux sciences. Elle sut, par des mesures réparatrices, effacer les pertes que la guerre de sept ans avait fait éprouver au duché de Weimar, mit un grand ordre dans les finances et préserva son peuple de la famine qui, en 1772, désola le reste de la Saxe.
La Duchesse Amélie avait donné Wieland pour précepteur à son fils, Charles-Auguste, et s’efforçait de lui inspirer le goût dont elle était animée pour les choses de l’esprit en l’entourant et en s’entourant elle-même d’écrivains éminents. Elle fut la constante protectrice de Herder, de Bœttiger, de Seckendorff et de Knobel. Elle pensait avoir fait une glorieuse conquête quand elle parvenait à fixer à sa cour un poète ou un philosophe de plus.
Cette princesse partageait son temps entre Weimar et deux retraites champêtres où elle satisfaisait sa passion pour les fleurs ; lorsqu’en 1775 elle remit à son fils les rênes de son petit et florissant empire, la Duchesse Amélie ne cessa point d’avoir une influence prépondérante, et elle put se livrer sans partage à son goût pour la société des lettrés et à son penchant pour les lettres.
En dirigeant le choix de son fils sur la princesse Louise, fille du Landgrave de Hesse, la Duchesse Amélie lui avait assuré une compagne digne de lui. En effet, une âme généreuse et fière, un caractère vraiment royal, un ferme courage et la plus indulgente bonté eurent bientôt placé cette jeune princesse au premier rang parmi les personnes supérieures qui faisaient de Weimar un monde à part.
Le Duc Charles-Auguste, qui devait, avec les années, compter au nombre des officiers généraux les plus distingués de l’Allemagne, n’avait point un goût aussi exclusif que sa mère pour la poésie ; mais homme d’esprit et élevé dans le culte de tous les talents, il fut, comme la Duchesse Amélie, un protecteur empressé et intelligent des hommes de lettres.
L’année qui précéda sa majorité, c’est-à-dire en 1774, le prince de Saxe-Weimar, voyageant en Allemagne, voulut s’arrêter à Francfort pour y voir le poète dont les écrits commençaient à exciter une admiration enthousiaste. Goethe venait de publier Werther, et ce roman tournait toutes les têtes ; Gœtz de Berlichingen, imprimé peu de mois auparavant, n’avait pas rencontré moins de faveur.
Le prince témoigna son admiration à Goethe avec tout l’entrain de la jeunesse, et décida le poète à l’accompagner à Manheim. On comprend sans peine l’ascendant, qu’un génie de l’ordre de celui de Goethe devait prendre sur l’imagination d’un prince de dix-sept ans : au reste, cette vive impression de jeunesse ne s’effaça jamais, et à partir de ce moment le Duc de Saxe-Weimar subit tout entière l’influence de Goethe. Aussi l’un des premiers actes de Charles-Auguste, lorsqu’il prit possession du pouvoir, fut-il d’appeler le grand poète auprès de lui. Annobli, fixé à la cour par des emplois importants, Goethe ne cessa point d’exercer, durant plus d’un demi-siècle, le crédit le plus absolu, le moins contesté sur les souverains de Weimar. On pourrait dire qu’il régna véritablement dans ce duché ; mais l’Allemagne entière s’inclinait devant la puissance de ce génie poétique, et il serait, je crois, assez difficile de rencontrer ailleurs une idolâtrie littéraire poussée jusqu’à ce degré de superstition.
Goethe, par sa rare et prodigieuse intelligence, par la variété, la fécondité et la souplesse de son talent, justifiait assurément le fanatisme de ses admirateurs ; et pourtant, ce merveilleux poète, dont le caractère était si fort inférieur au talent, incapable de dévouement, dépourvu de la délicatesse du sens moral et chez lequel la personnalité était devenue monstrueuse, nous paraît un des plus tristes exemples de l’égoïsme dans lequel puisse tomber le génie passé à l’état d’idole.
En 1787, une autre brillante étoile littéraire vint ajouter son éclat au firmament de Weimar. Schiller cependant ne trouva pas d’abord à cette cour tout le charme qu’il s’y était d’avance promis. La Duchesse Amélie était tout occupée des préparatifs d’un voyage en Italie qu’elle allait entreprendre avec Goethe, et de poète-ministre n’inspira à Schiller et ne sentit d’abord pour lui qu’une très médiocre sympathie. De toutes les célébrités de Weimar, Wieland fut à cette époque le seul qui lui témoigna un véritable empressement.
Néanmoins le Duc Charles-Auguste, fidèle aux traditions maternelles et soigneux de fixer dans ses États, toutes les fois que le hasard lui en offrait l’occasion, les talents éminents de l’Allemagne, nomma Schiller professeur à l’université d’Iéna. Celui-ci prit possession de sa chaire en 1789. Quelques années plus tard une étroite et tendre amitié s’établit entre Goethe et Schiller, et ce fut une belle chose que l’intime commerce de ces deux génies si divers, mais égaux.
On se laisserait volontiers entraîner au charme de peindre, avec quelques détails, l’intérieur de ce palais où, sous le patronage d’une race royale animée du goût héréditaire des belles choses, tant de chefs-d’œuvre ont pris naissance ; mais nous n’avons pas la prétention de faire ici l’histoire littéraire de Weimar, nous ne voulions que tracer rapidement le cadre dans lequel viendront se placer les lettres de Mme de Staël à la Grande-Duchesse Louise.
Quel que soit d’ailleurs le respectueux intérêt que nous inspire le personnage aimable et auguste de la correspondante de cette femme célèbre, nous ne devons pas oublier que l’objet de notre étude, l’héroïne de notre livre, la figure que nous avons voulu éclairer d’un jour plus vrai que celui sous lequel on la présente communément, c’est Mme de Staël.
On nous permettra cependant de rappeler un incident de la vie de Schiller qui se lie à notre histoire nationale.
En 1792, notre première Assemblée Législative rendit, sur la proposition de Guadet, un décret qui décernait le titre de citoyen français à dix-sept étrangers de célébrités fort diverses, au nombre desquels se trouvaient Wilberforce, Washington, Kosciusko, Campe, Klopstock et l’orateur du genre humain, anacharsis Cloots.
Un membre resté inconnu proposa d’ajouter à cette liste le nom de Schiller, célèbre seulement alors en France par le succès devenu populaire de son drame des Brigands ; il le qualifia de publiciste allemand. L’Assemblée consentit sans hésiter à cette proposition ; mais, sous la plume du rédacteur du procès-verbal de la séance, le nom de Schiller se transforma en Giller, et au Bulletin des Lois, ce nom, altéré une fois de plus, devint celui de M. Gille. Rolland, alors ministre de l’intérieur, expédia le diplôme ainsi conçu. La pancarte mit cinq ans à parvenir au poète illustre dont le nom était de la sorte défiguré.
Lorsque Schiller la reçut, il était dans une disposition d’esprit fort différente de celle qui lui avait fait écrire ses Brigands et mérité l’hommage de l’Assemblée. À l’enthousiasme avec lequel il avait accueilli les premiers actes de notre révolution avait succédé plus que de la froideur. Les crimes qui ne tardèrent pas à souiller la cause de la liberté, le procès et le meurtre de Louis XVI avaient soulevé d’indignation l’âme de Schiller, et dans une lettre adressée à Kœrner, en 1793, on le voit demander un traducteur habile qui puisse mettre en français le mémoire qu’il projette d’adresser à la Convention au nom du peuple allemand en faveur de Louis XVI.« Je crois, dit-il, qu’en de telles occasions on ne peut demeurer inactif. » Il n’écrivit pas cette protestation, dont sans doute il n’espéra aucun résultat, mais il était digne de plaider une telle cause.
Après avoir raconté le mouvement généreux de Schiller, nous nous reprocherions de ne pas remarquer qu’un autre grand poète, mais celui-là français, jeune comme Schiller, comme lui appartenant au parti libéral, indigné comme lui des excès commis sous le nom de la liberté, sollicita et obtint l’honneur de partager les efforts et les périls du défenseur de Louis XVI. Après la condamnation du Roi, André Chénier rédigea la lettre par laquelle le malheureux monarque en appelait au peuple de la sentence de la Convention. Il paya de sa tête ce courageux dévouement ; mais qui n’envierait son sort ?
Nous aimons à rappeler que Mme





























