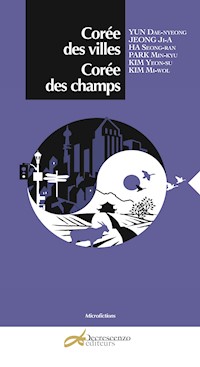
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Decrescenzo
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Découvrez six récits tissés d'illusions, d'aspirations sociales, de rêves brisés et d'amertumes !
Six écrivains, six nouvelles.
La ville brille, mais blesse. Elle représente toutes les illusions, les aspirations sociales de la jeunesse, mais aussi les rêves brisés, les amertumes. Dans
Les Poncires, une grand-mère rompt avec la morosité de son appartement citadin pour faire un dernier voyage : les somptueux paysages de l’île de Jeju, au large de la Corée. Un homme entre deux âges retourne dans son village natal s’occuper de ses vieux parents et redécouvre la vie à la campagne dans
La Lumière du printemps, tandis que le père d’une famille habitant un immeuble résidentiel considère l’éventualité d’échanger son épouse pour sa jeune voisine dans
La Femme d’à côté. Chez Park Min-gyu, l’auteur de
Norme coréenne, l’écologie est un refuge utopique, vite rattrapé par la dure réalité du monde rural, la restructuration industrielle et l’évolution des mentalités. Dans
La Boulangerie de New-York, le narrateur se rappelle avec tendresse la boulangerie familiale et le quartier de son enfance. Quant à Kim Mi-wol, elle nous propose une exploration inattendue de la capitale coréenne dans
Le Guide des grottes de Séoul.
Ce recueil présente les œuvres d’auteurs nés dans les années 60-70. Tous décrivent à leur manière le rapide développement économique et industriel de la Corée. Qu’ils soient citadins convaincus ou habitants de la campagne, la vie quotidienne éprouve nos héros, tous à la recherche d’un lieu de chaleur sentimentale.
Découvrez un recueil de nouvelles originales dont les héros vous emmèneront dans leur quête sentimentale, entre campagnes et villes coréennes !
EXTRAIT
Ma tante arriva le mercredi 21 juillet, un de ces jours où règne une chaleur épouvantable dès le matin et jusque tard dans la nuit. Comme tous les bateaux en provenance de Tongyeong accostaient au port de Seongsanpo, je conduisis plus d’une heure pour m’y rendre à partir d’Aewol et arrivé là-bas, j’attendis en mangeant des naengmyeon. Vers deux heures, un paquebot blanc se dirigeant vers la côte apparut loin dans le nord et une demi-heure plus tard, le Mandarin faisait son entrée au port avec sa cargaison de touristes. Quand il fut à quai, les passagers en descendirent un à un par la passerelle métallique, mais j’eus beau chercher ma tante du regard, je ne la vis pas. Je commençai à avoir quelques inquiétudes, bien que certain de ne pas m’être trompé, puisque j’avais reçu le matin même l’appel annonçant son départ. Les touristes étant tous sortis, après avoir traversé la salle d’attente, j’allais m’avancer jusqu’au bureau situé sur l’embarcadère pour demander la liste des passagers quand j’aperçus, au bas de l’escalier, une petite dame âgée flanquée de deux hommes d’équipage qui la soutenaient pour marcher. Elle détonnait, avec sa robe noire et sa veste en coton blanc de style traditionnel.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
C'est une très belle découverte que ce recueil de nouvelles [...] le thème choisi est d'ailleurs pour beaucoup dans le fait que j'ai apprécié cette lecture, tant c'est quelque chose qui m'a frappé lors de la vision de films ou reportages sur la Corée : l'opposition entre la ville très moderne et la campagne encore très traditionnelle. Une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée ! -
Sofynet, Babelio
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
YUN DAE-NYEONG, JEONG JIA,
HA SONGNAN, PARK MIN-KYU, KIM YEON-SU,
KIM MI-WOL.
CORÉE DES VILLES, CORÉE DES CHAMPS
Micro-fictions
Traduit du coréen par KIM Jeong-yeon et Suzanne SALINAS
Collection Micro-fictionsDirigée par Julien PAOLUCCI
Anthologie de nouvelles traduites avec le soutien de Korea Foundation.
Ouvrage publié avec le concours de l’Institut coréen pour la Traduction littéraire (LTI Korea)
© Decrescenzo Éditeurs, 2015
pour la traduction française.
ISBN 978-2-36727-040-1
Si vous souhaitez être informés de nos parutions,
N’hésitez pas à consulter notre site.
www.decrescenzo-editeurs.com
La couverture deCorée des villes, Corée des champsa été dessinée par Thomas GILLANT.
YUN DAE-NYEONG
LES PONCIRES
Titre original : 탱자[Taengja]
© Yun Dae-nyeong, 2007Publié pour la première fois en Corée par
Changbi Publishers, Inc.
L’édition française est publiée avec l’accord de
Changbi Publishers, Inc.
Tous droits réservés
© Decrescenzo éditeurs, 2015
pour la traduction française.
Ce printemps-là, un vieux moine rencontré sur le bateau qui nous emmenait de Tongyeong à Jeju m’avait assuré qu’en prenant de l’âge, il fallait de temps en temps purifier son âme. C’était pour cette raison qu’il traversait la mer, sans destination précise. Je revenais quant à moi de Jinhae où j’avais été admirer les cerisiers en fleur. Quand je lui avais demandé ce qu’il voulait dire par « purifier », il avait tendu le doigt vers le bout rouge de la cigarette qui se consumait dans ma main, à côté d’une bouteille de soju1 vide. Puis, en souriant avec embarras, il avait ajouté que j’aurais à le faire une fois encore, avant de mourir.
Je ne sais pas si tu t’en rappelleras de suite. La dernière fois que je t’ai vu, c’était pour l’enterrement de ton grand-père. Il y a déjà trente ans de ça, alors on en perd le compte. À l’époque, tu étais collégien et tu portais un uniforme noir et les cheveux coupés à ras. Tu n’as pas versé une larme pour ce grand-père qui te faisait asseoir sur ses genoux, jusqu’à ce que tu sois grandet. Assis sur le maru2 des hommes, tu avalais ton bol de riz et de soupe avec un air de chèvre hargneuse. Dans mon souvenir, c’est comme ça que je te revois. Dire que tu as la quarantaine ! Le temps est vraiment comme un méchant vieux à la figure toute pleine d’emplâtre !
Tu dois être surpris que je m’adresse à toi, tout d’un coup, mais je te prie de ne pas arrêter de lire et d’aller jusqu’au bout. Il y a bien un mois, avec mes frères et sœurs aujourd’hui dispersés, nous nous sommes retrouvés à ton ancienne maison pour l’anniversaire de la mort de ton grand-père. Je n’y avais pas été depuis dix ans, peut-être même vingt, mais j’ai soudain eu très envie de revoir les miens et j’ai sauté dans le premier car, malgré la journée de trajet. Tout le monde était là, sauf le plus jeune de tes oncles de Gangnung. C’est par ton père que j’ai eu de tes nouvelles.
Voilà en bref ce qui se passe. Je souhaiterais te rendre visite. J’ai beaucoup hésité avant de me décider à t’écrire, de peur de te causer du dérangement. Toutefois, je voudrais te demander un service. J’aimerais que tu me réserves une chambre. Nous n’aurons à nous voir que deux fois, à mon arrivée et à mon départ. Je compte rester une quinzaine de jours, voire un mois, mais en tant que femme, ça me gênerait de loger seule dans une petite auberge, même si ça se fait, de nos jours. Une chambre chez un particulier me conviendrait tout à fait, même très simple et sans beaucoup de confort.
J’ai l’intention de prendre le bateau à Tongyeong, mercredi prochain. Mais avant, je voudrais aller à Gyeongju pour m’y promener seule et visiter le temple de Bulguksa, que je ne connais que de nom. Ce sera aussi la première fois que j’irai à l’île de Jeju et que je prends le bateau, mais peut-être aussi la dernière, comme mon vieux cœur s’empresse de me le rappeler.
Je me doute bien que cette lettre va te mettre dans l’embarras. Je te demande quand même de ne pas t’absenter pour m’éviter. Quand j’ai téléphoné, j’ai appris que la ville de Chungmu s’appelle Tongyeong depuis quelque temps. Je t’appellerai de là-bas avant d’embarquer. Fais en sorte que ma venue ne crée pas de souci à ta femme. De plus, je désire que ta famille n’en sache rien. À mon âge, je ne souhaite pas être la cible des critiques.
Ta tante de Séoul, qui t’envoie bien vite cette lettre péniblement écrite.
Mon grand-père lui avait donné pour prénom Gyeong-ja. Comme elle était née quelques années avant la Libération, il avait choisi ce prénom de style japonais sans trop se soucier de sa signification. Sommairement traduit en coréen, cela donnait « la fille de Séoul », mais qu’est-ce que ça aurait pu vouloir dire ? Tout de même, le prénom influence toujours un peu le destin, alors je me demandais si ce n’était pas pour ça qu’elle habitait Séoul. Avant de recevoir sa lettre, j’ignorais même qu’elle y vivait. En effet, je n’avais jamais entendu parler d’elle au cours des trente dernières années, y compris par mes parents.
C’est à l’été 1975 que grand-père s’est éteint. J’étais en deuxième année du collège et ma tante, alors âgée de trente-cinq ans, était depuis longtemps mariée. J’avais vaguement entendu dire qu’elle habitait Jinjuk, une localité de la province du Chungcheongnam-do voisine de Gwangcheon, la ville aux célèbres crevettes en saumure qui se situe non loin de Daecheon, quant à elle renommée pour sa plage. C’était une petite commune rurale desservie par la ligne de chemin de fer de Janghang. Le mari devait occuper un poste subalterne dans sa minuscule gare. Ce jour-là, ma tante était venue avec son fils âgé de sept ans. Mais pour une raison mystérieuse, son mari ne l’accompagnait pas. Pour autant, personne ne lui avait demandé pourquoi. Quand j’étais entré dans la cuisine pour la questionner, elle m’avait caressé gauchement la tête de sa main mouillée et avait eu un petit sourire amer.
Son visage ingrat, petit comme une graine de sésame, sa maigreur et sa courte taille la destinaient à être traitée sans grands égards dès son enfance. De plus, elle n’allait pas encore à l’école qu’elle disparaissait souvent jusque très tard le soir et il fallut plus d’une fois partir à sa recherche en famille, à la lumière d’une lampe. Par ces actes de rébellion, elle cherchait en fait à attirer l’attention, ce qui lui valut au contraire d’être considérée comme une source de tracas et ses parents en vinrent à se désintéresser presque totalement d’elle quand naquirent leurs autres enfants. Son père ayant été maire d’un chef-lieu de canton, elle aurait dû mieux se conduire, mais elle s’en souciait toujours moins avec le temps. Elle chapardait même pommes ou melons en compagnie de petits garçons, voire les poules des voisins. Sans chercher à en savoir davantage, les gens décrétaient, avec un claquement de langue désapprobateur, qu’elle n’aurait jamais dû voir le jour. Ses parents, voulant tout de même qu’elle ait de l’instruction, l’avaient envoyée au collège, mais avant même d’en sortir, elle avait pris la fuite en pleine nuit avec son maître d’école boiteux, car elle était tombée sous son charme. Au bout de quelques mois, elle s’en était revenue toute déguenillée et dès lors, avait été traitée par les siens comme une domestique pendant pas moins de douze années, jusqu’à son mariage à l’âge de vingt-huit ans. S’ils ne l’avaient pas chassée, ses parents pas plus que ses frères et sœurs ne lui avaient accordé la moindre attention et ne s’étaient occupés d’elle. Lorsque survenait quelque incident fâcheux pour la famille, aussi insignifiant soit-il, c’était toujours elle qui se le voyait reprocher.
Quand on la maria à l’âge de vingt-huit ans, tous se crurent enfin débarrassés d’une éternelle source d’ennuis familiaux. Si on l’avait tenue enfermée et laissée vieillir au logis plus de dix années durant, c’était dans le seul but de faire taire la rumeur sur sa liaison avec l’enseignant éclopé. Tout avait été fait pour mettre fin aux racontars, y compris le choix d’une famille vivant aussi loin que possible du pays natal, pour éviter d’être embêté si elle venait à apprendre quelque chose, même tardivement, et c’est au petit matin, en catimini, qu’avait eu lieu le mariage. Sur ce, interdiction lui avait été faite de revenir à la maison pour quelque raison familiale que ce soit. J’avais alors huit ans et en grandissant à ses côtés, je l’observais. Je savais bien que c’était ma tante, mais elle avait toujours le visage tout noir de suie, comme une souillon. Il avait fallu cette conversation entre adultes, surprise quelques jours plus tard sur le maru, pour que j’apprenne son mariage. Puis j’étais resté sans nouvelles jusqu’à sa venue à l’enterrement de grand-père, et de même par la suite. En prenant de l’âge, je commençais moi aussi à passer moins souvent à la maison.
La lettre avait été écrite au crayon sur du papier quadrillé de noir et placée sur un sous-main. À vrai dire, je ne l’avais pas reçue avec joie. Il en serait allé autrement s’il s’était agi de quelqu’un de la famille avec qui on mange tous les jours et encore, n’était-il pas tout à fait normal que les proches fassent chacun leur vie et s’éloignent les uns des autres ? C’était d’ailleurs pour cela qu’après avoir quitté le domicile familial, on avait de la difficulté à se retrouver, en dehors des jours de fête. Si on y pensait bien, rien ne pesait plus que les liens de famille. Les occasions de se voir ne faisaient que multiplier les sources de conflit, même entre parents et enfants. Alors, que dire de la venue prochaine d’une tante qui s’annonçait un beau matin par le courrier, après presque trente ans d’absence ? Comme si de rien n’était, elle avait parlé d’une quinzaine de jours ou d’un mois, mais pour celui qui recevait, cela semblait bien long. Dans le cas d’un proche, un jour ou deux suffisaient, après quoi on n’en pouvait déjà plus. Dans la vie, il était cependant des obligations auxquelles on ne pouvait se soustraire. Notamment en matière de relations. Après m’être fait à cette idée, j’en venais déjà à m’inquiéter de la traversée en bateau qu’aurait à effectuer cette vieille dame seule. Comme j’en avais fait moi-même l’expérience au printemps, quelques grosses vagues suffisaient à transformer ce trajet de quatre heures en un véritable calvaire.
Après en avoir parlé à ma femme, j’entrepris de chercher une pension dans le quartier. Cependant, les prix étaient exorbitants. À la saison haute, le montant dépassait partout cent mille wons la nuitée, ce qui semblait difficilement envisageable pour une vieille personne seule, quelle que soit sa situation. En outre, hormis par l’apparence et le confort, ces établissements ne différaient en rien des auberges. Je regardai aussi dans les petites résidences à vendre, mais on se refusait toujours à louer entretemps pour quinze jours ou un mois. C’était aussi le cas de l’hébergement chez les particuliers. Ils se montraient tous réticents, en apprenant que c’était pour une vieille dame seule. La seule possibilité qui restait était de réserver une chambre dans une pension de famille de la plage, mais j’avais peine à imaginer ma tante vivre en permanence au bord de la mer. Par prudence, ma femme me proposa alors de la prendre chez nous, redoutant les reproches de mes parents, s’ils venaient à l’apprendre.
Ma tante arriva le mercredi 21 juillet, un de ces jours où règne une chaleur épouvantable dès le matin et jusque tard dans la nuit. Comme tous les bateaux en provenance de Tongyeong accostaient au port de Seongsanpo, je conduisis plus d’une heure pour m’y rendre à partir d’Aewol et arrivé là-bas, j’attendis en mangeant des naengmyeon. Vers deux heures, un paquebot blanc se dirigeant vers la côte apparut loin dans le nord et une demi-heure plus tard, le Mandarin faisait son entrée au port avec sa cargaison de touristes. Quand il fut à quai, les passagers en descendirent un à un par la passerelle métallique, mais j’eus beau chercher ma tante du regard, je ne la vis pas. Je commençai à avoir quelques inquiétudes, bien que certain de ne pas m’être trompé, puisque j’avais reçu le matin même l’appel annonçant son départ. Les touristes étant tous sortis, après avoir traversé la salle d’attente, j’allais m’avancer jusqu’au bureau situé sur l’embarcadère pour demander la liste des passagers quand j’aperçus, au bas de l’escalier, une petite dame âgée flanquée de deux hommes d’équipage qui la soutenaient pour marcher. Elle détonnait, avec sa robe noire et sa veste en coton blanc de style traditionnel. Je dévalai l’escalier pour aller à sa rencontre. Son visage était baigné d’une sueur glacée. L’un des hommes m’expliqua qu’elle avait terriblement souffert du mal de mer et avait dû prendre un médicament, mais avait tout vomi et se trouvait dans un tel état d’épuisement que mieux valait l’emmener à l’hôpital. Sans même avoir le temps de les remercier, il me fallut la porter sur mon dos pour quitter l’embarcadère et aller chez un médecin de l’agglomération de Seongsan.
Trois heures durant, elle resta profondément endormie, deux aiguilles à perfusion piquées au dos de la main. J’appelai ma femme pour la tenir au courant de la situation, retournant toutes les demi-heures à la chambre pour regarder dormir ma tante. Je ne reconnaissais plus les traits qui avaient été les siens trente-cinq ans auparavant, lorsque je l’avais vue pour la dernière fois, ce qui était peut-être normal. Seuls les contours de son visage pouvaient faire penser que c’était elle. Lassé d’attendre, je sortis un moment de l’hôpital pour aller boire un café au distributeur, assis sur une chaise en plastique posée devant l’arrêt de bus, et fumai trois ou quatre cigarettes d’affilée. Puis je rappelai ma femme pour lui dire de dîner sans nous attendre. Voyant le soir tomber au loin sur la mer, je pressai le pas pour retourner à l’hôpital.
Toute propre après sa toilette, ma tante bavardait avec l’infirmière, assise sur le canapé de la salle d’attente. À mon arrivée, elle me prit la main, l’air embarrassé.
« Je suis vraiment confuse... Pour une toute première rencontre...
– Si vous étiez passée par Gyeong-ju, il y avait l’aéroport de Pohang, tout près. Pourquoi avez-vous préféré le bateau, qui est si pénible ?
– Le principal, c’est que je sois là, non ? En tout cas, j’ai rendu tout ce que j’avais mangé ce matin, alors j’ai de plus en plus faim. Allons vite nous mettre quelque chose sous la dent ! »
Elle tendit un billet de dix mille wons à l’infirmière, qui l’avait raccompagnée jusqu’à la sortie en portant son sac. La femme eut beau refuser obstinément l’argent, tante le lui glissa de force dans la main. Le ciel s’assombrissait rapidement et les bateaux de pêche au calmar ou au sabre allumèrent leurs lampes tous ensemble. Dans un restaurant situé au pied du Pic Ilchulbong, nous commandâmes une marmite de fruits de mer, mais avec un plissement au front, elle déclara y trouver un goût prononcé de poisson. Les gens nous observaient sans cesse à la dérobée, pensant que c’était une réfugiée nord-coréenne arrivée à bord du Mangyeongbongho. C’était à cause de son habillement. À la vitre du restaurant, se dressait l’ombre du Pic Ilchulbong, telle une formidable muraille noire, mais tante ne le voyait même pas. Posant sa cuillère, elle commença à se plaindre, un peu tard, de s’être sentie mal dès son embarquement à Tongyeong.
« J’ai vraiment cru m’évanouir tant ce bateau tanguait ! »
Je savais d’expérience que rien n’était plus pénible que le mal de mer. Pas question de s’arrêter ou de descendre en route, comme dans un car ou un taxi. Pour changer de sujet, je l’interrogeai sur ce qu’elle avait fait depuis son départ.
« Comment avez-vous trouvé Gyeongju ? »
Changeant subitement d’expression, elle répliqua :
« Bien. C’était dur de monter à pied jusqu’à Iljumun, mais une fois au temple de Bulguksa, je me suis sentie l’âme plus pure, tout ignorante que je suis.
– Vous vouliez à ce point y aller ?
– Ah oui ! Depuis l’âge de quinze ans... J’ai donc réalisé mon rêve cinquante ans après ! De plus, j’ai enfin vu par moi-même les pagodes de Dabotap et Seokgatap, que je ne connaissais que par les pièces de monnaie. Je ne souhaite plus rien d’autre. »
Dans un pays aussi petit, Gyeongju paraissait très loin à certains. Pourquoi donc s’était-elle mis en tête d’aller jusqu’à Jejudo ? Si je ne lui avais pas posé cette question, elle m’avait traversé l’esprit en recevant sa lettre et me revenait brusquement en mémoire. Était-elle venue faire du tourisme tout bonnement parce que j’y étais ?
En sortant du restaurant, je lui proposai de s’installer confortablement chez nous, puisque je n’avais pas fait de réservation. Elle demeura sans réaction, comme si elle ne m’avait pas entendu, et n’ouvrit pas la bouche avant d’être dans la voiture. Plus ou moins près de la côte, de nombreux bateaux illuminaient la mer sombre, tel un marché aux poissons flottant. Après avoir posé un instant son regard sur l’eau, ma tante reprit, comme pour tirer la nuit de son sommeil. « Mais, au fait... »
Dans son ton prudent, on sentait poindre le reproche.
« Je sais très bien à quel point tu es occupé, mais était-ce si gênant de chercher un logement ? »
J’en restai coi.
« Je sais. Il y a ce qu’on appelle les obligations familiales. Moi qui me suis souciée toute ma vie de ce que pensait la famille, je ne tiens vraiment pas à faire de même avec la femme de mon neveu.
– Mais elle n’est pas comme ça.
– Au début, ça se passe toujours bien pour tout le monde. Mais au bout d’un jour ou deux à peine, on se sent mal à l’aise et c’est ainsi avec n’importe qui. De plus, je ne sais pas si c’est toujours le cas, mais si mes souvenirs sont bons, tu es aussi d’un caractère difficile. C’est dans le sang. Dans la famille, tu le sais, tout en ne se critiquant pas, on est dur les uns avec les autres. On a beau se retrouver pour une occasion ou une autre, au moment de partir, on se quitte tous sans faire de bruit, comme au temple. »
Était-ce pour cela que j’avais cessé depuis longtemps d’aller voir la famille ? Tout ce qui semblait rester de nos liens du sang était les os épars d’un squelette. Un squelette qui se reconstituait rituellement aux moindres fêtes et événements familiaux, pour une raison que je ne m’expliquais pas. De plus, ceux ayant manqué, ne serait-ce qu’une fois, à des traditions ou pratiques familiales qui se perpétuaient de longue date ne pouvaient que difficilement prétendre y avoir leur place. Nous n’avions pourtant rien d’une grande famille.
« Je passerai cette nuit chez toi, puisque je n’ai pas le choix, mais demain à la première heure, tu t’en iras me chercher une chambre dans une auberge. »
Après m’être garé sur le front de mer de Hamdeok, je descendis sur la plage pour uriner dans le noir, puis je pris deux cafés au distributeur d’un minuscule supermarché. Si je me pliais à sa volonté, je ne savais pas comment allait le prendre ma femme et en avais déjà des maux de tête. Elle serait forcément mal à l’aise si ma tante restait chez nous une quinzaine, voire un mois. Toutefois, elle accordait la plus grande importance au sens du devoir et au bon sens dans les relations entre les gens.
En buvant le café dans la voiture, à côté de ma tante, je déclarai :
« Je ferai comme vous voudrez. »
J’avais pensé que ce serait mieux ainsi.
« Bien. Excuse-moi, mais je me sentirai plus à mon aise comme ça. Pourquoi donc ce café est-il aussi amer ? Puis-je laisser le reste ? »
Au moment où nous approchions d’Aewol, après avoir traversé la ville de Jeju, me revint en mémoire un voisin originaire de l’île de Wando. Je pensai qu’il pourrait me venir en aide pour résoudre ce cas. Âgé d’environ cinquante-cinq ans, il vivait à Jeju depuis une vingtaine d’années. Alors qu’il travaillait comme bûcheron à l’Office des forêts, il avait eu l’épaule brisée par un cèdre du Japon, voilà quelques années, et avait été hospitalisé huit mois, après quoi il avait reçu les indemnités de la sécurité sociale et avait pris sa retraite. Sa femme tenait un restaurant dans l’agglomération d’Aewol. L’homme s’était remis physiquement, mais le traumatisme avait été tel que sa femme lui avait interdit de reprendre quelque travail que ce soit. Souvent, nous allions à la pêche près de la digue et buvions ensemble, ce qui nous avait beaucoup rapprochés. Entre voisins, il nous arrivait souvent de manger en famille les uns chez les autres et on nous faisait cadeau de condiments.
Quand j’appelai cet homme pour lui évoquer la situation, il me proposa une chose fort simple. D’après lui, il y avait, près d’une montagne d’Aewol, une maison tranquille d’où l’on voyait par moments la mer. Elle venait d’être construite ce printemps pour y aménager une pension et restait pourtant vide, faute d’autorisation en vue de son exploitation commerciale. Le couple qui en était propriétaire approchait la cinquantaine et vivait à l’étage supérieur, mais il n’y avait aucune raison de s’en inquiéter de part et d’autre. De plus, la maison ayant été prévue pour des particuliers, on n’avait nullement l’impression de se trouver dans un établissement commercial.
Avant de prendre mon petit déjeuner, le lendemain, j’allai examiner l’habitation qu’il m’avait indiquée. Le couple était au jardin, en train de désherber. Quand je parlai au propriétaire du restaurant de Wando, il me répondit qu’il avait été averti et demanda où j’habitais. La venue d’une vieille dame seule le préoccupait. Quand je lui répondis que nous étions tout près, il me dit de revenir avec elle vers midi. Il m’accorda en outre un rabais de la moitié du prix, sans que je lui aie rien demandé. Enfin, il me dit de ne pas m’en faire, car pendant un certain temps il ne pourrait de toute façon pas accueillir de clients comme il se devait.
Heureusement, il se trouvait que la maison plaisait à ma tante. Prévoyant qu’il lui serait difficile de monter et descendre les escaliers, le propriétaire lui donna une chambre au rez-de-chaussée. C’était une maison à un étage, d’où l’on ne voyait la mer que du toit en terrasse, mais comme un champ s’étendait par devant, on n’avait pas l’impression d’y être enfermé. Pendant que ma tante défaisait ses bagages dans la chambre, l’homme de Wando appela et arriva à moto dix minutes après. Il partait à la pêche.
« Il fait chaud, alors si nous allions respirer le bon air ensemble, mon neveu ? »
Lui aussi m’appelait « son neveu ».
« Ma femme n’aime pas que j’y aille pendant la journée, à cause du bronzage. »
Quand j’allais pêcher trois ou quatre jours d’affilée, j’avais la peau brune comme les gens d’Asie du Sud-Est et je perdais du poids. Ma femme n’était pas contente et disait que je ressemblais à un malfaiteur en fuite.
« Mais où est votre tante ? »
À cause du bruit, peut-être, elle nous regarda par la fenêtre de sa chambre. Je lui présentai l’homme et lui expliquai que c’était lui qui avait eu l’idée de cette maison, alors elle accourut aussitôt pour le saluer bien bas. Après nous avoir invités dans son restaurant, l’homme repartit sur sa moto et disparut entre les champs de pommes de terre. Dès qu’il eut tourné le dos, ma tante déclara :
« Pourquoi donc a-t-il le teint aussi sombre ? On dirait un voleur de bétail. »
Je répondis, à demi sérieux :
« C’est vrai, j’ai entendu dire que c’était un bandit des montagnes. D’ailleurs, il mange encore les bêtes et les poissons vivants.
– Ça ne m’étonne pas. Tst ! Tst ! Je lui suis certes reconnaissante de m’avoir trouvé ce logement, mais ça ne me dit vraiment rien de le revoir. »
Je lui proposai d’aller prendre l’air, puisque nous avions enfin trouvé une chambre, mais elle refusa d’un signe de tête.
« Tu as perdu toute une journée, hier, alors il te faut étudier, aujourd’hui. Si tu as des inquiétudes à mon sujet, reviens me voir dans deux jours. J’ai encore le vertige et je sens que je dois prendre encore une ou deux journées de repos. »
Puis elle me demanda un peu tardivement :
« Est-ce que ton père sait que je suis là ? »
Comme elle m’avait déconseillé de l’en informer, dans sa lettre, je ne m’étais pas donné la peine de téléphoner dans le seul but d’en parler. Mon père était aussi son frère, de cinq ans son aîné.
« Tu as bien fait. Dorénavant non plus, ne lui en parle surtout pas. J’ai toujours tenu à venir ici sans faire d’histoire. »
Quand j’arrivai à la pension, le surlendemain, ma tante enlevait les mauvaises herbes du jardin, la tête ceinte d’une serviette éponge. Le couple de propriétaires était parti au marché qui se tenait tous les cinq jours. Quand je lui demandai pourquoi elle ne les avait pas accompagnés, elle affirma qu’ils ne le lui avaient pas proposé. Et si nous y allions ? Elle répondit qu’elle n’aimait pas faire comme les autres.





























