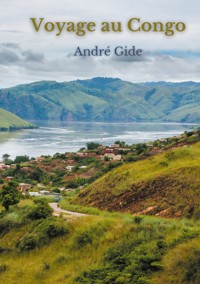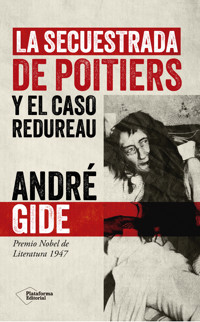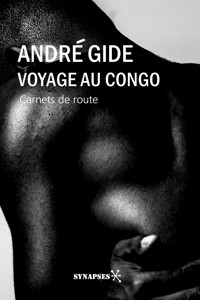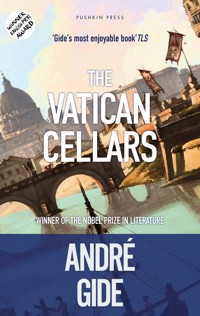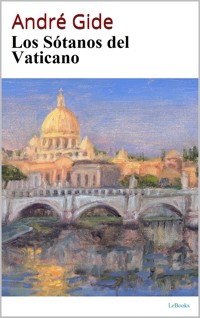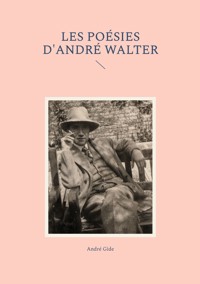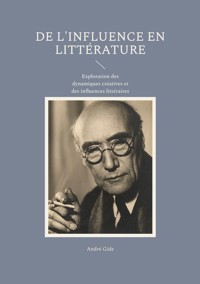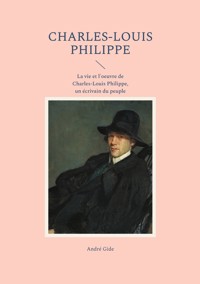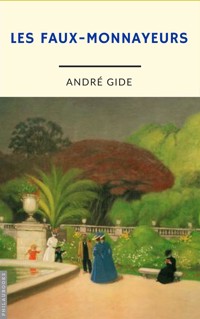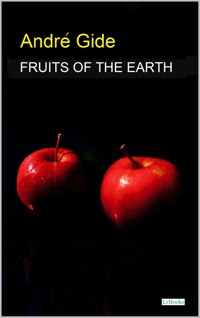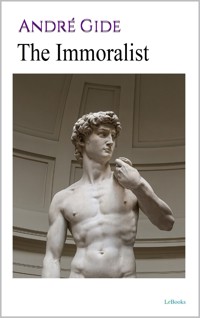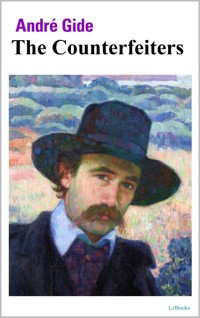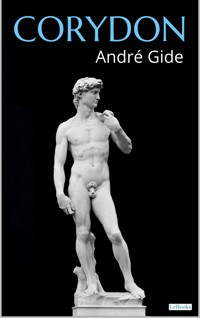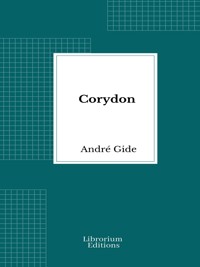
0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L’an 190 un scandaleux procès remit sur le tapis une fois encore l’irritante question de l’uranisme. Dans les salons et les cafés, huit jours durant, on ne parla plus de rien d’autre. Las d’entendre à ce sujet s’exclamer ou théoriser au hasard les ignorants, les butés et les sots, je souhaitai d’éclairer mon jugement et, ne reconnaissant qu’à la raison, non point au seul tempérament, le droit de condamner ou d’absoudre, je résolus d’aller interviewer Corydon. Il ne protestait point, m’avait-on dit, contre certains penchants dénaturés dont on l’accuse ; j’en voulus avoir le cœur net et savoir ce qu’il trouvait à dire pour les excuser.
Je n’avais pas revu Corydon depuis dix ans. C’était alors un garçon plein de flamme, doux et fier à la fois, généreux, serviable, dont le regard déjà forçait l’estime. Ses études de médecine avaient été des plus brillantes et ses premiers travaux remporté l’applaudissement des gens de métier. Au sortir du lycée où nous avions été condisciples, longtemps une assez étroite amitié nous unit. Puis des années de voyage nous séparèrent, et lorsque je revins m’installer à Paris, la déplorable réputation que ses mœurs commençaient de lui valoir me retint de le fréquenter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Corydon
André Gide
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385743697
TABLE
Préface de la 1re édition
Préface de la 2e édition
Premier dialogue
Deuxième dialogue
Troisième dialogue
Quatrième dialogue
Appendice
PRÉFACE
Mes amis me répètent que ce petit livre est de nature à me faire le plus grand tort. Je ne pense pas qu’il puisse me ravir autre chose à quoi je tienne ; ou mieux : je ne crois pas tenir beaucoup à rien de ce qu’il m’enlèvera : applaudissements, décorations, honneurs, entrées dans les salons à la mode, je ne les ai jamais recherchés. Je ne tiens qu’à l’estime de quelques rares esprits, qui, je l’espère, comprendront que je ne l’ai jamais mieux méritée qu’en écrivant ce livre et qu’en osant aujourd’hui le publier. Cette estime, je souhaite de ne pas la perdre ; mais certainement, je préfère la perdre que la devoir à un mensonge, ou à quelque malentendu.
Je n’ai jamais cherché de plaire au public ; mais je tiens excessivement à l’opinion de quelques-uns ; c’est affaire de sentiment et rien ne peut contre cela. Ce que l’on a pris parfois pour une certaine timidité de pensée, n’était le plus souvent que la crainte de contrister ces quelques personnes ; de contrister une âme, en particulier, qui de tout temps me fut chère entre toutes. Qui dira de combien d’arrêts, de réticences et de détours est responsable lasympathie,la tendresse ? — Pour ce qui est des simples retards, je ne puis les tenir pour regrettables, estimant que les artistes de notre temps pèchent le plus souvent par grand défaut de patience. Ce que l’on nous sert aujourd’hui eût souvent gagné à mûrir. Telle pensée qui d’abord nous occupe et nous paraît éblouissante, n’attend que demain pour flétrir. C’est pourquoi j’ai longtemps attendu pour écrire ce livre, et, l’ayant écrit, pour l’imprimer. Je voulais être sûr que ce que j’avançais dans Corydon, et qui me paraissait évident, je n’allais pas avoir bientôt à m’en dédire. Mais non : ma pensée n’a fait ici que s’affermir, et ce que je reproche à présent à mon livre, c’est sa réserve et sa timidité. Depuis plus de dix ans qu’il est écrit, exemples, arguments nouveaux, témoignages, sont venus corroborer mes théories. Ce que je pensais avant la guerre, je le pense plus fort aujourd’hui. L’indignation que Corydon pourra provoquer, ne m’empêchera pas de croire que les choses que je dis ici doivent être dites. Non que j’estime que tout ce que l’on pense doive être dit, et dit n’importe quand — mais bien ceci précisément, et qu’il le faut dire aujourd’hui[1]!
Certains amis, à qui d’abord j’avais soumis ce livre, estiment que je m’y occupe trop des questions d’histoire naturelle — encore que je n’aie point tort, sans doute, de leur accorder tant d’importance ; mais, disent-ils, ces questions fatigueront et rebuteront les lecteurs. — Eh parbleu ! c’est bien ce que j’espère : je n’écris pas pour amuser et prétends décevoir dès le seuil ceux qui chercheront ici du plaisir, de l’art, de l’esprit ou quoi que ce soit d’autre enfin que l’expression la plus simple d’une pensée très sérieuse. —
Encore ceci :
Je ne crois nullement que le dernier mot de la sagesse soit de s’abandonner à la nature, et de laisser libre cours aux instincts ; mais je crois qu’avant de chercher à les réduire et domestiquer, il importe de les bien comprendre — car nombre des disharmonies dont nous avons à souffrir ne sont qu’apparentes et dues uniquement à des erreurs d’interprétation.
Nov. 1922.
↑
Certains livres — ceux de Proust en particulier — ont habitué le public à s’effaroucher moins et à oser considérer de sang-froid ce qu’il feignait d’ignorer, ou préférait ignorer d’abord. Nombre d’esprits se figurent volontiers qu’ils suppriment ce qu’ils ignorent… Mais ces livres, du même coup, ont beaucoup contribué, je le crains, à égarer l’opinion. La théorie de l’homme-femme, des « Sexuelle Zwischenstufen » (degrés intermédiaires de la sexualité) que lançait le D
r
Hirschfeld en Allemagne, assez longtemps déjà avant la guerre, et à laquelle Marcel Proust semble se ranger — peut bien n’être point fausse ; mais elle n’explique et ne concerne que certains cas d’homosexualité, ceux dont précisément je ne m’occupe pas dans ce livre — les cas d’inversion, d’efféminement, de sodomie. Et je vois bien aujourd’hui qu’un des grands défauts de mon livre est précisément de ne m’occuper point d’eux — qui se découvrent être beaucoup plus fréquents que je ne le croyais d’abord.
Et mettons que, ceux-ci, la théorie de Hirschfeld les satisfasse. Cette théorie du « troisième sexe » ne saurait aucunement expliquer ce que l’on a coutume d’appeler « l’amour grec » : la pédérastie — qui ne comporte efféminement aucun, de part ni d’autre.
PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION(1920)
Je me décide après huit ans d’attente à réimprimer ce petit livre. Il parut en 1911, tiré à douze exemplaires, lesquels furent remisés dans un tiroir — d’où ils ne sont pas encore sortis.
Le Corydon ne comprenait alors que les deux premiers dialogues, et le premier tiers du troisième. Le reste du livre n’était qu’ébauché. Des amis me dissuadaient d’achever de l’écrire. « Les amis, dit Ibsen, sont dangereux non point tant par ce qu’ils vous font faire, que par ce qu’ils vous empêchent de faire. » Les considérations que j’exposais dans ce petit livre me paraissaient pourtant des plus importantes, et je tenais pour nécessaire de les présenter. Mais j’étais d’autre part très soucieux du bien public, et prêt à celer ma pensée dès que je croyais qu’elle pût troubler le bon ordre. C’est bien aussi pourquoi, plutôt que par prudence personnelle, je serrai Corydon dans un tiroir et l’y étouffai si longtemps. Ces derniers mois néanmoins je me persuadai que ce petit livre, pour subversif qu’il fût en apparence, ne combattaitaprès tout que le mensonge, et que rien n’est plus malsain au contraire, pour l’individu et pour la société, que le mensonge accrédité.
Ce que j’en dis ici, après tout, pensais-je, ne fait point que tout cela soit. Cela est. Je tâche d’expliquer ce qui est. Et puisque l’on ne veut point, à l’ordinaire, admettre que cela est, j’examine, je tâche d’examiner, s’il est vraiment aussi déplorable qu’on le dit — que cela soit.
PREMIER DIALOGUE
L’an 190 un scandaleux procès remit sur le tapis une fois encore l’irritante question de l’uranisme. Dans les salons et les cafés, huit jours durant, on ne parla plus de rien d’autre. Las d’entendre à ce sujet s’exclamer ou théoriser au hasard les ignorants, les butés et les sots, je souhaitai d’éclairer mon jugement et, ne reconnaissant qu’à la raison, non point au seul tempérament, le droit de condamner ou d’absoudre, je résolus d’aller interviewer Corydon. Il ne protestait point, m’avait-on dit, contre certains penchants dénaturés dont on l’accuse ; j’en voulus avoir le cœur net et savoir ce qu’il trouvait à dire pour les excuser.
Je n’avais pas revu Corydon depuis dix ans. C’était alors un garçon plein de flamme, doux et fier à la fois, généreux, serviable, dont le regard déjà forçait l’estime. Ses études de médecine avaient été des plus brillantes et ses premiers travaux remporté l’applaudissement des gens de métier. Au sortir du lycée où nous avions été condisciples, longtemps une assez étroite amitié nous unit. Puis des années de voyage nous séparèrent, et lorsque je revins m’installer à Paris, la déplorable réputation que ses mœurs commençaient de lui valoir me retint de le fréquenter.
En pénétrant dans son appartement, je n’eus point, je l’avoue, la fâcheuse impression que je craignais. Il est vrai que Corydon ne la donne pas non plus par sa mise, qui reste correcte, avec même une certaine affectation d’austérité. Mes yeux cherchaient en vain, dans la pièce où il m’introduisit, ces marques d’efféminement que les spécialistes retrouvent à tout ce qui touche les invertis, et à quoi ils prétendent ne s’être jamais trompés. Toutefois on pouvait remarquer, au-dessus de son bureau d’acajou, une grande photographie d’après Michel-Ange : celle de la formation de l’homme — où l’on voit, obéissant au doigt créateur, la créature Adam, nue, étendue sur le limon plastique, tourner vers Dieu son regard ébloui de reconnaissance. Corydon professe un certain goût pour l’œuvre d’art, derrière lequel il eût pu s’abriter si j’avais été m’étonner du choix de ce sujet spécial. Sur la table de travail, le portrait d’un vieillard à grande barbe blanche, que je reconnus aussitôt pour celui de l’Américain Walt Whitman, car il figure en tête d’une traduction que M. Bazalgette vient de donner de son œuvre. M. Bazalgette venait de publier également une biographie de ce poète, volumineuse étude dont j’avais récemment pris connaissance, et qui me servit de prétexte pour engager l’entretien.
I
— Après lecture du livre de Bazalgette, commençai-je, il appert que ce portrait n’a pas grand-raison de figurer sur votre table.
Ma phrase était impertinente ; Corydon feignit de ne la point comprendre ; j’insistai.
— D’abord, répondit-il, l’œuvre de Whitman reste également admirable, quelle que soit l’interprétation qu’il plaise à chacun de donner à ses mœurs…
— Avouez pourtant que votre admiration pour Whitman a quelque peu faibli depuis que Bazalgette a démontré qu’il n’avait pas les mœurs que vous étiez heureux de lui prêter.
— Votre ami Bazalgette n’a rien démontré du tout ; tout son raisonnement tient dans un syllogisme qu’on peut aussi bien rétorquer :
L’homosexualité, pose-t-il en principe, est un penchant contre nature.
Or, Whitman était de parfaite santé ; c’était, à proprement parler, le représentant le plus parfait que nous ait offert la littérature, de l’homme naturel…
— Donc Whitman n’était pas pédéraste. Voici qui me paraît péremptoire.
— Mais l’œuvre est là, où M. Bazalgette aura beau traduire par « affection » ou « amitié » le mot love et sweet par « pur » dès qu’il s’adresse au « camarade »… Il n’en restera pas moins que toutes les pièces passionnées, sensuelles, tendres, frémissantes, du volume sont du même ordre : de cet ordre que vous appelez « contre nature ».
— De ce que je n’appelle pas « ordre » du tout… Mais voyons votre syllogisme ?
— Le voici :
Whitman peut être pris comme type de l’homme normal.
Or Whitman était pédéraste.
— Donc la pédérastie est un penchant normal. Bravo ! Il reste seulement à prouver que Whitman était pédéraste. Pétition de principes pour pétition de principes, je préfère le syllogisme de Bazalgette ; il heurte moins le sens commun.
— Ce n’est pas le sens commun, c’est la vérité qu’il importe de ne pas heurter. Je prépare un article sur Whitman, une réponse à l’argumentation de Bazalgette[1].
— Ces questions de mœurs vous occupent beaucoup ?
— Passablement, je l’avoue ; je prépare également un assez important travail sur ce sujet.
— Les travaux de MM. Moll, Krafft-Ebing, Raffalovich, etc. ne vous suffisent donc pas !
— Ils n’ont pas su me satisfaire ; je voudrais parler de cela différemment.
— J’ai toujours pensé qu’on se trouvait bien à parler le moins possible de ces choses et que souvent elles n’existent que parce qu’un maladroit les divulgue. Outre qu’elles sont inélégantes à dire, quelques mauvais garnements seront là pour prendre en exemple précisément ce que l’on prétendait blâmer.
— Je ne prétends pas blâmer.
— Le bruit court que vous posez pour tolérant.
— Vous ne m’entendez point. Je vois qu’il faut vous dire le titre de mon ouvrage.
— Allez-y.
— C’est une Défense de la Pédérastie que j’écris.
— Pourquoi pas Éloge, pendant que vous y êtes ?
— Ce titre forcerait ma pensée ; déjà je crains que dans le mot Défense, certains ne voient une sorte de provocation.
— Et vous oserez publier cela ?
— Non ; je n’oserai pas, fit-il sur un ton plus grave.
— Décidément vous êtes tous les mêmes, repris-je après un court silence ; vous crânez en chambre et parmi vos pairs ; mais en plein air et devant public votre courage s’évapore. Vous sentez parfaitement, au fond, la légitimité de la réprobation qui vous accable ; vous protestez éloquemment à voix basse ; mais à voix haute vous flanchez.
— Il est vrai que la cause manque de martyrs.
— N’employez donc pas de grands mots.
— J’emploie les mots qu’il faut. Nous avons eu Wilde, Krupp, Macdonald, Eulenburg…
— Si cela ne vous suffit pas.
— Oh ! des victimes ! des victimes tant qu’on en veut ! des martyrs, point. Tous ont nié ; tous nieront.
— Eh ! parbleu, devant l’opinion, les journaux ou les tribunaux, chacun prend honte et se rétracte.
— On se tue, hélas ! Oui, vous avez raison : c’est donner gain de cause à l’opinion que d’établir son innocence sur le désaveu de sa vie. Étrange ! On a le courage de ses opinions ; de ses mœurs, point. On accepte bien de souffrir ; mais pas d’être déshonoré.
— N’êtes-vous pas comme eux, en reculant devant la publication de votre livre ?
Il hésita quelques instants, puis :
— Peut-être que je ne reculerai pas.
— Acculé devant les tribunaux par un Queensberry ou un Harden, vous prévoyez pourtant quelle serait votre attitude.
— Hélas ! Sans doute que tout pareil à ceux qui m’y ont précédé, je perdrais contenance et nierais. On n’est jamais si seul dans la vie, que la boue que certains nous jettent n’éclabousse à la fois quelques autres qui nous sont chers. Le scandale désolerait ma mère ; je ne me le pardonnerais pas. Ma jeune sœur vit avec elle et n’est pas encore mariée. Peut-être se trouverait-il malaisément quelqu’un qui m’accepterait pour beau-frère.
— Eh ! parbleu ! je vous saisis bien ; vous avouez donc que ces mœurs déshonorent même celui qui ne fait que les tolérer.
— Ce n’est pas un aveu ; c’est une constatation. Voilà bien pourquoi je souhaite à cette cause des martyrs.
— Vous entendez par le mot… ?
— Quelqu’un qui irait au-devant de l’attaque ; qui, sans forfanterie, sans bravade, supporterait la réprobation, l’insulte ; ou mieux, qui serait de valeur, de probité, de droiture si reconnues que la réprobation hésiterait d’abord…
— Précisément cet homme-là, vous ne le trouverez pas.
— Laissez-moi souhaiter qu’il se trouve.
— Voyons ! Entre nous, vous le croyez donc bien utile ? Quel changement d’opinion attendez-vous ? J’accorde que vous êtes un peu contraints. Si vous l’étiez un peu davantage, il n’en vaudrait que mieux, croyez-moi ; ces abominables mœurs cesseraient tout naturellement d’exister, pour n’arriver plus à se produire. (Je remarquai qu’il haussait les épaules ; ce qui ne m’empêcha pas d’insister) : Prétendez-vous qu’assez de turpitudes ne s’étalent déjà pas au grand jour ? Je me suis laissé dire que les homosexuels trouvent de-ci de-là de nombreuses facilités. Qu’ils se contentent de celles qui se cachent, des complaisances de leurs pareils ; ne briguez point pour eux l’approbation, ni même l’indulgence, des honnêtes gens.
— C’est pourtant de l’estime de ceux-ci que je ne puis pas me passer.
— Qu’y faire ? Changez vos mœurs.
— C’est que je ne puis pas les changer. Voilà le dilemme auquel Krupp, Macdonald et tant d’autres ne virent d’autre solution que le coup de revolver.
— Heureusement vous êtes moins tragique.