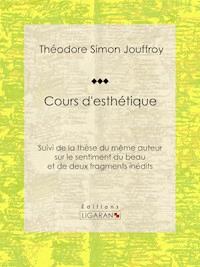
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le monde qui n'est pas nous, le monde extérieur se manifeste à l'homme de deux façons : par des attributs et par des phénomènes. Les attributs sont les propriétés qui ne varient pas, comme l'étendue, la figure. Ce sont les qualités fixes."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054385
©Ligaran 2015
Faces diverses sous lesquelles les choses nous apparaissent : la réalité, la bonté, la beauté. – Décomposition de la question du beau. – Quels sont les phénomènes que produit en nous la vue des objets beaux ? – Quels sont les caractères de ces objets ? – Autres questions secondaires.
Le monde qui n’est pas nous, le monde extérieur se manifeste à l’homme de deux façons : par des attributs et par des phénomènes.
Les attributs sont les propriétés qui ne varient pas, comme l’étendue, la figure. Ce sont les qualités fixes.
Les phénomènes sont les accidents physiques qui commencent et finissent. Ce sont les évènements passagers.
Or, l’intelligence apprend qu’il y a quelque chose que nous ne voyons pas, et derrière les évènements passagers que nous voyons, ou les phénomènes, pour les produire, et sous les qualités fixes que nous voyons, ou les attributs, pour les supporter.
Ainsi, qu’est-ce pour nous que le monde extérieur ? C’est une collection de choses qui se manifestent à nous par des attributs et des phénomènes.
Or, maintenant, quand ces choses se manifestent par des attributs et des phénomènes à l’esprit des hommes, ils croient l’idée qui leur en vient d’accord avec la chose manifestée, ils la proclament vraie. La vérité, c’est la conformité de l’idée que la vue de l’objet fait naître dans l’intelligence, avec l’objet que l’intelligence voit. Mais les objets ou les choses ne peuvent être qu’à tort aussi proclamées vraies. Tout ce qu’on peut dire des choses, c’est seulement qu’elles sont et sont de telle ou telle manière. L’existence est pour l’homme la première qualité des choses. Les choses sont donc d’abord des réalités existantes.
Ensuite, quand l’esprit s’avance dans la découverte du monde extérieur, il se surprend à nommer certains phénomènes ou certains actes, bons ou mauvais ; bons ou mauvais, certains attributs. Les choses ne sont donc plus seulement des réalités existantes ; ce sont encore des réalités existantes, bonnes ou mauvaises.
Enfin, l’esprit nomme de plus certains phénomènes ou certains actes beaux ou laids ; beaux ou laids, certains attributs. Les choses ne sont donc plus seulement des réalités existantes, bonnes ou mauvaises ; ce sont encore des réalités existantes, bonnes ou mauvaises, belles ou laides.
Ainsi le beau et le laid, le bien et le mal, puis l’existence ou la réalité, voilà trois formes sous lesquelles se manifestent, par des attributs et des phénomènes, les choses ou les objets dont la collection constitue le monde extérieur.
Et comme ces trois formes ne se confondent et ne s’identifient pas, comme le beau n’est pas le bien, ni le bien l’existence, il s’ensuit que le monde extérieur peut s’envisager sous trois faces distinctes.
Ainsi d’abord, les choses que le monde extérieur comprend, sont des réalités existantes. L’existence appartient universellement à tout ce qui tombe sous les sens ; c’est ce sans quoi les choses ne seraient pas, ce qui fait qu’elles sont, et l’intelligence dit sans rien ajouter : les choses existent ; les objets sont ; ce qui est, est, et voilà tout.
Mais ensuite les choses, outre leur existence, sont bonnes ou mauvaises, belles ou laides ; non pas cependant universellement, car les unes sont bonnes et belles, les autres sont mauvaises et laides ; d’autres ne sont ni bonnes, ni belles, ni mauvaises, ni laides. Deux questions s’élèvent donc ici.
1° Qu’entend-on dire quand on dit : Cette chose est bonne, cette chose est mauvaise ? C’est la question du bien ; nous l’avons déjà traitée.
2° Qu’entend-on dire quand on dit : Cette chose est belle, cette chose est laide ? C’est la question du beau ; nous allons la traiter.
La question du beau n’a pas été plus définitivement résolue que la question du bien, et on a tenté moins d’efforts pour la résoudre. Nous ne pourrons donc pas invoquer les recherches des philosophes, nos prédécesseurs ; nous n’aurons pas de guides, ou d’auxiliaires. Il nous faudra marcher tout seul, peu à peu, sonder en tâtonnant le terrain, commencer un voyage de découverte. Mais si les résultats de nos études ne sont pas très complets et très satisfaisants, si nos solutions ne sont pas entières, nous aurons au moins décomposé la question ; nous aurons vu comment il faut établir la science sur des fondements larges et solides ; nous aurons aperçu l’étendue de la science, ses limites, ses parties et leur rapport.
En premier lieu comprenons bien la question du beau, et voyons quelles questions principales elle renferme.
Qu’entend-on dire, quand on dit : Cette chose est belle ?
Distinguons d’abord dans la question deux parties : les faits et l’explication des faits.
Il y a dans toute perception du beau deux éléments : hors de nous un objet, au-dedans un phénomène que l’objet y produit, et qui fait que l’objet qui l’y produit s’appelle beau. Les faits sont donc d’une part les caractères de l’objet, d’autre part le phénomène que l’objet produit en nous.
L’explication des faits consiste à savoir pourquoi tel objet possédant tel caractère, produit en nous tel phénomène.
Et comme l’explication des faits doit en suivre la connaissance, voici les deux questions qu’il faut d’abord résoudre : Quels sont les caractères de l’objet qui s’appelle beau ? Quel phénomène produit en nous l’objet qui s’appelle beau.
Or ces deux questions sont complexes. Il faut donc les décomposer, et pour les décomposer clairement, pour les analyser, il faut les prendre l’une après l’autre.
Ainsi supposons maintenant que les caractères de l’objet qui s’appelle beau ne varient pas ; supposons que le beau soit un, qu’il n’y ait au monde qu’un seul beau, et prenons, décomposons, analysons la dernière des deux questions complexes : Quel phénomène produit en nous l’objet qui s’appelle beau, pour s’appeler beau ?
Le phénomène que produit en nous l’objet qui s’appelle beau, en comprend deux autres. L’un est un phénomène sensible ; c’est une sensation agréable que l’objet nous cause ; c’est un plaisir. L’autre est un phénomène intellectuel ; c’est comme une exclamation de l’esprit qui s’écrie : L’objet est beau ; c’est un jugement.
Le jugement est-il la suite du plaisir ? Le plaisir est-il la suite du jugement ? Le jugement et le plaisir sont-ils indépendants l’un de l’autre ? Voilà trois questions nouvelles que renferme la question première.
Pour répondre à ces trois questions, trois théories se sont élevées.
Les uns ont dit : L’objet qui s’appelle beau ne cause en nous que du plaisir ; le jugement n’est que l’énonciation du plaisir ; le jugement est la suite du plaisir.
Les autres ont dit : L’on n’atteint pas le beau dans l’objet avec la sensibilité, mais avec l’intelligence ; le plaisir est la suite du jugement.
Et dans ce système, deux systèmes encore ont paru. On a prétendu d’un côté, que le plaisir restant bien la suite du jugement, c’est l’image de ce qu’il y a de beau dans l’objet, qui, transportée dans l’intelligence, fait jouir la sensibilité.
Et de l’autre côté Kant a prétendu que le plaisir restant bien aussi la suite du jugement, c’est le jugement même qui fait le plaisir, l’acte même de juger qui nous affecte agréablement.
Enfin dans la troisième théorie d’autres ont dit : Le jugement se produit à part du plaisir, et le plaisir à part du jugement. Ce sont deux faits distincts qui se passent en nous, et ne s’engendrent pas. L’intelligence découvre quelque chose de beau dans un objet qui est là, et par cela seul qu’il est là, la sensibilité s’en trouve agréablement affectée. Le plaisir et le jugement sont indépendants l’un de l’autre.
Ainsi dans la première hypothèse, si le jugement est la suite du plaisir, la question du beau se réduit à savoir,
Quant aux faits :
1° Qu’est-ce qu’il y a dans l’objet qui nous fait plaisir ?
2° Quelle est la nature du plaisir que nous fait le quelque chose qui est dans l’objet ?
Quant à l’explication des faits :
Comment ce qu’il y a dans l’objet peut-il nous faire plaisir ?
Dans la seconde hypothèse, si le plaisir est la suite du jugement, soit qu’il résulte du jugement même ou de l’image de ce qu’il y a de jugé beau dans l’objet, la question consiste à trouver,
Pour la partie qui concerne les faits :
1° Qu’est-ce qu’il y a de jugé beau dans l’objet ?
2° Quelle est la nature de ce jugement ? Est-il contingent ? Est-il absolu ?
Pour la partie qui concerne l’explication des faits.
Comment, dans l’un des systèmes, l’image de ce qu’il y a de jugé beau dans l’objet, et comment dans l’autre système le jugement lui-même fait plaisir à la sensibilité ?
Quelle est la nature de ce plaisir ?
Dans la troisième hypothèse, si le jugement et le plaisir sont indépendants l’un de l’autre, il faudra savoir,
D’une part :
Qu’est-ce qu’il y a dans l’objet qui nous fait plaisir ?
Quelle est la nature de ce plaisir ?
Qu’est-ce qu’il y a de jugé beau dans l’objet ?
Quelle est la nature de ce jugement ?
Et d’autre part :
Comment ce qu’il y a dans l’objet peut-il nous faire plaisir ?
Comment ce qu’il y a de jugé beau dans l’objet peut-il être jugé beau ?
Et de plus :
Comment tout objet que l’intelligence juge beau fait en même temps plaisir à la sensibilité ?
Toutes ces questions résolues, voici d’autres questions encore qui les suivent de près :
En supposant toujours que les caractères de l’objet qui s’appelle beau, ne varient pas, le beau dépend-il, dans l’homme qui le perçoit, de sa constitution, de ses organes ? Le beau qui ne serait plus beau pour l’homme autrement fait, serait-il toujours beau ? Le beau n’est-il beau que relativement à l’homme ? Le beau est-il absolu ?
Et si le beau n’est pas absolu dans ce sens, dépend-il dans l’homme qui le perçoit, de l’âge, du sexe, du pays, du climat, de la civilisation ? Le beau qui ne serait pas beau pour un homme serait-il beau pour un autre ? Le beau n’est-il beau que relativement à tel ou tel homme ? Le beau est-il absolu pour l’humanité ?
Autre question. Le beau est-il totalement invisible, ou moitié invisible, et moitié visible ? Le beau est-il quelque chose que l’observation ne voit pas, et que la raison conçoit à propos de ce que voit l’observation, ou quelque chose dont les deux éléments sont, l’un vu par l’observation, et l’autre conçu par la raison ? Le beau est-il l’affaire de la raison, ou l’affaire de la raison et de l’observation ? C’est un choix important à décider.
Ainsi voilà les questions comprises dans cette question : Quel phénomène produit en nous l’objet qui s’appelle beau pour s’appeler beau ?
Mais nous avons partout supposé que les caractères de l’objet qui s’appelle beau ne varient pas, et nous devons maintenant examiner s’ils ne varient véritablement pas.
Alors revient l’autre question de faits qu’il faut résoudre pour savoir ce qu’on entend dire en disant : Cette chose est belle, la question :
Quels sont les caractères de l’objet qui s’appelle beau ?
Toutes les langues distinguent plusieurs espèces de beau. Si l’on en croit les langues, le beau n’est pas l’agréable ou le joli ; le joli n’est pas le sublime, et de là sortent des séries de nouveaux problèmes.
D’abord un problème fondamental : L’agréable, le beau, le sublime ne sont-ils que trois degrés d’une seule chose dont l’agréable est le positif, le beau le comparatif, et le sublime le superlatif ? Ou l’agréable, le beau, le sublime sont-ils trois choses de nature différente ?
Deux théories célèbres ont proclamé, l’une que l’agréable, le beau, le sublime sont trois degrés d’une seule chose dont le sublime est le superlatif, et l’agréable le diminutif ; l’autre que l’agréable, le beau, le sublime sont trois choses de nature différente.
Et si l’on se décide pour l’affirmative, il faut élever sur l’agréable, le beau, le sublime, chacune des questions élevées sur le beau, quand on le supposait fixe et permanent.
De plus, il faut apprendre quelle est la nature particulière de ces trois espèces de beau, apprendre quel est leur rapport, apprendre par quelle loi l’agréable, le beau, le sublime font plaisir à la sensibilité, dans le même temps que l’intelligence les juge agréable, beau, sublime.
Cependant ce n’est pas tout. La question va se compliquer encore.
Il y a deux sortes d’agréable, de beau, de sublime. Le beau se divise sous ces deux espèces. Il y a du beau naturel et du beau artificiel.
Le beau naturel est celui qu’offre la nature, celui qu’offrent les actions humaines.
Le beau artificiel est celui que créent les arts, l’éloquence, la poésie, la musique.
Or quel rapport y a-t-il entre le beau naturel et le beau artificiel ?
Là-dessus plusieurs opinions qu’il faut exposer.
On a pensé d’abord que le beau artificiel est l’exacte copie du beau naturel. C’est la doctrine de l’imitation.
On a pensé ensuite que le beau artificiel est la copie du beau naturel, mais choisi, perfectionné.
Et pour les uns, le choix consiste à prendre dans la nature les parties les plus belles pour les réunir sans les changer et faire un tout plus beau que le beau naturel.
Pour les autres, le perfectionnement consiste à réellement embellir les parties les plus belles prises dans la nature, en les réunissant pour en former un tout.
On a pensé encore que le beau naturel était une chose et le beau artificiel une autre chose, une invention de l’art.
On a pensé enfin que le beau naturel est aussi un beau artificiel ; seulement dans un cas l’artiste est Dieu ; dans l’autre c’est l’homme. La nature ainsi serait un langage de Dieu pour exprimer le beau, comme les couleurs du peintre et les sons du musicien. Les formes de la nature sont comme autant de symboles du beau ; le beau, c’est donc à ce compte quelque chose d’invisible que la nature exprime et traduit par ses formes et que l’artiste humain conçoit peut-être par les formes de la nature, qui l’expriment et le traduisent pour le traduire et l’exprimer à son tour.
C’est là que se terminerait la science, s’il n’y avait qu’un art pour exprimer le beau ; s’il n’y avait qu’un beau seulement et qu’un moyen seulement pour le rendre.
Mais après avoir défini l’art, il faut descendre aux arts particuliers, comme la peinture, la parole.
Et comme chaque art a son beau, il faut pareillement descendre aux différentes espèces de beau que chaque art peut produire, soit qu’il copie le beau naturel, soit qu’il le perfectionne.
Puis des arts particuliers il faut arriver jusqu’aux subdivisions de ces arts. Il y a dans l’art de la peinture, par exemple, l’art du tableau héroïque, l’art du tableau historique, l’art du tableau de genre, l’art du paysage. Il y a dans l’art de la parole, l’art de l’éloquence et l’art de la poésie ; dans l’art de la poésie, l’art du lyrique et l’art du dramatique ; dans l’art du dramatique, l’art du tragique et l’art du comique.
Il faut donc également arriver aux subdivisions des différentes espèces de beau qui correspondent aux subdivisions de chaque art particulier. Dans le beau de la peinture on distinguera donc le beau du tableau héroïque, le beau du tableau historique, le beau du tableau de genre, le beau du paysage.
Ainsi l’on déterminera les rapports de tous les arts entre eux : leurs règles et leurs principes, leurs limites et leurs moyens ; ce que chacun d’eux peut et ce qu’il veut. Là s’arrête enfin la science.
Tel est l’arbre généalogique, le catalogue, la table des questions que contient la question du beau. Telle est la carte du pays que nous allons parcourir. Tel est notre plan de campagne.
Question fondamentale de la science. – Méthode française ou extérieure ; son insuffisance. – Autre méthode consistant à analyser l’effet que produit sur nous un objet beau : qu’elle est plus directe que la précédente. – Que tous les objets beaux font plaisir. – Causes connues de plaisirs : 1° ce qui favorise notre développement, égoïsme : 2° le triomphe de la force sur la matière, la sympathie. – Rapports et différences de ces deux espèces de plaisir. – Si elles peuvent être ramenées à un même principe.
Qu’entendons-nous dire, quand nous disons : Cet objet est beau ? C’est toujours là le problème dont il s’agit, le problème unique et capital, qui doit nous occuper. Comprenons nettement et précisément ce qu’il y a dans l’esprit de l’homme qui s’écrie : Cela est beau. Déterminons, fixons, définissons exactement le sens que ces trois mots ont pour nous ; et nous tenons la science du beau, nous en avons décidé la grande question, la question première et fondamentale. Il ne restera plus qu’à faire sortir de sa généralité l’idée claire que nous possédons du beau, pour la présenter successivement aux questions particulières et secondaires, aux problèmes de détail, dont nous avons précédemment établi le catalogue, et qui tous, en sa présence, devront facilement se résoudre. Ainsi le but de nos efforts, le sujet de nos recherches, et comme notre point de mire principal, c’est la solution de ce problème : Qu’entendons-nous dire, quand nous disons : Cet objet est beau ?
Or, pour arriver à la solution de ce problème, voici la marche qu’ont suivie les philosophes de l’école française ; voici leur plan de conduite.
Quand nous disons : Cet objet est beau, ont-ils pensé d’abord, nous entendons dire qu’il y a dans l’objet qui est beau certains caractères visibles, ou un certain ensemble de caractères visibles, que le mot beau désigne ? Ainsi quand nous disons : L’Apollon du Belvédère est beau, c’est qu’il y a dans l’Apollon du Belvédère quelque chose que l’œil saisit et qui constitue le beau. Quand nous disons : Les opéras de Mozart sont beaux, c’est qu’il y a dans les opéras de Mozart quelque chose que l’oreille perçoit, et qui constitue pareillement le beau.
Partant de ce principe, les philosophes français ont fait alors ce raisonnement : S’il y a dans chaque objet qui s’appelle beau quelque chose de visible, qui fait qu’on l’appelle beau, il doit donc y avoir dans tous les objets qu’on qualifie de beaux quelque chose de visible, qui leur est commun, puisqu’on les qualifie tous de beaux. Cela posé, mettons-nous à réunir tous les objets qu’on qualifie de beaux, et ceux que produit l’art et ceux que produit la nature. Comparons-les, et dans ce parallèle, laissant de côté les caractères visibles qui sont spéciaux à chacun d’eux, extrayons avec soin les caractères visibles qui leur sont communs à tous ; nous ne manquerons sans doute pas alors de trouver, en jetant les regards sur les caractères communs visibles de tous les objets qu’on nomme beaux, et de toucher presque du doigt la chose que le mot beau doit désigner.
Ainsi ont procédé les philosophes français, et leur méthode paraît au premier coup d’œil très simple, très naturelle, très juste. Cependant, voyons-la de plus près ; considérons-la plus attentivement, et nous allons sur-le-champ en découvrir les défauts. Nous allons sentir bien vite que ses voies sont fausses et ne mènent pas où l’on veut arriver.
D’abord on pourra bien réunir tous les objets que l’on nomme beaux, nous l’accordons ; on pourra les comparer, nous l’accordons encore. Mais pourra-t-on rencontrer en les comparant un caractère visible qui leur soit commun à tous ? En pourra-t-on marquer un seul trait ? Qu’on prenne l’Apollon du Belvédère et les opéras de Mozart. Voilà d’une part des sons, et d’autre part des formes. Or les formes et les sons, dira-t-on qu’ils se ressemblent sous quelque rapport dans leurs apparences perceptibles ? Quel est le caractère commun visible des formes et des sons ? Qui se mettrait en quête pour le signaler ne réussirait évidemment qu’à perdre son temps et sa peine. Les philosophes français, par les résultats qu’ils ont obtenus, conformément à leur méthode, l’ont eux-mêmes contre eux fort bien démontré ; car tout ce qu’ils ont pu tirer des objets beaux comparés en fait de caractère commun qui tombe sous les sens, c’est l’ordre, c’est la symétrie ; et la symétrie ne se voit pas ; l’ordre ne se voit pas davantage.
Ensuite, supposons même qu’on ait pu saisir et constater ce caractère commun visible de tous les objets qu’on déclare beaux, qu’arriverait-il ? En serions-nous guère plus avancés ? Nous saurions qu’il y a dans tous les objets qu’on a coutume de proclamer beaux un caractère qu’on peut voir, et qu’on peut voir dans chacun d’eux également ; nous saurions aussi qu’en face de ce caractère nous éprouvons un certain plaisir, qui se distingue de tous les autres. Mais, qu’entendons-nous bien dire, quand nous disons : Cela est beau ? Quelle idée attachons-nous positivement au mot beau ? Qu’est-ce enfin pour l’homme que le beau ? Nous ne le saurions pas ; car on ne le sait qu’en sachant pourquoi ce certain caractère nous fait plaisir. Il faut d’abord apprendre son singulier effet sur la nature humaine, sa merveilleuse influence. Comment tel objet, possédant tel caractère, peut-il agréablement affecter la sensibilité de l’homme ? Voilà toujours le secret, voilà l’énigme dont il faut commencer par trouver le mot.
De toutes ces considérations donc il résulte que par les yeux, les mains et les oreilles, le beau n’est pas trouvable. Les philosophes français ont eu tort de prétendre qu’on le peut voir. Il est inaccessible aux sens, il est invisible. Dans ce cas il faut abandonner le monde du dehors, et c’est au-dedans de nous qu’il faut diriger nos regards. C’est en nous et par la conscience qu’il faut attaquer la question. Déterminons donc quels phénomènes le beau produit en nous, et nous parviendrons à déterminer d’abord pourquoi le beau les produit, et puis qu’est-ce que le beau ? quelle est la nature du beau ? qu’entendons-nous dire, quand nous disons : Cet objet est beau ?
Or, en suivant cette méthode, voici ce que nous observons et reconnaissons en nous-mêmes.
Ce que nous trouvons d’abord dans toute perception possible d’un objet qui nous semble beau, c’est un sentiment de plaisir. Plaçons-nous vis-à-vis tel ou tel objet, soit agréable, soit beau, soit sublime, qui fasse partie de la nature ou soit l’œuvre de l’art, la sensibilité s’émeut en nous à son aspect, et l’émotion qui s’élève dans notre âme est celle de la joie.
Causer du plaisir est donc une propriété ou un caractère que nous pouvons affirmer du beau. Nous ne disons pas que tout ce qui nous cause du plaisir est beau. Si nous le disions, l’expérience nous contredirait à chaque instant. Mais tout ce qui est beau nous cause toujours du plaisir. Voilà ce que nous disons et le fait est facile à vérifier ; et comme généralement dans tout objet qui produit la joie en nous, il est un élément qu’on peut nommer le principe du plaisir, sa source, son origine, et qu’il y a du plaisir en nous causé par les objets beaux, on est forcé d’en conclure que l’essence ou la nature de ce qui est beau comprend en soi l’essence ou la nature de ce qui cause le plaisir.
Donc déterminer l’essence ou la nature de ce qui cause le plaisir est le meilleur moyen d’aborder la question. Car ainsi nous constatons un caractère commun à tous les objets qu’on appelle beaux ; et ce caractère constaté, nous posons dès lors le pied dans la science ; nous y pénétrons. Nous tenons le beau par un endroit. Nous n’avons plus qu’à achever de définir l’idée dont nous aurons marqué le premier trait.
Voyons donc d’où vient le plaisir et comment il vient.
Il y a dans le monde deux choses : l’une essentiellement inerte, improductive, passive, c’est la matière ; l’autre essentiellement vive, productive, active, c’est la force.
Or la matière ne sent pas. L’inertie repousse la sensibilité. L’inertie, c’est comme si l’on disait la mort ; et sans la vie, pourrait-on jamais sentir. Soient donc çà et là devant nous des molécules matérielles ; nous ne leur supposons ni plaisir, ni douleur. Ces deux phénomènes ne nous paraissent aucunement convenir à leur état inanimé.
Mais arrive avec la sensibilité ou la faculté de se sentir, une force qui tende à lier les molécules matérielles isolées et dispersées devant nous ; puis arrivent en sa présence deux autres forces qui tendent, l’une à les séparer, et l’autre à les lier de plus près, et nous concevons alors la sensation ; nous la concevons agréable et désagréable, nous comprenons ce que c’est que jouir ou souffrir. Contrariée par l’une des deux forces qui tend à séparer les molécules matérielles, la force sensible, qui tend à les lier, se sentira contrariée, c’est-à-dire souffrira. Favorisée par l’autre des deux forces qui tend à lier comme elle les molécules matérielles, elle se sentira favorisée, et par là même elle jouira. Ainsi nous nous représentons la sensation agréable et désagréable, comme deux faits particuliers à la force, qui se sent, et comme totalement étrangers à la matière, qui ne se sent pas.
Si nous voulions confirmer par des exemples la théorie que nous indiquons ici, nous n’aurions qu’à voir ce qui se passe en nous. Quand nous arrive-t-il en effet de jouir et de souffrir ? Que l’intelligence s’épuise en vains efforts à la poursuite et à la connaissance de la vérité, n’est-ce pas pour nous une souffrance ? Mais si l’intelligence, poursuivant la vérité, la saisit, l’atteint et s’en empare sans effort, n’est-ce pas pour nous une jouissance ? La douleur du corps ne tient-elle pas aussi à la gêne qui borne et empêche ses mouvements ? Son bien-être, n’est-ce pas l’absence des obstacles, son affranchissement des entraves et des contraintes qui arrêtent sa parfaite liberté d’agir ? Force intellectuelle et productive, l’homme est-il empêché dans son développement intellectuel et productif, il éprouve une sensation désagréable. Est-il au contraire aidé, il éprouve une sensation agréable. Être contrarié et impuissant, voilà pour lui la peine. Être secouru et puissant, voilà pour lui le plaisir. Bref, ce qui nous affecte agréablement, c’est ce qui nous rend la vie plus facile, ce qui nous sert ; et ce qui nous affecte désagréablement, c’est ce qui nous la rend plus pénible, ce qui nous nuit. Jusqu’ici l’expérience a justifié la théorie.
Cependant poussons plus loin nos épreuves et la théorie va peut-être nous sembler en défaut. En effet l’homme ne rencontre-t-il pas dans la nature, hors de lui, des réalités, des êtres, qui ne contrarient et ne gênent en rien le développement de sa force, qui ne lui rendent la vie ni plus pénible ni plus facile, qui ne sauraient pas plus lui nuire que le servir, et ces réalités, néanmoins, ces êtres lui plaisent ou lui déplaisent. La rose, par exemple, d’aussi loin qu’il la verra, lui plaira ; la rose pourtant n’agira pas sur lui pour ouvrir ou fermer le passage aux exécutions de sa volonté. La plante lourde, lente et rampante lui déplaira ; cette plante pourtant n’a rien à démêler avec sa puissance ; elle n’en peut pas arrêter, borner ou circonscrire l’essor. Ainsi d’une part il y a des objets qui lui plaisent ou lui déplaisent parce qu’ils lui sont utiles en facilitant son développement intellectuel et physique, ou nuisibles en l’empêchant ; et jusque-là tout va bien, tout s’accorde. Mais d’autre part apparaissent d’autres objets qui lui plaisent ou lui déplaisent, sans faciliter son développement sous sa double forme, ou sans, l’empêcher ; et dans ce cas, pourquoi ces objets, innocents autant qu’inutiles, lui plaisent ou lui déplaisent-ils ? Comment expliquer, conséquemment à la théorie, son plaisir et son déplaisir ? Voilà la question. Comment la théorie réussira-t-elle à se tirer de ce mauvais pas ?
Quand on approfondit les objets ou les êtres en question, voici ce qu’on observe. Plus ces êtres ressemblent à l’homme et participent de sa nature, plus ils ont le don de lui plaire ; le fait est constant. Or la nature de l’homme, sa nature intime, première, fondamentale, c’est la force ; et sa loi est d’agir de toute part, continuellement, à l’infini, sans repos ; c’est de vivre pleinement et largement, c’est de dominer, c’est de vaincre. Quand donc l’homme voit un être où ne paraît pas l’ombre de la vie, où la matière étouffe et presse de son poids la force vive, c’est-à-dire ce qui est la nature même de l’homme, cet être lui déplaît. Mais s’il y voit la force de temps en temps se ranimer et comme se soulever sous le poids qui l’opprime, le déplaisir est pour lui moins grand, il est moins affligé. Puis quand il voit les plantes, où la force commence à donner signe d’existence et jette quelques lueurs, il y a pour lui commencement de plaisir, et parmi les plantes, celle-là lui plaira beaucoup moins, qui lourde et traînante, semble prête à tomber de langueur : celle-là beaucoup plus, qui svelte et légère, semble dans ses hardis élans secouer et défier la matière. Puis encore, quand il voit les animaux, où la force brille et se signale avec tant d’éclat et d’impétuosité, le plaisir est pour lui plus grand. Il est complet quand il voit les hommes, ses semblables ; il est extrême quand il voit, parmi les hommes, ses semblables, l’homme de génie, le héros, vainqueur et maître des formes corporelles qui l’enveloppent, vainqueur vigoureux et ferme, maître impérieux et suprême, autour de qui le mouvement, l’activité, la force, la vie circule, coule et se répand sans cesse à longs flots. Dans tous ces exemples, à la vue des héros, des hommes, des animaux, des plantes, et des choses inanimées, ce qui fait donc jouir ou souffrir la sensibilité de l’homme, c’est l’aspect de sa nature qui triomphe ou succombe ; et par là s’expliquent le plaisir et le déplaisir, que peuvent lui causer certaines réalités qui ne gênent en rien son développement et ne le favorisent en rien.
Ainsi voilà bien, pour nous résumer, voilà dans les deux ordres d’objets qui produisent en nous du plaisir, les deux principes du plaisir que ces objets produisent. Nous venons d’en rendre compte. Il y a d’une part un ordre d’objets qui plaisent à l’homme ou lui déplaisent, parce qu’ils sont utiles en aidant son développement ou nuisibles en l’empêchant, et le principe du plaisir qu’il ressent à leur vue, c’est ce qu’on nomme l’égoïsme. Il y a d’autre part un autre ordre d’objets, qui sans aider le développement de l’homme ou sans l’empêcher, lui plaisent encore ou lui déplaisent, parce qu’ils lui présentent l’image de sa nature triomphant ou succombant, et le principe du plaisir que leur aspect lui fait sentir, c’est ce qu’on nomme la sympathie.
Or la sympathie, l’égoïsme, ne peut-on pas les résumer sous une loi commune ? Le principe du plaisir que produit la sympathie, le principe du plaisir que l’égoïsme produit, ne peut-on pas les résoudre et les confondre dans quelque principe de plaisir supérieur, qui les embrasse tous les deux et les contienne en lui ? Ce qui fait que l’homme jouit, quand il aperçoit sa nature victorieuse, n’est-ce pas exactement ce qui fait qu’il jouit aussi, quand il est aidé dans son développement ? Voilà maintenant la nouvelle question. Peut-on ramener et ranger dans un lien commun l’égoïsme et la sympathie ?
L’homme plaît à l’homme. Il s’aime dès qu’il se sent. Il trouve en lui son principe, la force qui le constitue ; d’abord donc il s’aime dans son principe. Son principe a des tendances, il s’aime dans ses tendances ; rien n’est plus conséquent. Son principe se développe pour satisfaire ses tendances, il s’aime donc également dans son développement. Son principe se développe intellectuellement, puissamment, librement ; il s’aime donc aussi dans son intelligence, dans sa puissance, dans sa liberté ; c’est en effet lui, la force intelligente, puissante et libre, c’est toujours lui qu’il ne cesse pas d’aimer. Enfin son principe quand il se développe est favorisé : ne doit-il pas alors aimer ce qui favorise son développement ? Car il aime les tendances que son développement seul peut satisfaire, il aime le principe qui possède ces tendances, il s’aime dans ce principe. D’un autre côté son principe, quand il se développe, est arrêté : ne doit-il pas alors par opposition haïr ce qui arrête son développement ? Car arrêter son développement, c’est altérer les tendances que son développement veut remplir ; c’est détruire le principe qui ne marche pas sans ces tendances ; c’est l’anéantir dans son principe. L’homme prend donc en antipathie la matière, substance impassible et morte dont l’office semble consister ici-bas à gêner le libre jeu des forces, leurs mouvements faciles et naturels. L’homme, force gênée dans son action par la matière, se rallie partout à la force, dont la matière, son seul ennemi, mais son ennemi juré, gêne aussi l’action. Productif, il défend la productivité contre l’inertie. Pouvoir intéressé dans la querelle, il se coalise avec les pouvoirs, ses semblables, qui s’allient, se liguent, en sorte que tous ils se ressentent des succès d’un seul. Ainsi partout où la force triomphe, l’homme triomphe aussi : c’est un coup de plus porté sur l’ennemi commun ; partout où la force succombe, il s’afflige de sa chute et partage son désastre. Tel est le secret de la sympathie. L’homme s’aime, et les objets qui font triompher sa nature lui plaisent. L’homme s’aime, et les objets, qui sans faire triompher sa nature la lui font voir triomphante, lui plaisent encore. L’égoïsme et la sympathie sont des transformations de l’amour de soi. Nous nous aimons, voilà l’origine de tout plaisir. Tout ce qui nous plaît, c’est l’amour de soi qui fait que cela nous plaît.
Voici donc le point où nous sommes arrivés, voici la conséquence de tout ce que nous avons dit : les deux classes d’objets qui nous font plaisir, nous font plaisir de deux manières différentes, mais par la même raison. L’égoïsme et la sympathie rentrent dans l’amour de soi. Or, les objets beaux nous faisant plaisir, l’amour de soi doit se rencontrer en eux ; il doit s’en trouver là. Reste à savoir si c’est l’amour de soi sous sa forme sympathique ou sous sa forme égoïste, ou sous une autre forme. En d’autres termes, les objets qui sont beaux nous font-ils plaisir comme les objets qui font triompher notre nature, ou comme les objets qui, sans faire triompher notre nature, nous la montrent triomphante ? Ou le plaisir que nous causent les objets beaux est-il un autre plaisir que celui de l’égoïsme ou celui de la sympathie ? C’est ce qui nous reste à savoir, et ce qui nous conduira peut-être, quand nous le saurons, à quelques découvertes sur la nature du beau.
Retour sur la leçon précédente. – Justification de la méthode que nous suivons. – De l’égoïsme et de la sympathie considérés comme sources de plaisir. – Si les plaisirs du beau peuvent être ramenés à ceux de l’égoïsme ou si le beau est l’utile. – Réfutation.
Nous allons aujourd’hui réduire à leur expression la plus simple et la plus vraie les différents points de la dernière leçon.
Un caractère commun à tous les objets beaux est de faire plaisir. Peut-être n’est-ce pas le seul qui se trouve dans ces objets ; mais il est indubitable que tous le possèdent, que tous font plaisir.
Mais toutes les choses qui font plaisir, font-elles plaisir au même titre ? Si toutes font plaisir au même titre, découvrir à quel titre toutes font plaisir, ce sera découvrir ce qu’il y a de commun entre le beau et les autres choses agréables, l’élément qui distingue le beau de tout ce qui ne fait pas plaisir, et qui l’assimile à toutes celles qui font plaisir. Il restera alors à découvrir par quoi il se distingue des autres choses qui font plaisir sans être belles. Si au contraire toutes les choses qui font plaisir, ne font pas plaisir au même titre, ou au moins, de la même manière, en cherchant à quel titre le beau fait plaisir, nous trouverons non seulement ce qui le distingue des choses qui ne font pas plaisir, mais encore ce qui le distingue des autres choses qui font plaisir, mais non pas au même titre ou de la même manière. Dans cette hypothèse, il serait possible que ce qui constitue le beau ne fût qu’une manière de faire plaisir.
Quoi qu’il arrive, cette route offre des chances de découvertes sur le beau. Nous apprendrons au moins ce qui le distingue de tout ce qui ne fait pas plaisir, et si, sous le rapport du plaisir, il se confond ou se distingue des autres objets agréables.
Nous avons déjà distingué trois classes d’objets agréables, c’est-à-dire trois classes d’objets qui ne nous font pas plaisir au même titre, nous, les choses qui nous sont utiles, et les choses qui ont une nature analogue à la nôtre.
Nous ne disons pas que ce soient là les seules classes d’objets qui nous fassent plaisir, et que d’autres objets ne puissent être découverts qui fassent plaisir à d’autres titres, et nous espérons au contraire étendre cette liste incessamment ; mais nous disons que, connaissant déjà ces trois classes d’objets agréables, il est de bon sens de voir d’abord si le beau ne serait pas d’une de ces classes. S’il en est, nous nous épargnerons la peine d’aller plus loin ; s’il n’en est pas, nous aurons exclu de la classe des objets beaux trois classes d’objets qui font plaisir sans être beaux.
Il se passe ici dans notre méthode un fait singulier : nous cherchons si telle classe d’objets sont beaux, et nous nous promettons de le voir : or pour juger il faudrait que nous sussions ce que c’est que le beau, et cependant nous cherchons encore ce qu’il est : si nous le savions, notre cours serait fini.
C’est qu’au fond nous le savons, mais obscurément comme toutes choses. La science n’a d’autre but que d’éclaircir ce que nous savons d’abord sans nous en rendre compte. La preuve que nous savons ce que c’est que le beau, c’est que nous prononçons sur ce qui est beau, et que nous le distinguons de ce qui est laid. Notre but est donc d’examiner ce que nous sentons sur telle ou telle classe d’objets connus, afin de reconnaître si ce sont ou ne sont pas ces objets que nous sentons beaux ; si ce ne sont pas ces objets, ce n’est point le caractère propre de ces objets qui est le beau. Nous irons donc d’objets en objets, jusqu’à ce que nous sachions nettement lesquels nous sentons beaux, et lesquels nous ne sentons pas beaux ; cette délimitation opérée, les caractères propres et communs à tous les objets sentis beaux, seront le beau, ou du moins la condition du beau.
Revenons donc à nos trois classes d’objets qui nous font plaisir. Nous avons tenté de réduire à une même cause, de faire sortir d’une même explication le plaisir qu’ils nous causent ; nous ne disons pas que nous y soyons parvenus entièrement, et ici nous allons dire franchement ce que nous pensons.
Que nous aimions les choses utiles par la même raison que nous nous aimons nous-mêmes, cela nous paraît incontestable ; nous appelons amour de soi le principe de cet amour, et égoïsme la cause qui fait que nous nous plaisons à nous-mêmes, et que les choses utiles nous plaisent.
Mais que nous aimions les choses qui sont de même nature que nous, par la même raison que nous nous aimons nous-mêmes, c’est ce qui n’est point si parfaitement démontré. Là-dessus il peut rester bien des doutes. Et quant au fond, il serait réel que les natures analogues à la nôtre nous plaisent au même titre que les choses utiles, il resterait toujours une différence notable entre la manière dont les deux classes d’objets nous plaisent ; car les choses utiles ne nous plaisent que quand nous les avons jugées et reconnues propres à servir notre développement, en sorte que c’est bien par intérêt qu’elles nous agréent ; tandis que les natures analogues à nous, nous plaisent indépendamment de tout jugement semblable, c’est-à-dire sans intérêt patent, apparent, ni compris. En un mot, c’est par un égoïsme, dont nous avons conscience, par calcul, que les choses utiles nous plaisent ; si nous ne voyions pas leur utilité, elles ne nous plairaient point ; tandis que les choses analogues nous plaisent sans que nous voyions à quoi elles nous servent et indépendamment de tout objet d’utilité, quoiqu’au fond il soit possible qu’il y ait de l’amour de soi inaperçu dans l’amour qu’elles excitent en nous.
Il y a donc lieu de distinguer entre les motifs, sinon entiers, au moins explicites, du plaisir que nous causent ces deux sortes d’objets. Les objets utiles nous plaisent parce que nous les jugeons favorables à notre développement ; les natures semblables nous plaisent sans que nous les jugions favorables à notre développement, mais seulement parce que nous les reconnaissons natures semblables. Aussi notre amour pour ces dernières a-t-il été distingué de l’amour pour les choses utiles par un nom différent dans toutes les langues ; on a appelé sympathie cet amour, tandis qu’on a appelé égoïsme ou intérêt l’amour des choses utiles.
L’égoïsme est donc le principe du plaisir que nous cause notre propre nature et les choses qui lui sont utiles ; la sympathie, le principe de celui que nous causent les objets d’une nature semblable à la nôtre. Nous parlerons ainsi par la suite, et avec raison, parce que cette différence de nom représente une différence bien réelle dans les choses. Quant à savoir si la différence est au fond comme à la superficie, nous laisserons là cette question pour le moment, parce qu’elle importe peu à notre objet actuel.
Nous connaissons donc deux sources différentes de plaisir, l’égoïsme et la sympathie ; la sympathie n’est pas l’égoïsme, c’est-à-dire nous n’aimons pas certaines choses par la vue de leur utilité ; cela est certain ; mais la cause du plaisir que nous donnent les objets avec lesquels nous sympathisons, est-elle bien l’identité ou l’analogie de nature ? c’est une autre question.
Que toutes les choses qui nous plaisent d’une part, et qui de l’autre ne nous plaisent pas par la vue de leur utilité, nous plaisent par l’analogie de leur nature avec la nôtre, c’est ce que nous ne prétendons point, car ce serait prétendre qu’il n’y a que l’intérêt et l’analogie de nature qui dans les objets puissent nous causer du plaisir.
Mais que l’analogie de nature nous plaise, soit une source de plaisir pour nous, c’est ce que nous croyons incontestable.
En premier lieu, le plaisir que nous causent les différentes classes d’êtres croit ou décroît selon que l’on remonte à des espèces plus voisines de la nôtre, ou que l’on descend à des espèces plus éloignées, toutes choses égales d’ailleurs, et en supposant écartée toute autre cause de plaisir ou de déplaisir. Une fleur peut nous plaire plus qu’un homme, qu’un lion, si nous avons peur du lion, si l’homme est notre ennemi, si par connaissance de l’ingratitude et de la méchanceté humaine, nous haïssons les hommes, etc. Mais supposons un homme seul, abandonné dans une île dépouillée de végétation et d’êtres animés, indépendamment de toute idée de délivrance, que souhaiterait-il le plus d’avoir pour compagnie, ou d’un homme, ou d’un oiseau, ou d’un parterre de fleurs ? La société humaine est une solution de fait à la question ; si les espèces différentes nous agréaient plus que la nôtre, l’homme ne vivrait pas avec son semblable. Et avec quoi, après son semblable, l’homme sympathise-t-il le plus ? Avec les animaux, puis les plantes, puis les êtres inanimés.
Secondement, le plaisir que nous causent les différents individus d’une même classe d’êtres, est en raison directe de la plus grande vie manifestée par ces individus. Le plus animé nous plaît le plus ; le plus engourdi, le moins, toujours abstraction faite des autres causes de plaisir ou de déplaisir. Parmi les êtres inorganisés, nous préférons ceux dont les formes expriment le plus la puissance, la légèreté, la douceur, quelques qualités de la vie ; parmi les plantes, les plus vivaces, les plus élégantes, les plus gracieuses, les plus hardies ; parmi les animaux, les plus agiles, les plus forts, les plus intelligents, les plus sensibles ; parmi les hommes, les plus énergiques, les plus sensibles, les plus intelligents, et par-dessus tout les hommes de génie.
Enfin, dégagez l’humanité, et dans l’humanité l’être le plus parfait, des conditions matérielles, des appétits, des besoins, des chaînes du corps, imaginez l’ange développant sans entraves toutes ces qualités de l’âme humaine, vous sympathisez avec lui plus qu’avec l’homme.
Par ces raisons et d’autres encore trop longues à développer, nous croyons pouvoir compter parmi les causes de plaisir les plus générales et les mieux constatées, l’analogie de nature ou la sympathie, et dire qu’il y a des objets qui nous plaisent sympathiquement, tout aussi certainement qu’il y en a qui nous plaisent par utilité.
Voilà donc déjà dans ces objets deux sources de plaisirs distinctes bien constatées ; sans aller plus loin, examinons donc si nous ne reconnaîtrions pas que c’est à l’une de ces deux sources que le plaisir du beau doit être rapporté, si nous ne trouverions pas que c’est par la vue de leur utilité que ces choses belles nous plaisent, ou par la vue de leur analogie de nature avec nous.
Nous devons le dire d’abord, nous croyons par les considérations suivantes que l’utilité n’est point ce qui nous plaît dans le beau.
1° Si l’égoïsme était le juge de la beauté, ce qui serait le plus beau pour chacun de nous, ce serait nous-mêmes ; nous n’éprouverions dans aucun cas le sentiment du beau, le plaisir du beau que dans la conscience de notre propre individualité. Ce qui est le plus cher à l’égoïsme du moi, c’est le moi, toutes les autres choses ne lui sont chères que par rapport à celle-là et pour celle-là. Or, le plaisir du beau ne se trouve pas toujours dans les sentiments que nous avons de nous-mêmes.
2° Si l’utilité était le principe de la beauté, elle en serait la mesure ; les choses les plus utiles seraient les plus belles ; les moins utiles, les moins belles ; les plus nuisibles, les plus laides ; les moins nuisibles, les moins laides.
3° Toute chose utile serait belle ; toute chose nuisible, laide ; aucune chose inutile ne pourrait être belle ; aucune chose laide ne pourrait être utile ; aucune chose nuisible ne pourrait être belle ; aucune chose belle, nuisible.
4° Une chose cesserait d’être belle quand elle deviendrait inutile, et redeviendrait belle quand elle redeviendrait utile. La même chose serait ainsi belle et laide successivement, selon qu’elle serait utile et cesserait de l’être.
5° Un jugement d’utilité précéderait tout plaisir du beau, et on se sentirait apprécier et calculer l’utilité d’une chose pour décider sa beauté.
6° Il y a des choses belles qui sont en même temps utiles : un meuble, par exemple, une coupe à boire ; dans ce cas, on sent que l’esprit distingue l’utilité de la beauté, et n’induit pas l’une de l’autre. Les belles coupes antiques sont moins commodes que nos gobelets ; si elles étaient d’une forme moins belle, de proportions moins parfaites, elles seraient aussi utiles et cesseraient d’être belles ; il en est de même de tous nos meubles. Ce qui fait la beauté d’une maison, d’un palais, fait rarement son utilité. Les colonnes qui entourent la Bourse font sa beauté ; mais elles font qu’on ne voit pas clair dans les chambres ; j’aimerais mieux les maisons de la rue de Rivoli. Les palais italiens sont, dit-on, aussi incommodes que beaux. Un arbre chargé de fruits est aussi beau pour le passant que pour le maître ; ni l’un ni l’autre ne confondent l’utilité de son produit avec la richesse, la variété, la grâce et les autres beautés dont il réjouit les yeux.
7° Les hommes qui se sont plus occupés d’envisager les choses sous leurs rapports d’utilité, seraient les meilleurs appréciateurs de la beauté ; ce qui est si peu, que ce genre d’études pour l’ordinaire émousse le goût ; et qu’en revanche, l’amour du beau, la mesure du beau, éloigne des calculs de l’intérêt et de l’appréciation de l’utile : voyez les artistes.
Il y a un cas du beau qui semble prouver en faveur de la théorie de l’utilité. Dans une machine, par exemple, la perception du rapport des moyens à la fin excite souvent le sentiment du beau ; ce qui fait croire que c’est l’appréciation de l’utilité de la machine qui la fait trouver belle. Mais ce n’est pas l’utilité de ce que peut faire la machine qui la fait trouver belle ; c’est le rapport de toutes ses parties à une seule fin ; cette combinaison est seule belle. Ce qui le prouve, c’est 1° que l’admiration est la même quand la machine, comme les automates, ne produit rien d’utile ; 2° que ceux-là seuls trouvent la machine belle qui comprennent son mécanisme ; tandis que si on produit quelque chose d’utile, tout le monde peut le voir sans en comprendre le jeu ; 3° que si le résultat est immense quoique inutile, l’admiration est au comble, parce que c’est le fait de la puissance et non celui de l’utilité qu’on admire.
Nous ne pousserons pas plus loin ces réflexions, et nous passerons dans les prochaines leçons à l’autre des deux sources de plaisirs que nous avons indiquées.
Différence de l’utile et du beau. – Si le beau est le contraire de l’utile. – Phénomènes intérieurs qui accompagnent le sentiment du beau. – Phénomènes opposés qui accompagnent le sentiment de l’utile. – Caractère essentiel du beau : ne répondre à aucun besoin déterminé. – Nouveaux faits à l’appui. – Si le beau ne correspondrait pas à des besoins qui ne pourraient Cire satisfaits dans la condition présente. – Rapport entre les plaisirs du beau et ceux de la sympathie.
Le sentiment de l’utile n’est pas le sentiment du beau. L’utile n’est pas ce qui constitue le beau. Voilà tout ce que nous avons précédemment démontré.
Mais, quand on réfléchit davantage sur la nature du plaisir que font le beau d’une part et d’autre part l’utile, il semble qu’on peut aller plus loin et démontrer quelque chose de plus sur la distinction de l’utile et du beau. Nous dirons quoi tout à l’heure. Donnons d’abord quelques explications pour compléter ce que nous avons déjà dit.
L’utilité d’un objet se reconnaît pour moi de deux manières : par expérience, quand j’éprouve que l’objet m’est utile, au moment même je le vois, actuellement ; par prévision, quand je conçois que l’objet qui ne m’est pas actuellement utile, peut l’être postérieurement.
Dans les deux cas, le plaisir que fait l’utile est différent. Quand j’éprouve que l’objet m’est utile actuellement, quand je reconnais son utilité par expérience, quand je le touche avec mes sens, je jouis, parce qu’il me sert et satisfait un de mes besoins. Le plaisir est donc alors dans le sentiment d’un besoin satisfait.
Quand je conçois que l’objet qui ne m’est pas utile actuellement peut l’être postérieurement, quand je reconnais son utilité par prévision, quand je l’aperçois en perspective, je jouis encore, mais parce qu’il peut me servir plus tard et satisfaire un de mes besoins futurs. Le plaisir est donc alors dans le pressentiment d’un besoin futur satisfait.
Ainsi, quand on a dit, pour définir le beau : c’est un plaisir contemplatif ; si l’on a prétendu prendre ces mots dans leur acception la plus commune, dans leur sens le plus rigoureux, la définition du beau n’est pas juste. Car, soit devant mes yeux un objet, qui ne m’a pas servi, qui ne me sert pas, mais qui peut me servir, soit un objet enfin dont je reconnaisse l’utilité par prévision, je me plais en espoir et d’avance au bien qui ne résulte encore qu’en idée de son effet sur moi. C’est donc un plaisir contemplatif aussi que le plaisir produit, dans ce cas, par l’utile, et l’utile cependant ne constitue pas le beau.
Au contraire, si par plaisir contemplatif on entend le plaisir produit tout entier par la seule vue de l’objet, sans retour sur soi-même, la définition devient exacte. Car c’est là justement ce qui distingue le plaisir que fait le beau du plaisir que fait l’utile. Nous aimons l’utile pour l’effet que nous en éprouvons ou que nous espérons en éprouver ; nous aimons le beau pour lui-même, sans considérations personnelles, indépendamment de nous.
Ces explications données, nous allons continuer nos recherches, et dire maintenant ce qu’on peut encore démontrer sur la distinction de l’utile et du beau.
Soit devant nous tel ou tel objet qui nous affecte agréablement ; l’affection agréable qu’il nous imprime, ou le plaisir qu’il nous cause, fait naître fatalement en nous, à sa suite, un mouvement sensible : c’est l’amour par lequel nous tendons vers l’objet ; puis aussitôt et presque simultanément un autre mouvement de la sensibilité se développe : c’est le désir ; nous voulons approcher de nous l’objet, lors même qu’il ne peut nous servir à rien ; nous voulons nous unir à lui, l’attirer à nous ; et quand nous avons pu l’attirer à nous, quand nous nous sommes unis à lui, quand nous l’avons approché de nous, nous ne savons plus qu’en faire. Ainsi la rose que nous voyons nous plaît ; nous l’aimons, nous la désirons, et, quand nous la possédons, nous en sommes embarrassés. Tel est en nous un premier phénomène d’amour et de désir.
D’autre part, l’homme a des besoins naturels ou factices, et tout besoin n’est autre chose qu’une privation. Quand donc il aperçoit l’objet dont il est privé, viennent alors et se développent inévitablement en lui, comme ci-dessus, un mouvement d’amour, puis un mouvement de désir ; mais ici l’amour n’est plus le même ; le désir a changé, c’est-à-dire qu’il tend bien toujours vers l’objet qui l’affecte agréablement ; il veut bien toujours s’unir à lui ; mais la tendance qu’il suit n’est plus vaine ; l’union qu’il accomplit n’est plus stérile. Quand il s’est emparé de l’objet, il sait qu’en faire ; il n’en est pas embarrassé. L’emploi n’en est pas douteux ; il ne manque pas de l’appliquer au mal de privation dont il souffre et qu’il veut faire cesser ; il l’introduit en lui, si l’on peut ainsi parler, il l’amène et le conduit jusqu’au besoin qu’il faut contenter. Ce n’est donc plus vaguement qu’il aime et qu’il désire alors ; ce n’est plus sans savoir pourquoi, sans savoir à quoi bon ; c’est dans un but connu, fixe, précis et déterminé. Tel est en nous un second phénomène d’amour et de désir.
Or, ces deux phénomènes différents d’amour et de désir sont produits en nous, l’un par l’objet beau, l’autre par l’objet utile. L’objet beau ne me sert pas ; il est incapable de remédier à quelqu’une de mes privations déterminées ; sa possession n’aboutit à rien. L’objet utile, au contraire, se met à profit ; je n’ignore pas sa destination, si j’en suis maître ; son usage propre est de faire cesser des privations à lui particulièrement assignées. L’objet utile, nous le définirons donc l’objet qui peut satisfaire dans l’homme des besoins précis ; et l’objet beau, nous le définirons provisoirement l’objet qui ne correspond pas dans l’homme à quelqu’un de ces besoins ; le beau, dans ce cas, c’est l’inutile, le contraire de l’utile.
Et cependant l’inutile n’est pas l’indifférent, car nous aimons, nous désirons le beau, c’est-à-dire que nous tendons vers un objet qui ne peut nous servir ; nous voulons attirer à nous ce qui nous est d’aucun usage ; nous nous intéressons à ce qui ne contente pas en nous un besoin marqué ; la sensibilité s’émeut en nous à la vue du beau. Comment donc le beau, qui est l’inutile, n’est-il pas indifférent ? Voilà le miracle du beau, son secret, son mystère.
Mais revenons sur la définition du beau. Le beau, disons-nous, c’est le contraire de l’utile. Voici des exemples pour éclaircir et prouver le fait :
Soit une campagne, riche, féconde et couverte de moissons ; c’est un beau spectacle pour l’homme qui la voit et ne fait que la voir, la regarder, sans avoir égard à son utilité. Vienne le propriétaire : songeant à quels besoins le prix de ses moissons pourra satisfaire, le besoin de se nourrir, le besoin de s’enrichir et beaucoup d’autres, sa campagne n’est pas un beau spectacle pour lui. Quand il en pèse l’utilité, aussitôt il cesse d’en apprécier la beauté. Si quelquefois il lui semble que sa campagne est belle, c’est qu’alors, certainement, il ne pense plus au profit qu’il en peut tirer.
Pareillement, un beau fruit n’est plus beau pour l’homme qui a soif ; l’utilité du fruit a seule frappé son esprit.
La solution d’un problème peut être à la fois utile et belle. Le manufacturier qui en a besoin pour l’usage de sa manufacture, et qui la trouve, jouit d’en sentir l’utilité ; le mathématicien qui n’en a pas besoin, et qui la trouve aussi, jouit aussi, mais jouit seulement de la beauté qu’il y sent.
Ainsi, dans tous ces exemples, l’utile exclut le beau, non pas cependant dans ce qui est, mais seulement dans ce qui paraît ; c’est-à-dire que l’utilité peut se rencontrer avec la beauté dans une chose, que le même objet peut être utile et beau dans le même temps, mais non par les mêmes caractères ; il cesse, non pas d’être, mais d’être senti beau, quand on le sent utile ; le sentiment de l’utile exclut le sentiment du beau, non pas cependant encore que le sentiment de l’utile exclue à jamais le sentiment du beau, non pas que l’utilité d’une chose, une fois jugée, on n’en puisse plus juger dorénavant la beauté, non pas que la chose, quand on l’a d’abord considérée comme belle, ne puisse plus être considérée que comme belle ; mais le sentiment du beau détruit, étouffe, au moment même où il naît, le sentiment de l’utile. L’un des deux sentiments produit, arrête, à l’instant où il est produit, la production de l’autre. Dans un temps donné, la chose doit me sembler inutile, pour me sembler belle.
Faut-il de nouveaux exemples ? En voici : Les classes élevées et riches de la société, qui s’embarrassent en général très peu de l’utile, ont plus d’aptitude à goûter le beau que les classes pauvres et mal aisées, qui s’occupent de l’utile tous les jours de l’année.
Il n’y a que beauté pour l’artiste, dans l’incendie, dans la tempête, fût-ce même sa maison qui brulât ou son vaisseau que l’orage tourmentât ; mais pour le paysan, qui voit se consumer sa ferme, pour le matelot, qui voit la foudre suspendue sur lui, tout est crainte et douleur ; car ils sont accoutumés à considérer dans chaque chose le côté de l’utile, et non pas, comme l’artiste, le côté du beau.
Ainsi, pour nous résumer, l’utile n’est pas le beau, c’est-à-dire ce qui fait plaisir à l’homme et qu’il appelle beau. L’utile est quelque chose qui nous plaît, en satisfaisant un besoin qu’il rencontre en nous et qui lui correspond. Le beau est une autre chose qui nous plaît, sans rencontrer en nous un besoin correspondant qu’il ait à satisfaire. De là sort la différence du plaisir que fait l’utile, et du plaisir que fait le beau. Le beau ne s’applique pas à quelque besoin précis de l’homme ; tel est, non pas peut-être le seul, mais un de ses caractères essentiels. La condition nécessaire pour qu’un objet beau paraisse beau, c’est qu’il paraisse le plus qu’il peut inutile, sans qu’il puisse par là devenir indifférent ; car bien qu’il ne nous serve pas, et conséquemment nous fatigue quand nous l’avons trop longtemps entre nos mains en ne sachant qu’en faire, il nous a plu cependant ; nous l’avons aimé, nous l’avons désiré.





























