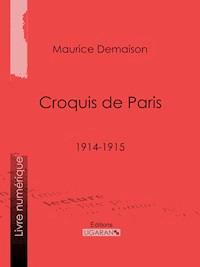
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Une détonation brève et sourde, et qui semble si proche qu'on dirait l'explosion d'un pneu dans la rue de Rivoli. Les vieux messieurs qui lisent le journal sur les bancs des Tuileries relèvent à peine la tête ; les enfants continuent leurs jeux. Une seconde, une troisième, puis deux autres encore. Cette fois, un petit garçon laisse tomber sa balle, et montrant du doigt la cime des marronniers, crie : « Un aéroplane ! »"
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AU
COMTE ÉTIENNE DE NALÈCHE
au directeur et à l’ami
HENRI DE RÉGNIER.
Ces notes ont été publiées dans le Journal des Débats. Quelques lecteurs ont eu l’indulgence de croire que, réunies en volume, elles formeraient un tableau de Paris pendant la guerre. L’auteur ne s’est pas rendu sans hésiter. Ces Croquis sont loin de composer une histoire. Ils n’ont commencé de paraître que vers les premiers jours de septembre 1914 ; on n’y trouvera donc ni les journées héroïques de la mobilisation, ni les semaines d’enthousiasme qui suivirent. Tracés sans ordre, au hasard des spectacles qui s’offraient à un passant, ils omettent trop souvent les faits autrement graves qui s’accomplissaient à l’heure où ces articles étaient écrits. Beaucoup de scènes qu’ils évoquent sembleront bien menuesau regard du drame qui se jouait près de nous. Mais les moindres aspects d’un si grand évènement valaient d’être fixés.
Le Paris de cette époque, un Paris qu’on n’avait jamais vu, est déjà loin de nous. Les pouvoirs publics quittaient la capitale. Privée de la présence de son gouvernement, mal instruite des espérances qui demeuraient permises, elle attendait les maux de l’invasion avec une fermeté qui restera son honneur. Dans le moment même où tout semblait perdu, la manœuvre oblique de von Kluck détourne d’elle le péril immédiat ; elle apprend d’abord les succès remportés sur l’Ourcq, ensuite ceux de la Marne ; puis, peu à peu, elle comprend que cette immense bataille, si lentement connue, a sauvé toute la France et brisé le plan de l’ennemi. Comment n’aurait-elle pas envisagé, dans un avenir prochain, la déroute des Barbares ? Une certitude absolue de la Victoire, l’ignorance des innombrables deuils qu’elle devait encore nous coûter, justifiaient l’allégresse virile avec laquelle chacun se résignait d’avance aux sacrifices nécessaires. Dans cette grande ville redevenue provinciale, une pensée commune unissait fraternellementles cœurs ; on se sentait entre soi, on pouvait causer en confiance et même sourire sans crainte de n’être pas compris.
L’auteur s’estimera heureux si, dans les plus frivoles de ces Croquis, le lecteur veut bien retrouver quelque chose des traits qui aux derniers jours de 1914, ont composé la figure vaillante et sereine de Paris.
Une détonation brève et sourde, et qui semble si proche qu’on dirait l’explosion d’un pneu dans la rue de Rivoli. Les vieux messieurs qui lisent le journal sur les bancs des Tuileries relèvent à peine la tête ; les enfants continuent leurs jeux. Une seconde, une troisième, puis deux autres encore. Cette fois, un petit garçon laisse tomber sa balle, et montrant du doigt la cime des marronniers, crie : « Un aéroplane ! » Fier de sa découverte, il a le ton si joyeux, la mine si triomphante, qu’on se demande s’il ne badine pas. « Un Taube ! » poursuit-il. C’est un Taube, en effet ; il l’a reconnu soudain à la courbe des ailes, avec la certitude d’un aviateur consommé.
Toutes les têtes sont maintenant levées vers le zénith, tous les regards fixés sur le ciel blanc. Le Taube plane très haut ; il monte plus haut encore, virant vers le nord-est, tandis que, de divers points, crépite une fusillade. Les échos empêchent de distinguer d’où elle vient ; les coups semblent partir du bord de l’eau ou de la place de la Concorde ; les journaux annoncent ce matin qu’on tirait de la Pépinière et d’un café près de l’Opéra.
À chacune des salves, on s’attend à voir fléchir le Taube, méchant oiseau qui porte un nom de colombe ; mais les yeux, éblouis par la blancheur du ciel, voient danser des lucioles, perdent la trace de l’avion et, quand ils l’ont retrouvé, l’aperçoivent tout petit, bien loin derrière Montmartre.
Des conversations s’engagent entre les promeneurs ; des groupes se forment ; des spécialistes improvisés pérorent ; ils comparent nos aéroplanes à ceux de l’ennemi ; ils savent tout de l’aviation et de la stratégie.
Dans le quartier qui s’étend des Tuileries aux boulevards, concierges et boutiquiers sont debout devant les portes ; ils continuent d’interroger le ciel où il n’y a plus rien, tout en devisant le plus tranquillement du monde. Sur la chaussée, libre de voitures, les piétons marchent du pas accoutumé, regagnant leur domicile après la journée faite. Aucune fièvre, aucune agitation. « Ça, dit un philosophe, ça ne serait bon que pour la panique. Mais les Prussiens se trompent ; ils nous rendent service : nous sommes tellement badauds que ça nous fait passer le temps. – Après tout, dit un autre, qui montre du geste la rue vide, nous avons le risque des bombes, mais au moins les autobus ne nous écraseront pas. »
(3 septembre 1914.)
Quatre heures. C’est le moment où le travail bat son plein. Il y a six semaines, bien que la saison fût déjà avancée, taxis et équipages s’alignaient le long du ruisseau sur plusieurs rangs et en files serrées. Sur le trottoir, on avait peine à fendre le flot qui se pressait vers les portes, à se frayer un passage parmi la foule des demi-élégantes, en quête d’une occasion, qui assiégeaient les comptoirs en plein air, retournant les coupons, les rubans et les soldes d’un geste avide et affairé. Sur la façade d’arrière, tout un peuple de facteurs engouffrait des tapis, des meubles, de la vaisselle dans les grandes autos de livraison.
Aujourd’hui, plus de voitures, plus de comptoirs au-dehors ; quelques rares passantes qui ne s’arrêtent même plus aux devantures ; on circule aussi librement que dans une rue d’Auteuil. On entre. Sous ce hall, jadis bourdonnant de rumeurs et qui, vu des galeries d’en haut, rappelait une fourmilière, solitude et silence complets. Les avenues sont désertes ; on aperçoit d’un bout à l’autre l’étendue luisante du parquet et les dessins insoupçonnés de ses voliges en point de Hongrie. Il y a encore tout un personnel mâle d’employés en jaquette et d’inspecteurs en cravate blanche ; mais ce personnel a les tempes grisonnantes et le ventre arrondi ; c’est fini des jolis vendeurs à la taille fine, à la moustache mousseuse, qui souriaient au rayon des gants et faisaient apprécier la qualité des Suède avec des gestes si caressants.
De temps en temps, une cliente arrive. Elle ne s’attarde pas, elle n’a même point à lutter contre les tentations, elle ne regarde pas. C’est une ménagère qui va aux choses sérieuses, à la chaussure, à la flanelle et qui va tout droit vers son but. Peu de monde à la confection, très peu aux modes ; à la dentelle personne. Le rayon de librairie est encombré de cartes géographiques, celui des jouets vend des drapeaux aux couleurs des alliés, des bannières de Jeanne d’Arc, et tient même en réserve deux ou trois étendards aux armes de Savoie.
Le rayon le plus achalandé est un rayon nouveau, celui des ambulances. On y vend du matériel d’hôpital, du coton hydrophile, de la toile à pansement. Et l’on admire dans une vitrine la dernière création de la couture parisienne, un costume complet de dame de la Croix-Rouge, auquel, par habitude, la main de l’étalagiste a su donner une élégance exquise en imprimant à la jupe de laine blanche les plis savants et la grâce ondoyante d’une toilette de soirée.
(4 septembre 1914.)
Un arrêté du préfet de police a fermé la Bourse des valeurs. Plus d’un capitaliste doit trouver que cette mesure s’est fait beaucoup attendre ; ceux qui ont mis en portefeuille de la rente autrichienne estiment pour le moins qu’elle retarde d’une année.
La Bourse n’offre jamais au profane un spectacle bien attrayant. Pour le rentier timide qu’une mauvaise étoile égare sous ses portiques, c’est un peu un cercle de l’enfer où démons et damnés poussent des cris sauvages. On entend leur clameur longtemps avant de les voir ; elle domine le bruit des tramways, la trompe des taxis et celle des autobus, tout le tumulte de la rue. Au sommet du perron, entre les lourdes et noires colonnes corinthiennes, semble se dérouler une parade singulière ; des énergumènes, juchés sur des bancs, échangent des vociférations et des gestes enragés. On franchit les portes non sans peine, giflé par les battants qui retombent, poussé tour à tour et refoulé par le flux et le reflux. On arrive dans le hall. Des gens affolés vous bousculent sans vergogne, impétueux et brutaux comme s’il était question de gagner cent mille francs ou de ramasser deux sous. Un charivari effroyable emplit la vaste nef et monte jusqu’aux voûtes où Abel de Pujol a simulé en grisaille les bas-reliefs d’un Phidias éclos sous Louis-Philippe. Une mêlée furieuse empêche d’approcher du milieu de la salle ; on ne distingue pas ce qui peut s’y passer ; mais, à en juger par les cris, un Huron ne douterait pas qu’on n’assassine quelqu’un. Une cloche retentit ; les hurlements redoublent aux premiers coups et décroissent ensuite pour finir en murmures ; les combattants se séparent, laissant le champ de bataille tout fumant de poussière et couvert de papiers.
Depuis un mois, la Bourse était l’asile du silence et de la désolation. Personne aux abords du parvis, personne sous les portiques, personne aux Pieds-Crottés. Dans la nef, plus un cri. Au lieu des milliers de fidèles qui d’habitude, en guise de livres de prières, y tiennent des carnets, deux cents vieillards au plus, princes des prêtres ou anciens du peuple qui, nourris dans le temple, n’avaient pu s’affranchir d’une routine demi-séculaire. Réunis en petits groupes, ils causaient à voix basse ou, solitaires, ils lisaient leur journal, assis sur les strapontins, dans l’ombre des bas-côtés.
Le centre de la salle, le saint des saints, jadis inaccessible, se montrait entièrement à nu ; on y découvrait la « corbeille », qui ressemble à une garderie d’enfants, et je ne sais quelle enceinte, au parquet relevé en cône, pareille à quelque jeu bizarre de casino. Pas une offre, pas une demande ; point d’affaires ni de commission. La cloche tintait un glas, et l’assistance se dispersait avec des mines d’enterrement.
La Bourse a la figure d’un temple. On y honore un dieu à deux visages, dieu de la hausse et de la baisse ; mais, à la différence de celui de Janus, ce temple s’ouvre dans la paix et se ferme dans la guerre.
(7 septembre 1914.)
Paris peut être tranquille : il ne mourra pas de faim. Il voit de ses yeux, le dimanche, les troupeaux assemblés dans le bois de Boulogne ; ce n’est qu’une faible partie des vivantes réserves qu’il a autour de lui et qu’il ne soupçonne pas. Sur tout le périmètre du camp retranché, l’intendance a ménagé des parcs où paissent par milliers les bœufs, les veaux et les moutons. L’un d’eux est installé dans le domaine de Sceaux.
Les habitués de Robinson savent l’emplacement de ces jardins magnifiques dont ils aperçoivent les pelouses du haut de Malabry ; mais bien peu de Parisiens en connaissent autre chose que cette vue cavalière et la muraille interminable qui, de près, les dérobe aux passants.
Derrière ce mur, subsiste l’un des plus beaux domaines de l’ancienne France. Colbert l’avait créé en 1671 ; après la mort de son fils Seignelay, il passa au duc du Maine, puis au duc de Penthièvre ; il appartient aujourd’hui aux descendants de Mortier, duc de Trévise.
Du palais construit par le Vau, ou peut-être par Claude Perrault, l’architecte du Louvre, il ne reste plus rien ; un château du second Empire, sans grand caractère, s’est bâti sur ses ruines ; on ne reconnaît, d’après les vieilles gravures, que la grille d’entrée avec ses logements de gardes et ses groupes d’animaux, quelques communs, une superbe orangerie et le délicieux pavillon de l’Aurore. Celui-ci occupe, dans un angle du parc, du côté de Bourg-la-Reine, une petite hauteur, d’où la vue devait s’étendre sur Fontenay-aux-Roses. C’est une retraite charmante et silencieuse. Une rotonde, surmontée d’un dôme et flanquée de deux cabinets, s’élève sur un double perron. Au dedans, des pilastres de stuc soutiennent une coupole, décorée par Lebrun de fresques mythologiques qui s’effacent sous l’injure du temps.
Au contraire, la beauté du parc demeure presque entière. Les bosquets ont perdu la plupart des chefs-d’œuvre de sculpture qu’un ministre tout-puissant et un fils de roi y avaient prodigués ; on ne retrouve plus ni la Diane de bronze, offerte à Servien par Christine de Suède, ni l’Hercule gaulois, acheté par Colbert à Puget. La cascade, autrefois célèbre, a été remplacée par un tapis vert, comme, sous Louis XV, celle de Marly. Mais le plan de Le Nôtre survit, avec son admirable parterre, ses grandes voûtes de verdure, plus ombreuses que celles de Versailles, son canal long d’un quart de lieue, ses bassins où chantent les jets d’eau.
La hauteur des terrasses, la pente des allées offrent de tous côtés des perspectives imprévues, un pittoresque plus animé que ne l’est d’ordinaire celui des parcs français. Çà et là, sur des piédestaux, se dressent des figures de dieux, figures souvent médiocres, mais d’un style si rustique et d’une pierre si fruste qu’on dirait que la nature elle-même a modelé des rochers en forme de statues.
Au coucher du soleil, tandis que, du parterre, on contemple une dernière fois, par-delà Aulnay et la Vallée aux Loups, la courbe exquise des bois de Verrières, on entend monter, de la prairie où fume le grand canal, les mugissements des bœufs ; ils dominent à peine le tumulte enragé des grenouilles.
Cette transformation agricole scandaliserait peut-être l’ombre fluette de la duchesse du Maine. Celle de Colbert, plus grave, n’en serait point surprise. Ce ministre positif, quand il acheta la baronnie de Sceaux et Châtenay, commença par y établir « un marché de bestiaux pour l’approvisionnement de Paris ». Ayant ainsi réglé l’intérêt du public et le sien propre, il ne songea qu’ensuite à son plaisir et au soin, d’ailleurs superflu, de bâtir sa maison de repos.
(9 septembre 1914.)
J’avais pour amis tous les chiens de mon quartier ; je les saluais, le matin, quand ils allaient avec leurs femmes de chambre faire les commissions ; je ne les rencontre plus. La netteté du trottoir y a beaucoup gagné ; je regrette cependant mes amis à quatre pattes.
L’exode avait commencé dès le mois de juillet, car les chiens de mon quartier fréquentent les bains de mer ; mais la grande dispersion date de ces dernières semaines. Leur départ fut toute une affaire. On ne les acceptait pas dans les trains militaires, refus bien naturel puisque la place manquait pour les personnes ; seuls, des roquets de manchon forcèrent la consigne ; à la faveur d’un panier ou d’un sac, ils voyagèrent incognito. Les autres, plus gros seigneurs, sont partis en automobile, et c’est là qu’on a vu l’attachement de leurs maîtres. Sans le dogue, la famille eût pris le chemin de fer ; à cause de lui, elle s’est payé un taxi de douze cents francs. Tout le monde ne marche pas comme ce propriétaire qui, pour mettre en sûreté sa meute, l’a conduite aux Andelys à pied et est revenu ensuite s’enfermer dans Paris.
La place des chiens de luxe n’est pas dans une ville assiégée. Ils ont les nerfs trop délicats. J’ai connu un King Charles si sensible au bruit du canon qu’il tombait malade à chaque visite royale et qu’à la venue des souverains danois il mourut d’un arrêt du cœur.
L’humble cabot offre plus de résistance ; vieux faubourien habitué aux taloches, aguerri aux pétards par le Quatorze-Juillet, il ne redoute ni les bombes des avions ni les obus des mortiers de 42. Il n’a même point souci de la famine. Pourtant, aux premiers jours de la mobilisation, on voyait parfois un pauvre diable de chien, couché en travers de la rue, anéanti de fatigue, de faim et de tristesse. On sentait qu’il avait erré nuit et jour, à la recherche de son maître envoyé sur le front.
Ces orphelins ont fini par trouver asile ; on les a recueillis dans les quartiers populaires, où les toutous sont plus nombreux que jamais ; d’autres mangent la soupe à la porte des casernes ; plusieurs ont adopté des territoriaux. Ils gardent avec eux les ponts de l’avenue du Maine ; ils patrouillent sur les voies ferrées de la banlieue.
La guerre aura permis aux chiens de mesurer leur puissance. Une ménagère modèle avait juré de suivre son mari partout, même sur la ligne de feu : « On ne vous laissera pas faire. – Si ; si ; j’irai jusqu’à Berlin. » Deux jours après, son mari, ouvrier bottier, était convoqué dans un dépôt du Centre pour y travailler de son état : « Vous partez avec lui ? – Ah ! non, répond l’épouse ; il me l’a demandé ; mais il ne veut pas que j’emmène Clairon. »
Le chien est l’ami de l’homme ; mais c’est la femme qui est l’amie du chien.
(11 septembre 1914.)
On distingue deux sortes de guerriers : les militaires et les stratèges. Les premiers, comme leur nom l’indique, appartiennent à l’armée ; les seconds se recrutent dans le civil. Ceux-là opèrent en rase campagne, sous la pluie, le soleil et les balles ; ceux-ci manœuvrent en ville, dans la fumée des pipes, derrière un rempart de soucoupes.
Le combattant de café, depuis qu’on l’a sevré de sa « verte », couleur de l’espérance, se sent porté à la mélancolie. Vainement, vous essayez de dissiper son humeur chagrine. Une journée sans victoire est pour lui une défaite ; un succès même ne le rassure pas. La retraite des Allemands pourrait n’être qu’une feinte : s’ils reculent à l’aile droite, c’est pour enfoncer le centre. À chaque nouvelle heureuse, il répond en hochant la tête ; mais deux craintes surtout l’empoisonnent : il a peur d’être coupé, il se méfie de la marche débordante.
En chemin de fer, en tramway, sur le seuil de la loge où se réunit, le soir, tout un état-major, on discute aussi le plan de campagne. Le belligérant de la rue se montre plus optimiste que celui du café : il ne doute pas de la victoire. Mais l’un et l’autre ont des vues aussi simples et disent les mêmes mots. La seule différence, c’est que, selon le caractère des gens et leur fermeté d’âme, ils emploient l’actif ou le passif : « Nous coupons ; nous sommes coupés ; nous débordons ; on nous déborde. » La science des stratèges se résume presque toute dans cette conjugaison. « Couper, envelopper, » disait le général Boum dans la Grande-Duchesse. Les Napoléons de la guerre en chambre sont de l’école de Gérolstein.
Pourtant un troisième cliché complète leur vocabulaire ; c’est « la ligne de communications ». Ils en saisissent l’importance ; ils savent que l’ennemi a hasardé la sienne et lorsqu’ils la décrivent, elle s’allonge, s’étire, s’amincit comme la ficelle d’un cerf-volant, pour mieux nous représenter que « les Allemands sont en l’air ».
Les stratèges sont géographes. Qui ne l’est pas ? À la devanture d’un libraire, j’ai vu, l’autre jour, une brave femme chercher l’Autriche sur une carte de l’Europe ; quand elle eut mis le doigt dessus, elle parut fort peinée parce qu’elle ne voyait pas Lemberg dans la banlieue de Vienne. Les stratèges placent Coulommiers en Beauce et l’Ourcq à la Villette. Ils parlent de la vallée de l’Argonne ; ils ne doutent pas que ce ne soit un cours d’eau ; ils hésitent seulement à dire où elle se jette, si c’est un affluent de la Marne ou de la Meuse. Il y a, comme cela, des rivières qui se révèlent tout à coup. Pendant les inondations, un sujet d’inquiétude était la crue d’un des Morins, grand ou petit, je ne me souviens plus. « Est-ce curieux ! disait un de ces Parisiens qui ne franchissent guère l’enceinte des fortifs, cet animal de Morin, personne n’en a jamais parlé. – Ah ! pardon, répondit quelqu’un, Maupassant, dans un de ses contes. »
(13 septembre 1914.)
L’habitude, dit-on, est une seconde nature. C’est aussi une seconde vue. Bien que les Allemands s’éloignent et avec eux la crainte de leurs zeppelins-fantômes, on continue de tenir dans une obscurité profonde de vastes régions de Paris. Des soirées admirables, les plus pures qu’on ait eues de tout l’été, une pleine lune resplendissante éclairaient d’abord ces ténèbres ; maintenant la lune décroît, le ciel n’a plus d’étoiles, les nuages qui l’obstruent arrêtent court le rayon des projecteurs électriques ; dès sept heures, c’est la nuit épaisse. Nos yeux s’y sont accommodés ; comme le chat et les oiseaux nocturnes, les Parisiens se sont accoutumés à voir à travers l’ombre ; ils se dirigent sans trop de peine et sans mauvaise humeur dans cette obscurité.
Quand on commença à nous rationner l’éclairage, ce fut pour éteindre les lanternes des ponts ; les gens de la rive gauche furent seuls à s’en apercevoir et n’en eurent point d’alarme. Le lendemain, brusquement, d’immenses quartiers étaient privés de lumière ; on ne put s’empêcher de sentir un petit frisson. Pour la première fois, l’imminence du péril, l’approche de l’ennemi, d’autant plus redoutable qu’on était sans nouvelles précises, s’imposait à l’esprit. À ce moment, l’amour de la verdure se réveilla chez beaucoup de Parisiens ; on les vit se porter vers les gares avec un impérieux désir de goûter la fraîcheur des bois ou le grand air du large.
Ceux qui restaient eurent des heures de tristesse. Ils se sentaient abandonnés ; les uns après les autres, pour des motifs souvent fort légitimes, ils voyaient partir des compagnons sur lesquels ils avaient compté. Les maisons amies se fermaient, les restaurants se vidaient et, lorsqu’on rentrait le soir, le long des rues désertes, on trouvait un visage étranger, presque hostile, à toutes ces façades mornes, à ces kyrielles de volets clos.
De loin en loin, une lumière brillait comme une veilleuse dans la ville endormie : c’était la fenêtre « d’un qui était resté ». Souvent on n’apercevait que par l’entrebâillement des rideaux la lueur discrète de la lampe ; quelquefois les carreaux grands ouverts laissaient voir toute la pièce, une salle à manger avec sa suspension et la vaisselle des bahuts, ou bien encore un cabinet de travail avec les livres de la bibliothèque, les gravures pendues à la muraille et un crâne laborieux penché sur le bureau.
Chaque soir, aux mêmes heures, on retrouvait éclairées les mêmes fenêtres et, derrière elles, la famille attablée ou le savant perdu dans son étude. Quels gens étaient-ce ? On ne le savait point, on n’éprouvait même pas la curiosité de le savoir ; mais on se sentait pour eux un peu de gratitude et une vague tendresse. Leurs fenêtres devenaient des amies. On aurait eu de la peine, de la désillusion à les voir se fermer. Aucune de ces amies ne s’est montrée infidèle ; on les salue du regard avant de rentrer chez soi.
(15 septembre 1914.)
Ils appelaient Paris Babylone et c’est une des raisons, au moins l’un des prétextes qu’ils se donnaient pour vouloir le punir. Ils seraient bien surpris s’ils pouvaient y entrer.
Une ville de province, plus grande que les autres, plus silencieuse et plus tranquille. Dans la rue, des passants au visage sérieux qui ne musent point et vont à leurs affaires. Pas de luxe insolent. Aucun de ces équipages qui, en d’autres capitales, promènent des financiers repus et des demoiselles à falbalas ; riches ou pauvres, tout le monde prend le métro. Nulle boutique fastueuse pour tenter la concupiscence par l’étalage de perles, diamants, dentelles, broderies et autres vaines parures. Des magasins modestes et qui n’offrent au regard que des choses solides, telles que provisions de bouche, chaussures, vêtements, tous objets de première utilité.
La population est si sobre qu’on peut clore les cafés tous les soirs à huit heures, les restaurants à neuf heures et demie. Ces restaurants sont la simplicité même ; on y mange à des prix de bouillons. Il y en avait de plus opulents ; ils ont fermé depuis qu’ils n’attendent plus la visite d’un auguste monarque qui pourtant avait pris la peine de se faire annoncer. Au café, gardez-vous de commander une absinthe ; vous feriez scandale ; le garçon vous mettrait à la porte, aidé par les consommateurs pour qui l’extrême débauche est un verre de quinquina.
Vous ne trouveriez dans Babylone ni une maison de jeu, ni une agence de pari mutuel ; les champs de courses sont délaissés à ce point qu’on y engraisse des bœufs. Les théâtres, les music-halls ont renoncé à attirer la foule, que rebutait leur bêtise obscène ; à peine subsiste-t-il quelques innocents cinémas.
Les apaches ont disparu comme par enchantement ; avec eux, le meurtre et le vol ; les rues sont devenues si sûres qu’on peut sans imprudence éteindre les becs de gaz ; les rares noctambules, n’étant plus ivrognes, ne risquent pas de méconnaître leur maison dans cette obscurité. Comme il n’y a plus de crimes, le public en a perdu jusqu’à la notion ; les journaux, purgés des faits divers et des romans de police, peuvent intéresser leurs lecteurs à des sujets intelligents.
Babylone était infestée de politiques, dont les rivalités ignobles mettaient en péril tout l’État ; on n’y entend plus de bavards, on n’y voit plus de brouillons, on ne rencontre que des figures honnêtes.
Ainsi, en peu de semaines, cette ville tant décriée est devenue la plus vertueuse du globe ; elle s’est même dépouillée de sa nervosité habituelle. Elle s’est faite docile, patiente, raisonnable ; elle supporte sans murmure les gênes qu’on lui impose, accepte d’ignorer ce que l’on juge à propos de lui taire, s’attriste des insuccès sans se décourager, se réjouit des victoires sans clameurs et sans fanfaronnade. Il a suffi, pour opérer ce prodige, de lui promettre que, si elle était sage, on la débarrasserait pour toujours du cauchemar allemand.
(17 septembre 1914.)
Le premier soir, vers cinq heures, les tramways s’arrêtèrent, les autobus s’évanouirent soudain ; tapissières, camions et voitures de maître, réquisitionnés par l’armée, allèrent se parquer sous les quinconces des Invalides ; il ne resta sur la chaussée que des taxis filant à toute vitesse et conduisant aux gares les militaires mobilisés. Point de chauffeurs pour les civils. Leur morgue dura cinq ou six jours ; puis ils s’humanisèrent et condescendirent à charger des bourgeois. Ensuite ce fut l’exode ; les familles, échouées parmi leurs paquets en détresse, se flattaient vainement d’aller à Montparnasse ; les chauffeurs passaient dédaigneux ; ils n’avaient de regard que pour le client de luxe à qui l’on pouvait confier sur un ton de mystère qu’on avait un sauf-conduit « pour toute la province ».
Les taxis redeviennent abordables, mais la demande se fait rare ; les tramways marchent, mais ils passent moins souvent et circulent moins tard ; au roulement continu, au fracas de tonnerre a succédé un silence rompu de temps à autre par l’appel d’une trompe ou le trot d’un cheval ; le calme est si profond qu’on entend au loin, à neuf heures et demie, sonner dans les casernes l’extinction des feux.
Au début, les camelots criaient à tue-tête leurs éditions spéciales, des victoires antérieures à la première rencontre, les Russes dans la banlieue de Berlin, ou la mort du kronprinz. Une autorité judicieuse a mis ordre à cela. Les camelots ne crient plus, et ne vendent pas un exemplaire de moins. Ce personnel s’est beaucoup affiné. Les aboyeurs brutaux qui vous bousculaient sans merci ont fait place à des vieillards discrets, à des adolescents, surtout à des jeunes filles qui trouvent le moyen de disposer gracieusement le titre du journal en guise d’écharpe sur leur corsage.
Il a fallu une guerre, une guerre qui mette à feu les trois quarts de l’Europe, sans compter le Japon, pour faire apercevoir qu’on peut vendre des journaux sans affoler tout le monde, que le public les trouve, quand il en a envie, comme il trouve du tabac ou de la pâte à reluire, et qu’un peuple, pour vivre, n’a pas besoin de connaître, à cinq heures tapant, le résultat des cœurses.





























