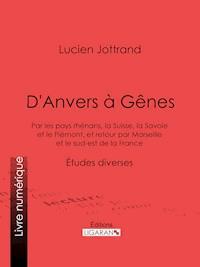
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est encore une rivière des Pays-Bas, disent tous ceux qui voient le Rhin à Cologne, après avoir visité la Hollande et la Belgique. Les Anglais, préparés par Byron à ce Rhin qui présente l'assemblage de toutes les beautés, sont étonnés en arrivant, de se trouver sur les rives plates d'un cours d'eau plus souvent trouble que clair. De rochers, de forêts, de vignobles, de vieux châteaux forts, pas la moindre apparence."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Notre Belgique n’est que le premier anneau d’une chaîne de petits pays que la Providence, bien avant les traités politiques, a tendue, de l’Océan à la Méditerranée, entre des pays plus grands, condamnés, dirait-on, à une rivalité éternelle.
Le long de cette chaîne se sont posés tous les problèmes difficiles du gouvernement des peuples : différences de religion, différences de langage à concilier dans une même nation ; institutions représentatives sous des chefs héréditaires, institutions républicaines fédératives ; suffrage universel, suffrage restreint ; armées permanentes, armées non permanentes, armées mixtes ; judicature élective inamovible, judicature non élective inamovible, judicature périodiquement élective ; administration centralisée, administration localisée.
Dans ces derniers temps la chaîne est devenue une sorte de conducteur de la grande politique anglo-saxonne entre la France d’un côté, l’Autriche et l’Italie de l’autre. L’escadre anglaise remontant l’Escaut jusqu’à Anvers, en juillet 1852, à la suite de la reine Victoria ; le port de refuge et de radoub à la Spezzia, concédé, presqu’à la même époque, par le roi de Sardaigne, aux escadres des États-Unis dans la Méditerranée, ont indiqué déjà l’usage qui pourra être fait de ce conducteur.
En voilà plus qu’il ne faut pour justifier l’intérêt que l’on accorde généralement à tout ce qui se passe en Belgique, sur les bords du Rhin, en Suisse et dans les États sardes.
Grâce à cet intérêt, nous réussirons peut-être à faire agréer par le public ce livre, fruit d’une étude assidue de la situation de notre pays, et d’un voyage d’observation entrepris, en dernier lieu, chez des peuples que nous croyons solidaires de cette situation.
De Gênes, terme de ce voyage, nous sommes revenus par Marseille, Lyon, la Bourgogne et Paris, juste au moment du pèlerinage que Louis-Napoléon faisait pour gagner les indulgences que l’on sait. Nous n’avons pas cru devoir omettre les renseignements qu’il nous a été donné de recueillir en cette occasion sur l’esprit de cette partie de la France.
Sur un chemin où l’on rencontre successivement les cathédrales, les ruines et les vignobles des bords du Rhin ; les lacs et les montagnes de la Suisse et de la Savoie ; les fertiles campagnes du Piémont ; les belles eaux de la Méditerranée ; le Rhône impétueux ; la Saône, l’Yonne et la Seine, ces trois sœurs véritablement gauloises, le touriste politique ne pouvait manquer de s’oublier de temps en temps et de se laisser aller à quelques descriptions dont le moindre défaut sera, sans doute, de venir après cent descriptions du même genre. Son excuse a déjà été présentée ailleurs : le point de vue allemand, français, anglais lui semble parfois différent du « point de vue belge ». C’est à ce dernier point de vue qu’il a surtout essayé de refaire ce qu’on avait déjà fait avant lui. Pourquoi n’y aurait-il pas, en ce genre aussi, « une école flamande » ?
Pour le dessiner à grands traits, voici le tableau que l’histoire nous offre des peuples qui, de la mer du Nord au golfe de Gênes, s’interposent aujourd’hui entre la France et la monarchie prussienne proprement dite, sur un point ; la France et la monarchie autrichienne, sur un autre point.
Au temps de Jules César, des embouchures de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin, jusqu’à une grande distance sur le cours de ces fleuves en les remontant, le pays est occupé par les Bataves et les Belges, déjà distincts du gros des Germains et des Gaulois. Des premiers, en effet, Tacite dit qu’ils sont les plus vaillants de tous les Germains ; des seconds, César dit qu’ils sont les plus courageux de tous les Gaulois.
Les Cattes viennent ensuite, en continuant de remonter le Rhin jusqu’au Mein. Ce sont encore des Germains distincts des autres. Tacite témoigne qu’à son époque les Romains les exemptaient toujours de l’impôt et les ménageaient comme d’excellents auxiliaires pour la guerre.
Les Helvétiens touchent les Cattes, et ce sont des Gaulois dont César dit, comme des Belges, qu’ils sont particulièrement courageux à cause de leurs guerres continuelles contre les Germains.
Au territoire des Helvétiens, vers le midi, confine le territoire des Allobroges. Genève, dit César, est le point intermédiaire entre les deux nations. L’importance toute spéciale des Allobroges, au temps dont nous parlons, est prouvée par ce que dit Salluste de leur participation à la conjuration de Catilina. Cet historien leur donne d’ailleurs le même certificat que Tacite et César ont donné aux Bataves, aux Belges, aux Cattes, aux Helvétiens : « Ce sont de leur nature des Gaulois très belliqueux. »
Sous ces dénominations de Bataves, de Belges, de Cattes, d’Helvétiens et d’Allobroges, nous venons de passer en revue ce qu’on appelle aujourd’hui les Hollandais, les Belges, les Rhénans-Prussiens, les habitants du duché de Nassau, les Hessois, les Badois, les Suisses et les Savoyards ; et nous avons, pour faire cette revue, parcouru cette continuité de vallées qu’arrosent successivement, du pied des dunes au pied des Alpes, l’Escaut, la Meuse, le Rhin, deux de ses grands affluents le Mein et le Necker, et enfin les premiers rudiments du Rhône. Puisque nous sommes Belges, notons, en passant, que, seuls de tous ces peuples, nous portons encore notre ancien nom.
Des Alpes jusqu’au golfe de Gênes, nous trouvons, au temps de César, des populations confondues parmi les autres populations du reste de l’Italie. Mais n’est-ce pas un phénomène historique bien digne d’attention que ce cachet particulier donné, il y a près de dix-neuf siècles, par trois historiens différents, à cinq petites nations qui se tiennent encore aujourd’hui distinctes des mêmes masses gauloises et germaines d’où elles sont sorties ?
Plus tard, l’empire romain a contenu ces petits peuples dans ses vastes limites. Toutefois, à la dissolution de cet empire, nous allons les voir reprendre leur originalité première, pour ne plus la perdre que pendant les courtes périodes où des forces artificielles parviennent à interrompre momentanément le cours naturel des choses, à suspendre violemment, mais avec la courte durée de toute violence, le travail de l’humanité.
L’empire ne fut pas plutôt démembré par les diverses races de ses envahisseurs, que les cinq petites nationalités dont il vient d’être question se dessinèrent de nouveau. Les Francs ripuaires et les Francs saliens, accueillis comme des compatriotes libérateurs parmi les peuples bataves et belges, fondèrent des établissements stables dans les pays qui forment la Hollande, la Belgique et les provinces rhénanes-prussiennes d’aujourd’hui. Ils avaient, dès le commencement du cinquième siècle, des chefs distincts dans ces différents pays ; et ces chefs n’étaient plus des sujets, mais des alliés de Rome. À la même époque, les deux grands affluents du Rhin, le Mein et le Necker, voyaient leurs rives soumises à une famille germanique dont le nom s’est perpétué jusqu’à nos jours, la famille de Nassau.
Les Burgondes, qui s’étaient emparés, entre autres débris de l’empire, de la Suisse et de la Savoie d’aujourd’hui, y eurent, dès lors, des États permanents. Les autres invasions n’avaient pas produit les mêmes résultats. À l’orient et au sud de l’empire, les envahisseurs ne se répandaient partout que pour piller et se déplacer sans cesse. Il ne faut que rappeler ici à la mémoire du commun des lecteurs les noms des Alaric, des Genseric, des Attila. On peut dire, d’une manière générale, qu’au premier dépècement de l’empire romain, les seules nationalités absorbées en lui, qui se reformèrent d’anciens éléments latents, furent celles que nous connaissons encore aujourd’hui dans cette chaîne de petits peuples qui s’étend de la mer du Nord aux Alpes. Plus tard, d’autres nationalités furent reconstruites sur les débris du monde romain. Mais le temps, beaucoup plus long, et les efforts, souvent renouvelés, qu’il fallut y employer, témoignent assez de la difficulté moins grande qu’il y avait eu à plier ces peuples au joug.
L’empire des Francs, qui s’éleva peu à peu sur les débris occidentaux de l’empire romain, réunit de nouveau à un seul centre les populations gallo-germaniques des rives de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin, et des vallées septentrionales des Alpes. Il y avait pour cela un motif particulier. Les chefs francs et les chefs burgondes, qui avaient rétabli d’abord les petites nationalités de ces contrées, avaient, depuis, marché ensemble à la conquête des Gaules demeurées romaines. Les princes et les peuples conquérants s’unirent facilement pour la conservation de la domination commune. Ils finirent, comme toujours en pareilles circonstances, par reconnaître un seul chef ; et Clovis consolida cette domination commune sur les Gaulois asservis.
Le meilleur moyen de vérifier que la cause de la réunion sous Clovis de ces nationalités distinctes est réellement le besoin de la domination commune sur les Gaulois, c’est d’observer ce qui va se passer à la dissolution de l’empire de Charlemagne. Ce dernier fait historique est dû, comme on sait, à la réaction de la nationalité gauloise contre les nationalités germaniques, sous les successeurs dégénérés du grand Germain, qui avait si largement continué et amplifié l’œuvre de Clovis. Or, il ne fut pas plutôt certain que la Gaule allait échapper à l’autorité des dynasties d’origine germanique, que toutes les populations bataves, belges, rhénanes et cisalpines se séparèrent de nouveau de l’ancien centre, pour se reconstituer en nationalités séparées, dans la nouvelle forme politique qui résultait de principes établis par Charlemagne et son premier successeur. Les efforts de ces peuples pour aider les derniers descendants de leurs anciens chefs à maintenir leur pouvoir sur les Gaulois ont été racontés par de nombreux historiens. Leur résolution et leur succès à se rétablir en nations distinctes, dès qu’il ne leur fut plus possible de maintenir l’empire que ces chefs avaient créé principalement à leur aide, se prouvent par la seule nomenclature des dynasties qui les gouvernaient à part dès le milieu du dixième siècle.
La Hollande d’aujourd’hui a dès lors ses comtes de Zélande et ses comtes de Frise. La Belgique a ses comtes de Flandre, ses comtes de Hainaut, ses comtes de Louvain ou de Brabant. Des évêques souverains gouvernent Utrecht, Liège et Cologne. Les comtes de Nassau se sont perpétués vers les bords du Mein. On connaît déjà les margraves de Bade. Les Suisses ont les comtes d’Helvétie et les comtes de Neuchâtel. Les comtes de Maurienne forment déjà la souche de la maison de Savoie, qui règne encore aujourd’hui sur les États sardes.
N’oublions pas qu’à la même époque, les marquis de Montferrat et de Saluces, et les capitaines du peuple de la république de Gênes, ont fondé des établissements qui ne disparaîtront plus, quels que soient les bouleversements et les remaniements qui, à partir de cette époque, menacent encore le reste de l’Italie.
Ce tableau, pourra-t-on dire, n’offre rien de spécial au milieu de l’Europe du centre, découpée alors partout en petites souverainetés féodales ressortissant à l’empire d’Allemagne ou au royaume de France, ces deux grandes parts de la monarchie de Charlemagne. D’accord ; mais notre thèse consiste en ceci : les petits peuples en question, distincts de bonne heure des peuples plus grands leurs voisins dont ils se détachent facilement, ne retournent pas à leur centre respectif avec la même facilité. Ils répugnent même à y retourner. Dans toute la France actuelle, les dernières traces de l’ancien morcellement féodal ont disparu depuis longtemps. La maison de Habsbourg n’aurait pas réussi à centraliser, comme elle le fait, son autorité impériale, si ses domaines avaient encore compris des Allemands du Rhin. La Suisse est encore là pour lui rappeler ce qu’en produit la seule tentative. La Prusse n’a réuni quelques-uns de ces Rhénans sous son gouvernement, qu’en leur laissant des lois civiles particulières ; et encore la Prusse est-elle menacée de graves difficultés dans ces provinces, pour certaines questions politiques et religieuses qu’elle fait souvent imprudemment renaître. Le Nassau, la Hesse rhénane et Bade se distinguent plus que jamais du reste de l’Allemagne par les institutions relativement libérales qu’ils ont gardées au milieu du naufrage récent des mêmes institutions chez leurs voisins. Il ne faut que citer, après cela, les États sardes à une extrémité, la Belgique et la Hollande à l’autre extrémité de ce Rhin, père et nourricier de races énergiques entre toutes, pour prouver que la nature a semé et entretenu ces divers peuples, au milieu des autres, pour un objet que l’on peut contrarier quelquefois, mais que l’on ne saurait absolument paralyser.
Ces petites nationalités vivaces ont donc conservé leur caractère, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Comme dernière épreuve subie par elles, pour établir ce qu’elles ont de robuste, il est curieux de rappeler leur attitude pendant l’empire de Napoléon et à la chute de cet empire.
La France conquérante avait successivement rencontré les Belges classés comme ils l’étaient depuis la fin de l’empire de Charlemagne, sous les dénominations de Flamands, Brabançons, Hennuyers, Liégeois, etc., et gouvernés par leurs lois civiles et politiques spéciales ; les Bataves, constitués en république fédérative ; les Rhénans, associés à l’ancien empire germanique, mais gouvernés en divers États séparés par les mêmes princes particuliers dont l’établissement remontait aussi à l’époque carlovingienne ; les Suisses constitués en république fédérative comme les Bataves ; les Savoyards et les Piémontais réunis depuis longtemps sous une seule dynastie, l’ancienne race des comtes de Maurienne, devenue depuis peu de temps la maison royale de Savoie ; les Génois, républicains beaucoup plus anciens que les Bataves, et même que les Suisses.
À la liquidation de ces diverses conquêtes de la France, Napoléon, vers le milieu de son règne d’empereur des Français, avait érigé en simples départements de son empire tout le territoire de la Belgique, tout le territoire de l’ancienne république des Provinces-Unies, toute la rive gauche du Rhin, de la Savoie, du Piémont et de la république de Gênes. Il avait écarté de la rive droite du Rhin le patronage ou l’autorité des deux grandes dynasties allemandes, les Hapsbourg et les Hohenzollern, et s’était constitué « le protecteur » des petites dynasties qu’il avait bien voulu y tolérer encore. La Suisse, dont il avait occupé les deux dernières portes en établissant à Genève son département du Léman et son département du Simplon, au versant des Alpes helvétiennes, était mise sous la quasi-dictature de « sa médiation. »
C’était bien, pour tous ces pays, l’effacement complet de leur ancienne individualité. Ce qui en avait été respecté, pour la forme, à l’égard du plus petit nombre, ne pouvait réellement être mis en ligne de compte.
L’empire napoléonien était à peine tombé, que Bataves, Belges, Rhénans, Suisses, Savoyards, Piémontais et Génois viennent se ranger de nouveau côte à côte, entre les deux grandes monarchies auxquelles on distribue le reste de l’Allemagne et de l’Italie, soit en territoire, soit en patronage, et la France, qui rentre dans ses anciennes limites.
Il est inutile d’objecter ici ce qui se passa alors pour les provinces rhénanes, attribuées à la monarchie prussienne. On ne les y attacha qu’avec leurs lois particulières ; on ne se donna pas même le soin de les souder au reste du territoire de la Prusse. C’est plutôt un pays qu’on donna à gouverner à la maison de Hohenzollern qu’une adjonction définitive et entière à la Prusse de Frédéric le Grand. Le double cachet de lois civiles distinctes de la législation due à ce monarque, et d’une religion différente de celle que la dynastie appelle toujours la religion de l’État prussien, tient les Rhénans prussiens à part des autres sujets de la maison de Hohenzollern.
Depuis la chute de l’empire napoléonien, cette ligue tacite de petits peuples, établie sur les frontières de grandes monarchies, s’est raffermie et consolidée encore à la suite d’évènements plus nouveaux. Ce qui n’avait eu lieu que pour quelques-uns en 1815 est devenu commun à tous depuis 1848. Le système représentatif est le type uniforme de leurs gouvernements. Il les distingue d’autant plus aujourd’hui de leurs grands voisins, que les deux empires français et autrichien, tels qu’ils sont sortis de remaniements tout récents, n’ont plus rien de commun avec la forme représentative. L’Autriche l’a abolie en Hongrie. La France y a substitué un régime qui ne peut encore être bien défini jusqu’à cette heure. D’un autre côté, ce qui sépare ces petits peuples des autres peuples continentaux auxquels ils confinent les rapproche d’autant des deux grands peuples maritimes à l’accord desquels est évidemment dévolue la direction suprême de la civilisation européenne dans les temps présents. C’est une nouvelle garantie de la mission de ces petits peuples, et une nouvelle cause de puissance pour accomplir cette mission qui consiste principalement à séparer des forces matérielles et purement brutales qui se menacent et se provoquent sans cesse, et à infiltrer peu à peu dans ces masses l’intelligence politique qui leur fait encore défaut.
Ces petits peuples sont solidaires dans leur mission, c’est-à-dire que tous s’intéressent d’ordinaire à l’œuvre de chacun, et chacun à l’œuvre de tous, quand il s’agit de leur attitude vis-à-vis de leurs grands voisins.
Lisons César aux livres Ier et II de ses Commentaires, et nous trouvons qu’une fermentation générale règne, depuis les Allobroges jusque chez les Bataves (nous dirions aujourd’hui depuis le fond de la Savoie jusqu’aux embouchures du Rhin), au moment où le grand capitaine prépare son expédition des Gaules. Les Romains se sont établis presque sans difficulté sur tout le territoire qui forme la France d’aujourd’hui. Ils en possèdent, à titre direct, la Provence, qui a retenu d’eux ce nom même. Ils sont les protecteurs impérieux de tout le reste. C’est de ce point de départ que César va procéder. Dès ses premiers mouvements, il trouve sur pied contre lui les Allobroges, les Helvétiens, les Germains d’Arioviste, et apprend, peu de temps après, que tous les Belges viennent de former une grande ligue pour lui résister. Ses efforts, au début, consistent à pacifier les premiers, puis il combat et défait successivement les seconds et les troisièmes. Dans la campagne qui suit immédiatement, il en est déjà venu aux mains avec les quatrièmes. À la vérité, le conquérant romain attribue des motifs différents aux prises d’armes de ces peuples. Mais de ce qu’elles sont simultanées juste au moment où s’approche la conquête, il faut tirer la conséquence qu’elles n’avaient au fond qu’un seul et même mobile, l’idée soit de faire diversion, soit de résister directement à l’agression romaine. Les Helvétiens qui, dit César, marchaient sur la Provence lorsqu’il les arrêta et les défit ; Arioviste, qu’il fut obligé d’expulser des territoires qui répondent à ce qu’on a appelé depuis la Bourgogne et la Franche-Comté, où il s’était déjà établi après avoir traversé le Rhin, faisaient la guerre de diversion, tandis que les Belges préparaient la guerre de résistance. Ce n’en était pas moins un évident ensemble de mesures contre un danger commun.
Toute la suite de la guerre prouve d’ailleurs qu’il s’agissait d’une défense solidaire contre l’attaque de César. Ceux de Trèves accourant des bords de la Moselle au secours des Nerviens résistant sur la Sambre ; ceux de la Meuse, les Éburons d’Ambiorix, appelant plus tard à l’insurrection ceux du moyen Rhin, pour aller ensemble détruire l’occupation romaine jusque sur les rives de la Senne ou de la Haine ; ceux des côtes maritimes, depuis l’embouchure de la Somme jusqu’au fond des marais des bouches de la Meuse et de l’Escaut, maintenant leur indépendance par des efforts combinés, étaient animés d’un seul et même esprit, bien que ses manifestations n’aient pas toujours eu l’ensemble désirable.
Nous avons déjà dit la spontanéité avec laquelle tous les peuples dont nous nous occupons ici reprirent leur indépendance aux premiers temps de la décadence de l’empire romain, et l’accord qu’ils surent mettre à aider dans leur établissement en France les dynasties mérovingienne et carlovingienne sorties d’eux-mêmes.
Il est tout aussi curieux de rechercher les traces des mêmes rapports de solidarité pendant l’époque féodale qui succéda à Charlemagne. Alors que la division infinie des territoires et la multiplication des chefs d’États rendaient l’intimité moins facile entre les peuples, ceux qui conservaient des relations suivies pouvaient les attribuer avec raison à une impérieuse identité de nature, de position et d’intérêt. À l’époque dont nous parlons, les signes d’alliance entre les peuples étaient presque toujours l’alliance entre les dynasties. Quoi de plus significatif en faveur de notre thèse que les faits suivants recueillis à la hâte dans nos souvenirs, et dont nous pourrions aisément décupler le nombre, à l’aide de quelques recherches ?
Au douzième siècle, la famille de Zæhringen qui réunissait sous son autorité presque toute la Suisse et le pays de Bade d’aujourd’hui, et dont deux grands chefs ont fondé Berne et Fribourg en Brisgau, était alliée à nos comtes de Namur et fournissait des évêques à notre évêché de Liège. Dès le siècle précédent, notre maison de Brabant était alliée à celle des landgraves de Hesse. Au commencement du treizième siècle, notre célèbre Jeanne de Constantinople, fille de l’empereur Baudouin et comtesse de Flandre après lui, prit pour second mari Thomas de Savoie, comte de Maurienne, après la mort de son premier époux, Ferrand, l’infortuné prisonnier de Philippe-Auguste. Il n’y avait pas alors une seule guerre dans l’empire germanique où Belges, Rhénans et Suisses ne tinssent toujours le même parti, soit pour, soit contre l’Empereur. Si les Flamands avaient quelque grande querelle avec les rois de France, on retrouvait les Allemands du Rhin rangés à leurs côtés à Bovines comme à Courtray.
Lorsque la maison de Bourgogne se fut substituée dans toutes les provinces des Pays-Bas à nos princes des maisons de Flandre, de Brabant, de Hainaut, de Namur, de Hollande, de Gueldre, etc., l’ancienne politique des Belges fut souvent détournée de ses voies naturelles par les Bourguignons. Mais quand il s’agit d’une dérogation par trop complète à nos tendances intimes et à nos souvenirs historiques, les ducs de Bourgogne ne peuvent avoir raison de notre résistance. Charles le Téméraire n’obtint en Flandre et en Brabant ni argent ni soldats pour sa guerre contre les Suisses. Ni Granson ni Morat n’ont mêlé les ossements de nos pères à ceux des Bourguignons.
Vint le temps des guerres de la réforme et l’introduction de cette nouvelle cause de division entre les peuples : la différence des croyances religieuses, aussi puissante que la différence des langages. Pendant la lutte et avant le classement définitif de nos petits peuples dans les deux religions, l’ancienne et la nouvelle, voyez comme le mouvement les entraîne pêle-mêle les uns chez les autres ! Quel rôle la famille de Nassau ne joue-t-elle pas en Belgique et en Hollande ? Pourquoi Hembyze appelle-t-il à Gand Jean-Casimir le palatin du Rhin ? Les Belges wallons qui suivent Tilly en Allemagne ne vont-ils pas rendre aux catholiques de ces contrées les secours que les protestants des nôtres avaient les premiers tirés des protestants allemands ? Si pendant un court épisode de cette longue mêlée un roi de France envoie son frère pour y prendre part chez nous, ceux mêmes qui l’ont d’abord le mieux reçu ne le chassent-ils pas bientôt comme un intrus qui n’est pas de la famille ? Enfin, n’est-ce pas à titre de prince allemand que l’archiduc Albert nous est envoyé pour pacifier nos querelles ? Qu’est-ce aussi, durant toute cette déplorable histoire, que cette fraternité si touchante d’Anvers et de Cologne ?
Quand les guerres se furent apaisées, on retrouva notre chaîne de petites nationalités rétablie comme auparavant, malgré les changements apportés dans les croyances de plusieurs. Sa force ne fut même pas diminuée par les différences de religions ajoutées aux différences de langages. On put le voir bientôt à l’époque de Louis XIV. Le protestant Guillaume III fut l’âme des ligues contre ce prince ambitieux. Le catholique Eugène de Savoie, dont la maison était alors devenue une des dynasties italiennes, conduisait les armées qui triomphèrent définitivement des prétentions de l’ennemi commun des Hollandais, des Belges, des Rhénans et des Piémontais.
C’est à partir de Louis XIV qu’il fut surtout prouvé combien notre rempart entre la France et l’Empire était chose providentiellement établie. C’est alors aussi qu’il s’étendit au-delà des Alpes pour les questions italiennes de la rivalité de la maison de Bourbon et de la maison d’Autriche. C’est encore alors que l’Angleterre en reconnut le salutaire usage pour l’arbitrage qu’elle s’attribua toujours depuis entre la France et l’Allemagne.
Aujourd’hui que ce rempart est devenu de plus une voie de communication pour la politique anglo-saxonne sur le continent d’Europe, il ne sera pas inutile de rechercher comment on s’en est servi pour le double usage de la défense des peuples et de la transmission des idées, à deux époques caractéristiques de la première moitié de notre dix-neuvième siècle : la fin de l’empire napoléonien et les révolutions de 1848.
Dès que l’agonie de l’empire eut sonné, l’Angleterre prit notre chaîne par les deux bouts pour la relever et la tendre, avant même que l’on pût s’occuper du règlement des nouvelles relations entre la France abattue et l’Allemagne victorieuse. L’insurrection des Hollandais en novembre 1813 lui mit en main le bout septentrional, cinq mois avant l’entrée des Allemands dans Paris ; et quant au bout méridional, voici ce que lord Bathurst avait écrit, dès le 28 décembre de la même année, à lord Bentinck, établi avec des forces anglaises en Sardaigne : « J’ai l’honneur de vous transmettre quelques renseignements qui me sont parvenus sur les dispositions des habitants de Gênes et du Piémont, ainsi que sur le dénuement où l’ennemi se trouve dans ce pays. Si l’état des forces que vous commandez le permet, vous y enverrez un détachement de troupes et les suivrez bientôt vous-même… Le principal objet serait l’occupation de Gênes, ou du moins des deux forts qui commandent l’entrée du port. Pourvu que ce soit manifestement avec l’entier concours des habitants, vous pourrez prendre possession de Gênes au nom et pour le compte de Sa Majesté Sarde. »
C’était l’idée de la création des États sardes, tels qu’ils ont été constitués depuis, de la Savoie, du Piémont, de Gênes et de la Sardaigne. Du côté opposé, l’idée du royaume des Pays-Bas, formé de la Hollande et de la Belgique, était écrite dans cet article de la convention de Londres du 8 mai 1814 : « La Hollande recevra un accroissement de territoire. » Quant à la Suisse et aux États allemands du Rhin, ils reprenaient d’eux-mêmes leur ancienne position, sauf quelques petites modifications de détail. Lorsque le traité de Paris du 30 mai fut signé, il n’y avait plus eu qu’à ratifier, à cet égard, dans ce traité des faits déjà établis sous l’initiative de l’Angleterre. Ces faits eux-mêmes n’étaient que le renouvellement et la consolidation d’un ordre ancien.
Il faut voir dans une publication récente encore destinée à glorifier la politique de l’Autriche, ce cauchemar éternel de l’indépendance et de la liberté de tous les petits peuples ses voisins, il faut voir avec quel dépit l’auteur parle des mesures à l’aide desquelles l’Angleterre a su ravir en 1814 les Pays-Bas à la domination et même à l’influence des despotes d’Allemagne. C’est la meilleure justification de notre dire, savoir que la chaîne des petites nationalités établies de la mer du Nord à la Méditerranée est tendue aussi bien contre les autocrates allemands que contre l’inquiète ambition des Français. Sans doute, la monarchie sarde et la république suisse offusquent bien autant l’Autriche que nous l’offusquons nous-mêmes, s’il faut en croire M. de Ficquelmont : nouvelle confirmation de la justesse de notre thèse.
Nous n’étions pas encore reconstitués d’une année, que l’évasion de Napoléon de l’île d’Elbe vint fournir une excellente occasion d’éprouver l’opportunité de l’établissement. C’est d’Ostende et d’Anvers à Gênes que s’établit, comme en un clin d’œil, la première ligne de défense derrière laquelle les masses autrichiennes et russes auront le temps de se reformer. C’est sur un point de cette ligne que vient se briser la nouvelle agression française, avant son contact avec d’autres ennemis qui n’auraient pas autant ménagé la France après la victoire. Les Anglais, les Hollandais, les Belges, les Allemands du Rhin, en défaisant à Waterloo l’armée de Napoléon avant son contact avec les Autrichiens, ont épargné à la France le sort que lui réservait alors la politique de M. de Metternich, c’est-à-dire l’anéantissement. Cette fois, c’est au profit de la France que fonctionnait notre ligue de petits peuples mise en mouvement par la politique de l’Angleterre.
On se rend parfaitement compte de cela en lisant avec attention le recueil des dépêches de Wellington pendant les années 1814 et 1815. L’activité et la sollicitude de ce grand capitaine à appeler surtout autour de lui l’armée des Pays-Bas, les corps allemands des provinces rhénanes-prussiennes, du pays de Nassau, du Hanovre et du Brunswick ; les traités qu’il se hâte de signer avec Bade, le Wurtemberg et le roi de Sardaigne, pour avoir leurs troupes sur pied aux frais de l’Angleterre ; la satisfaction qu’il manifeste dès qu’il apprend d’une manière certaine que l’attaque de Napoléon se portera vers la Belgique ; la confiance qu’il témoigne d’en avoir raison sans l’intervention des autres alliés, tout révèle en Wellington la pensée intérieure qu’il doit être utile à la politique générale de l’Europe de prouver, dans cette occasion solennelle, l’efficacité du rétablissement récent de la barrière entre la France et les grandes puissances du Nord et de l’Est. Cette pensée est sans doute accompagnée en lui de celle que l’Angleterre acquerra en outre une expérience décisive de l’usage qu’elle peut faire de cette barrière.
L’utilité qu’il y avait de vaincre à Waterloo sans les Autrichiens est bien prouvée par l’influence prépondérante que le général vainqueur put heureusement exercer sur le règlement du sort de la France après la victoire. Sa remarquable dépêche à lord Castlereagh, datée de Paris, 11 août 1815, et son mémorandum du 31 du même mois, ont sans doute sauvé la France du sort que lui destinait l’Autriche. Or, si, dans ces derniers temps, c’est la France qui a semblé menacer de nouveau les petits peuples du centre de l’Europe, cela ne doit pas faire oublier à ceux-ci quel régime ils auraient subi depuis 1815 jusqu’à nos jours, si, la France détruite, c’eût été à la politique autrichienne à dominer sur le centre de l’Europe.
Dans la période qui suivit la chute définitive de Napoléon, l’Angleterre s’étudia particulièrement à consolider son influence sur les pays qui avaient si efficacement servi de point d’appui à son arbitrage entre la France et l’Autriche. À cet effet, elle imagina de les faire participer autant que possible aux principes de son organisation politique. Elle savait bien que la communauté des idées constitue bientôt la communauté des intérêts.
Le premier soin de l’Angleterre, après 1815, fut cependant de faire fortifier matériellement les positions stratégiques. Les soixante millions accordés au roi des Pays-Bas et les dix millions accordés au roi de Sardaigne sur l’indemnité pécuniaire imposée à la France, après Waterloo, furent employés en construction de forteresses. C’était une concession aux préjugés militaires de lord Wellington. Mais ce n’était pas là que se trouvait la principale idée de la politique anglaise.
La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, les constitutions des petits États du Rhin, la consolidation de l’ancienne confédération suisse augmentée de Genève et de la neutralité militaire des trois provinces savoyardes limitrophes, le Chablais, le Faucigny et la Genevoise, jusqu’au torrent du Fier, voilà le véritable fondement de la nouvelle ligue qui s’établissait sous les auspices de l’Angleterre. Les révolutions italiennes de 1821 devaient servir à rallier les États sardes à ce système ; et ce que les évènements d’alors forcèrent de différer ne devait pas être perdu.
En 1830, l’Angleterre fut aussi vigilante à conserver les créations de 1815 qu’elle avait été active à les réaliser d’abord. La dissolution du royaume des Pays-Bas ne changea rien à l’établissement primitif, quant à ce qui concernait les grands pays voisins. On s’imagina un instant que la Belgique séparée de la Hollande deviendrait de nouveau française. La suite a bien prouvé le contraire. La Suisse, de son côté, ne fit qu’élargir encore la base démocratique de ses institutions : ce qui la soustrayait d’autant plus à l’influence autrichienne. Les États sardes en avancèrent d’autant vers le régime constitutionnel qu’ils attendaient.
En 1846, les symptômes politiques annonçaient que la ligue des petits peuples constituée entre la France et les deux grands États d’Allemagne allait être menacée, et qu’il s’agirait par conséquent, pour l’Angleterre, de la rendre plus solide encore. Le gouvernement de Louis-Philippe avait préparé de nouveau les Français au servage en les corrompant. Il songeait à employer ses sujets assouplis à porter l’oppression en Belgique et en Suisse, où les développements des principes de liberté étaient rapides. La lettre du roi des Français au roi des Belges à l’occasion du congrès libéral convoqué à Bruxelles en 1846, et l’alliance de la politique de M. Guizot à la politique de M. de Metternich quant aux affaires suisses à la même époque, témoignent assez de ce que nous venons de dire.
Cet accord de la France et de l’Autriche fournit l’occasion de prouver combien avait été juste l’idée de l’Angleterre, que la liberté semée entre les grands États de l’Allemagne et la France deviendrait un obstacle à l’association éventuelle de ces grands États et de la France dans une même politique. Ce qui n’avait servi jusque-là que de ligne de séparation entre des despotes puissants pour les questions de leur rivalité, en devenait une pour les questions de leur bonne entente.
C’est à la Suisse que l’Angleterre donna en 1847 le premier signal de la résistance à faire à l’accord des cabinets de Vienne et de Paris. La guerre contre le Sunderbund, si rapidement entreprise et terminée, dérouta d’abord la politique de M. Guizot et de M. de Metternich. Ils n’avaient pas encore eu le temps de se remettre de leur première stupeur, que la diplomatie de lord Minto leur avait déjà préparé la diversion piémontaise et lombarde. Les échauffourées révolutionnaires de Paris, de Berlin et de Vienne, en 1848 et 1849, sont venues noyer l’insurrection de la haute Italie dans tant d’évènements contemporains, que le véritable sens de cette insurrection a été perdu pour le vulgaire des observateurs. Mais la solution que nous avons aujourd’hui des mouvements révolutionnaires de ces derniers temps permet de distinguer ce qu’ils ont eu de réel de ce qu’ils ont eu de factice ou de purement accidentel. Les semences tombées en bon sol ont seule porté des fruits. La Suisse a consolidé sa révolution démocratique. La monarchie sarde est définitivement entrée dans le système des gouvernements représentatifs. La Belgique et la Hollande ont considérablement élargi chez elles les bases de ce système qu’elles possédaient déjà. Quant aux peuples rhénans, ceux de la Prusse sauront bien rendre sérieux ce parlement de Berlin dont on aurait bien voulu ne faire qu’un vain simulacre ; et ceux de la Hesse et de Bade rendront bientôt, selon toute apparence, l’esprit à la lettre des institutions démocratiques qu’ils ont gardées. Les accidents de Paris et de Vienne sont restés des accidents, puisque la France et l’Autriche sont retombées toutes les deux sous des politiques de dynastie. Au point de vue où nous nous plaçons, il est inutile de tenir compte des faits secondaires. La France est l’instrument de la politique de la famille Bonaparte, comme elle était l’instrument de la politique de la famille de Bourbon. L’empire d’Autriche sert comme toujours les seuls intérêts de la maison de Habsbourg.
Il serait impossible de dire en quoi les dispositions naturelles du peuple français influent plus aujourd’hui sur les projets de la dynastie napoléonienne qu’elles n’influaient naguère sur ceux de la maison de Bourbon. Le peuple français, comme tel, n’est pas plus libre de s’exprimer sous Napoléon III que sous Louis-Philippe ; au contraire. Quant à l’empire d’Autriche, l’influence de la volonté de tous les peuples qui le composent sur la politique de l’Empereur est diminuée en raison directe de tout ce qui a été ravi de liberté, en dernier lieu, à l’ancien royaume de Hongrie.
À l’arrêté de compte des évènements dont nous avons été témoins, depuis 1817 jusqu’en 1852, il y a, comme avant 1847, une Allemagne monarchique et une France monarchique qui peuvent, suivant certaines éventualités, se jalouser, selon les penchants et les intérêts naturels de leurs populations respectives, ou s’entendre, selon les caprices de la politique de leurs maîtres. Mais il y a, entre ces rivaux naturels ou ces amis de circonstance, une ligue plus forte que jamais de petits peuples, pour la plus grande partie débarrassées par leurs institutions actuelles de toute direction autre que celle de leurs intérêts propres. C’est le profit des dernières révolutions ; car sur ces intérêts l’on peut, sans crainte, assurer à la fois et la paix de l’Europe centrale, et le développement de la liberté chrétienne.
Avec cette vue de l’état actuel des petites nationalités constituées bout à bout depuis la mer du Nord jusqu’au golfe de Gênes, nous avons entrepris, il y a peu de mois un voyage d’observation à travers quelques pays et quelques populations qui constituent ces nationalités. La Hollande nous était déjà connue par un voyage antérieur, par les souvenirs que nous avons gardés de notre vie commune de Belges et de Hollandais pendant quinze ans avant 1830, et par le soin que nous n’avons cessé de prendre de suivre attentivement tout ce qui s’est fait chez ces frères du Nord depuis notre séparation politique. Notre Belgique est depuis longtemps pour nous l’objet d’études assidues. Il nous a semblé qu’en parcourant les pays du Rhin, la Suisse et les États sardes, nous compléterions des renseignements propres à justifier ce fait de solidarité politique que l’histoire ancienne et moderne nous enseigne comme nous venons de l’exposer.
Un fait nouveau, celui de l’action exercée par l’Angleterre et préparée pour les États-Unis d’Amérique sur notre continent, à l’aide de cette ligue tacite des petits peuples qui le traversent du nord au midi, mérite en outre d’être bien observé. Il ajoute considérablement à l’intérêt que ces petits peuples excitent. Les deux points opposés par lesquels les Anglais et les Américains se mettent le plus facilement en communication avec eux, Anvers et Gênes, indiquent le mieux les termes entre lesquels se concentre cet intérêt. C’est donc d’Anvers que nous commençons notre itinéraire, sans laisser toutefois de côté la Hollande et la Belgique occidentale et méridionale, qui font partie de l’ensemble à étudier pour se rendre compte de ce qui précède déjà et de ce qui va suivre encore. Nous en parlerons chemin faisant.
Le premier railway un peu important établi sur le continent a été celui d’Anvers à Cologne. Il n’en faudrait pas davantage pour prouver que cette direction a une importance toute particulière pour les peuples européens. Si l’on se rappelle ensuite le rôle historique que jouaient au Moyen Âge le Brabant, le pays de Liège et l’archevêché de Cologne, et la part que ces contrées ont prise aux évènements de la réforme religieuse qui a ouvert les temps modernes, on est convaincu de l’idée qu’une espèce de moyenne de la civilisation d’Europe se trouve établie, depuis longtemps, dans ces contrées. Il ne faut que les parcourir rapidement pour reconnaître que l’aspect matériel du pays et le caractère des populations confirment partout cette idée.
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que sur un parcours de cinquante à soixante lieues, vous traversez trois races, de langues différentes, sans que vous rencontriez beaucoup de variété dans l’aspect des villes et des campagnes, dans les habitudes et le costume des habitants.
Prenez les églises et les autres monuments d’Anvers, de Malines, de Louvain, pour les comparer à ceux de Liège, puis à ceux d’Aix-la-Chapelle et de Cologne, vous emportez de tous ensemble un souvenir uniforme. Il nous est arrivé souvent de revoir en imagination dans le même cadre les vieux quartiers d’Anvers ou les vieux quartiers de Cologne. Les abords de la Meuse à Liège, en s’y rendant par les rues étroites qui partent de derrière l’hôtel de ville, sont en tout semblables aux abords du Rhin à Cologne, quand on y descend des environs de la cathédrale.
À partir de Louvain, les plaines qui s’étendent jusqu’au commencement du versant vers la Meuse, ces plaines qui entourent Tirlemont, Landen, Waremme, ont le même aspect que celles qui s’étendent depuis Aix-la-Chapelle jusqu’au Rhin. L’intervalle de pays montagneux qui s’étend de Liège à Aix-la-Chapelle varie à la vérité le paysage, mais ce sont toujours les mêmes populations et les mêmes habitations, dans les villes comme dans les campagnes.
Les touristes étrangers sont habitués à confondre dans une seule et même idée le Brabant, le pays de Liège et les bords du Rhin. L’Anglaise mistress Trollope n’a pas manqué de réunir ces pays dans une de ses nombreuses relations de voyage. On sait que Walter Scott, trompé par la ressemblance absolue des pays et des habitants, et par la communauté de leur histoire, a fait de Liège une ville flamande. Il n’est même peut-être pas inutile de dire ici, pour beaucoup de nos compatriotes et de nos voisins qui l’ignorent, que l’on parle flamand à Anvers, français ou wallon à Liège, et allemand à Cologne.
On peut se figurer la route d’Anvers par Liège à Cologne comme la couture principale de l’habit d’arlequin qui rejoint les pièces de diverses couleurs dont cet habit est composé. C’est par cette route que nos voisins d’Albion et leurs descendants de par-delà l’Atlantique, qui les imitent désormais dans leurs habitudes de touristes, commencent tous aujourd’hui leur visite à notre continent. Vous ne rencontrez pas un Anglais ou un Américain en Allemagne ou en Italie qui n’ait déjà vu Anvers, Liège et Cologne. C’est le vestibule qu’ils ont pris pour entrer. Plusieurs, en débarquant sur le rivage belge, ont eu soin, avant de pénétrer plus loin, d’aller visiter à droite et à gauche nos principales provinces et celles de la Hollande. Le meilleur est de retracer ici les impressions qu’ils vous disent généralement en avoir reçues.
Les habitants de Londres et de New-York ne sont guère frappés de l’activité commerciale d’Anvers, de Rotterdam, ni même d’Amsterdam. Ils ont eu sous les yeux, bien avant de voir ces ports de commerce, le mouvement de leurs propres ports. Tous les navires de l’Escaut, de la Meuse et de l’Y réunis, leur feraient à peu près l’effet du cabotage d’Ostende sur un marchand d’Anvers, ou du cabotage de Dunkerque sur un armateur du Havre. Ils ne sont pas beaucoup plus émerveillés des usines de notre Hainaut et de notre pays de Liège. Ils en ont vu chez eux des spécimens satisfaisants. Le luxe et la splendeur de nos grandes villes ne sont pas non plus ce qui les frappe.
Mais tous parlent avec éloge de cette multitude de villes répandues sur une surface géographique aussi peu étendue ; des monuments et des collections d’objets d’art qu’elles renferment à profusion ; de ces grasses et plantureuses prairies de la Hollande et des innombrables troupeaux qui s’y nourrissent ; de ces plaines de la Flandre, où les clochers des villages sont presque aussi nombreux que les grands arbres ; de ces autres plaines du Hainaut et du Brabant, où les moissons ondulent sous la brise comme les flots d’un océan sans rivage. Ceux qui ont séjourné assez de temps en Hollande ou en Belgique, pour pouvoir se rendre compte de quelque chose de plus que de l’architecture des villes et du paysage des campagnes, s’étendent avec complaisance sur les facilités de la vie et la sûreté des rapports que l’on rencontre partout. Bref, si les Hollandais, les Belges et les Rhénans n’excitent pas chez ces visiteurs les sentiments d’une admiration enthousiaste, ils leur laissent l’impression d’un pays et d’un peuple qui reproduisent très convenablement les faces les plus importantes de la civilisation européenne.
Un Américain qui avait parfaitement étudié l’Angleterre avant de venir sur notre continent, et qui s’était arrêté quelques mois en Belgique, en Hollande et dans les provinces rhénanes, avant d’arriver en Suisse, où nous le rencontrions, nous disait que ces trois contrées réunies faisaient, pour les grands États qui les entourent, ce que le comté d’York fait pour toute l’Angleterre et l’État de Pennsylvanie pour tous les États-Unis. Elles sont comme le miroir des mœurs, des intérêts, des langages, des religions et des institutions politiques de ces grands États. On sait que les Anglais admettent qu’on peut prendre l’exacte mesure de leur nationalité dans l’Yorkshire. L’État fondé par Guillaume Penn résume assez bien, à ce qu’on dit, la nouvelle civilisation américaine.
Au reste, cette appréciation du voyageur américain reproduit ce qu’un de nos vieux auteurs flamands a déjà dit, dès le milieu du seizième siècle, en parlant de son temps et des temps plus anciens. Marc van Vaernewyck a donné le titre suivant, qui est tout un prospectus, à un de ses ouvrages : « Le miroir de l’antiquité des Pays-Bas, représentant la construction ou fondation de Belgis, et dans lequel on peut voir, comme dans un clair miroir, beaucoup d’histoires étonnantes qui, depuis les temps les plus reculés, sont arrivées dans le monde, mais particulièrement dans les Pays-Bas, tels que la Flandre, le Brabant, la Hollande, la Zélande, la Frise, la Gueldre, Juliers, Clèves, la Westphalie, le Hainaut, l’Artois, et puis encore en Angleterre, en Écosse, en France, en Allemagne et autres pays, ainsi qu’il pourra venir à propos. » Le naïf compilateur annonçait son travail tel qu’il s’était produit naturellement à la suite de ses recherches. Les principaux faits relatifs à l’histoire de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne trouvaient leur origine ou leur aboutissement dans les Pays-Bas. Il faisait donc de ceux-ci, dans lesquels il comprend les provinces du Rhin inférieur, le miroir de tous les pays voisins.
Donc, cette première étape d’Anvers à Cologne, sur la ligne que nous voulons parcourir, offre à tout le monde ce que nous y avons trouvé nous-même un ensemble qui n’est ni l’Angleterre, ni la France, ni l’Allemagne, mais qui participe un peu de tous ces pays.
Si nous n’écrivions pas plus spécialement pour nos compatriotes, nous nous arrêterions un peu aux détails d’un itinéraire des bords de l’Escaut aux bords du Rhin, par le railway belge-rhénan. Mais qui, parmi nous, n’a pas vu Anvers, son fleuve, ses bassins, sa cathédrale et son musée ? Qui n’est pas descendu des plaines du Brabant et de la Hesbaye dans cette admirable vallée de la Meuse ? Qui n’a pas vu, de Liège à Verviers, le convoi rapide enfiler successivement, comme un cavalier au jeu des bagues, tous les tunnels de la vallée de la Vesdre ? Qui ne s’est pas détourné un moment vers Spa, avant d’aller voir Aix-la-Chapelle ? Qui, reprenant, au sortir de la ville de Charlemagne, les grandes plaines du pays de Juliers, n’y a pas retrouvé les horizons infinis de nos champs de Fleurus, de Seneffe, de Ramillies, de Neerwinde, de Waterloo, s’étonnant seulement d’entendre le paysan y parler une autre langue que notre flamand et notre wallon ?
C’est à compter de Cologne qu’une relation plus étendue et plus détaillée d’un voyage de touriste belge peut offrir quelque intérêt à ses compatriotes ; non que le Rhin ne soit aussi beaucoup visité par eux, mais le pays a une physionomie qui permet d’en varier à l’infini la description comme la peinture.
C’est encore une rivière des Pays-Bas, disent tous ceux qui voient le Rhin à Cologne, après avoir visité la Hollande et la Belgique. Les Anglais, préparés par Byron à ce Rhin qui présente l’assemblage de toutes les beautés,
sont tout étonnés, en arrivant, de se trouver sur les rives plates d’un cours d’eau plus souvent trouble que clair. De rochers, de forêts, de vignobles, de vieux châteaux forts, pas la moindre apparence. Les champs de blé y sont ; le feuillage et les fruits y sont aussi ; mais dans des campagnes qui ressemblent à des polders flamands, mais dans des vergers qui ne diffèrent en rien de ceux du pays de Liège.
Toutefois, si le Rhin n’a rien de romantique à Cologne, il a un autre caractère qui frappe l’observateur moins enthousiaste. Ces bateaux à vapeur qui fument en deçà et au-delà du pont jeté sur le fleuve ; ces grands magasins bâtis sur les deux rives ; ces quais encombrés de marchandises de toute espèce ; cette fourmilière de travailleurs allant et venant par toutes les rues qui aboutissent aux magasins et aux quais ; les cris des mariniers qui montent ou qui descendent ; le bruit des chariots qui arrivent ou qui partent, tout cela vous remplit d’une émotion qui a bien son charme aussi, même en comparaison de ce que fait éprouver le spectacle de la nature sauvage ou le silence des grandes ruines.
Une promenade sur les quais de Cologne et dans les quartiers qui les avoisinent offre encore un autre intérêt. Lire les enseignes de tous ces magasins, les noms écrits à la poupe de tous ces bateaux, les adresses de ces balles, de ces caisses, de ces tonneaux, de ces colis de mille formes, répandus partout autour de vous, c’est se rendre compte en quelques instants de l’importance de la grande rivière qui coule à vos pieds. Anvers, Liège, Dort, Rotterdam, Dusseldorf, Trèves, Mayence, Francfort, Strasbourg, Bâle, Constance, Saint-Gall, Zurich, Genève, tous ces noms reviennent cent fois à vos yeux. Vous êtes au centre de ce monde de petites nations qu’une activité incessante, une énergie indomptable ont de tout temps mises en relief sur la carte et dans l’histoire de notre Europe.
À la saison des touristes, les hôtels de Cologne participent singulièrement des caractères de cette situation centrale. Il n’en est aucun qui, le soir après l’arrivée des bateaux à vapeur et des convois de chemins de fer, ou, le matin, à l’heure de départ de ces mêmes bateaux et convois, ne ressemble à Babel, la veille ou le jour de la grande dispersion du genre humain. Les syllabes rudes et gutturales de l’allemand, du hollandais, du danois s’entrechoquent dans le péristyle, les salons et les corridors. Les sifflements de l’anglais percent à tout moment ce premier bruit. Les aigres voyelles du français viennent s’y mêler à leur tour, et le mol italien expire étouffé dans ce tumulte de langues. Il nous fallait nous embarquer de grand matin sur un de ces « steamers » si confortables qui remontent chaque jour le Rhin, de Cologne à Manheim. Le nombre infini de stations importantes que l’on rencontre dans ce long voyage : tous les sites pittoresques, depuis « les sept montagnes » jusqu’au fond du « Rheingau ; » toutes les grandes villes, depuis Bonn jusqu’à Mayence ; tous les points de débarquement pour arriver aux eaux d’Ems, de Wisbaden, de Hombourg, de Baden-Baden ; les embouchures de la Moselle, du Mein, du Necker, notre steamer desservait tout cela. On peut juger de la variété de passagers qu’il allait prendre à bord ! C’était comme une émigration. Aussi était-ce là une excellente occasion de vérifier d’un seul coup toute l’importance que Cologne doit à sa situation.
Notre navigation devait se prolonger quelque temps entre des rives comme celles sur lesquelles la grande ville est assise, avant que nous n’arrivassions aux premiers sites célébrés par tous les écrivains, et connus, au moins de nom, par tous les lecteurs. Avant d’entamer mentalement le fameux chant :
les passagers anglais (les plus nombreux parmi nous) achevaient de secouer la torpeur qui accompagne d’ordinaire les premiers moments d’une matinée commencée trop tôt. Nous nous tenions à l’arrière ; et le silence momentané, qui avait succédé à tout le bruit de l’embarquement, nous laissait contempler à notre aise la grande métropole du commerce rhénan que ses nombreux clochers, et surtout son immense cathédrale nous présentaient alors sous son second aspect : celui de métropole du catholicisme germain.
Quel passé sur ce Rhin qui descend si majestueusement vers la mer ! Et sans doute quel avenir encore !
Il nous semblait voir les générations écoulées reparaître successivement le long du fleuve sur les divers points que l’histoire a, de bonne heure, rendus célèbres, surtout depuis « la colonie d’Agrippine » jusqu’aux « fossés de Drusus et de Corbulon. »
Voilà Jules-César qui, vainqueur des Gaulois, occupe ses légions à poursuivre l’Annibal belge, Ambiorix, reparaissant toujours en quelque lieu entre la Meuse et le Rhin, pour faire douter Rome de sa conquête. Ici, le grand capitaine établit des postes militaires sur la rive gauche de ce dernier fleuve. Là, il fait jeter le pont qui va le porter, lui et son armée, au milieu de ces Germains de la rive droite, dont les excitations et les secours raniment sans cesse les insurrections qu’il croit avoir domptées sur l’autre rive. Il passe le fleuve. Il s’avance avec précaution dans des contrées inconnues. Le voilà tout à coup qui rétrograde comme saisi d’une terreur subite. Il repasse son pont qu’il fait rompre derrière lui. C’est en vain qu’il voudra cacher à la postérité les causes de cette retraite précipitée. Il avait lu, à la lisière de la forêt Hercynienne, le sort qui attendait, à quelque temps de là, Varus et les légions qu’Auguste réclamerait si souvent dans ses rêves. Quelque précurseur d’Herman lui avait montré les guerriers qui devaient arrêter Rome, et plus tard établir un empire sur les ruines du sien.
César quitte ces contrées pour aller chercher ailleurs, même au hasard d’une traversée de l’Océan, une gloire moins chanceuse. Les lieutenants d’Auguste et de Tibère vont y paraître à leur tour. C’est Varus qui passe encore le Rhin pour ne jamais le repasser. C’est Paulin, c’est Drusus, qui, mieux avisés, s’occupent à dompter le fleuve chez les Bataves, pour utiliser du moins ce qu’ils en ont conquis. La paix règne un moment sur les deux rives, jusqu’à ce que Civilis en agite de nouveau les populations pour leur faire obtenir, sous sa conduite, des conditions d’alliance avec Rome qui leur garantissent le maintien de leurs mœurs et de leurs lois.
Plus tard, Pline et Tacite voyagent sur les eaux du Rhin ; et ces touristes de génie y recueillent pour la postérité des notions qui valent bien tous les récits d’expéditions militaires dont il a été presque exclusivement le sujet jusqu’à leur époque.
À moins de deux siècles de là, les rives du grand fleuve vont de nouveau s’agiter dans un grand mouvement d’hommes. Pharabert le traverse avec les premiers Francs, pour aller s’établir dans notre Campine belge d’aujourd’hui. Au soldat germain succède bientôt le missionnaire chrétien, et saint Materne établit, à Cologne même, le siège épiscopal que protège Constantin et d’où rayonnera bientôt la doctrine du Christ vers Trèves, vers Liège, vers Munster et vers Utrecht, pour former un jour ces États ecclésiastiques, oasis de liberté et de prospérité au milieu de l’ère féodale.
Le mouvement s’accélère : des forêts que César n’a osé aborder et de celles où Varus a péri, d’innombrables essaims de guerriers sortent pour traverser le Rhin, et marcher à la destruction de l’empire romain. Pendant plus de deux siècles, le passage en ce sens ne s’arrêtera pas. Lorsqu’il s’est arrêté, un grand nom, le nom de Charlemagne, retentit sur la rive. Cologne est devenue la métropole religieuse, comme Aix-la-Chapelle la métropole politique d’un nouvel empire
Mais les Germains se replient sur eux-mêmes, après avoir été infuser un nouveau sang aux populations les plus méridionales de l’ancien empire romain. Voilà leurs chefs rentrés dans les centres de la rive droite du Rhin, et la descendance de Charlemagne rappelée au service exclusif des populations teutoniques. Le vieux fleuve a toujours son attraction. Voici que l’empereur Arnould le passe avec une immense armée pour aller à la rencontre des Normands, qu’il va détruire sous les murs de Louvain. Godefroi de Bouillon appelle à lui sur ses bords les Belges et les Germains qu’il réunit pour les conduire à la croisade. L’empereur Henri IV se retire vers le Rhin pour échapper aux suites des anathèmes du pape et de la guerre que lui fait son propre fils. C’est à Cologne et puis à Liège qu’il trouve un refuge contre les persécutions de Rome.
Que de noms dont les Belges ont à se souvenir comme les Allemands ; que de noms rappellent ce Rhin, avant même qu’il soit bordé des châteaux des burgraves et parfumé des raisins du Rheingau ! C’est Woeringen où notre duc Jean le Victorieux a livré, au profit commun des Brabançons et des Colonais, la grande bataille sujet de l’épopée de Jean Van Heelu ; c’est Dusseldorf, c’est Wesel, c’est Nimègue, c’est Arnhem, c’est Utrecht, c’est Leyde dont les noms reviennent dans toutes nos annales militaires, commerciales ou religieuses, aussi souvent que les noms de nos plus célèbres forteresses, de nos villes les plus manufacturières, de nos ports, de nos évêchés.
Ce pont de Cologne, l’empereur Othon l’a passé, pour venir combattre avec nous à Bouvines ; Maximilien l’a passé, pour venir épouser notre Marie de Bourgogne ; Charles-Quint l’a passé, allant de ses duchés et de ses comtés des Pays-Bas dans son empire d’Allemagne ; Guillaume de Nassau et Tilly ; tous les grands noms catholiques et protestants des guerres de la réforme ; Guillaume III, Louis XIV, et la suite innombrable des guerriers illustres de leur époque ; tous ceux des guerres de la révolution et de l’empire français : quelle procession interminable se déroule là devant nos yeux, et confond notre imagination ! Et c’est à peine si le théâtre est le tiers de ce Rhin, aussi célèbre à sa source et sur tout son cours.
Que sera l’avenir sur ce théâtre, l’avenir le plus prochain seulement ? Anvers, Rotterdam et Cologne sont bien riches et bien influentes autour d’elles ; elles ont bien des rapports de mœurs et d’intérêts. On ne sait ; mais si l’Europe du milieu venait encore à être agitée de quelque grande crise, ces trois villes, entraînant les systèmes dont elles font le centre, se grouperaient peut-être en quelque nouvelle combinaison politique déjà rêvée, en plus d’une occasion, sur les bords de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin, aux lieux surtout où les trois fleuves forment « les Pays-Bas géographiques. »
Assez de ces rêveries politiques. Voici commencer le Rhin des touristes. Au silence qui régnait d’abord succèdent tout à coup le tumulte et l’agitation. Ce sont les passagers qui montent des cabines inférieures, ou qui courent pêle-mêle sur le pont, cherchant les meilleures places pour contempler les premiers aspects pittoresques du grand fleuve. Voilà Bonn. Voilà « les sept montagnes. » Voilà les premiers vignobles et les premiers châteaux en ruine. C’est l’entrée du Rhin des peintres et des poètes.
On a décrit et dessiné cent fois Godesberg, Drachenfels, Rolandseck, Lintz, Reineck, Andernach, toutes ces étapes des touristes depuis Bonn jusqu’à Coblence. C’est de l’ensemble du pays que nous préférons parler.
Bonn, où les anciens archevêques de Cologne avaient leur résidence favorite, est, comme on sait, l’Athènes des populations rhénanes. L’ancien palais des archevêques est devenu l’université d’aujourd’hui ; et ce centre académique a donné à la ville une importance qu’elle était loin d’avoir autrefois. C’est de là principalement que rayonne sur l’Allemagne catholique du nord cet enseignement qui fait des catholiques prussiens un si notable appoint pour l’école démocratique du centre de l’Europe. Sous ce point de vue, Bonn est comme Cologne encore une ville des Pays-Bas ; une dernière liaison entre les peuples de la Moselle et du Rhin supérieur, et ceux du Rhin inférieur et de l’Escaut.





























