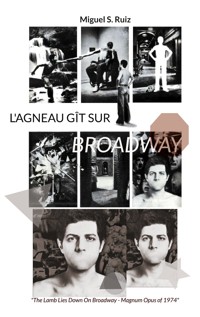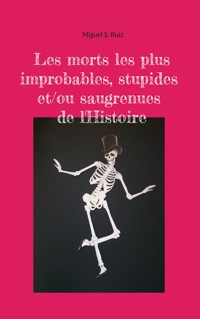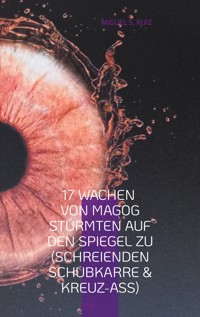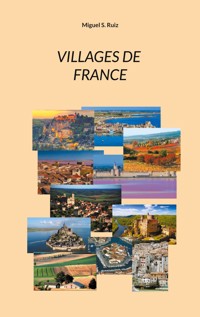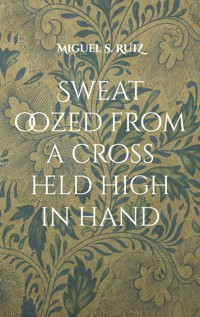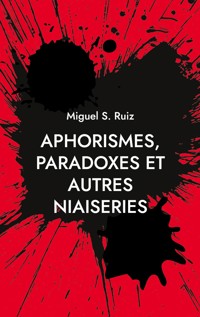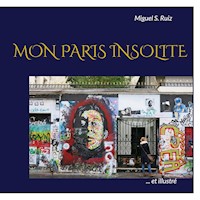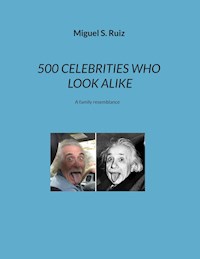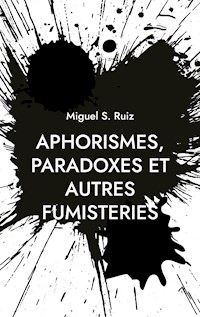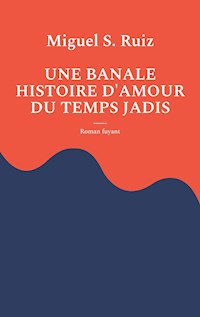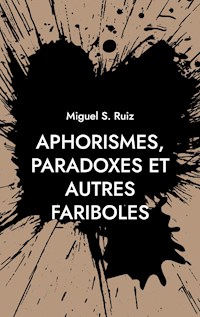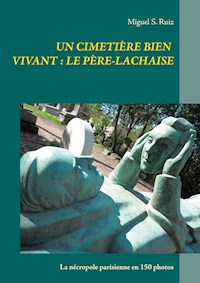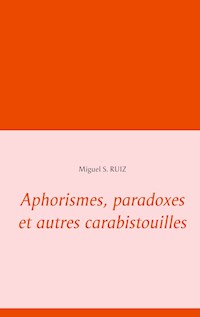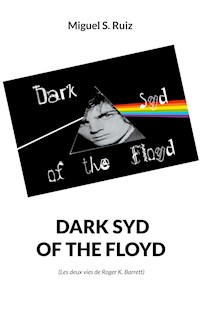
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Diamant fou, dandy pop de l'avant-garde sixties, peintre ignoré et compositeur de génie, Syd Barrett fut à lui seul le créateur du premier album de Pink Floyd : 'The Piper at the Gates of Dawn', cette pierre de touche du psychédélisme à la sauce anglaise. Suivit, l'espace de trois ans, une mystérieuse trajectoire ponctuée par deux pépites de rock schizophrène : 'The Madcap Laughs' et 'Barrett'. Et puis : plus rien, pour toujours... Quinze ans après sa mort, il est temps de redécouvrir l'ange maudit du Swinging London. Celui qui sut faire la nique au destin et larguer les amarres - après avoir livré ses fulgurantes et énigmatiques beautés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
‘'Puisse l'artiste mettre au jour son monde,
la beauté à laquelle il donne naissance, qui n'a
encore jamais été et qui ne sera plus jamais.''
(Hermann Bahr)
‘'Son oisiveté est un travail, et son travail
un repos ; il est élégant et négligé tour à tour...
Il ne subit pas de lois : il les impose.
Qu'il s'occupe à ne rien faire, ou médite
un chef-d'œuvre ; qu'il n'ait pas vingt-cinq
centimes à lui, ou jette de l'or à pleines mains,
il est toujours l'expression d'une grande pensée
et domine la société. C'est un artiste.''
(H. de Balzac, ‘'Traité de la vie élégante'')
‘'Que le désordre ait parfois accompagné
le génie, cela prouve seulement que
le génie est terriblement fort.''
(C. Baudelaire, ''Conseils aux jeunes littérateurs'')
‘'Je suis un sprinter, les choses ayant toujours été
trop lentes pour moi... I’m full of dust and guitars.”
(R.K.B)
Table des matières
Préface
Une trajectoire
1 - L’oiseau dans son nid (1946-1964
)
2 -L’envol (1965-1966
)
3 - Au zénith (1966-1967
)
4 - La chute (1967-1968
)
5 - Au fil du rasoir : une renaissance (1969-1970
)
6 - En attente (1971-1973
)
7-Un destin subi... et choisi (1974-2006
)
Cahier central (photos
)
Héritage et influences
Discographie et lyrics
“Arnold Layne” / “Candy and a Currant Bun”
“See Emily Play
”
“Apples and Oranges
”
“The Piper at the Gates of Dawn” (LP
)
“Jugband Blues”
“Vegetable Man” / “Scream Thy Last Scream
”
“The Madcap Laughs” (LP
)
“Barrett” (LP
)
“Opel” (LP
)
“Bob Dylan Blues” / “Two of a Kind”
Titres inédits avec Pink Floyd
Les concerts
Notes
Index-Top de l’auteur
Index général
Préface
« Remember when you were young, you shone like the sun » chantait Pink Floyd en 1975, dans “Shine On You Crazy Diamond”, un morceau dédié à leur ami et ex-leader, Roger ‘Syd’ Barrett. Lequel avait été évincé du groupe sept ans auparavant, pour cause d'instabilité mentale, de ‘dérèglement de tous les sens’ et de lucidité approchée de trop près.
Diamant fou, dandy pop maudit de l’avant-garde sixties, peintre ignoré à (re)découvrir, guitariste et lyriciste novateur... Ce manieur de mots et compositeur de génie - le plus grand de sa génération, avec Ray Davies et le tandem Lennon-McCartney - fut à lui seul le créateur du premier album du groupe, en 1967. The Piper at the Gates of Dawn, cette pierre de touche du psychédélisme à la sauce anglaise, sera dans la foulée complété par deux autres enregistrements aux fulgurances mélodiques et au chaos lyrique : The Madcap Laughs et Barrett, ovnis schizophréniques et chefs-d’œuvre de rock'n'roll introspectif.
Dans la nuit sidérale « les étoiles font peur » ; et un prince à la beauté préraphaélite se mue lentement en monstre asocial, sous les coups de boutoir de sa propre psyché. Au risque de se brûler les ailes, il joue avec ses propres démons, tentant ainsi de s’en déjouer pour l’amour de l’art. Et tout un peuple de créatures se presse en/autour de lui, tandis que les débris d’une boîte à musique (son groupe qui lui échappe, puis lui en solo) joue mille airs à l’irréelle splendeur. Les siens, directement branchés sur des plaies à vif - qui sont les siennes.
La voix venait d'ailleurs. Et va y retourner. Car comme Rimbaud son frère en précocité et ineffable poésie, Roger Keith, un temps Syd, lâchera tout - à vingt-quatre ans. Et partira soudainement se terrer jusqu’à la fin de ses jours à Cambridge, sa ville natale.
Quinze ans après sa mort, il est temps de redécouvrir l’ange charismatique du Swinging London. Et le sage caché derrière le poète déglingué, qui sut faire un sort au sort que lui réservait l’industrie musicale. Pour partir à temps - après avoir livré ses énigmatiques beautés.
Paris/Sigüenza/Cambridge, juillet 2021
Une trajectoire
1 - L'oiseau dans son nid (1946-1964)
Venu au monde le 6 janvier 1946 - à Cambridge, au 60 Glisson Road -, Roger Keith Barrett est issu d’une famille typique de la classe moyenne britannique de l’après-guerre. Il est le quatrième enfant d’une fratrie de cinq (deux frères et une sœur aînés - Alan, Donald et Ruth -, et une autre sœur plus jeune - Rosemary). Le père, Arthur Max Barrett, est un éminent médecin de la ville, spécialiste de pathologie morbide à l’hôpital Addenbrooke de Cambridge. Célèbre pour ses démonstrations médicales à la morgue de l’hôpital, modeste mais doté d’une grande capacité de travail alliée à un amour passionné de son métier, il était apprécié de tous - famille, amis comme collègues de travail. Son épouse Winifred Flack, plus âgée de cinq ans, est elle une autre figure de la communauté, tenant un club qui fut en son temps très côté dans les guides de la ville. Energique, enjouée et dotée d’un humour très british, elle était un peu le pendant de son médecin de mari, lui d’une nature plus réservée et introvertie. Etonnamment - et peut-être est-ce là une des clés de l’union de ces deux êtres aux caractères différents - une « connexion » médicale existait déjà entre eux, Winifred descendant d’Elizabeth Garrett Anderson (1838-1917), la toute première femme médecin diplômée d’Angleterre.
En 1951, la famille déménage dans une spacieuse demeure au 183 Hills Road, dans les faubourgs sud de la ville. Le petit clan est constitué de parents et d’enfants aux tempéraments tous très différents mais la vie familiale semble avoir été un havre de bonheur, aux dires de Rosemary. De fait, les trois aînés ayant quitté le domicile au mitan et à la fin des années 50, Roger et sa plus jeune sœur purent alors pleinement profiter du cocon familial. Cela tombait bien, puisque c’est avec Rosemary que le futur Syd se sentait le plus d’affinités (proches en âge et chacun avec des natures, si ce n’est communes, du moins complémentaires).
Durant son enfance, Roger Keith, d’un naturel joyeux et sociable, pouvait néanmoins rentrer dans des crises terribles et se montrer rétif à toute forme d’autorité, en cas de contrariété. Il faut dire que l’enfant est alors (et en fait fut toujours) le «préféré» de sa mère, un cas typique de progéniture un peu trop idolâtrée et choyée. Quoi qu’il en soit, les premières années de la vie de Roger furent tout sauf mornes. La maison de son enfance d’abord - une grande bâtisse victorienne à double façade, ornée de lierre sauvage comme de haies bien taillées - était située en retrait de la route et longée par de hauts murs derrière lesquels se trouvaient un grand jardin et un belvédère. Décorée de manière baroque et cocasse - portes émaillées donnant sur un vaste salon, lavabos de porcelaines, rideaux mordorés, lampes de verres multicolores - elle constituait de fait le terreau idéal pour un enfant imaginatif comme lui. Ses parents étant de plus attirés par le monde artistique en général (littérature, peinture, musique), on comprend aisément ce que fut la nature profonde de Syd, rêveuse et créative à la fois, marquée à jamais par le mystère de cette demeure et de cet environnement familial insolite.
L’enfant développe très tôt une personnalité et une faculté d’assimilation étonnantes. Aux dires de sa jeune sœur Rosemary, il eut très tôt la capacité d’absorber les diverses influences extérieures, comme si une source interne irriguait constamment sa soif de connaissances. Serviable et espiègle à la fois, mais aussi doté d’un char(is)me qui le fait aimer par tous, c’est un intuitif. Sensible à une approche synesthési-que (1) du monde - ‘grille de lecture’ et vision propre aux âmes artistes -, il semble aussi avoir développé très tôt ses propres structure syntaxique et code sensoriel, parlant, sachant compter avant même de pouvoir marcher et étonnant son entourage par son appétence pour l’imaginaire. Dans une maison où régnait donc le monde des arts, et en particulier celui de la musique (père grand amateur de valses classiques et un frère jouant dans un groupe de jazz), Roger était un peu comme un enfant-roi à qui l’on passe tout, afin de favoriser ses talents et ses dons artistiques. Il bénéficia dès l’âge de sept ans de leçons de piano, mais très vite sa préférence se (re)tourna vers le dessin et la peinture - en fait sa toute première passion puisqu’il avait développé dès l’âge de dix-huit mois un talent... inné, pour la représentation et la caricature en particulier. Une passion qui ne le quittera jamais vraiment, ni pendant les succès musicaux (voir ses croquis du verso du premier album et du second single du groupe, de la pochette de son second album solo et de celle de son 45 tours “Octopus’’), ni après sa retraite finale. (Malheureusement, à l’instar d’un autre musicien peintre contrarié - Serge Gainsbourg -, il détruisit la plupart de sa production et il ne reste aujourd’hui que très peu de ses étonnantes toiles qui aient été épargnées...)
Mais revenons au Roger/Syd des premières années. En 1957 il commence ses études secondaires à la Cambridgeshire High School for Boys, aux côtés de son ami d'enfance Roger Waters - avec qui il fondera plus tard Pink Floyd. Quelques années plus tôt, à la Morley Memorial Junior School, il avait aussi été l’élève de la mère de son ami, laquelle exerçait comme professeure dans l’établissement. A cette époque, passant constamment de la musique à l’art pictural, il acquiert très vite un ukulélé puis un banjo (vers 10-11 ans), et finalement une guitare à 14 (une Hoffner Congress acoustique). L’année suivante, il se fait offrir sa première guitare électrique et fabrique son propre amplificateur. Ses idoles de l’époque sont les américains Bo Diddley (ses rythmes tribaux et ses riffs carrés) ; Buddy Holly, le précurseur Us de cette pop mélodique qui fera florès dans la décennie à venir... Et les anglais des Shadows, dont il apprécie particulièrement les effets d’écho novateurs du guitariste Hank Marvin. C'est vers cette période qu'il se donne le surnom de Syd, peut-être en référence à un musicien de jazz de la région (qui s'appelait Sid Barrett) - batteur (ou contrebassiste selon d’autres sources) qu’il appréciait, lui et son groupe. Une autre version viendrait... de son passage chez les scouts pendant sa prime jeunesse ! Refusant en effet de porter le béret règlementaire, il fut affublé par dérision du sobriquet de Sid, diminutif de Sidney, un prénom « typique » de la classe ouvrière britannique. Dans les deux versions, le « y » dut apparaitre pour se différencier soit 1) de son homonyme batteur, soit 2) de la masse des scouts conformistes et moqueurs ! Quoi qu’il en soit, comme le dit un jour sa cadette Rosemary : « C’était juste un surnom. Il n’était jamais Syd à la maison, il ne l’aurait jamais permis. » Ce patronyme adopté semblerait aussi, sans doute, provenir d’une référence aux personnages des Goonishes (Syd-Knee et Sydernee), qu’il trouvait à son goût. Ancêtre des Monty Python, l’humour absurde et un brin cruel de cette troupe de théâtre lui convenait et lui correspondait en effet à merveille (comprenant l’humoriste Spike Milligan et l’acteur Peter Sellers, elle connut son heure de gloire à la radio dans les années 50).
Le 11 décembre 1961, Max Barrett succombe à un cancer, moins d'un mois avant le seizième anniversaire de Roger. Fait significatif, à partir de cette date l’adolescent va arrêter son journal intime, qu’il tenait depuis une dizaine d’années. Suite à cet évènement, les frères et sœurs aînés de Syd ayant quitté la maison, et afin de subvenir aux besoins de la famille, Winifred décide de louer deux des chambres de la maison (entre autres locataires, elle eut un temps le fils de l’actrice Jeanne Moreau et le futur premier ministre japonais Junichiro Koizumi !). Désireuse d’aider son fils - lequel, même s’il ne le montre pas, a été très marqué par la mort du Dr. Barrett -, elle encourage ses penchants musicaux en laissant son tout nouveau groupe, Geoff Mott & the Mottoes, se produire dans le salon familial. Le combo de débutants se séparera au printemps 1962.
En septembre de cette même année, Barrett entre au département Arts du Cambridge Technical College, où il va faire la connaissance de David Gilmour (son futur remplaçant au sein de Pink Floyd). Comme beaucoup d'adolescents britanniques, c’est alors un fan des Beatles et des Rolling Stones (qu’il aura l’occasion de voir dans un village du Cambridgeshire), mais aussi de blues vintage américain (Robert Johnson, Elmore James). II commence dès 1963 à écrire ses propres chansons (“Effervescing Elephant’’, que l’on retrouvera sur son 2ème album solo, semble avoir été la toute première jamais composée), tout en se produisant avec divers petits groupes, ou bien en duo acoustique avec son compère Gilmour. On le retrouve ensuite comme bassiste dans le groupe Those Without, à l’été 63, puis comme guitariste et bassiste dans une autre formation, The Hollerin’ Blues, un an plus tard. En 1964, avec sa petite amie Libby Gausden, il assiste à un concert de Bob Dylan, une autre de ses grandes influences (il écrira dans la foulée un sarcastique “Bob Dylan Blues’’ qu’on retrouvera des décennies plus tard sur une compilation d’inédits). .
Au printemps, après avoir pesé le pour et le contre, Syd/Roger décide de privilégier les études - et son amour de toujours pour la peinture - en s’inscrivant au Camberwell College of Arts, un département londonien de l’Université britannique. De fait, l’atmosphère provinciale de Cambridge commençait à lui peser, et l’occasion de faire d’une pierre deux coups était trop belle : la promesse d’une nouvelle vie dans la capitale... tout en gardant la possibilité de continuer de se dédier à ses passions artistiques. Dès lors, à partir de septembre, fréquentant assidument l’établissement universitaire, il va s’intégrer à une petite bande d’étudiants qui vont devenir inséparables durant les deux années à venir.
2 - L'envol (1965-1966)
Au début de l’année 1965, Barrett rejoint comme chanteur et guitariste le groupe de son ami d'enfance, Roger Waters, qui étudie lui aussi à Londres, à la Royal Polytechnic de Westminster. La formation, qui comprend également Nicolas ‘Nick’ Mason et Richard ‘Rick’ Wright (deux autres étudiants en architecture), change fréquemment de nom - s'appelant tour à tour The Abdabs, Sigma 6, The Meggadeaths ou encore The Tea Set. C'est finalement Barrett qui va trouver leur nom définitif. Un jour qu’ils partagent l'affiche avec une autre formation nommée elle aussi The Tea Set, il décide de juxtaposer les noms de deux obscurs bluesmen américains, Pink Anderson et Floyd Council, devenant ainsi « The Pink Floyd Sound », puis plus simplement «The Pink Floyd »... Plus tard, il affirmera souvent que ce patronyme étrange lui avait été communiqué par les occupants d’une soucoupe volante alors qu’il se trouvait assis sur une ligne tellurique, à Glastonbury dans le Somerset ! Un trait de caractère typique de Syd, qui n’aime rien tant que combiner l’étrange, l’absurde. et la moquerie. Quoi qu’il en soit, au cours de l'année leur répertoire - d'abord constitué de reprises de standards de rhythm’n’blues américain - va laisser progressivement place à une musique plus improvisée et sophistiquée, s'inspirant du rock comme du jazz et intégrant aussi quelques chansons personnelles (écrites par Syd lui-même). Notre homme écoute alors beaucoup les albums précurseurs du courant psychédélique à venir - Fifth Dimension des Byrds, Aftermath des Rolling Stones, Rubber Soul et Revolver des Beatles -, dont l'influence sur son écriture est déjà perceptible. C'est également le cas pour le Da Capo du groupe californien Love, et les singles des Kinks de Ray Davies, des classiques de pop sophistiquée tels que Sunny Afternoon, All Day and All of the Night ou Dead End Street.
A l’été 1965, tandis que Barrett fait ses premiers pas dans un Pink Floyd embryonnaire, celui-ci commence alors à s’adonner aux drogues psychédéliques, avec quelques-uns de ses amis de la coterie intellectuelle de Cambridge (Nigel Lesmoir-Gordon, Ian Moore, Storm Thorgerson, etc). Il devient même la vedette d’un petit film amateur, que « dirige » Nigel, à propos d’un groupe de farfelus de Cambridge qui prennent des champignons hallucinogènes dans une carrière abandonnée (on peut trouver le film sous le nom de Syd’s First Trip sur Internet, malgré les efforts constants de David Gilmour pour empêcher sa diffusion...). D’aucuns prétendent que c’est à partir de cette première expérience des drogues psychédéliques que Syd, à la base un type à la personnalité plutôt solaire et au caractère malicieux, commença à changer - révélant une face plus sombre, introvertie et fragile.
Quoi qu’il en soit, le caractère introspectif du LSD - et des autres substances tendant à « accroître le champ de conscience » - amena certaines connaissances de son cercle à rejoindre une secte sikh connue sous le nom de Sant Mat (« La Voie des Saints »). Remontant à l’Inde du 13ème siècle, cette religion-philosophie prônait un strict code moral et des principes d’abstinence. Interviewé par Rob Chapman pour sa biographie de Barrett, David Gale, un ami proche de l’époque, se souvient : « Un tas d’amis de Syd furent attirés et rejoignirent avec enthousiasme ce groupement. » L’un après l’autre, ces jeunes bohèmes firent même le pèlerinage jusqu’en Inde et revinrent profondément changés... pour le meilleur et pour le pire. « Ils se coupèrent les cheveux, échangèrent leurs fringues hippies pour un costume ordinaire, arrêtèrent l’alcool et les drogues, se marièrent avec une personne aux mêmes nouvelles conceptions, en un mot adoptèrent un style de vie strict », raconte Gale. Contre toute attente, Barrett, qui était tout sauf « ordinaire », faillit bien les rejoindre. Le jeune homme décida donc d’aller rencontrer le gourou de la secte, Maharaj Charan Singh Ji - surnommé « The Master » par ses disciples -, afin d’être admis dans leur cénacle. A cette époque, il était extrêmement rare que le Sant Mat refuse un disciple. C’est pourtant ce qu’il fit avec notre jeune impétrant. Il lui dit qu’il était trop jeune et que « sa demande d’initiation était trop ‘émotionnelle’ et pas assez basée sur une véritable quête spirituelle », comme le raconte Andrew Rawlinson, un disciple dévoué qui lui fut «intronisé » par le maître... Aux dires de certains, ce rejet dévasta (ou peut-être seulement vexa ? - on ne sait trop) notre jeune artiste en pleine recherche existentielle. Etant donné les problèmes à venir, une vie simple et structurée, sans drogues et basée sur la méditation, aurait pu s’avérer être une bonne chose pour lui. Mais indépendamment du fait que sa santé mentale aurait pu être préservée, cette « voie » nous aurait privée du Syd génial auteur-compositeur en gestation. Un mal pour un bien donc, pourrait-on se dire égoïstement.
Suite à cet épisode d’« initiation avortée », Barrett décide de se reconcentrer sur le groupe. C’est à cette époque - printemps 1966 - qu’il écrit une de ses premières compositions vraiment abouties : “Bike’’, que l’on retrouvera sur le premier album. Alors que Pink Floyd avait commencé en jouant des covers de standards du rhythm ’n’blues et du rock américain des années 50 (Bo Diddley, Eddie Cochran, les artistes de chez Stax et Motown, etc), le combo d’étudiants s’était maintenant forgé son propre style, à base de longues improvisations jazz et rock’n’roll. Après le départ de Bob Klose (le musicien le plus aguerri du groupe), la direction musicale changea du tout au tout, la guitare de Syd et les claviers de Wright devenant de plus en plus prépondérants. A partir de là, et même si Barrett n’avait pas encore vraiment commencé à composer des morceaux totalement achevés, comme le dira bien volontiers le batteur Nick Mason : « Déjà pendant notre période ‘impro’, la plupart des idées venait de Syd »... Toujours est-il que cette fin d’année 1966 voit Pink Floyd devenir le groupe phare de la scène psychédélique londonienne, grâce en particulier à ses concerts à la Roundhouse, et surtout à l’UFO Club, haut lieu de l'underground de la capitale. Parallèlement à un matériel musical «brut de décoffrage» (le groupe joue alors à un niveau sonore rarement atteint), Syd commençait donc à composer sérieusement. En quelques mois, il se roda puis écrivit la presque totalité de l’album à venir, sans parler même de quelques titres de ses futurs albums solos. L’influence de ses lectures de jeunesse (Les Contes des frères Grimm, L’Herbe du Diable et la Petite Fumée de Carlos Castaneda, l’ouvrage philosophico-religieux chinois I-Ching, et l’œuvre phare de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux) va y être particulièrement perceptible.
En octobre de cette même année, les managers du groupe, Andrew King et Peter Jenner, mettent sur pied la compagnie Blackhill Enterprises afin de gérer les finances et de démarcher les maisons de disques. Parallèlement à cela, ils souhaitent faire enregistrer au groupe une démo et pour cela programment une session dans un studio du quartier londonien de Hampstead. King raconte : « C’est à ce moment -là que je me suis rendu compte que le groupe interprétait son propre matériel et que Syd, d’un seul coup, était devenu un véritable songwriter. »
Ils font alors la connaissance de Joe Boyd, un expatrié américain qui s’est récemment fait un nom dans le milieu des promoteurs de la scène musicale anglaise (en particulier au sein de l’UFO Club). Grâce à Boyd et à l’agence du manager Bryan Morrison, le groupe peut dès lors prétendre à de meilleures conditions d’enregistrement - et décrocher leur premier concert en dehors de Londres (le Floyd étant depuis ses débuts un groupe strictement « londonien »). A partir de novembre, ils se produisent dans le cadre d’évènements musicaux et multimédia aux noms tous plus étranges les uns que les autres : d’abord le Philadelic Music for Simian Hominids au Hornsey College of Art, suivi de deux semaines complètes à l’affiche de la London Free School... Puis, en décembre, c’est la Psychodelia Versus Ian Smith (un évènement organisé par des militants politiques rhodésiens) ; tandis que le mois suivant, le groupe joue pour un concert de soutien à l’Oxford Commitee for Famine Relief (Oxfam), une organisation luttant contre la pauvreté au Royaume-Uni. Ce dernier show au mythique Royal Albert Hall constituait à ce jour leur plus important concert.
A la fin de l’année et grâce aux efforts combinés du groupe et de ses managers, un contrat de 5 000 £ est signé avec la maison de disques EMI, pour l'enregistrement d'un album. Un record pour l'époque. Et pour un groupe encore peu connu nationalement, avant tout estampillé underground...
3 - Au zénith (1966-1967)
Les trois premiers 45 tours de Pink Floyd sont tous l’œuvre de Barrett, qui de fait était maintenant devenu le leader du groupe, ou tout au moins sa principale force créatrice. Le premier, “Arnold Layne’’, sort en mars 1967 et va rapidement faire connaître le groupe dans tout le pays (si ce n’est encore au niveau international). Et ceci en dépit de la censure exercée par certains médias : c’était de fait une des toutes premières chansons à faire allusion - de manière voilée certes mais tout de même... - à l’homosexualité. Syd avait écrit ce morceau à propos d’un voleur un peu spécial qui sévissait alors à Cambridge. Une expérience qui était en particulier arrivée dans le jardin de la maison de Roger Waters, le bassiste du groupe. « Ma mère et celle de Syd avaient l’habitude de loger des étudiants », rapporte Waters dans une interview de 1967. « Il y avait un collège de filles pas loin de la maison. Nous avions donc constamment des soutiens-gorges et autres culottes suspendus à la corde à linge dans le jardin ! Et Arnold, ou quel que soit son véritable nom, s’ingéniait à les subtiliser, de nuit de préférence. On ne réussit jamais à l’attraper. Je suppose qu’il s’arrêta quand il sentit que les choses risquaient de mal tourner pour lui. »
Waters raconta donc cette anecdote cocasse à Barrett qui s’en inspira et décida d’immortaliser le fétichiste de Cambridge. « Je trouvais qu’Arnold Layne était un chouette nom et collait bien à la musique que j’avais composée », dit Syd à un journaliste du Melody Maker venu l’interviewer juste après la sortie du 45 tours. « Arnold semblait juste avoir un hobby - collectionner les sous-vêtements féminins au clair de lune -, et tout partit de là »... « Collecting clothes, moon-shine washing liiiiiiines / They suit him fine ! », indeed... Les allusions elliptiques au travestisme étaient de fait ‘too much’ pour certains, et la chanson fut donc interdite d’antenne sur la très populaire Radio London. « Arnold Layne prend son pied à s’habiller en femme. Des tas de gens font ça dans la vie, ne soyons pas dupes ou choqués ! » - telle fut la réponse de Barrett, dans une attitude de défi et d’anticonformisme. Attitude provocatrice tempérée, si l’on écoute bien la chute de la chanson, par une gentille touche ironique, et ce qui pourrait apparaître comme un semblant de morale : « Why can’t you see ?? Don’t do it again ! »...
Néanmoins, comme le dit encore Nick Mason : « Nous voulions tous devenir des stars et pour cela il fallait passer par la case single. Et "Arnold” semblait la chanson la plus appropriée pour être ‘condensée’ en trois minutes sans trop perdre de sa substance. » Le groupe réenregistrera une autre version (plus sophistiquée) du morceau aux studios EMI, mais ce fut bien la version initiale de janvier qui fut au bout du compte privilégiée (avec l’accord final de Barrett). Première et dernière production de Joe Boyd pour le groupe, celui-ci a souvent dit que le morceau avait maintes et maintes fois été joué en concert, longtemps avant, dans une version en effet plus étoffée (plus de quinze minutes faisant la part belle à de longs passages instrumentaux). Or donc, le groupe et Syd avaient finalement pris conscience que “Arnold’’ devait être ‘raccourci’ - ceci afin de pouvoir être commercialisé comme 45 tours... Et prouvant ainsi que lui et les autres étaient capables de concessions pour parvenir au succès ! Quoi qu’il en soit, ce fut selon les dires de Boyd un enregistrement complexe et un montage délicat à finaliser, en particulier la section instrumentale du milieu (le solo d'orgue de Wright). Celle-ci fut en effet enregistrée comme une véritable pièce de musique par elle-même, indépendante, pour être finalement intégrée au corps de la chanson et à son riff-break emblématique - une variation style drama-sound (2) de celui de... “Jailhouse Rock”, l’antédiluvien rock fifties d’Elvis Presley.
Un film promotionnel fut réalisé fin février 1967, mettant en scène les quatre membres du groupe. Affublés qui d’un masque, qui d’un chapeau melon ou d’une redingote au style suranné, la petite troupe fut filmée sur une plage de East Wittering (West Sussex), déambulant. avec un incongru et inquiétant mannequin ! Petite merveille surréaliste en noir et blanc, cette séquence de Derek Nice, réalisée pour 2000 £, était à l’origine destinée à être projetée pour un show du Top of the Pops de la BBC (3 avril 1967). Le ton était à la farce absurde, avec Waters effectuant des figures de pantomime grotesques et un Syd resplendissant dans un kimono japonais orné de petits disques argentés (les mêmes qu’il accolait sur sa guitare lors des concerts du groupe). Un autre scopitone à la sauce anglaise, cette fois filmé près de l'église St-Michael à Highgate, fut aussi tourné au printemps (29 avril 1967). Dernière concession ‘commerciale’ ?... C'est en tout cas la seule séquence connue de « synchronisation labiale » - autrement dit de play-back -, qui fut acceptée par Barrett !
Mais revenons à la musique. Malgré l’absence d’accords mineurs, “Arnold Layne’’ possède cette étonnante et fascinante tonalité mélancolico-lyrique. Les accents gutturaux de Barrett semblent aussi tendre vers la pénombre. Car de fait, avec ce morceau et à l’instar du “Paint it Black’’ des Stones (et encore plus du “I am the Walrus’’ des Beatles), Syd parvient à introduire pour la première fois une touche sombre dans la production musicale de l’époque. Véritable point de rupture avec la tradition d’alors, “Arnold” constitue aussi - malgré les coupures de la production - une forme de mini-symphonie, tant par sa couleur musicale inédite et ses lyrics décalées, que par ses ineffables réverbérations harmoniques (si, si...!). Comme le “Pictures of Lily” des Who, sorti quelque temps avant et qui possède la même cadence montante, la chanson est de fait un petit trésor sonore - qui se veut à la première écoute sans prétention mais qui au fond est tout plein de son originalité. Ces breaks abrupts qui lui donnent sa dimension « dramatique », ce côté garage et mélodique à la fois et - mix des influences déclarées de Barrett vis-à-vis des Kinks et des Beach Boys - ces étonnantes envolées lyriques et douces-amères qui ponctuent le morceau à intervalles réguliers... Tout fait de “Arnold” un des jalons musicaux de l’époque, ouvrant des perspectives pour les innovations-transformations à venir (psychédélisme ; rock progressif de la décennie suivante ; manière de traiter les sujets abordés - entre journalisme et distance caustique). Et, bien que le succès commercial ne fût pas vraiment à la hauteur (le single atteignit péniblement le n° 20 des ventes au Royaume-Uni), le morceau - ovni débarqué dont on se sait où - est considéré depuis longtemps comme une des pierres angulaires de la pop anglaise (reconnu par tous, fans et ‘pairs’ musicaux compris). En ce qui concerne la face B, on trouve à nouveau une composition de Syd : “Candy and a Currant Bun’’. La chanson - une page trop méconnue de la production barrettienne qui fut à l’origine créée sous le nom de “Stoned Alone’’ puis de “Let’s Roll Another One’’ - est encore une franche réussite. Beat jouissif, guitare hendrixienne en diable (avec une pointe de fuzz à la “Satisfaction’’), chœurs à l’unisson et chant lead aussi étrange que fou et passionné, le morceau est un génial - quoique bref (2’38) - trip musical, tout en ruptures rythmiques et mélodie addictive. Jusqu’à ce final apocalyptico-psychotique, drone bourdonnant et balbutiements d’aliénés sur fond d’écho dissonant. Dans cette autre pépite pop aux influences avant-gardistes, les paroles étaient elles au départ beaucoup plus explicites et ambitieuses - tant sur le plan de l’évocation de certaines substances illicites que sur celui d’allusions ouvertement sexuelles. Reste ici un bien innocent « Please just fuck with me »... Car de fait la BBC censura à nouveau, et Barrett dut changer le texte initial. On imagine aisément sa colère et son dépit tant son allergie pour toute forme d’autorité et de contrainte était marquée - mais aussi apparemment sa farouche volonté d’atteindre le succès ! Quoi qu’il en soit, ce premier single “Arnold/Candy’’ constitue un véritable coup de maître. Selon votre serviteur, avec le “Strawberry Fields Forever / Penny Lane’’ des 4 de Liverpool : peut-être LE chef-d’œuvre de cette année 1967 - qui pourtant n’en manqua pas.
Jusqu'alors, il y avait deux Pink Floyd bien distincts. D’un côté celui qui, en compagnie de Soft Machine et de quelques autres apprentis artificiers, massacrait des standards R&B sur la scène de l'UFO et explorait un rock mâtiné de musique bruitiste (AMM), de jazz (John Coltrane) et de musique concrète (La Monte Young). Et de l’autre celui, autrement plus « commercial », que l'on pouvait entendre, en chemise à fleurs, à Top of The Pops ou sur les ondes de la BBC.