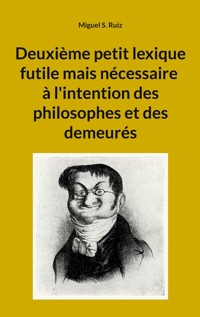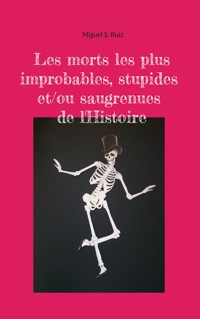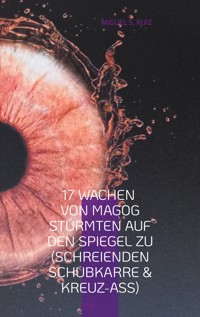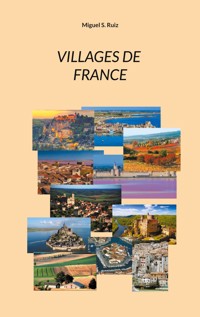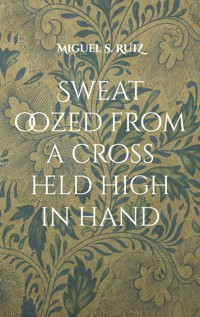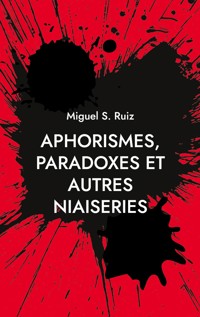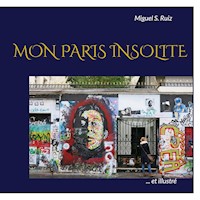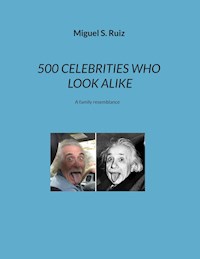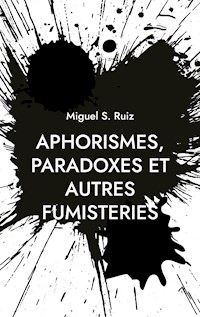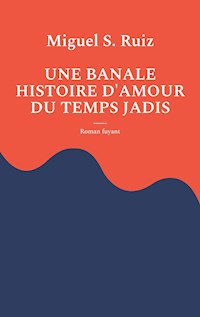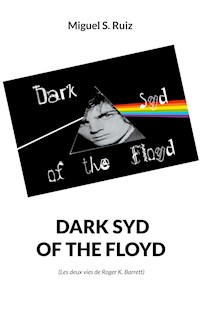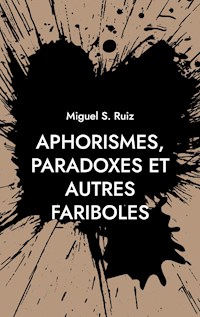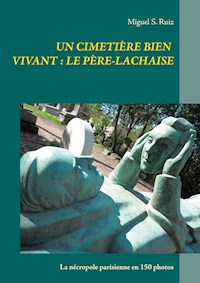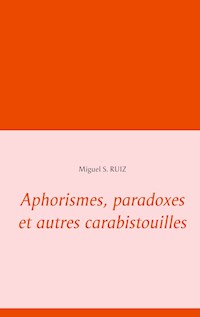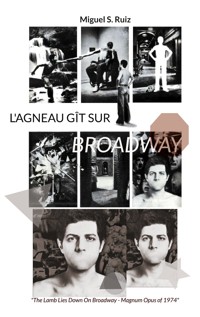
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Tour de force d'extravagance maîtrisée, monstre échevelé fonçant vers un but bien précis - la quête de soi et de l'excellence musicale - dans la carrière de Genesis "The Lamb Lies Down On Broadway" est cette grandiose parenthèse en forme d'apothéose. Mais une parenthèse finale. Car son principal créateur (le frontman Peter Gabriel) va quitter le groupe six mois plus tard, lessivé, un brin désabusé mais conscient qu'après avoir accouché d'un tel ovni, ils (le groupe et lui) étaient arrivés à un point de non-retour. Et c'est bien de cela qu'il s'agit : un quasar issu de nulle part, brillant de mille feux et qui explose dans un inévitable et glorieux final., telle une planète déjà morte mais que l'on peut encore admirer de nos jours, émus et estomaqués, depuis la Terre. Oeuvre au noir et joyau lumineux, produit inspiré mais fragile d'un groupe qui se sait condamné (les tensions internes et le départ programmé de PG), apex né de la psyché foisonnante de son chanteur et d'une grâce musicale à son zénith, "The Lamb" est là pour l'éternité... Alors Alléluia, sonnez trompettes, battez tambours ! ; voici l'histoire de cet astre sombre et incandescent, pierre angulaire du rock anglais - et de la musique, toutes périodes confondues.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Ce récit est totalement le fruit de mon imagination – et c’est bien pour cela qu’il est vrai. »
(Boris Vian, L’Écume des jours)
« Les personnages étant réels, toute ressemblance avec des individus imaginaires serait fortuite. »
(Raymond Queneau, Le Dimanche de la vie)
Table des matières
1 –
A whirring sound growing near
Introduction
2 –
Something solid forming in the air
Construction et… genèse
3 –
Only a magic that a name would stain
L’album
4 –
Singing all the chants
Les lyrics
5 –
Even academics searching printed words
Texte de la pochette intérieure
6 –
And once again the stage is set for you
Les concerts de la tournée
7 –
(Knock and) knowall
Annexes
8 –
Got the whole thing down by numbers !
Index général
1
A whirring sound growing near
Introduction
En matière de musique populaire et de rock music en général, quand on parle de doubles albums, c'est pour convenir qu'ils sont bien souvent trop longs, inégaux, voire un brin auto-indulgents – pour ne pas dire prétentieux. Et qu'un disque simple aurait en l’occurrence sans doute été préférable. C’est le cas par exemple pour l’Umma-gumma de Pink Floyd (une bonne galette live, une autre en studio sans intérêt), et aussi l’album que beaucoup considèrent pourtant comme leur œuvre majeure, The Wall : la production – un peu verbeuse, trop lourde – d’un groupe à bout de souffle. De même, on pourrait citer le Tales from Topographic Oceans de Yes (une véritable boursouflure celui-là, tant pour la musique que pour les thèmes abordés) ; A Passion Play de Jethro Tull (enflure classicisante de 1973 assassinée par la critique, à juste titre, dès sa sortie) ; le All Things Must Pass de George Harrison (en fait un triple, qui aurait tout juste fait un bon simple) ou le Quadrophenia des Who (superbe pochette… mais musique presque totalement ratée). Quoi d’autre ? Le décevant live de Led Zeppelin de 1977 The Song Remains the Same ; 666 des Aphrodite’s Child (le groupe splitta dès sa sortie, c’est dire) ; ou encore cet autre triple des Clash de 1980, Sandinista (trop confus, trop touffu)… Bref n’en jetons plus, les exemples sont légion de toutes ces entreprises ratées.
Mais il y a aussi de notables et totales réussites. Des disques en tout point remarquables, des monstres que l'on n'imaginerait jamais raccourcis, tant ils brillent par leur cohérence et par le fait qu’ils ont réussi à maintenir de bout en bout une constante qualité d’écriture. Dépendants certes de la subjectivité propre à chacun, les exemples ne sont au final pourtant pas si nombreux que cela… Alors, petit florilège idiosyncrasique de votre serviteur : à tout seigneur tout honneur l’Electric Ladyland de Jimi Hendrix (1968), extraordinaire de novation musicale et qui marqua son époque. Citons aussi l’avant-gardiste et abrasif Trout Mask Replica de Cpt. Beefheart (1969), le jazz fusion révolutionnaire de Bitches Brew (Miles Davis, 1970) et le mythique album en public des Doors, Absolutely Live, de la même année. Mais aussi l’Exile On Main St. des Rolling Stones de 1972 (aucun rock hit mais une merveille de cohésion et de simplicité), Physical Graffiti de Led Zeppelin (1975), le live Roxy & Elsewhere (1974) de Frank Zappa, de 1979 le post-punk clinique Metal Box de P.I.L. et le foisonnant London Calling des Clash, un authentique chef-d’œuvre celui-là. Mais encore ? À un degré moindre peut-être : The River de Bruce Springsteen (1980), le Kiss Me Kiss Me Kiss Me de Cure (1987), ou – plus près de nous – le clinique et étonnant Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven des Canadiens de Godspeed You! Black Emperor (2000), ou encore – dans un style tout hard-prog’ symphonique – The Human Equation des Hollandais d’Ayreon (2004). Sans oublier bien évidemment l’emblématique Double Blanc des Beatles (1968), pierre de touche et à coup sûr le plus célèbre de tous les doubles albums, mais certes pas le premier – l’honneur revenant au Freak Out ! des Mothers Of Invention de Frank Zappa et au Blonde On Blonde de Bob Dylan, tous deux sortis circa 19661... Ouf ! . . .
Quoi qu’il en soit, une autre des emblématiques galettes de ce genre est sans conteste le concept album2 des Anglais de Genesis, paru en 1974 : The Lamb Lies Down On Broadway. Dernier disque avec leur leader chanteur Peter Gabriel, TLLDOB « s’apparente autant à un aboutissement, celui de leur première période, qu’à une parenthèse, par la crispation sans précédent de la musique ».3 Beauté formelle des compositions, complexité et innovation musicales, romantisme et non-sens à la sauce british, on a bien là affaire à un pas de côté du groupe vis-à-vis de son ADN revendiquée jusqu’ici – au travers d’une toute nouvelle étrangeté et de la dureté de la musique et du sujet abordé. Chronique de la quête existentielle et de la psyché d’un jeune misfit des rues de New York, au fil des ans l’album a acquis un statut culte, et de fait il continue d’être la proie de constantes exégèses – tant du point de vue de sa qualité musicale que de celle de ses lyrics. Richesse poétique teintée de nihilisme, le tout est nimbé dans une ambiance de mini movies mêlant évanescence, surréalisme, images empruntées à la mythologie la plus classique et prosaïque réalité.
Aaaargh, Genesis… Fils indignes de débuts en demi-teinte – un nom un brin pompeux imposé par un manager4, un premier album raté5 – et d’une seconde partie de carrière légèrement douteuse6, l’image du groupe est depuis longtemps celle d’un hiatus. Entre la musique proposée à partir des 80’s et une période – la décennie précédente – que d’aucuns, votre serviteur en tête, considèrent comme leur âge d’or, le groupe possède encore et toujours ses fans transis… comme ses contempteurs. Les deux peuvent se confondre – votre serviteur encore ! Mais en 1974, bien avant le virage et le succès commercial des eighties, Genesis était ce groupe certes novateur mais en pleine crise, sur la corde raide, tiraillé entre un trop-plein musical exigeant et un chanteur désabusé et habité dorénavant par une vision nouvelle – à contre-courant de l’image véhiculé par le groupe depuis ses débuts. Créateur depuis quatre ans d’une des musiques les plus audacieuses jamais entendues7, avec ce nouveau projet abracadabrantesque on pouvait s’attendre à un ratage, maelström musical sans queue ni tête, brouet à prétentions intellectuelles indigestes et soap-opera rock au symbolisme un brin lourdaud (le Rael sans bouche de la pochette comme allégorie de l’incommunicabilité). Or il n’en fut rien, le groupe réussissant même le tour de force de se renouveler et de continuer à créer une musique brillante, exigeante et novatrice – sans pour autant paraître prétentieux ou pompeux. Mouton noir – pendant un temps – devenu désormais leur loup blanc, pour beaucoup de fans The Lamb représente le zénith du groupe ; et une pierre de touche du genre (le rock progressif) auquel il est, à tort ou à raison, associé.
Comme toute œuvre marquante, les réactions de la critique furent plus que contrastées à l’époque8, parfois au sein d’une même personne : pour Davin Seay9, le double album était « incroyablement dérangeant, parfois presque désagréable dans son impénétrable densité » et en même temps « une des musiques les plus étrangement troublantes » de l’époque (« some of the strangest, most viscerally unsettling music »). 94 minutes et 13 secondes d’un disque aux ambiances foisonnantes – mystérieuse et pastorale à la fois, éthérée, sereine puis angoissante, enjouée, étrange, tour à tour comme mystique (voire même proprement liturgique)10, puis à nouveau romantique et tout à coup violente, drôle mais ironique, ouf n’en jetez plus… De fait, beaucoup de choses dans cet album sont remarquables. La musique avant tout, qui sait se faire évanescente mais aussi énergique et groovy, d’une sophistication extrême – difficilement définissable, de par ses références classiques et ses subtils changements d’atmos-phères s’imbriquant les unes dans les autres –… puis soudain à nouveau brut de décoffrage. L’autre aspect marquant de ce projet est son ambiance et la tonalité de l’histoire qu’il retrace – un conte surréaliste à base de sexe, de violence et de mort, tempéré par l’onirisme11 et… l’humour.
C’est l’album des paradoxes assumés et de la réconciliation des contraires, un foisonnement de rêverie poétique et d’authenticité crue. Concepts philosophiques pointus y côtoient des références à la violence des rues, et la réalité banale du monde moderne constitue le terreau d’une quête d’idéal à atteindre. Slogans mystico-libertaires, influences et schèmes religieux12 s’acoquinent à de multiples sentences nonsensiques ; tandis que des citations classiquement littéraires (Wordsworth, Keats, John Bunyan) arrivent à faire bon ménage avec la culture pop(ulaire) de l’époque (J. Hendrix, Stones, Burt Bacharach, Leiber & Stoller), le tout baignant dans une ambiance caustique certes, mais jamais donneuse de leçons. Révolte, poésie, thématiques sexuelles sous-jacentes, séquences de la vie quotidienne et sentences surréalistico-absurdes se succèdent donc les unes après les autres, avec en prime cette touche qui irrigue l’album de bout en bout, subtile atmosphère de drôlerie truculente, de dérision et d’humour noir13 – mais aussi de compassion vis-à-vis du kid Rael, l’anti-héros post-moderne de cette fable édifiante. Quant à la musique proposée, on l’a dit, c’est un constant va-et-vient entre richesse harmonique et rock abrasif, délicatesse mélodique et rythmes déstructurés, exigence musicale et influences pop, classique, rock, jazz ou underground. Mais qui donc aurait cru que – à l’image de ce fragile agneau étendu dans le vacarme de la grande ville – un tel projet puisse aboutir ? Et laisser une trace aussi prégnante cinquante ans plus tard – mystère... . . Tour de force d’extravagance maîtrisée, monstre échevelé fonçant vers un but bien précis – la quête de soi et de l’excellence musicale –, dans la carrière du groupe The Lamb est bien cette grandiose parenthèse en forme d’apothéose. Mais une parenthèse finale. Car son principal créateur (le chanteur et frontman Peter Gabriel) va quitter le groupe six mois plus tard, lessivé, un brin désabusé mais conscient qu’après avoir accouché d’un tel ovni, ils (le groupe et lui) étaient arrivés à un point de non-retour. Et c’est bien de cela qu’il s’agit : devant nous un quasar issu de nulle part, brillant de mille feux et qui explose dans un inévitable et glorieux final, telle une planète déjà morte mais que l’on peut encore admirer de nos jours, émus et estomaqués, depuis la Terre. . . OEuvre au noir14 et joyau lumineux, produit inspiré15 mais fragile d’un groupe qui se sait condamné (les tensions internes et le départ programmé de PG), apex né de la psyché foisonnante de son chanteur et d’une grâce musicale à son zénith, The Lamb Lies Down On Broadway est là pour l’éternité… Alors Alléluia, sonnez trompettes, battez tambours ! ; voici l’histoire de cet astre sombre et incandescent, pierre angulaire du rock anglais – et de la musique, toutes périodes confondues.
1. En juin pour le gang de Zappa, en mai pour le barde de Duluth, Minnesota.
2. Voir chapitre 7, annexes 1 et 2. .
3. Frédéric Delâge in Prog 100 – Le Rock progressif des précurseurs aux héritiers (Ed. Le Mot et le Reste, 2014). .
4. En l’occurrence Jonathan King – dont le premier choix était même « Gabriel’s Angels » ! On imagine l’égo flatté du chanteur et la tête des autres... Ceci dit, comme Peter le déclara un jour : « Au point où on en était et avec ce type (King) qui payait pour nous permettre d’enregistrer, personne n’émit d’objections ». Et après tout, une certaine touche/ambiance mystique était de fait propre à la musique que les cinq proposaient déjà, dès leur début...
5. Peter, dans une interview de 1980 avec le journaliste musical Armando Gallo : « On nous suggéra de centrer l’album sur le thème des origines du monde. En y repensant, c’était terriblement prétentieux, imaginez, une histoire de l’évolution humaine résumée en dix chansons pop ! Mais nous débutions, nous étions tous très jeunes, 18 ans dans mon cas, et avions toujours été attirés par l’imagerie biblique. » De fait, et comme dans un écho rétroactif, le chanteur avait prévenu dans les notes intérieures de la pochette : « Nous espérons que vous ne trouverez pas tout cela prétentieux et manquant d’humour, car dans les deux cas cela n’a jamais été notre but ». …
6. Au mieux parangon d’une certaine pop eighties de qualité, au pire vendu à un certain succès commercial. . …
7. Larry Fast, compositeur-producteur et futur collaborateur de Peter en solo, à propos des influences antinomiques du groupe : « Les sons folko-acoustiques combinés à la puissance d’évocation du mellotron et des effets de pédale basse étaient tellement novateurs... Solos de guitare et parties de synthé dénotaient des sources autres que celles du rock proprement dit, et l’ensemble sonnait comme rien de ce qui était connu à l’époque, les multiples breaks et la structure musicale de l’ensemble se mariant parfaitement avec les visions de Peter. » ..
8. Dans un trait d’humour typiquement british, Mike Rutherford confia un jour à Dave Gregory – guitariste du groupe anglais new wave XTC et fan devant l’éternel de The Lamb : « Même Hitler eut de meilleures revues de presse que nous » ! !
9. Auteur américain d’ouvrages politiques (With God on our side, Capturing Saddam), Davin Seay (?-2019) était aussi un journaliste musical, biographe – entre autres – du soulman américain Al Green, de Mick Jagger, du chanteur fifties Dion DiMucci ou encore du rappeur Snoop Dogg. .
10. L’influence des chants religieux entendus dans leur enfance a toujours été revendiquée (en particulier par Peter et Tony). (Cf. aussi note 12 infra.) .
11. On pense un peu au climat délétère, fantasmagorique et presque irréel de La Nuit du Chasseur, le classique ciné de Charles Laughton (1954) – avec Robert Mitchum en Dr. Dyper au cauteleux charme lamiesque ! .
12. En 1998, Ed Goodgold, représentant de la maison de disques de Genesis aux Usa, se remémorait sa découverte du groupe, insistant sur la touche mystique des thèmes traités déjà à l’époque – 1970-71, soit trois ans avant la conception de The Lamb – et aussi de leurs prestations : « La musique me faisait penser à du Berlioz rock. Et leurs shows presque à un service cultuel : à certains moments leur public ressemblait plus à une congrégation qu’à autre chose ». En quelque sorte une espèce d’église rock… heureusement contrebalancée par l’humour et le sens de la dérision de Peter et des quatre autres.
13. On n’insistera jamais assez sur cet aspect de The Lamb comme production – pour ainsi dire – pas dupe d’elle-même. À l’image d’autres célèbres œuvres artistiques cataloguées sombres et pessimistes mais qui sont, en sous-texte, des bijoux d’ironie sachant travailler contre elles-mêmes… Les exemples sont légion à travers les âges. Citons, en peinture : le catalogue des grotesques de Jérôme Bosch et de Goya, gore avant l’heure, ou l’érotisme teinté d’humour noir de Clovis Trouille... En littérature : les stances macabres mais moqueuses du Lautréamont des Chants de Maldoror ; l’Edgar Poe analytique et faussement horrifique (Double assassinat dans la rue Morgue, La vérité sur le cas de M. Valdemar, Une descente dans le maelström) ; l’absurdité cocasse des Procès et autre Métamorphose de Franz Kafka, d’En Attendant Godot (Samuel Beckett), d’Ubu Roi (Alfred Jarry) ; l’ignoble traité sous l’angle du picaresque (L.-F. Céline, D’un Château l’Autre) ou du grotesque (Jean Teulé, Mangez-le Si Vous Voulez, Charly 9) ; le théâtre absurde et désespéré – mais au fond si comique – d’Eugène Ionesco... Pour ce qui est du cinéma : les comédies italiennes des années 60-70, railleuses et hilarantes à la fois ; la violence pure de Quentin Tarantino ou du trio belge Poelvoorde/Belvaux/Bonzel (C’est arrivé près de chez vous) – traitée sous un mode extravagant, bigger than life, décalé et cathartique ; l’ironie railleuse alliée à un regard d’entomologiste de Claude Chabrol, etc., etc. Et même, dans le domaine de la bande dessinée, discipline artistique où l’on pourrait citer, entre autres : les délires comico-poé-tiques de Caza, la métaphysique S.-F. distanciée de Mœbius, ou encore les contes désespérés mais solaires de Philippe Druillet – tous trois auteurs teintant leurs récits d’humour drolatique, contrepoids à la noirceur de leurs univers respectifs. (Ouf, fin de la parenthèse !)
14. En alchimie, l'expression œuvre au noir désigne la première des trois phases dont l'accomplissement est nécessaire pour achever le magnum opus (la pierre philosophale, soit la transmutation du plomb en or). Par extension, dans les arts, elle symbolise l'œuvre la plus importante d'un artiste, ou tout au moins la plus accomplie. L'alchimiste doit successivement mener à bien l'œuvre au noir, puis au blanc, et enfin au rouge pour arriver à ses fins, tout comme l’artiste qui cherche la perfection dans son art tout au long de sa vie. En 1968, Marguerite Yourcenar en a tiré son célèbre roman éponyme, où elle développe le thème de la connaissance inatteignable par essence, mais qu’il faut néanmoins s’attacher à poursuivre. .
15. Le manager du groupe (Tony Stratton-Smith) au moment du Six of The Best – le concert des retrouvailles d’octobre 1982 –, dans une envolée lyrico-nostalgique : « The Lamb est un hymne à la pureté de l’esprit humain aux prises avec une société corrompue et un précurseur du retour à la street music de la fin des seventies – avec une qualité musicale restée inégalée depuis »… Eh oui, rien de moins !
2
Something solid forming in the air
Construction et... genèse
Nous sommes en mai 1974 et Genesis vient de performer le dernier concert de sa tournée Selling England By The Pound, à l’Academy of Music de New York. Ce cinéma reconverti en salle de concert se trouvait tout près d’une autre salle, l’Elgin Theatre – au croisement de la 19ème rue et de la 8ème avenue –, salle connue pour ses projections de films avant-gardistes, dont en particulier le El Topo d’Alejandro Jodo-rowsky (cf. note 3 p. 105). Il est donc vraisemblable que c’est à cet endroit et à cette époque que Peter Gabriel a pour la première fois pu visionner ce long métrage qui, à ses dires, l’a tant marqué. Après cette séance de nuit – « the Movie Palace now undone » –, il sera probablement revenu à pied à travers les rues éclairées au néon, vers son hôtel, les images surréalistes du réalisateur franco-chilien rôdant dans sa tête, et autour de lui – « moving in the sidewalk steam ».
Il est assez facile de comprendre comment et pourquoi l’idée et le concept de The Lamb ont pu à ce moment commencer à germer dans l’esprit de Peter. El Topo est ce western bizarre, typique des films de l’époque (récit décousu, absurde et nonsensique) et à la forte imagerie surréalistico-sexuelle – une espèce de cinéma automatique comme il a pu y avoir une écriture automatique (celle des surréalistes des années 1920-30). D’une exubérance ubuesque, il contient de fait certaines similitudes troublantes avec ce que va devenir The Lamb. Accrochez-vous : on y rencontre tout d’abord un certain joueur de flûte – sur scène l’instrument de prédilection de qui l’on sait... Puis des gens qui se retrouvent coincés, comme prisonniers dans un lieu clos – « in a cave » –, et une « grand parade » de personnages qui défilent, comme zombifiés. Voilà ensuite des stalactites et des stalagmites, formations rocheuses qui surgissent du sol et du plafond d'une grotte ; et là, est-ce que vous voyez le – hum – topo ?? (ha, ha) : elles forment les barreaux d’une cage ! On rencontre aussi une dame gourou mystico-déjantée à la – je vous le donne en mille – « Lilywhite Lilith », laquelle conduit un individu vers un groupe de personnes qui rampent à travers un tunnel éclairé – « where the chamber is said to be »... Ce même individu qu’on retrouve un peu plus tard en train de se rafraîchir dans un bassin naturel, avec d’étranges créatures, « the Lamia of the pool » ? Alors qu'elles savourent et grignotent les fruits de sa chair – si, si ! – il semble plutôt apprécier (« he feels no pain »). Plus tard, quelqu'un meurt dans un torrent, tandis qu’un corbeau apparaît subitement au premier plan. Et pour couronner le tout, une espèce de « Dr. Dyper » sadique se met à fouetter un quidam alors que l’on distingue plus loin l’image furtive d’un agneau sacrificiel... Lequel agneau se verra ensuite carrément immolé en croix. Well well, pour qui est fan de The Lamb, voilà des coïncidences plus que troublantes, non ?
Parallèlement, les origines de The Lamb sont également à chercher du côté d’un récit tout ce qu’il y a de plus classique celui-là : Le Voyage du Pèlerin. Prédicateur et homme de lettres anglais du 17ème siècle, John Bunyan est l’auteur de cette allégorie de la découverte de la foi et de soi, un conte épique mêlant aventures et apologie du christianisme évangélique. Il retrace le voyage d’un homme ordinaire (nommé… Christian), qui décide de prendre la route pour atteindre la Cité de Sion et se trouver lui-même. Christian quitte le berceau de la destruction (la Terre) et se fraye un chemin vers la cité céleste, faisant face à de multiples épreuves et traversant des lieux aux noms évocateurs comme : Slough of Despond (Marais du Découragement), Vanity Fair (Foire aux Vanités) ou Hill of Lucre (Colline de l’Avidité). Quête spirituelle et évocation des démons intérieurs du héros, le conte est relaté sous forme imagée, comme celle du rêve d'un narrateur. Les protagonistes portent chacun un nom pittoresque, révélateur de leur personnalité – Faithful, Giant Despair ou Mr. Great Heart –, semblables en cela aux personnages des historiettes fantasmagoriques que Gabriel racontait pendant les concerts du groupe, entre chaque morceau1. Et aux morceaux eux-mêmes, souvent empreints de thèmes mythologico-apocalyptico-religieux (« Fountain of Salmacis », « The Knife », « Watcher of The Skies », « Return of the Giant Hogweed »…), ou à base de zen mâtiné de surréalisme – l’épique « Supper’s Ready » de 19722. Contrairement au délirant et païen El Topo, le récit de Bunyan fourmille donc lui de concepts plutôt bibliques et religieux (que l’on retrouvera aussi sur le projet à venir du groupe), d'étranges créatures venues d'un autre monde renvoyant aux notions de tentation, de culpabilité et de péché propres au christianisme.
Voilà donc où résident les deux principales influences qui vont donner naissance au thème central du disque à venir des 5 de Genesis. Marqué on l’a vu par le film culte de Jodorowsky (El Topo donc, mais aussi La Montagne Sacrée, autre œuvre de même veine du réalisateur) et le récit de Bunyan, Gabriel est en train d’imaginer le personnage iconoclaste de Rael, petite gouape en révolte et en pèlerinage existentialiste dans les rues de New York. Lequel Rael va littéralement traverser l’enfer afin de devenir lui-même, réel en quelque sorte. Real… Rael, got it ? – mais patience nous n’en sommes pas encore là…
Assurément, le résultat aurait pu/dû être complètement différent si le claviériste Tony Banks et le bassiste Mike Rutherford avaient suivi leur idée initiale, celle d’adapter le roman d’Antoine de St-Exupéry, Le Petit Prince. Un récit-conte du passage de l’enfance à l'âge adulte dans une veine philosophico-existentielle bien plus sage que celle du projet qui germait alors dans la tête de leur chanteur. Si ce choix avait été privilégié, The Lamb aurait probablement eu une ambiance bien plus pastorale, dans la veine par exemple de « Mad Man Moon », la chanson de Banks justement inspirée du roman de Saint-Ex (album A Trick Of The Tail). Et peut-être que le disque aurait alors poursuivi dans le style typiquement british de Selling England By The Pound, dernier effort en date du groupe. Or, l'histoire de Peter devait se dérouler dans les mean streets de New York, avec pour acteur principal ce kid latino-américain en proie à ses affres métaphysiques, hybride des deux héros de... Mean Streets justement, le chef-d’œuvre de M. Scor-sese.3 Le plan de Mike ayant été jugé au mieux trop consensuel, au pire trop mièvre – « too twee » pointa un jour malicieusement Peter4 –, le chanteur avait donc tranché, de manière un peu… tranchée certes, ce qui put contribuer à envenimer des conflits déjà latents. Quoi qu’il en soit, ce qu’aurait donné une adaptation de St-Exupéry, nul ne le saura jamais. On peut le regretter – ou en être soulagé !
On comprendra en tout cas pourquoi New York, lors des tournées américaines d’antan (celles de Foxtrot et de Selling England), avait pu à ce point stupéfier et fasciner le groupe, et en particulier Peter. New York la ville-monde, New York la ville qui ne dort jamais, la presqu’île du peuple algonquin, New York la ville de tous les possibles et forcément aussi de tous les excès.5 Gabriel s’est pris les gratte-ciels de Manhattan en pleine tête, et son cerveau hyperactif monté d’un cran est alors passé en surmultipliée. Les autres ont vite compris que le torrent de visions à venir ne tiendrait pas sur une seule galette. Alors ils ont bossé triple pour que l’album soit – lui – double.
De fait, dès le départ, Gabriel avait déclaré qu’il souhaitait une nouvelle direction, une ambiance et un ton/son plus rugueux. Un peu à l’image de la production d’artistes tels que Peter Hammill (dont le groupe – Van Der Graaf Generator – était aussi chez Charisma, le label de Genesis), Brian Eno ou King Crimson6 ; tous musiciens que le chanteur admirait depuis longtemps. L'aspect narratif de l'album et l'insistance obstinée – stiff upper lip – de Gabriel à écrire toutes les paroles, constituèrent très vite une pomme de discorde avec le reste du groupe, Banks en particulier. Celui-ci pensait en effet qu’une trame autant imposée et un tel déluge de lyrics risquaient d’empêcher de faire vivre les morceaux – la musique avant tout pour Banks – par eux-mêmes7. De fait, le maître des claviers de Genesis n’en démordait pas et il garda longtemps un grief envers son chanteur – quoique reconnaissant plus tard que les textes écrits par Peter étaient « plutôt réussis, pour ne pas dire brillants par moments ». Le clavier de Ge-nesis insistait néanmoins et trouvait aussi qu’un double album mènerait forcément à une certaine dilution de la bonne idée de départ ; mais en tant qu’ami de toujours de Peter, il consentit une fois de plus à le suivre dans les méandres de son foisonnant projet. Quant à l’éternellement débonnaire Phil Collins – plus tard, barbu, il ressemblera à un Charles Manson placide et jovial ! –, lui-même a toujours dit qu’il n’avait jamais pris la peine de lire l'histoire imprimée sur la pochette intérieure de l'album…
Les quatre autres membres du groupe ont donc eu vent et intégré les exigences de leur leader chanteur, à savoir le contrôle total sur le récit, sa conception comme son écriture8. Peter, qui l’a imaginé en entier, veut imposer cette histoire baroque, celle de Rael, sorte de punk métis portoricain traînant sa révolte et ses interrogations ontologiques dans la jungle new-yorkaise. TLLDOB sera de fait l’album d’une confrontation, d’un télescopage incessant entre deux paradigmes, tant musicaux que thématiques. D’abord par l’histoire racontée, qui fait se mêler le matérialisme étouffant d’une mégalopole et l’onirisme d’un univers parallèle peuplé de créatures imaginaires. Rael est propulsé dans un monde chimérique et cauchemardesque, où il va croiser les Lamia (dantesques femmes fatales à corps de serpents), devenir par leur faute un Slipperman (homme-pantoufle, ou homme-rampant, au choix), subir la cure-torture de l’inquiétant Dr. Dyper, avant de voir finalement son corps renaître, ou se désintégrer c’est selon, pour n’être plus qu’un esprit errant : un « it » (‘ça’) !
Parallèlement, au long de ces quatre faces tournant autour d’une quête existentielle à rebondissements, le sens des contrastes sera tout autant musical, dans une correspondance subtile avec les mots de Peter. Genesis y déploiera une frénésie et une urgence inédites, comme si les exigences de leur chanteur avaient fini par entraîner le quarteron de gentlemen vers des contrées sulfureuses, qui leur étaient jusqu’ici un peu étrangères. De joyaux mélodiques ouatés (« Cuckoo Cocoon »), espiègles (« Counting Out Time ») ou tout simplement éblouissants de virtuosité (« The Lamia », un des sommets de l’album), en évanescences mélancolico-orientales (« Hairless Heart », « Silent Sorrow In Empty Boats ») ou carrément psychédélico-enchanteurs (« The Waiting Room »), TLLDOB va faire scintiller comme jamais le raffinement et la fragilité propre au Genesis de la première époque. Le tout agrémenté dorénavant d’une noirceur, à un point inhabituel : cette violence sourde et cette sensation de malaise latent qui suintent tout au long de l’album.
Car ici l’atmosphère est tout aussi tendue que féerique : la dureté lancinante du riff de « Broadway Melody Of 1974 », les breaks rythmiques de « Lilywhite Lilith », l’ambiance de fête foraine déjantée de « The Grand Parade of Lifeleless Packaging », ou l’âpreté syncopée et la rage de « Back In NYC », ce morceau dont Jeff Buckley proposera une version quasi punk, quinze ans plus tard. Et si l’histoire et la geste de Rael appelle un récit à la fantasmagorie très visuelle – qu’il est tentant de savourer d’une traite, comme un film formant un tout – bon nombre de morceaux s’imposent d’eux-mêmes, leur qualité musicale intrinsèque étant leur atout majeur : citons en particulier la séduisante étrangeté de « Carpet Crawl », les épiques « In The Cage » et « Colony of Slippermen », mais aussi « The Chamber of 32 Doors » ou « Anyway », tous deux traversés des accents soul du chant de Gabriel. Cependant, le plus étonnant est que cette œuvre aux multiples facettes sait aussi se retourner contre elle-même et prendre de la distance, pour preuve l’atmosphère ironico-humoristique qui pointe son nez sur certains morceaux, tous plus hilarants les uns que les autres : le défilé grotesque de « The Grand Parade of Lifeless Packaging », les affres sexuelles adolescentes évoquées dans « Counting Out Time », le chant et l’accompagnement musical drolatiques de « Here Comes the Supernatural Anaesthetist », et le titre final (« it ») qui peut s’interpréter comme une entreprise de démythologisation de l’histoire contée, au travers de la liste/litanie moqueuse de ses multiples possibles significations.9 . .
Mais, flashback et retour en ce début de printemps 1974 : après le succès de l'album et de la tournée Selling England By The Pound, avec un single au Top 30 britannique (« I Know What I Like ») et un succès – modeste mais notable – dans les charts américains, il est clair que le prochain opus va attirer une attention considérable, tant au niveau du public que de la presse musicale. Dès lors nos cinq Anglais se savent à un point charnière de leur histoire et décident de s’isoler, afin d’entamer le processus d'écriture. Voilà donc le groupe, avec juste une ébauche d’histoire en tête, qui part s’exiler dans le bucolique village de Headley, à quelques 65 km au sud de la capitale. Moins de cinq mille âmes – et en effet le cadre idéal pour composer un opéra-rock urbain…
Headley Grange donc, East Hampshire. Une ancienne maison seigneuriale tombée en ruine qui avait été, dans les années 1960, louée à des étudiants, avant d'être transformée en hospice puis… en studio de répétition (on dit même que Richard Branson, le futur nabab de Virgin Records, l’occupa un temps). Entre taudis et phalanstère déjanté, avant l'arrivée de nos anciens étudiants de l’upper class, les lieux avaient déjà accueilli d’autres combos, bien plus turbulents que Genesis ceux-là : Led Zeppelin, Bad Company, Fleetwood Mac10... La légende veut aussi que l’endroit ait jadis appartenu au mage occultiste britannique Aleister Crowley (1875-1947). Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin, et le guitariste Jimmy Page – lequel était attiré par la réputation sulfureuse de Crowley (dont il était, si ce n’est un adepte, tout au moins un grand fan) – y avaient en effet enregistré une grande partie de leur quatrième album, et en particulier leur classique de 1971 : « Stairway to Heaven ». Les lieux, bien que délabrés en maints endroits, avaient à la fois l’apparence d’« un vieil endroit funky, avec une atmosphère agréable » (dixit Mike Rutherford) – mais aussi l’aspect sinistre d’une maison hantée, eu égard à son isolement et à ses anciens inquiétants locataires. Steve Hackett : « Vous entendiez des bruits bizarres la nuit – et il était presque impossible de dormir. Les rats couraient à droite à gauche et on avait vraiment l’impression d’être dans une maison hantée ! »
Le séjour là-bas fut en grande partie passé avec le groupe isolé dans un coin pour composer les parties instrumentales et Gabriel dans une pièce séparée, accouchant des paroles dans la douleur, la frénésie et l’urgence. D’un strict point de vue musical, les quatre autres membres avaient eux un tel trop-plein d'idées qu’ils décidèrent au bout du compte de modifier le projet initial – une simple galette 33 tours – et de le transformer en double album. « Je suis descendu à la Grange où ils répétaient », raconte John Burns, en charge de la production. « J’avais auparavant travaillé avec Traffic et Jethro Tull (l’album Aqualung – NdA), mais je n'avais jamais fait ce genre de disque conceptuel, double qui plus est. À vrai dire, j’étais un peu sceptique au début... » Mais selon le producteur – le White Album des Beatles (double paru six ans auparavant) et Exile On Main Street des Rolling Stones (deux disques en un aussi, sortis en 1972) aidant –, l’ambitieux projet finit par le convaincre.
Néanmoins, les tensions entre le chanteur et Banks, Rutherford & Co continuèrent de s’exacerber, en particulier lorsque la fille de Peter, Anna-Marie, naquit, le 26 juillet. Gabriel passa alors beaucoup de temps à faire des allers-retours entre le Hampshire et Londres, afin de 1) recoller les morceaux avec son épouse (laquelle, comme elle le confiera plus tard, avait eu récemment une liaison avec le manager du groupe – un des meilleurs amis de son mari…), et 2) essayer de la soutenir pendant sa difficile grossesse. Le nourrisson ayant en outre été placé sous incubateur à la naissance, il ne faut pas être fin psychologue pour comprendre ce qui se passait dans la tête de notre homme, entre vaudeville et tragique. Une expérience traumatisante, accentuée par l’attitude bien peu compatissante de ses comparses – le typique syndrome des artistes qui placent leur art au-dessus de tout (« Ils ne trouvaient pas normal que je privilégie mon môme à l’album en cours ! » – dixit Gabriel). « Well, I had to get it out of me if you know what I mean » – yes indeed, Pete...
« Ces événements avaient bouleversé la vision des choses de Peter, et ses priorités. Quand Angie et moi avons eu un bébé et que Tony (Banks) eut le sien plus tard, nous avons réalisé qu’effectivement cela changeait la vie », reconnut finalement Mike Rutherford en 2013, « mais à l’époque, ça constituait un gros problème pour la cohésion du groupe. » Steve Hackett fut lui, dès ce temps-là, plus lucide et compréhensif : « Peter traversait un enfer – et moi aussi. Mon premier mariage avait foiré et j'avais eu un fils. Il y avait énormément de culpabilité dans l’air : je voulais juste continuer avec la musique mais n'arrêtais pas d’être sollicité par les circonstances de la vie de tous les jours... » Avec toutes ces tensions et contraintes, de fait c'est un miracle que le projet n’ait pas été abandonné et qu’un tel album – nécessitant application et travail acharné – ait pu être, malgré tout, mené à terme11.
Les communications avec le monde extérieur étant tout aussi problématiques – il n'y avait pas de téléphone installé à Headley Grange –, Gabriel a raconté plus tard les incessants voyages qu'il entreprenait en direction de l’unique cabine du village, les poches remplies de pièces de dix cents. Ce phone booth est toujours là aujourd'hui et il est étrange de penser qu'en juillet 1974, Peter s’y tenait, tentant de rentrer en contact avec son épouse Jill. Avec Jill, mais aussi avec la Californie – et William Friedkin pour une éventuelle collaboration scénaristique. Car en effet, après les succès de French Connection (1971) et L’Exorciste (1973), l’attention du réalisateur américain, cherchant de nouveaux talents, avait été attirée par une nouvelle de Peter, imprimée au dos du Genesis Live de l’année précédente (l’histoire délirante d’une jeune femme qui se déshabille dans le métro et doit en affronter les conséquences ! – hybride de tonalité grotesque et de sexualité surréaliste que l’on retrouvera justement dans The Lamb). De fait, Gabriel, qui à l’été 1968 avait eu l’opportunité de suivre des études cinématographiques (à la.London School.of Film.Technique), quitta alors temporairement le groupe – afin de réfléchir au scénario du side-project Friedkin, probablement celui d’un film intitulé The Devil's Triangle sur lequel le réalisateur travaillait à l'époque. Le projet initial de Friedkin était de créer une équipe avec Peter, le groupe allemand Tangerine Dream et le dessinateur prodige Philippe Druillet (un des créateurs du magazine de BD français Métal Hurlant). Approche prometteuse s’il en est, au vu des talents rassemblés ; en tout cas dans une interview de l’époque, pour le magazine Sounds, Peter confirmait bien là son désir de nouvelles découvertes.
Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le disque à venir Gabriel gardait toujours une vision bien précise : l’approche filmique d’une histoire à raconter – et donc sa priorité irait bien vers un concept album, autrement dit une suite de chansons tournant autour d’un seul et même thème. Rutherford raconta plus tard que l’ambiance s’en ressentait fortement : « C'est un sentiment vraiment étrange, quand l'un des gars avec qui vous formez un groupe soudé semble ailleurs... » De fait, Gabriel paraissait bien isolé par rapport au reste de la bande – un climat particulier mais qui fut néanmoins, si ce n’est accepté, au moins supporté par tous, pour le bien du groupe. Donc notre homme va et vient tant bien que mal, avec sous le coude le scénario de Friedkin et l'intrigue lourde de The Lamb, entre l'hôpital de Londres, sa famille qui s’agrandit et les allers-retours au studio. Son insistance à imposer le thème, les paroles et la trame artistique tout en paraissant accaparé par un autre projet, continue de créer des frictions et l’acmé des tensions sera atteint lorsqu’il demandera de faire une nouvelle pause, en plein milieu des sessions en cours. Le groupe refusa alors catégoriquement et il sembla bien, un temps, que l’on se dirigeait vers le split final. Mais, révéla Hackett, « Friedkin a paniqué quand il a entendu qu'il pourrait être responsable de la fin du groupe », et son projet fut mis – temporairement – de côté… pour finalement tomber à l’eau un peu plus tard12. Grâce aussi à la force de persuasion du patron de Charisma – Tony Stratton-Smith13 –, lequel s’escrimait à trouver un terrain d'entente, Peter accepta alors – fut contraint ? – de remettre à plus tard ses velléités cinématographiques. Mais dès lors, on peut imaginer le ressentiment qui devait poindre dans son esprit… Ayant tout de même entrouvert quelques pistes artistiques pour l’avenir, au bout de quinze jours notre homme s’en revint donc, un peu penaud, à Headley. Il y retrouva ses camarades, la hache de guerre fut (provisoirement) enterrée et les cinq purent s’atteler à la finition de l’enregistrement, lequel s’annonçait épique au vu du retard pris.
Fruit de répétitions… répétées, près de six heures d’enregistrements ont émergé des sessions de Headley Grange – et sont maintenant à la disposition des collectionneurs, via YouTube. Une écoute attentive révèle des indices étonnants quant au plan originel (un album simple) et la façon dont les différentes chansons auraient pu/dû être agencées initialement. Examinons le tracklisting final, que nous connaissons aujourd'hui, et mettons de côté les pistes qui n'ont pas été enregistrées à la Grange, ces embryons de morceaux assemblés puis abandonnés (pour être finalement enregistrés séparément dans leurs versions finales quelques mois plus tard). Ces titres sont : « Cuckoo Cocoon », « Grand Parade», « Carpet Crawlers », « Anyway », « Silent Sorrow In Empty Boats », « Ravine » et « Riding the Scree ». Ce sont donc tous des ajouts tardifs à la setlist de l'album, intégrés plus tard pour combler les gaps dans l’histoire.
Il semble aussi que – chaos/défrichement propre aux sessions d’enregistrement –, le groupe ne savait pas trop comment terminer les deux premières faces, hésitant/procrastinant longtemps avant de prendre les décisions finales : pour preuve cette première mouture de « The Lamia », mixée avec « The Chamber of 32 Doors » qui elle-même, dans une autre version, menait directement à « Counting Out Time », dans un seul et même morceau… Sans parler de la prise qui unissait « In The Cage » à « Back in NYC », et de cette autre démo de « The Lamb » (le morceau) enchaînant directement sur « Fly On A Windshield » – mais sans les paroles chantées au début de la version finale ! Euh, vous suivez ?... D’autre part, penchons-nous donc sur le cas de « Lilywhite Lilith ». On sait que l’origine de ce morceau remontait à une vieille chanson intitulée « The Light » – que le groupe avait l’habitude de jouer live, durant la tournée Nursery Cryme de 1971. Premier morceau que Phil Collins ait jamais écrit pour le groupe, les répétitions prouvent que la première version d’« In The Cage » comprenait justement le riff spécifique de ce « The Light » – lequel sera finalement repris pour créer l’ossature de « Lilywhite ». Cette dernière rejoint donc la liste évoquée plus haut – celle des titres qui ne faisaient pas partie des enregistrements complets originaux.
On a vu qu’au début le groupe paraissait plutôt privilégier un disque simple, mais qu’après mûre réflexion – et au vu de tout le matériel enregistré –, les cinq membres avaient décidé de fondre l’ensemble dans un double album. Projet initial au rythme plus rapide, il est bien difficile de dire si cette incarnation concise aurait été plus heureuse, car en fin de compte c'est justement cette sensation d'espace et de distance qui fait si bien fonctionner la version finale. De fait aussi, dans le projet adopté, les ambiances étranges et mystérieuses des pièces atmosphériques, poupées russes musicales reliant et imbriquant les morceaux entre eux, paraissent (presque) aussi importantes que les chansons elles-mêmes. Tout en maintenant le niveau d’exigence, elles contribuent à renforcer le sentiment de cohésion qui se dégage du disque, sans rien perdre de la richesse et la diversité musicale de l’ensemble.
En août, Genesis quitta Headley Grange pour une autre demeure seigneuriale au style architectural suranné, cette fois-ci dans la campagne galloise, à Beulah, dans le comté de Ceredigion. Comme Headley, Glaspant Manor, un manoir du XVIIIème siècle, était régulièrement utilisé par d'autres groupes – plus classiquement rock –, tels Black Sabbath ou Queen. C’est là que nos cinq musiciens travaillèrent à nouveau pendant deux mois, utilisant le mobile studio d’Island Records, pour finalement ensuite revenir à un cadre plus traditionnel – les studios londoniens d’Island à Bashing Street. Nous étions alors fin septembre et on ne sait pas exactement ce qui fut enregistré ici (à Londres) ou au Pays de Galles… Ce dont par contre on est sûr, c’est que Brian Eno, en rupture de ban de Roxy Music, travaillait alors lui aussi dans ces mêmes studios, enregistrant son Taking Tiger Mountain By Strategy. Peter se lia d’amitié avec lui et lui demanda un coup de main pour certains effets de production de l’album – le deal étant qu’en retour Collins apporte son aide à Eno, en mal de batteur pour son projet solo. À propos de cette collaboration, on sait que Tony Banks a bien souvent nié l'influence du futur producteur à succès14 dans le mixage final… Mais – au vu de certaines originalités et effets sonores de The Lamb – rien n’est moins sûr, car, en effet, la touche arty et les techniques typiques d’Eno y sont clairement reconnaissables (en particulier sur « The Grand Parade », où le sorcier de Roxy Music filtre avec bonheur la voix de Gabriel, à travers son synthétiseur ARP). En fait, « Eno fut bien une bouffée d'air frais », se souvient Hackett, prenant ainsi le contre-pied de Banks : « Il est venu plein d'enthousiasme et a apporté des traitements radicaux et novateurs ». Alors Tony : lucidité ou petite crise de jalousie ?15
. En tout cas, c’est bien pendant la toute fin du mixage final que Peter, en proie au doute, tourna à nouveau casaque et proposa que l’album sorte plutôt en deux temps : une première partie en novembre et la seconde six mois plus tard ! Le manque de cohésion et le contraste entre les faces 1/2 et 3/4 semblent avoir été les raisons principales de cette nouvelle option. Beaucoup de morceaux – « Anyway », « Lilywhite Lilith / The Light » et la majeure partie de « Colony » qui dataient des années 71-73 – risquaient en effet de nuire au reste, cette ambiance si particulière qui faisait la cohésion de la première galette. Finalement, après avoir frôlé un nouveau psychodrame, on revint à l’option initiale et on décida, comme on l’a vu plus haut, de renforcer l’ensemble par des séquences d’ambient music, parties liantes permettant d’assurer l’homogénéité du tout. Rétrospectivement et aux dires des musiciens, le procédé pouvait sentir son rafistolage, mais c’était un risque à prendre, Charisma Records pressant le groupe de finir dans les délais. C’était un parti/pari certes pris un peu à la va-vite, mais une décision qui finalement s’avéra payante, tant maintenant les morceaux parvenaient à s’agencer harmonieusement. Pourtant, le reste du groupe, et encore et toujours Tony, trouvaient toujours le concept du disque et sa trame narrative trop envahissants par rapport à la musique… Les séances furent à nouveau assez tendues, mais, après un bienvenu break d’un mois – sur proposition du producteur John Burns et histoire de finaliser les idées et les lyrics foisonnants de Peter –, le groupe se réunit à nouveau pour finalement, à force de diplomatie, de compromis… et d’intérêts communs, parvenir à s’accorder16. Palinodies, conflits et revirements s’atténuèrent d’eux-mêmes et, après intégration des dernières parties vocales et mixage final, début novembre l’album était enfin terminé. Au grand soulagement de tous, musiciens, maison de disques et promoteurs de la tournée à venir – car comme Steve Hackett le reconnaît : « Nous avions épuisé la patience et les nerfs de tout le monde, et les dépassements d’horaires commençaient vraiment à se faire sentir, financièrement parlant. »
Rael donc. Après l’étrange galerie de personnages créés depuis les débuts du groupe – le vieillard libidineux de « The Musical Box », le monstre botanique de « Return of the Giant Hogweed », le Britannia de Selling England By The Pound –, voici Rael, le plus emblématique des caractères sortis de l’imagination du frontman de Genesis. « Oui, bien sûr, il y avait pas mal de moi en Rael », déclara Peter en 2012. « Le truc, c'est qu'il était plus libre, libre de vivre des choses que je n'allais jamais pouvoir connaître », d’où la foisonnante intrigue du récit. L'une des implications politiques les plus évidentes était aussi le regard du héros de cette histoire, et la partie intégrante du concept : une vision critique, révoltée et pour tout dire nihiliste de la société contemporaine. Rael était ce petit rebelle portoricain en rupture de ban, mais cette fois-ci dans un West Side Story à la sauce seventies – plus âpre et sombre que l’original, cette gentille comédie musicale à succès de la précédente décennie. Sur scène, Gabriel arborait un perfecto ouvert sur un simple t-shirt blanc, et les cheveux coupés très courts – croisement improbable entre Dee Dee Ramone et George Chakiris17 !!! En tout cas, c'était quelque chose que les musiciens de la scène progressive ne faisaient pas, en 1974 – arborer ce look hybride déjanté, entre fifties/pré-punk à la Ramones, Iggy Pop (Peter se traînant torse nu le long de la scène) et le Pierre Clémenti frénétique des Idoles18... Jusqu’ici le public avait entendu (parler de) ce groupe anglais au style héroïco-théâtral, dont les morceaux parlaient d’un Scrutateur-des-Cieux ou de demi-dieux hermaphrodites tout droit sortis de la mythologie gréco-romaine19. Il connaissait aussi leur chanteur, lequel contait de bizarres et cruelles histoires, à propos d’un type – philosophe ou loque humaine psychopathe on ne sait trop (cf. la démarche grotesque de Peter mimant le personnage sur scène) –, lequel type trouve son bonheur dans la tonte de pelouses (« I Know What I Like »). Ou d’un autre weirdo ‘‘qui-s’est-coupé-les-orteils-lesa-servis-pour-le-thé-puis-s’est-réfugié-sur-un-toit-pour-échapper-à-lavindicte-populaire’’ (« Harold the Barrel ») ; du Reverend, ce ‘‘minis-tre-du-culte-pervers-surpris-en-plein-ébat-et-à-qui-on-propose-un-joliservice-d’assiettes-du-Staffordshire’’ (?!?, in « The Battle of Epping Forest ») – ou de la geste épique et ubuesque d’un apprenti dictateur et chef de guerre (« The Knife »20)… Ce même chanteur, qui arborait alors une longue chevelure noire – tempes et front rasés –, avait aussi l’habitude de porter un masque de renard et une robe rouge, tandis qu’il toisait le public ou se balançait au-dessus de lui, accroché à un filin21. Une espèce d’attraction culte – à mi-chemin entre le progressif intello (King Crimson, Van der Graaf Generator22, Yes dans ses bons jours), et un rock théâtralisé plus cru à la David Bowie ou Alice Cooper23. Adoncques, quoique son nouveau personnage soit encore ancré dans le surnaturel et le mystique, on était dorénavant bien loin de l’univers propre à ce rock qui faisait florès à l’époque : onirique et éthéré24, novateur et fascinant certes, mais qui pouvait par moments paraître complètement déconnecté de la réalité – et pour tout dire de plus en plus daté, voire boursouflé25. Et dorénavant la question était : comment cette histoire sortie de nulle part mais bien ancrée dans la réalité – celle du subconscient chargé d’une petite frappe errant dans New York – allait-elle donc être reçue ?
Le fait de situer l’histoire dans la métropole américaine a immédiatement donné – si ce n’est complètement à la musique elle-même, au moins à la thématique – un lien avec l’underground de la ville et de sa scène naissante. C'est déjà le New York qui va accoucher du punk en gestation et des autres musiques alternatives (celles du Max’s Kansas City, du Mudd Club ou du CBGB)26 : un endroit attractif et excitant, mais aussi dangereux et synonyme d’aliénation et de danger (drogue, prostitution et violence endémique). Évoquant sa première visite en 1974, le vibrionnant rock critic Philippe Manœuvre parle de la cité comme si elle était « au bord du gouffre, les taxis évitant des ornières profondes comme des baignoires au milieu des avenues. (…) La ville est un étrange mélange de buildings de verre flamboyants et de quartiers délabrés » (Flashback Acide, 2021). On imagine donc, quand les cinq amis y sont allés pour la première fois en 1972, pour la tournée Foxtrot… Ils n'avaient tous pas plus de 22 ans et New York était alors encore moins la ville assainie qu’elle est devenue par la suite (à partir des années 90 et sous la houlette du maire Rudolph Giuliani) ; bien plutôt un coupe-gorge, puisque le taux de criminalité y était le plus élevé du pays. En conséquence, à leur deuxième passage dix-huit mois plus tard, la musique se mit à refléter la densité d'une ville en permanence surchargée, comme sur le point d’exploser. Ainsi que l’expliqua un jour Hackett : « Quand nous y sommes retournés, nous n'avons pas pu dormir de la nuit, à cause du bruit constant des sirènes de police. Il semblait que la cité était en feu en permanence »... Or donc, maintenant, de fait, la méga(lo)pole était devenue tout autant un pilier que le fil conducteur de l'inspiration du groupe.
Comme on l’a vu plus haut, The Lamb Lies Down On Broadway fut finalement livré dans les derniers jours d’octobre, fin prêt pour une sortie trois semaines plus tard (le 18 novembre). L’agence Hipgnosis, créatrice de pochettes d’albums incontournables des années 7027, conçut un renversant et classieux objet bien de son cru : crispé, arty et énigmatique à la fois, il mettait en vedette un mystérieux modèle masculin – un certain Omar – pour personnifier Rael (on trouve un sibyllin « Thanks to Omar who played Rael » en note de pochette intérieure). Dans cet univers noir et blanc, on est maintenant bien loin des peintures d'un autre temps, rêveuses et délicieusement surannées, celles qui avaient illustré les disques précédents – de Betty Swanwick (Selling England By The Pound) à Paul Whitehead (Nursery Cryme et Foxtrot)28. Les graphismes de George Hardie – y compris un nouveau logo aux traits anguleux29 – et ses incises intérieures, les photos de la pochette (en particulier le visage sans bouche de Rael30 et celles shootées au Pays de Galles et dans les caveaux et tunnels de la Roundhouse31), tout contribua à accoucher d’un visuel étonnant/déto-nant.32 Abondance d’images paradoxales et marquantes : un mélange incongru mais totalement réussi de délires visuels, agressifs et étranges à la fois – et d’austérité dans la forme.
Ce qui ajoutait à la densité du concept, c'est aussi le texte délivré par Gabriel et reproduit sur la pochette intérieure de l'album – une manière d’explications pour se retrouver dans cette histoire tournant autour des luttes désespérées de son héros. Dans un New York anxiogène et souterrain, celui-ci va essayer de retrouver son frère John, se trouver lui-même par la même occasion et affronter la vie et ses propres angoisses, personnifiées par les Slippermen, Lilywhite Lilith, Lamia et autre Doktor Dyper… « Certaines paroles étaient excellentes », déclarera plus tard Banks, en 2013. « Mais j’étais un peu sceptique par rapport à l'histoire dans son ensemble. Elle doit beaucoup au Petit Déjeuner des Champions de Kurt Vonnegut33. Comme si l’album se devait d’être lourd et pessimiste de bout en bout. Or ce n'est pas vraiment le cas, il y a aussi autre chose dans The Lamb, des morceaux moins sombres, presque légers… »34 « En fait, c'est comme un poème que tout le monde peut interpréter à sa façon », rationalisera à son tour Mike Rutherford. « Ça semblait manquer de cohésion à l’époque, mais en réalité ce fut une expérience et un voyage merveilleux – quoique bien douloureux par moments » insiste le bassiste, dont la placidité légendaire contribua à aplanir les problèmes relationnels au sein du groupe.
L'œuvre en surprit/déçut plus d’un à sa sortie, mais compte tenu de son accouchement problématique, le résultat est un petit miracle. Selon les musiciens probablement ce qu’ils ont enregistré de plus fort, à l’image de la chanson titre, au refrain catchy – la dernière que Banks et Gabriel ont écrite ensemble35. Ou de l'époustouflant « Fly On A Windshield » qui, de l’avis des deux suscités – et de votre serviteur –, est un des plus grands moments de Genesis toutes époques confondues. Le groupe y apparaît soudé comme jamais, tendant vers des climats jamais abordés auparavant, étranges et nerveux à la fois. « Back In NYC » est lui l'un des morceaux les plus problématiques que le groupe ait eu à enregistrer, Gabriel passant constamment de cris hystérico-rageurs au chuchotement le plus intimiste. La délicate folk-pop onirique/ironique de « Carpet Crawl » est elle un des sommets mélodiques du groupe. Quant à « Riding The Scree », il contient plusieurs minutes d’un Genesis… funky ! – l'album se terminant par une figure de style typiquement gabrielesque, inspirée du single des Rolling Stones de 1974, « It's Only Rock'n'Roll » : « Cos’ it’s only knock-and-know-all but I like it »… En quelque sorte l’art du jeu de mots et du calembour appliqué à une vision qui fait sens. .
De fait, de tout ce qu’a produit Genesis, The Lamb est bien l’album vers lequel les adeptes du groupe reviennent inexorablement, une justification ultime du travail et de l’inspiration de ces cinq Anglais touchés par la grâce, en cet an de grâce de 1974. Peter Gabriel revenait sur cet Agneau, avec affection et nostalgie, dans une interview de 2012 au magazine Prog : « Je ne sais pas si l'histoire avait beaucoup de sens pour la plupart des gens, mais tout cela signifiait vraiment beaucoup pour moi. C’était aussi un voyage pour se (re)trouver, dans un contexte séduisant et magique, tout en gardant prise avec la réalité. En substance, il s'agissait d’un réveil tout autant que d’un éveil » – une manière donc de grandir en tant qu’homme et artiste. Bien sûr on a beaucoup parlé des déclarations mitigées de Tony Banks au fil des ans, passant de rabat-joie vis-à-vis du projet initial, mais qui finit par admettre que ce disque constituait bien le sommet créatif du groupe. « Peter et Tony se sont toujours bien entendus, mais ils étaient tout de même un peu rivaux, pour faire court », analyse et conclut le producteur John Burns.36 « Tony était définitivement l’influence majeure du son de Genesis à l’époque ; c'était un groupe de claviers, vraiment. Peter apportait lui tous les concepts, les costumes, l’aspect théâtral, etc. » Certes mais pas que, Mr. Burns… Il ne faut pas oublier l’apport des autres – Collins et Rutherford dans un rôle peut-être plus discret –, tous fantastiques musiciens, et en particulier le jeu de guitare de Steve Hackett : novateur, complexe, tour à tour lyrique, torturé, délicat (arpèges languides et trouées lumineuses), mais aussi sachant à l’occasion se faire concis et aller à l’essentiel. Autodidacte influencé autant par le blues que par Bach et la musique baroque, puis plus tard par Robert Fripp (le guitariste et cerveau de King Crimson), sa contribution est primordiale pour le Genesis de ces années-là. Quant à Peter, il prouva – avec sa carrière solo des décennies à venir – qu’il était lui aussi un musicien accompli et un songwriter (sur)doué.
Ceci dit et encore une fois, à l’époque de sa sortie, malgré sa richesse musicale et son intrigue novatrice, The Lamb reçut un accueil critique rien moins qu’enthousiaste. Si dans le magazine Sounds Barbara Charone le qualifie de « pur joyau sorti des décombres », dans sa chronique du disque, le journaliste vedette du Melody Maker Chris Welch, pourtant l'un des plus ardents supporters du groupe au Royaume-Uni, marque certaines réticences, anticipant les détracteurs qu’il sent venir : « Genesis devrait tenir compte de l’adage Small is beautiful37… Néanmoins le groupe mérite le respect pour ses efforts, et peut-être devons-nous être patients et attendre que ce nouvel album grandisse en nous. » De fait, si la patience était ce qu'il fallait pour l'album, à quoi diable devaient s’attendre les futurs spectateurs des concerts à venir ? Car en effet, conçus comme un spectacle vivant, tenant presque autant du théâtre – Peter en Fregoli rock – que du show musical38, les concerts qui arrivaient risquaient de susciter quelques controverses… Un véritable challenge : un nouvel album tout juste sorti et à jouer dans son intégralité (double qui plus est), cette volonté de ne reprendre aucun ancien morceau – qu’attendaient avec impatience les fans du groupe (beaucoup n’avaient pas encore eu l’occasion de voir le groupe jouer live) – et, on le verra plus loin, ces problèmes techniques récurrents qui affectèrent une bonne partie des quelque cent dates de la tournée39.
On sait qu’à la veille de la sortie de l’album, « Counting out Time » (couplé avec « Riding the Scree ») sortit en single mais échoua à entrer dans les charts, s’attirant même quelques autres critiques plutôt négatives. Mauvais présage ? Le fait est qu’en plus les choses se compliquèrent lorsque Steve Hackett se blessa bêtement à la main, causant ainsi l’annulation de la tournée de chauffe (onze dates au Royaume-Uni). C’est aussi à ce moment que Gabriel se rendit compte que le nom du personnage central – Rael donc – avait déjà été utilisé, huit ans auparavant, par les Who sur leur album de 1966, Sell Out40 ! Quelque chose qu'il ignorait complètement et qui lui fit peut-être craindre que son projet paraisse moins novateur et original qu’il ne l’aurait souhaité... Quoiqu’il en soit le disque sortit finalement le 18 novembre et le groupe enchaîna directement avec la tournée (le 20), devant un public qui n’avait donc pas encore eu le temps de s’habituer au nouvel opus (aux Usa, le disque fut en plus commercialisé avec un mois de décalage). Sans parler du fait que, faute des shows préparatoires du mini-tour anglais, le groupe dût, à marche forcée, se (re)faire la main – au sens propre comme au figuré pour Steve, qui dût subir un traitement à base… d’électricité ! Départ au forceps donc, et au détriment peut-être des premières prestations de la tournée américaine.
Les concerts de The Lamb s'ouvraient sur des images de Manhattan au petit matin – projetées sur trois écrans différents, en fond de scène. Quoique le show représentait, de l’avis de tous, ce qui se faisait de plus ambitieux en matière de rock théâtral scénarisé – éclipsant même ce que Pink Floyd avait proposé pour sa dernière tournée The Dark Side Of The Moon –, les premiers concerts ne furent rien moins que compliqués. Les projecteurs ne fonctionnaient pas toujours comme prévu et certains costumes de Gabriel créaient des problèmes de son (micros défectueux et/ou mal placés), outre que certaines parties musicales étaient pratiquement impossibles à reproduire fidèlement sur scène (les séquences d’ambient music en particulier, mais aussi certains gimmicks instrumentaux et effets vocaux). Pour compliquer les choses, le public néophyte, celui qui venait juste d’entrer dans l’univers des premiers albums, fut bien évidemment confronté à tout autre chose que ce dont il pouvait s’attendre. Des morceaux tout aussi complexes qu’avant mais dans un style bien plus brut, un univers décalé par rapport à l’image habituelle véhiculée par le groupe, et un nouveau visuel à bien des égards avant-gardiste, novateur certes mais déconcertant à la fois. Face au public, chaque musicien se tenait sur une espèce de contremarche et tout (la scène en elle-même, les amplis, les vêtements) se devait d’être de couleur sombre, de manière à créer l’ambiance la plus ténébreuse possible. Jusqu’ici les fans avaient vu ou entendu parler de l'Homme-Fleur et de la Femme-Renard-à-la-Robe-Rouge41