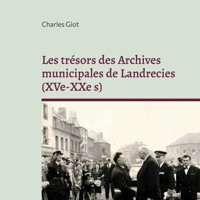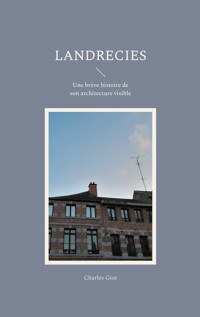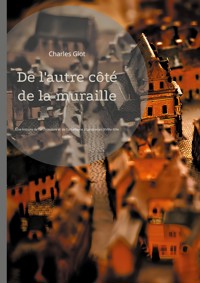
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
De 1895 à 1920, Landrecies s'est vue perdre ce qui faisait son identité urbaine jusqu'alors : ses fortifications. Aujourd'hui, ville ouverte sur le bocage de l'Avesnois, la cité natale de Dupleix entretient une histoire particulière avec ce passé et souffre de l'absence de vestiges conséquents encore en place. La vision passéiste de certains ouvrages, à l'unisson du fait militaire, n'a fait que négliger un autre pan de la vie urbaine à Landrecies aux XVIIIe et XIXe siècles durant le temps de la fortification : son urbanisme et son architecture. De cela, à travers une approche novatrice, et alors que les villes fortes de l'Avesnois n'ont jamais été étudiées sous cet angle, on découvre une autre histoire de Landrecies, celle des aménagements plus ou moins accomplis, de la réglementation urbaine et surtout d'une architecture que l'on n'avait jamais nommée jusqu'ici, l'architecture tournaisienne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Remerciements
Cet ouvrage représente l’aboutissement d’une réflexion initiée au cours de ma deuxième année de licence en histoire, aboutissant à la publication de mon mémoire de première année de master, revisité et enrichi pour l’occasion. Ce travail s’est développé parallèlement à une mission confiée par le CREHS, consistant en un état de l’art archivistique et bibliographique sur la culture de la waide (Isatis tinctoria) en France et à l’étranger. L’année universitaire ayant conduit à cette production a été marquée par une variété de recherches, de découvertes enrichissantes et d’explorations thématiques. Cet ouvrage ambitionne de souligner l’intérêt d’une étude historique de l’urbanisme dans le cadre d’un ensemble urbain fortifié de petite dimension.
Un tel projet ne pourrait voir le jour sans le soutien et les apports précieux de plusieurs personnalités et institutions.
En premier lieu, il convient de souligner l’apport essentiel de Youri Carbonnier, dont l’écoute, les conseils et l’encadrement ont offert un cadre rigoureux mais flexible, propice à la réalisation du mémoire.
Le rôle de l’équipe du Musée des plans-reliefs mérite également d’être salué. Les échanges avec Arnaud Trochet, pour sa disponibilité et son engagement, ainsi qu’avec Isabelle Warmoes, dont les conseils lors de la visite du 6 octobre 2023 ont été particulièrement éclairants, ont largement contribué à la réflexion que je vous propose.
Les Archives municipales de Landrecies, sous l’égide de Philippe Mézière, ont également joué un rôle clé dans ce projet. Ses échanges érudits et stimulants ont apporté des éclairages utiles à la recherche.
Enfin, une mention particulière doit être adressée à Pierre Nourisson, dont la réalisation d’une élévation de façade et d’un schéma de fenêtre a été précieuse pour l’analyse architecturale.
Liste des abréviations
ADN : Archives départementales du Nord
AMCE : Archives municipales de Condé-sur-l’Escaut
AML : Archives municipales de Landrecies
AMM : Archives municipales de Maubeuge.
Sommaire
Remerciements
Liste des abréviations
Sommaire
Introduction
I) Présentation du sujet
II) Se replacer dans l’historiographique : les tenants et les aboutissants de la fabrique d’une histoire de l’urbanisme à Landrecies aux XVIII
e
et XIX
e
s
III) Sources et méthodes
IV) Organisation du livre : des potentialités archivistiques au plan final
Première partie
Un espace urbain réglementé, une ville structurée
Chapitre I :
Un siècle de réglementations urbaines (1731-1825)
Chapitre II :
Le caractère d’une cité : une morphologie urbaine singulière ?
Chapitre III :
Le choix de l’alignement
Deuxième partie
Paysage urbain et sentiment d’urbanité : portrait architectural de Landrecies
Chapitre I :
Typologie d’une façade : parler d’ une architecture landrecienne
Chapitre II :
Reconstituer l’état et les pratiques d’une architecture civile au XIX
e
s : entre héritages et altérations
Chapitre III :
Un espace bâti en évolution : la traversée de Landrecies
Troisième partie
Un décor en mutation : des politiques d’aménagement vectrices d’une forme de conscience urbaine
Chapitre I :
Une circulation priorisée : l’idéal d’une voirie large et partagée
Chapitre II :
Végétaliser l’espace urbain : Landrecies ville arborée
Chapitre III :
Salubrité et sécurité : des préoccupations diachroniques objets de transformations urbaines
Conclusion
I) Définir les tenants et les aboutissants de l’histoire de l’urbanisme et de l’architecture civile à Landrecies aux XVIII
e
et XIX
e
s
II) Un épisode et un lieu qui concentrent les transformations du paysage urbain?
III) Perspectives de recherches à partir du cas de Landrecies
Corpus de sources :
I) Services d’archives :
II) Cartes et plans :
III) Sources imprimées :
Bibliographie :
I) Instruments de travail :
II) Ouvrages spécialisés :
Table des illustrations
Index des tableaux
Table des matières
Introduction
I) Présentation du sujet
I) Les origines du sujet
Commencer cette recherche, c’est avant tout entreprendre un retour sur soi, une forme de quête personnelle. Pour moi, choisir Landrecies comme objet d’étude, c’est explorer une ville qui, comme l’écrivait si bien Victor Hugo, « finit par être une personne1» . Une personne que l’on découvre à travers sa matière, ses rues, ses vestiges, mais aussi à travers la parole qu’elle suscite. Cette parole, je l’ai rencontrée pour la première fois dans des ouvrages qui, bien que parfois moralisants2, ont émerveillé l’adolescent curieux que j’étais. Ces lectures3 ont semé les premières questions qui, avec le temps, m’ont forgé et conduit à entreprendre cette étude.
L’histoire de Landrecies inspire naturellement un certain lyrisme, tant elle semble se prêter à ce registre. Ses récits de faits d’armes, son historiographie construite dans le cadre républicain et marquée par le déclassement de la place militaire de Vauban témoignent d’un effort pour nourrir la fierté des Landreciens. Pourtant, malgré cet héritage, Landrecies, la ville natale de Dupleix, semble aujourd’hui en quête d’identité. Peu de gens connaissent en détail l’histoire de ses structures, elle qui fut une place forte, comme Maubeuge ou Le Quesnoy. Ce passé, désormais lointain, a laissé derrière lui des fragments matériels, des traces fragiles d’un patrimoine qui mérite d’être mieux compris et transmis.
C’est au bord de la Sambre que se situe Landrecies, sur un point de non-retour des contreforts des Ardennes pour Vidal de la Blache4. Cette situation géographique situe la ville à 25 kilomètres en amont de Maubeuge et nous la connaissons depuis les premières sources tangibles de son existence au IXe siècle5. Cette ville d’un peu plus de 3000 habitants aujourd’hui, située au sud du département du Nord, cherche sa place dans un territoire en lente recomposition par l’affirmation du tourisme vert. Il fait désormais de Landrecies un port d’attache sur la Sambre6. Plus que jamais tournée vers cette rivière, la ville en tire depuis l’époque médiévale une physionomie tout à fait particulière, puisqu’elle est scindée en deux parties par ce même cours d’eau. Plantées là, au milieu du bocage, subsistent une Ville-Haute et une Ville-Basse, la première est ainsi supérieur en nombre d’habitants par rapport à la seconde. Ces deux espaces sont eux-mêmes à replacer dans un ensemble urbain distendu par ses deux imposants faubourgs.
1: Landrecies, de part et d'autre de la Sambre rectiligne, au milieu du bocage de l’Avesnois (cliché l'Avesnois vu d'en haut, 2023).
De cette vue aérienne, on s’imprègne de la composition urbaine landrecienne. Sur la rive droite de la Sambre canalisée, la Ville-Haute propose un plan hétérogène, concentré à l’extrême et en étoile pour son épicentre, en damier et plus relâché pour ses contours. Cette forme interpelle, c’est une curiosité dans cet espace à l’absence notable de relief. Sur l’autre rive, c’est un cadre urbain tout aussi hétérogène qui est mis à notre disposition, il amalgame des habitations, des commerces et des entrepôts. Ces structures questionnent sur leur genèse, une approche historique s’impose pour faire l’état du développement des structures urbaines au fil de l’histoire de Landrecies.
II) Approche historique
Malgré quelques découvertes sommaires pour les périodes antérieures, la première source écrite mentionnant Landrecies date du IXe siècle. La ville ex-nihilo, sur la rive droite, fut probablement érigée du temps du seigneur d’Avesnes, Nicolas le Beau (1147-11697). Dès lors, Landrecies apparut comme une cité frontalière, un poste avancé dans les conflits seigneuriaux du Moyen Âge central. Bien qu’il y est cette instabilité politique chronique, la cité ne s’est pas vue enrayée dans le développement de ces édifices, même si l’époque médiévale fut celle d’une véritable fortification de la ville8. La forteresse édifiée vers 1140-1150, de forme quadrangulaire, prit rapidement une proportion plus importante. Cette construction originelle imposante, encore présente au XIXe siècle, sera pourtant, dans un siècle d’émergence de la patrimonialisation, détruite9. Ainsi, renforcée au sortir de l’époque médiévale, la ville possède une fonction militaire prédominante, un carcan sur la population et sur son développement commercial. Ses édifices, de ce fait, sont figés dans les murailles, victimes de l’affirmation progressive des systèmes de défense qui englobent la ville. Le XVIe siècle est celui d’une mutation poussée des dispositifs militaires de la ville dans un contexte de tensions militaires dans la région. La ville est prise par les Espagnols en 1526, tel qu’en fait état le traité de Madrid, confirmé par la Paix des Dames trois ans plus tard. De ce temps, la ville s’est parée de bastions figeant un peu plus son développement. Reprise par les Français en 1543, elle est rendue encore bastionnée davantage en 1544 à l’Empereur Charles Quint. Après cette date, c’est l’ensemble de l’environnement landrecien qui fut réaménagé, fossés, amélioration des murailles, des travaux comme dans bien d’autres cités fortifiées du secteur10. Encore rénovée, cette ville-forte est reprise définitivement en 1659 par le roi de France. La Ville-Basse fut remaniée et des travaux secondaires en Ville-Haute ont été réalisés jusqu’en 1692. La ville connaît, malgré le siège de 1712, un long XVIIIe siècle relativement calme, où furent construits, dans un souci d’équipement, de nouveaux casernements11. Mais en 1794, dans le contexte de la Guerre de la Première Coalition, Landrecies fut ravagée en grande partie12 par les bombardements des assiégeants. Du 17 au 30 avril 1794, Landrecies est pilonnée et les ravages sont si terribles que la ville mettra une dizaine d’années à se remettre de cet épisode. La reconstruction est lente et coûteuse dans un temps d’instabilité chronique des institutions politiques13. Elle a nourri une historiographique et des sources établissant des contre-vérités sur l’importance même de la reconstruction14. Restée dans la mémoire, elle demeure avec, c’est un hasard, un siècle plus tard en 1894, le début du démantèlement de la place, un événement douloureux pour la mémoire landrecienne15. Ainsi, dans un XIXe siècle marqué par l’absence de faits militaires d’importance dans cette ville, il n’est relaté aucun fait particulier à Landrecies autre que son démantèlement commencé en 1894. Des travaux entrepris de destruction des remparts, progressifs, au fil des financements et qui s’achèvent véritablement en 1920, la ville pansant difficilement ses plaies de la Première Guerre mondiale. Elle est depuis, sans jamais s’être remise véritablement des destructions occasionnées par ce conflit, une ville ouverte et modeste, qui n’a pas connu le développement tant espéré lors de son démantèlement, ne conservant qu’à titre mémoriel deux casernes en guise de matérialité de son histoire militaire. Elle est désormais, à compter de la seconde moitié du XXe siècle, une ville calme et paisible mais sans dynamique de développement réelle, trop éloignée de Valenciennes et de Maubeuge, Landrecies, n’échappant pas à la désindustrialisation, s’est vidée de près de 2000 habitants en 70 ans. Elle reste pourtant la cité natale de Dupleix, où sa statue trône fièrement sur la place principale, une ville qui souhaite aujourd’hui, ce livre en a l’ambition, renouveler son décor et son image.
III) Postulat et définition du sujet
Ainsi, entreprendre une approche historique à Landrecies, c’est avant tout, faute de plus, faire une histoire militaire. On ne peut, à la lecture des travaux historiques sur Landrecies, s’écarter de ce chemin. Pourtant, à l’instar des casernes encore présentes aujourd’hui, il subsiste des matérialités témoignant de ce que pouvait être la ville à partir de la conquête définitive par le roi de France et particulièrement durant les XVIIIe et XIXe siècles. Le patrimoine militaire, peu nombreux mais imposant, est celui aujourd’hui mis en valeur par la municipalité à travers un circuit historique créé il y a quelques années. Celui-ci valorise encore une fois l’histoire militaire littéraire et force le visiteur à un travail d’imagination pour s’imprégner des fortifications d’autrefois. Pourtant, malgré ce travail ambitieux, les ouvrages traitant du patrimoine fortifié de la région ne font pas mention de Landrecies. Ces vestiges militaires trop modestes, dans une ville caractérisée depuis toujours pas sa petitesse, l’enferment dans l’impasse de la mémoire de son passé militaire.
En forgeant l’imprégnation d’une ville par des balades attentives sur l’esthétique et les formes de ses édifices et plus largement de sa morphologie, l’inexistence d’un travail sur son histoire urbaine (au sens matériel du terme) apparaît comme dommageable. En effet, on peut constater l‘existence de façades d’habitations d’Ancien Régime et du premier XIXe siècle en nombre et non étudiées, leur valorisation apparaît ainsi comme bienvenue. Face à une histoire militaire qui laisse vides de travaux et d’informations deux siècles d’histoire urbaine landrecienne, il faut partir du principe que la condition de la fortification est un carcan tant pour l’historiographie que pour les Landreciens dans le développement urbain. De ce fait, nous ne savons rien, entre 1659 et 1894, sur les formes des édifices civils et sur les politiques urbaines dans un temps d’émergence, au XVIIIe siècle, du souci de l’embellissement16 des villes. Nous ne savons rien non plus sur les aménagements urbains réalisés et sur le sentiment d’urbanité landrecien au XIXe siècle, alors que s’instaure une mutation du regard porté sur la ville dans le cadre national17 et que Landrecies, ville fortifiée, apparaît comme un cas particulier.
IV) Questionnement initial
Landrecies (aux XVIIIe et XIXe siècles) étant d’abord une ville fortifiée, fortifications encadrant son développement et les structures habitées, mérite une approche dissonante, c’est-à-dire faire l’histoire de son urbanisme. Ce vocable néologique18 forgé depuis plus d’un siècle se définit, pour notre période d’étude plus ancienne, par une multiplicité de termes et de préoccupations à synthétiser ici. Ainsi, l’embellissement de la ville, s’il a existé, et particulièrement son architecture civile à défaut de militaire, constitue un premier cadre du sujet initié lors des balades que j’ai effectué dans le centre ancien de la ville. Ne bénéficiant que de la connaissance des équipements de la ville actuelle, on s’interroge sur l’existence de politiques d’aménagement durant deux siècles, malgré le poids des infrastructures militaires, dans l’optique de restituer son décor et ses mutations. Enfin, au sens large, c’est la ville dans ses structures que je souhaite faire partager aux lecteurs. L’objet est donc de travailler sur les structures habitées, civiles, car négligées, mais aussi plus largement, au jeu des emboîtements d’échelles, sur la morphologie urbaine dans son ensemble. Tels sont les tenants et les aboutissants du sujet à l’origine de sa définition pour mon mémoire et qui avaient donné corps au sujet suivant : Landrecies, ville fortifiée (XVIIIe-XIXe s) : embellissement, aménagement et structures.
II) Se replacer dans l’historiographique : les tenants et les aboutissants de la fabrique d’une histoire de l’urbanisme à Landrecies aux XVIIIe et XIXe s
I) L’historiographie locale
A l’évidence, parler de la construction d’une approche historique sur Landrecies revient à évoquer, en premier chef, l’historiographie locale. Comment s’insère donc cette étude de l’urbanisme dans ce cadre local? L’historiographie landrecienne est absorbée, depuis son apparition dans la seconde moitié du XIXe siècle, par la retranscription, tel un témoignage, des structures militaires d’autrefois, s’érigeant comme garante d’un passé révolu. Quatre ouvrages relatent de ce fait l’histoire de la ville19, ils sont empreints de poliorcétique et influencés significativement par le contexte de leur rédaction. Leur répétition tend à rendre inutile l’utilisation de la totalité de l’historiographie présente. Par souci de clarté, on s’accorde à retenir les ouvrages de Philippe Fournez20 et Paulin Giloteaux21, parus respectivement en 1911 et en 1962. Ce sont des œuvres générales, produites par des érudits, hors de toute entreprise universitaire normée et remises en question lorsqu’elles furent l’objet de comptes-rendus22. Pourtant, l’Histoire d’une forteresse de Fournez s’avère être l’ouvrage le plus complet en ce qui concerne l’examen de l’infrastructure militaire landrecienne. Bien que l’auteur ne mentionne pas toujours ses sources, il est le dernier ouvrage nourri potentiellement des archives municipales. En effet, celles-ci ont brûlé en novembre 1918. Plus distante du fait militaire, l’Histoire de Landrecies de Paulin Giloteaux dresse un portrait plus global de la ville, un portrait moralisant et critique, copiant parfois mot pour mot l’œuvre de Fournez et qui, une fois 1911 passée, prend un caractère politique et héroïsant ceux qui sont, pour lui, les grands hommes de Landrecies au XXe siècle. Ces deux ouvrages, les plus complets pourtant, n’ont rien de scientifique dans leur démarche. Ils sont à replacer, pour l’un, dans un contexte proche de la Première Guerre mondiale, dans une volonté de mettre en exergue le patriotisme landrecien peu de temps après le démantèlement de la place. Pour l’autre, il s’agit précisément du regard d’un auteur du XXe siècle, imprégné de l’œuvre de Fournez, et qui a connu de ses yeux la Seconde Guerre mondiale. L’auteur porte un jugement sur ce que devient Landrecies dans un temps de reconstruction d’une identité nationale23. Cette littérature a fait et fait référence encore aujourd’hui. De ce fait, l’écriture de l’histoire de Landrecies ne s’est jamais véritablement développée. L’explication réside dans l’inexistence de travaux universitaires sur celle-ci jusqu’alors. Les passionnés, préféreront ce mot à ceux d’historiens locaux, n’ayant pas la maîtrise de la méthodologie, ont synthétisé des faits déjà connus dans de nouveaux ouvrages24. De ce fait, puisque englué sous le thème de la ville fortifiée disparue, le travail sur l’histoire urbaine landrecienne relève d’abord d’une imprégnation de l’historiographie nationale puis régionale sur l’urbanisme et le fait urbain aux XVIIIe et XIXe siècles. La pertinence de ce travail s’affirme ainsi par la méconnaissance, par les plus savants eux-mêmes, acteurs de l’historiographie landrecienne, d’une autre histoire que celle du fait militaire, celle de l’urbanisme et du fait urbain dans une ville parsemée encore aujourd’hui d’habitations du XVIIIe et du XIXe siècles25 . Il s’agit de créer un champ d’étude nouveau à Landrecies mais aussi pour les villes fortes alentour.
II) Un travail qui se replace au premier chef dans l’historiographie de l’urbanisme
Ainsi, en conscience de la petitesse de la ville et de son caractère fortifié, les tenants et les aboutissants d’une telle étude sont à replacer, avant toute chose, dans le champ historiographique national. Dans ce champ, on retrouve quelques ouvrages fondateurs énonçant les possibilités qu’offre une étude sur la ville à l’époque moderne et contemporaine. L’ouvrage le plus complet, un modèle pour tout historien du fait urbain, reste encore de nos jours, celui dirigé par Emmanuel Leroy Ladurie intitulé La ville des temps modernes26. Cette synthèse fait pour nous un lien entre les études passées sur la ville, des études quantitatives, à l’instar des travaux de Jean-Claude Perrot sur Caen27, et les travaux postérieurs qui fondent encore aujourd’hui leurs axes de recherche sur quelques notions énumérées pour la première fois dans cet ouvrage. Cependant, cet ensemble universitaire relate une histoire urbaine des grandes villes du royaume où l’aspect matériel et architectural est un peu limité. Pourtant, l’étude historique que nous entreprenons à Landrecies, durant la temporalité définie, sous le thème de l’urbanisme du temps long, s’inscrit dans un continuum avec les grandes dynamiques évoquées dès les années 70 et 80 par Le Roy Ladurie et d’autres pour des ensembles urbains d’autres dimensions.
Ainsi, parler d’un « urbanisme frôleur28 » est devenu aujourd’hui une introduction bien courante lorsque l’on engage un travail sur l’urbanisme d’une entité urbaine au XVIIIe siècle. Cette notion définit un urbanisme néo-classique limité à la planification des quartiers ex-nihilo de la ville et qui ne s’affirme pas dans la ville médiévale, si ce n’est par une réglementation sommaire sur les façades par l’idée de la sécurité et par extension de la régularité du bâti. Cette notion a nourri l’œuvre fondamentale et plus tardive de Jean-Louis Harouel, L’embellissement des villes29, et qui vient appuyer la thèse d’Emmanuel Le Roy Ladurie. Là aussi, ses axes de recherches portent sur les politiques d’urbanisme dans les villes au XVIIIe siècle. Cependant, il met en exergue la prééminence de la production réglementaire dans l’étude du fait urbain. Cet urbanisme est défini régulièrement dans ces textes par le souci de l’embellissement de la ville. De ce fait, par l’aspect comparatif caractéristique de cet ouvrage et de sa méthodologie, renouvelant l’approche par les sources écrites, ce présent livre souhaite, en continuité avec l’usage des sources fait par Jean-Louis Harouel, aborder la production textuelle landrecienne par l’approche comparative. L’étude sur Landrecies à cette époque s’inscrit dans cette dynamique de positionnement des logiques de l’urbanisme dans le cadre de la production réglementaire à l’échelle du royaume. Ainsi, une meilleure compréhension des sources landreciennes est forcément assurée et nourrit la connaissance nationale et régionale de l’urbanisme néo-classique. En continuité avec les courants historiographiques nationaux évoqués jusqu’alors, bien qu’ils énumèrent souvent le cas des grandes villes loin d’être fortifiées comme Landrecies, on retrouve, pour le XIXe siècle, deux ouvrages fondamentaux qui ont inspiré le sujet de livre30. Ce sont des ouvrages du début des années 2000 qui notaient alors que « l’histoire urbaine de la première moitié du XIXe siècle est encore peu approfondie31 » à cette époque. Ainsi, à travers ces deux œuvres, Michèle Lambert-Bresson et Annie Térade ont proposé un véritable modèle mixte recoupant des études nationales et locales sur la ville française au XIXe siècle et loin des préjugés de l’unicité du modèle tardif Haussmannien. Cette compilation diverse d’articles chrono-thématiques permet de replacer les politiques nationales à des échelons locaux exemplifiés. Ainsi, le regard sur le cadre national demeure une condition pour réaliser ce travail face à la méconnaissance de l’histoire urbaine locale, alors qu’au XIXe siècle il s’annonce un contrôle national sur la ville.
III) Une histoire de la ville fortifiée aux XVIIIe et XIXe s
Faire une histoire de l’urbanisme à Landrecies, c’est aussi s’inscrire dans une forme d’histoire plus thématique et toujours en renouvellement du fait urbain. La première est celle de la ville fortifiée où Bernard le Petit avait déjà évoqué il y a quelques années le concept de « ville close 32 » . On se replace dans une dynamique portée, notamment pour le XIXe siècle, sous l’idée d’un « poids des infrastructures militaires33 » dans le développement urbain, tel que le décrit Philippe Diest pour les villes fortifiées du Nord-Pas-de-Calais. Notre travail s’inscrit dans cette étude des tenants et des aboutissants de la présence de l’infrastructure militaire dans la ville. Ainsi, c’est relater des comportements urbains de frustration face aux systèmes de servitude, mais aussi exposer les semblances morphologiques des villes fortifiées régionales dans leur développement. Étudier la ville fortifiée, c’est aussi souligner les aménagements réalisés malgré la présence militaire, comme l’ont fait Carole Espinosa et Jules Maurin34. Ils ont démontré l’entente qui s’opère parfois entre les sphères civiles et militaires, mais aussi les déceptions engendrées dans la sphère civile. Ainsi, à travers ce positionnement historiographique, on se replace dans une approche mixte du fait de l’apport de l’histoire des mentalités, ou bien à l’opposé, de l’apport de l’histoire matérielle, avec comme thème sous-jacent les conflits urbains qu’avait déjà mis en évidence (pour Caen) Jean-Claude Perrot .
IV) Les apports de l’histoire de l’architecture
L’histoire diachronique de l’urbanisme landrecien relève aussi d’un examen architectural de ses édifices civils. Ce travail sur la production textuelle et ses répercussions dans l’architecture domestique de la ville fut déjà entrepris à travers trois articles régionaux récents portant sur Airesur-la-Lys35 et Valenciennes36. Ces deux villes furent intégrées, avec une temporalité proche de Landrecies, dans le royaume de France et leurs études sur l’urbanisme et l’architecture eurent pour dessein de souligner les conséquences de la conquête dans ces domaines, mais aussi la constitution d’un décor urbain fait de normes et du style purement français. C’est dans cette lignée que s’inscrit naturellement l’étude landrecienne, sur les pas de Laurence Baudoux-Rousseau, dont les articles sont d’une grande richesse. Par ailleurs, étudier une architecture au-delà de la production textuelle qui la norme, c’est décrire une façade et des formes associées au bâti du Hainaut et de l’Avesnois. C’est ainsi, nous le verrons, suivre les pas d’une série de monographies belges, Le Patrimoine monumental de la Belgique, seuls ouvrages qui évoquent l’architecture observée ici et qui datent des années 7037. Cette série de monographies n’a jamais été renouvelée depuis, alors que l’on peut relever l’absence formelle d’étude universitaire sur l’architecture avesnoise, là encore cette étude sur Landrecies est novatrice.
V) Une historiographie de l’aménagement urbain
Ce livre s’inscrit aussi, toujours sous l’aspect thématique, dans la continuité des courants de recherche qui relatent une nouvelle perception des politiques d’aménagement du paysage urbain, et en particulier l’assainissement du décor de la ville. Il a été étudié de manière diachronique par Sabine Barles à travers son ouvrages La ville délétère : Médecins et ingénieurs dans l’espace urbain (XVIIIe-XIXe siècle38), ainsi que par ses multiples articles. Ils portent à la fois sur la politique d’assainissement de la ville, mais aussi sur son aménagement à travers l’ordre dans l’espace urbain39. Ses études relèvent bien souvent du fait parisien, il est donc judicieux de proposer un cas modeste d’application de ce courant de recherche à Landrecies. C’est ce que Laurence Baudoux Rousseau avait modestement accompli pour Valenciennes, en soulignant encore une fois l’importance de la réglementation. Cette idée de l’aménagement touche de multiples composantes de la ville. Ainsi, s’inscrire dans cette démarche revient à traiter d’une multiplicité de thématiques, comme celle abordée par Philippe Bragard : le décor végétal de la ville fortifiée40. Là aussi, au jeu de l’historiographie de l’aménagement urbain, je vous propose un travail d’emboîtement d’échelles, le cas de l’alignement, diachronique, en est l’exemple même41.
VI) Un ancrage historiographique conditionné par les sources
Enfin, nous le verrons bientôt, ce travail s’inscrit (par ses sources) dans une historiographie bien particulière en ce qui concerne l’étude des plans-reliefs. Ce courant de recherche est porté par quelques spécialistes, la première d’entre-eux étant Isabelle Warmoes42, ingénieure d’études au Musée des plans-reliefs, établissement dont l’aide fut précieuse pour la réalisation de cette étude. Celle-ci s’est notamment attachée à décrire l’évolution des méthodes de réalisation des plansreliefs, mais aussi les possibilités de recherche permises par leurs observations, ayant à cœur de montrer qu’il s’agit d’une source matérielle complémentaire à l’étude de la ville aux XVIII e et XIXe siècles. A ce titre, à l’examen du plan-relief de Landrecies, on s’engage aussi dans les axes de recherche d’Antoine de Roux qui travaille en partie sur les réalités architecturales des structures de la ville et de ses aménagements à travers l’étude des plans-reliefs43.
L’examen de l’histoire urbaine landrecienne, par les thèmes de l’urbanisme et de l’architecture notamment, relève d’une synthèse globale des courants qui traversent l’histoire de la ville durant deux siècles. Cette synthèse désire « réhabiliter la ville ordinaire 44 », c’est-à-dire son aspect civil, en associant les travaux des historiens de l’architecture comme Isabelle Warmoes ou Constant Pirlot, les historiens de l’art comme Laurence Baudoux-Rousseau, mais aussi des historiens du droit comme Jean-Louis Harouel. De cette synthèse, l’objectif assumé est ainsi de faire une histoire de l’urbanisme pleinement accomplie.
III) Sources et méthodes
I) L’inexistence d’archives municipales
A Landrecies, les archives municipales sont inexistantes avant 1918, l’hôtel de Ville de la cité de Dupleix ayant été incendié en novembre 1918 lors des bombardements de la ville. Ainsi, les sources municipales, souvent indispensables lorsque l’on souhaite étudier les politiques urbaines et architecturales d’une commune, sont inexistantes. Aujourd’hui, les Archives municipales sont classées et permettent un meilleur accès aux sources, mais aucune découverte n’a été faite sur des sources de l’urbanisme aux XVIIIe et XIXe siècles.
II) Le site des Archives départementales du Nord et son unicité dans l’apport des sources écrites
Faute de sources municipales, on s’oriente directement vers les fonds d’archives départementaux. On y trouve deux inventaires se substituant tant bien que mal aux Archives municipales, l’un pour le XVIIIe siècle, l’autre pour le XIXe siècle. Ainsi, en série C sont conservés les registres des délibérations, résolutions, ordonnances et correspondances. Cette sous-série est formée de plusieurs dizaines de petits livrets. Le livret n° 70 recèle un ensemble de références concernant les correspondances entre des autorités établies à Landrecies et des autorités externes, telles que l’intendance ou des supérieurs militaires. Au fil de l’exploration de ce fonds, on retrouve diverses correspondances assez dissemblables concernant des incendies45, mais aussi des projets comme la construction d’un abattoir46 et sa destruction, mais surtout deux dossiers d’affaires communales comportant un ensemble de correspondances et d’ordonnances communales et royales47. Dans ces dossiers, où les sources sont classées par années, il est mis en évidence la découverte, puisque méconnue, de trois ordonnances (1731-1766-1769) produites par les magistrats. On retrouve aussi quelques documents épistolaires qui relatent le dessein des magistrats de l’éloignement hors les murs du cimetière communal48, ou encore d’un conflit de voisinage au sujet d’un jardin intra-muros. Ce registre n°70 constitue, pour les sources écrites, l’unique fonds archivistique disponible au XVIIIe siècle. Il limite, in fine, l’approche historiographique nationale et régionale à ces quelques sources jusqu’alors inexploitées.
Le dossier d’affaires communales de Landrecies (1800-1940) classé en sous-série 2O est riche pour cette étude. En effet, le XIXe siècle est bâclé plus que les autres par l’historiographie49. Plus particulièrement, ce fonds peut être défini comme le réceptacle de la correspondance entre la commune et la préfecture, une certaine anti chambre des archives municipales. Plus riche car mieux conservé, on y retrouve des documents relatifs à de véritables politiques d’aménagements, comme le plan d’alignement de la ville et le règlement sur l’élévation des maisons produit en 182550, mais aussi des formes de conflits à travers la réglementation architecturale51. On retrouve aussi des dossiers relatifs aux travaux effectués dans la ville, notamment sur la voirie52, mais aussi, plus singulières, quelques sources qui relatent la réalisation d’une promenade urbaine en 181353. Enfin, il est aussi à noter que ce dossier conserve deux cotes relatives à l’enlèvement des boues et à l’éclairage public54 sur le temps long.
Ainsi, toujours aux Archives départementales, la sous-série 2R a été exploitée. Elle est intitulée organisation générale de l’armée : places-fortes. Les cotes 2R/396 et 2R/397 ont été explorées, elles sont relatives aux demandes des autorités, dans les années 1883-1885, du démantèlement de la place. Celles-ci illustrent les frustrations urbaines d’un développement urbain brimé, un dossier en partie utilisé par Philippe Diest et réexploité ici55.
Enfin, il reste à mentionner, en ce qui concerne directement Landrecies, l’existence en série S, relative aux travaux publics et aux transports (1800-1940), de l’atlas du plan général d’alignement de la ville56. Il complète ainsi les sources écrites mentionnées plus haut. Les plans d’alignement de 1854 et 1872 sur la route n°4557 (la traversée de ville) ont aussi été explorés. Elle dépendait alors des Ponts et Chaussées, ce qui permet de travailler aussi sur les demandes de modifications du bâti sur ce même axe de 1861 à 189558.
III) Une démarche comparée par les sources de quelques villes alentour
Dans une démarche comparative, ayant étudié l’intégralité des sources écrites attribuées à Landrecies, il s’est imposé un travail de sélection, à partir de l’inventaire des sources landreciennes, de villes fortifiées régionales qui, par leurs sources écrites, pouvaient au mieux permettre de se saisir des dynamiques de l’urbanisme landrecien dans une démarche comparée. Les sources écrites Maubeugeoises apparurent ainsi opportunes, l’implantation géographique des deux villes étant quelque peu similaire. Là aussi, dans son dossier d’affaires communales (2O/396), des éléments comme la réalisation de son plan d’alignement59 ont été sélectionnés. Mais plus encore, c’est aux Archives municipales de Maubeuge que l’on retrouve une belle production réglementaire jusque-là inexploitée60. Ces éléments permettent, à l’aide de l’historiographie, l’élaboration d’un examen comparatif temporel de la production réglementaire landrecienne. Ainsi, à lecture des sources landreciennes, il est apparu que Condé-sur-l'Escaut servit de modèle à l’élaboration d’une ordonnance (en 1769). Ce fut l’occasion d’une inspection plus approfondie des sources municipales de cette ville. Ce sont des sources éparses61, mais qui viennent compléter la méthodologie comparative de la lecture des archives landreciennes. Enfin, pour une approche plus tardive, la ville d’Avesnes-sur-Helpe, par son dossier d’affaires communales (2O/36), a permis de compléter l’approche comparative pour le XIXe siècle. Il a été relevé l’existence d’un projet de promenade urbaine peu de temps avant celui de Landrecies62, mais aussi des particularités comme l’existence d’une maison à encorbellement en 181363, ou la rédaction d’ un règlement sur la circulation des trottoirs en 185964.
IV) Les sources matérielles
Cependant, les sources écrites étant limitées, l’approche comparative inspirée de Jean-Louis Harouel ne peut se référer à l’unicité de l’étude de l’urbanisme à Landrecies durant deux siècles par les sources écrites. Ainsi, l’usage des sources matérielles et iconographiques complète nos documents écrits et donne corps à une méthodologie liant une variété de sources. La plus fameuse demeure le plan-relief de Landrecies65. Cette source matérielle produite en 1723 est conservée en réserve au Musée des plans-reliefs aux Invalides à Paris. Elle nécessita, pour être photographiée, un déplacement sur le terrain, au cœur d’un site exceptionnel et qui fut permis grâce à l’accord des équipes du musée. Une fois photographiée, cette représentation en trois dimensions de la ville au milieu du XVIIIe siècle a pour « avantage de paraître immédiatement lisible au profane66 », mais aussi de fournir une lecture complémentaire du paysage urbain de la ville sous l’Ancien Régime. Ce décor urbain on peut aussi l’aborder, sa retranscription étant un dessein de mon mémoire, à travers les quelques plans de Landrecies visualisables sur Gallica. La bibliographie en fournit un certain nombre, on retiendra celui de Jacques Deventer67. Le dessein de la retranscription des structures landreciennes use aussi du lever-nivelé du plan-relief (jamais réalisé) de 182568. Ce document se constitue comme une série de planches qui reproduisent les façades des habitations pour permettre la réalisation d’un plan-relief. Cet outil est plus que précieux, par sa richesse descriptive pour la première moitié du XIXe siècle, mais aussi par son unicité.
Enfin la source la plus totale, diachronique dans sa forme et sa structure, reste la ville ellemême. Cette source matérielle abrite les édifices civils datant du XVIIIe et XIXe siècles. Ce sont des habitations dont on sait la datation grâce à des fers d’ancrage en façade. Il s’agit d’un témoignage matériel, le seul véritable de l’architecture landrecienne. Ici, de manière non exhaustive, on considère qu’une dizaine de façades sont exploitables pour l’étude envisagée. Les fortifications bien que disparues, on peut restituer en partie la typologie de la ville ancienne pour son aspect domestique. Cela complète le travail de retranscription initié par le plan-relief notamment. La confrontation des sources matérielles est par ailleurs une méthode fondamentale dans l’étude des villes sous l’Ancien Régime69. Ce travail est complété part le lever-nivelé pour l’étude du XIXe siècle.
La méthode dans laquelle s’inscrit ce livre est celle d’une confrontation des sources, qu’elles soient écrites, matérielles ou iconographiques. Cette méthode est employée dans les études les plus récentes. C’est le cas de la méthodologie mise en place par Agnès Maillard-Delbende à Aire-sur-la-Lys au XVIIIe siècle et qui porte sur l’étude textuelle et matérielle de l’application d’un style purement français dans l’architecture domestique70. Ce sont une approche et une méthode essentielles pour cerner au mieux les enjeux de la ville dans une étude diachronique et novatrice à Landrecies.
IV) Organisation du livre : des potentialités archivistiques au plan final
I) Les orientations de la recherche après l’état des sources
L’état des sources, faible en nombre et la déconnexion de l’historiographie landrecienne vis à vis du sujet, ont révélé toutes les difficultés du travail défini jusqu’alors. Il est toujours difficile, encore plus lorsque l’on débute dans la recherche, de saisir précisément les potentialités de chaque source. Pourtant, la diversité des sources est une force lorsqu’il s’agit d’établir une étude transversale et diachronique sur une localité. Cette étude je l’ai souhaité dynamique et ouverte sur des champs de recherches multiples, ne voulant m’enfermer dans l’impasse de l’étude réglementaire, les sources sont trop modestes et l’approche répétée. Ainsi, ce livre se divise en neuf chapitres. Ils développent au fil des trois parties, trois enjeux constitutifs de nos axes de recherches dans l’étude diachronique de l’histoire urbaine landrecienne. Cette recherche tient sa pertinence de l’inexistence d’une étude faite sur l’histoire urbaine landrecienne et même plus largement des villes fortes de l’Avesnois. Ainsi, le dessein est aussi de démontrer qu’il est possible, malgré les difficultés archivistiques que nous connaissons, de faire l’histoire d’une ville, thématique même, malgré sa petitesse.
II) Les enjeux et les axes de recherche
L’enjeu premier, il est le plus traditionnel et reprend les dynamiques des travaux sur la ville d’Ancien Régime, est d’aborder la structuration de l’espace urbain intra-muros par son cadre réglementaire et morphologique. Deux objets liés par le cadre diachronique de la planification urbaine, la thématique de l’alignement en est une illustration. Cet axe de recherche est étudié grâce à la diversité des fonds, mais aussi il est encadré par l’hétérogénéité des sources. On rappelle qu’à Landrecies on retrouve cinq règlements d’urbanisme sur un siècle. Le plan général d’alignement, mieux documenté on l’a vu, est aussi une source précieuse dans la volonté de restituer le degré de la planification urbaine à Landrecies. Le dessein de ce premier axe de recherche est donc, a fortiori, de faire l’état de la réglementation et de la structuration de la ville sur le temps long, chronologiquement en partie, mais aussi par l’aspect comparatif, dans un jeu d’emboîtement d’échelles afin de produire une histoire de l’urbanisme landrecien.
Le deuxième enjeu, in fine la deuxième partie du plan et c’est le cœur de l’ouvrage, est de développer l’idée d’un paysage architectural landrecien. L’objectif de cet axe de recherche est de proposer aux lecteurs et à la connaissance une étude sur l’architecture avesnoise dont nous ne connaissons pas grand-chose. Cette architecture est abordée par les façades encore debout aujourd’hui, par le plan-relief, le lever-nivelé, mais aussi par la réglementation urbaine, désirant connaître s’il y a eu une politique architecturale à Landrecies. Le deuxième objet, dans les pas de Jean-Claude Perrot, est de relever les pratiques et les conflits dans l’espace urbain, se questionnant d’après l’historiographie landrecienne, si l’histoire urbaine du XIXe siècle était véritablement d’une monotonie exemplaire. Enfin, le cadre architectural relève aussi de cas spatiaux particuliers, c’est ce que l’on souhaite mettre en lumière à travers la série S des archives départementales.
Le troisième et dernier enjeu, plus thématique, sera de se questionner sur les politiques d’aménagement et in fine sur les transformations du décor de la ville sur le temps long. L’idée, à travers des sources éparses mais bien existantes, est de déterminer les tenants et les aboutissements de l’aménagement landrecien afin de restituer l’évolution du décor urbain. Il s’agit d’analyser les politiques communales en la matière, mais aussi de saisir l’influence des bouleversements urbains sur les habitants, tout comme de déceler la pratique de l’espace urbain. C’est-à-dire le regard des uns et des autres sur la ville, cela permet d’expliquer au mieux sa possible métamorphose.
III) Plan du livre
De ces enjeux, qui forgent inévitablement les axes de recherches du plan proposé, on se demande dans quelle mesure les politiques et les pratiques d’embellissement, d’aménagement et de structuration de l’espace bâti intra-muros se singularisent-elles dans leurs mises en place, leurs usages et leurs altérations du début du XVIIIe à la fin du XIXe siècle à Landrecies? Ainsi, divisé en trois parties, le travail proposé en neuf chapitres, présenté de manière concise, prend l’allure du plan chrono-thématique suivant.
Le premier chapitre se constitue en une étude comparative de la réglementation urbaine à Landrecies. Le dessein est de replacer et de déterminer les tenants et les aboutissant, de 1731 à 1825, de la politique d’urbanisme landrecienne. Un deuxième chapitre se consacre à l’examen des transformations morphologiques de la cité de Dupleix sur un temps long pour tenter de déceler la nature du développement urbain, ainsi que sa fixation et ses remaniements. Enfin, un dernier chapitre de cette première partie a pour objet de faire l’état des politiques d’alignement dans la cité de Dupleix, là aussi sur un temps long, nourri par le temps national de la réalisation d’un plan général d’alignement, mais aussi de la permanence de la réglementation d’Ancien Régime.
Dans une deuxième partie, un premier chapitre a pour dessein de restituer et d’étudier le cadre architectural landrecien à travers une méthodologie particulière et un état matériel de la question. Il sera interrogé la pertinence de l’hypothèse d’une politique architecturale à Landrecies. Un deuxième chapitre se portera davantage, pour le XIXe siècle, sur les pratiques architecturales à cette période, les conflits urbains, mais aussi en se focalisant sur l’évolution du bâti sur la Grand'Place. Il faut se rappeler l’influence architecturale et structurelle de la reconstruction à la suite des sièges de 1794. Un dernier chapitre, plus restreint spatialement et alimenté par les archives de la série S, se portera sur la traversée de la ville de Landrecies. Les sources plus tardives, du second XIXe siècle, nous invitent à étudier cet espace sous le concept de la crise urbaine. De ce fait, on peut souligner la fracturation, sur la traversée de la ville, de la Ville-Haute et de la Ville-Basse.
Dans une dernière partie, il sera question d’aborder les aménagements dans l’espace urbain sur le temps long. Un premier chapitre portera sur l’idée de la voirie large et partagée. L’usage des sources écrites permet de démontrer une progressive mutation des politiques de gestion la voirie, dont la réalisation de trottoirs au milieu du XIXe siècle sera l’aboutissement. Les politiques d’aménagement relèvent aussi du végétal, c’est un deuxième chapitre. Il sera proposé un autre regard, sur une ville fortifiée dont on a tendance, trop aisément, à l’imaginer à l’unisson du minéral. Cette politique du végétal n’est pas que du ressort du pouvoir communal, sa fonctionnalité était loin d’une décoration ou d’un hygiénisme quand elle était détenue par l’autorité militaire. Enfin, la notion d’aménagement, dans un dernier chapitre, impose aussi de s’attarder sur les dangers de l’espace urbain dans un temps long d’affirmation de l’hygiénisme. Le résultat de ces politiques est l’enlèvement des boues et donc l’étude de l’évolution de son organisation. Il faut aussi relever les tentatives d’assainissement de la ville durant tous le XVIIIe siècle. Il ne faudrait pas non plus oublier l’examen comptable de l’éclairage public landrecien.
Il s’agit donc d’un plan aux parties thématiques, mais borné par des chapitres plus restreints spatialement et chronologiquement. Il s’agit d’une forme particulière de développement qui regroupe, à dessein et de par les sources, une diversité de thématiques à étudier, mais le cadre architectural et réglementaire de la ville est tout de même le corps central du plan.
2: Landrecies intra-muros au XIXe siècle, voir ADN, S412-413 : plan d’alignement de Landrecies (1825) (cliché Charles Giot).
1 Victor Hugo, « Moi, l’amour, la femme » dans Oeuvres complètes : océan, Paris, Bouquins éditions, 2002.
2 C’est le constat historiographique que fait Sandrine Vistel, voir Sandrine Vistel (dir.), La demi-lune du Gaillardin et les vestiges de l’enceinte du XVIe siècle du front oriental, Rapport de diagnostic de l’INRAP, Glisy, INRAP Hauts-de-France, 2022, p. 34.
3 L’ouvrage de Paulin Giloteaux débute en ces termes : «Aux Landreciens et Landreciennes, en souvenir du glorieux passé de leur antique cité, admiratif hommage » , voir, Paulin Giloteaux, Histoire de Landrecies : Des origines à nos jours, Le Quesnoy, Oeuvres Charitables, 1962, p. 7.
4 Paul Vidal de La Blache, Tableau de la géographie de la France, Paris, Table Ronde, 2000, p. 71.
5 Sandrine Vistel (dir.), op. cit. , p. 34.
6 Pierre-Antoine Cristante, « La halte nautique de Landrecies, nouvel endroit pour flâner. », La voix du Nord, 1er juillet 2023.
7 Il existait, sur la rive gauche de la Sambre, aux Etoquies, une forteresse vers la fin du XIe siècle, voir Sandrine Vistel (dir.), op. cit. , p. 34.
8 Paulin Giloteaux, op. cit. , p. 32.
9 Sandrine Vistel (dir.), op. cit. , p. 35.
10 Sandrine Vistel (dir.), op. cit. , p. 37.
11 À l’image de la caserne Biron en 1740, voir Paulin Giloteaux, op. cit. , p. 90.
12 Sur 314 édifices, 198 sont entièrement détruits, voir ADN, 2O 331/67 : rapport sur la situation des travaux civils à Landrecies (an VIII).
13 Il faut attendre 1795 pour que l’État instaure un programme organisé pour une reconstruction subventionnée, celle-ci durera une dizaine d’années, voir ADN, 2O 331/67 : rapport sur l’état des travaux de la reconstruction de Landrecies (An VIII).
14 C’est le cas du rapport de Roger Ducos sur la reconstruction de Landrecies. Il a été étudié lors de mon mémoire de licence qui portait sur les sièges de Landrecies en 1794, voir Maurice Dussarp , Roger Ducos et sa mission à Landrecies en l'an III, premier germinal-10 fructidor an III : La réparation des dommages de guerre en 1795 d'après le registre de correspondance de Roger Ducos, Paris, Largentière, 1920.
15 Paulin Giloteaux, op. cit. , p. 170.
16 Jean-Louis Harouel, L’embellissement des villes : L’urbanisme français au XVIIIe siècle, Paris, Picard Editeur, 1993.
17 Michèle Lambert-Bresson et Annie Térade, Villes françaises au XIXe siècle;aménagement, extension et embellissement Paris, Cahiers de l’Ipraus, 2002.
18 Jean-Louis Harouel,