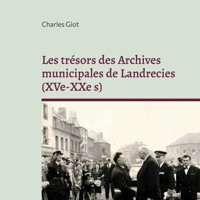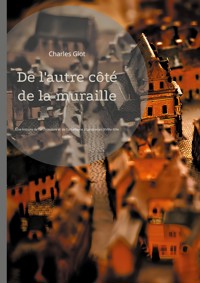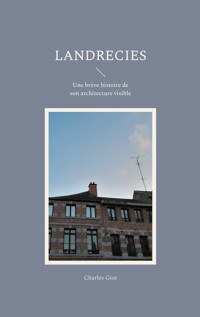Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Autrefois, la waide, ou pastel, était au cœur de la richesse de la Picardie et du sud-ouest de la France, offrant un bleu profond qui embellissait les étoffes recherchées à travers toute l’Europe. Cette plante, au centre d’un commerce florissant, reliait les champs français aux ateliers anglais, avant d’être supplantée par l’indigo importé d’ailleurs. La waide : l’or bleu oublié de la France retrace l’histoire fascinante de cette plante qui, après des siècles de gloire, a connu un déclin inexorable, avant de connaître une renaissance timide grâce à la passion de quelques artisans. Un voyage à travers l’histoire, de la splendeur médiévale à son renouveau discret, porté par ceux qui croient en la beauté et l’héritage de ce patrimoine oublié.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Diplômé d’un master recherche en histoire de l’architecture et de l’urbanisme, Charles Giot a toujours été guidé par sa passion pour la littérature historique. Au cours de ses études, il a eu l’opportunité de plonger dans l’histoire fascinante de l’Isatis tinctoria, aboutissant à un état de l’art sur cette plante oubliée. Cet ouvrage naît de la volonté de valoriser son rôle méconnu dans le patrimoine français et de partager le fruit de ses recherches avec un large public.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Giot
La waide :
l’or bleu oublié de la France
Roman
© Lys Bleu Éditions – Charles Giot
ISBN : 979-10-422-7457-3
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Remerciements
Je tiens à remercier chaleureusement Patrick Martin, professeur à l’IUT de Béthune et directeur de l’UTA, pour son soutien indéfectible tout au long de mon travail et l’appui constant de son laboratoire dans la valorisation de l’histoire de la waide.
J’adresse aussi mes remerciements aux professeurs d’histoire, membres du CREHS, m’ayant aidé et accompagné au fil de mon stage et de l’élaboration de mon état de l’art sur l’histoire de la waide en 2024.
Introduction
Guède, pastel, vouède1, ou encore waide sont des vocables régionaux qui ne définissent qu’une seule et même plante nommée universellement Isatis tinctoria. Une plante qui semble peu connue du profane, et dont ses propriétés tinctoriales, teignant en bleu les tissus, nous apparaissent bien lointaines. Et pourtant, quelques témoignages matériels semblent démontrer la place prédominante de l’Isatis tinctoria dans les sociétés européennes jusqu’au XVIIe siècle. Sa culture mouvante au fil des siècles et la richesse obtenue par sa production ont forgé une mémoire locale bien enracinée dans l’Amiénois2 et le Toulousain3. Cette mémoire renvoie à une historiographie particulière tant elle est fragmentée par les translations géographiques de la culture de l’Isatis tinctoria au fil des siècles4. Malgré quelques ouvrages généraux5 qui évoquent la plante dans le cadre d’une thématique étudiée beaucoup plus large, il n’existe pas de synthèse globale sur sa culture et son commerce durant le temps long. De ce constat, il apparaît nécessaire d’exposer au cours de cette courte synthèse les tenants et les aboutissants historiques de l’Isatis tinctoria en France et ailleurs du XIIeau XXIe siècle.
Une culture spatio-temporelle en France et ailleurs
L’hégémonie de la culture picarde et quelques pôles subalternes (XIIe-XIVe s)
Les premiers témoignages de la culture de l’Isatis tinctoria en Gaule remontent au Ve siècle6. Mais c’est en Picardie que l’on retrouve les traces les plus importantes de la waide à partir de 11057. Cette culture semble s’être progressivement développée pour inonder toute la région entre le XIIe et le XIVe siècle. La Picardie se caractérise pour avoir réuni à grande échelle un système efficient d’exportation de la production issue de l’exploitation de cette plante tinctoriale. Deux villes s’affirment par leur prééminence dans l’organisation de ce grand commerce européen en Picardie.
Tout d’abord, la plus connue reste Amiens. Proche des cultures, la ville, notamment dans le quartier Saint-Martin, est à l’époque médiévale un centre où l’on réduisait en poudre la récolte des feuilles de la waide. La fiscalité pesant sur le commerce de la waide rapporte beaucoup à la ville. La cathédrale d’Amiens est l’un des résultats concrets de la richesse procurée par ses impositions. Enfin, la ville était aussi un port d’attache sur la Somme, et plus loin vers la mer, in fine l’Angleterre. Jalonné de péages8 et bordé de cultures, le fleuve était imprégné de ce commerce qui a bouleversé l’agriculture de la région9.
Saint-Quentin, deuxième ville d’influence, participe également à la centralisation du commerce de la waide en Picardie. Là aussi, la plante semble être la base de la fiscalité de la ville. Pourtant, Saint-Quentin se singularise par l’absence d’une activité de transformation de la waide10. En effet, la ville peut être identifiée comme une plaque tournante du commerce de la waide entre l’Europe du Nord11, la France de l’Est et le bassin parisien. La ville, membre de la Hanse des XVII villes, organisait aussi deux foires annuelles qui ont fait sa richesse par le commerce de la waide.
Néanmoins, durant ce même temps, malgré la polarisation commerciale autour d’Amiens et de Saint-Quentin, d’autres espaces cultivés se développent. Tout d’abord, c’est dans la Flandre wallonne que s’opère une première translation géographique12. En effet, du XIIIe au XIVe siècle, la culture de la guède progresse entre Lille et le sud de l’Artois13. Elle fait notamment sa place sur les terres de Thierry D’Hireçon dans l’Artois14. L’Isatis tinctoria fait aussi sa place en Normandie, on y retrouve des traces de sa culture à partir du XIIIe siècle15. Elle semblait être cultivée davantage sur le littoral que dans l’intérieur des terres16. On ne sait malheureusement que peu de choses à ce sujet. Mais hors de France, dans le Namurois par exemple, la guède est aussi présente à la fin du XIIIe siècle17. La production était exportée vers Liège et Maastricht.
Entre le XIVe et le XVe siècle, on observe la disparition progressive de la culture l’Isatis tinctoria dans le nord de la France18. Malgré le discours général énonçant la guerre de Cent Ans comme une cause principale du déclin de la culture, l’explication paraît plus complexe. En effet, les facteurs sont multiples : certes le conflit entre les deux grandes royautés européennes a eu une influence non négligeable, mais l’incendie d’Amiens en 1358 ou l’affirmation de la culture de la waide19 en Rhénanie ont certainement déstabilisé eux aussi le commerce picard de la waide20.
Une translation géographique de grande importance : vers l’hégémonie du pastel toulousain (XIIIe-XIVe s)
Un autre facteur bien connu du déclin commercial de la Picardie est le déplacement progressif de la culture de la plante vers la région méditerranéenne de la France. Pour Gilles Caster21le pastel est introduit dans cette zone au XVe siècle. Mais dès le XIIIe siècle, c’est-à-dire à la période de l’apogée de la culture picarde22, on retrouve des traces méridionales de la culture de la guède23. Judicaël Petrowiste estime que la plante était présente dès 1250 dans l’Albigeois, et en 1268 dans le Lauragais, même si elle l’est de manière isolée24. Il faut attendre la fin du XIIIe siècle pour assister à une augmentation significative de la production. Elle se traduit par la multiplication des tarifs et des impositions. À Montpellier, la guède est taxée dès 129625.
Les sources pour décrire les débouchés de la production de la guède sont faibles26. Pour autant, on sait avec une quasi-certitude qu’à cette période c’est vers le sud que se dirigeait la production. Carcassonne et la péninsule ibérique (par les Pyrénées) apparaissent comme des voies commerciales de première importance27. En effet, l’économie du futur « Pays de cocagne »28 était orientée par les besoins des draperies catalanes et languedociennes. Mais les routes catalanes se sont vite retrouvées coupées, Philippe le Bel ayant interdit l’exportation de la guède en 1305. Destinée à protéger la draperie languedocienne de la concurrence étrangère, la mesure prise par le roi de France est venue restructurer l’ensemble de la région. À partir de 1335, on assiste à un essor rapide de la culture de la guède. Preuve en est, l’Abbaye de Gimont est allée jusqu’à reconvertir ses champs de blés en champs de guède29. Aussi, ce sont les centres d’échanges qui ont été bouleversés. Albi devient promptement un centre de négoce, la connexion des centres de négoce avec les campagnes semble d’ailleurs assez étroite dans ce commerce.
Mais cette production décuplée doit trouver des débouchés, c’est à ce moment que les routes internationales de la guède vont être bouleversées.
La polarisation et l’accaparement de la culture dans le Languedoc et l’Albigeois (XIVe-XVIe s)
L’histoire de l’apogée du pastel toulousain est assez travaillée, et Gilles Caster en a dressé une temporalité qui n’a pas été remaniée par la suite : de 1450 à 156130. La richesse des travaux sur le sujet étant immense, on ne peut tout dire31. Il est plutôt nécessaire d’orienter sur quelques pistes un peu moins développées par l’historiographie, et qui peut être définie, dans sa majorité, comme valorisant la richesse du patrimoine matériel issu de cette période32.
Au-delà du développement économique de Toulouse et de l’organisation socio-économique de la ville33, ce sont les routes commerciales que l’on peut interroger. La connexion avec Bordeaux semble assez particulière. En effet, malgré la guerre de Cent Ans et les troubles en Guyenne, la Garonne, autrefois une route secondaire, est passée au premier plan pour l’exportation du commerce du pastel en France à cette période. Cette nouvelle importance vient de l’affaiblissement progressif des cultures picardes, auquel il faut associer le fait que la Guyenne fut un temps anglaise, ce qui facilita les échanges commerciaux avec cette région34. Face à la fermeture des routes catalanes, la Garonne devient un débouché idéal pour la production du Lauragais et de l’Albigeois. Il s’instaure alors un système de taxes et d’impositions similaire à celui mis en place sur la Somme35.
Toutefois, ces lourdes contraintes fiscales ont un temps mis à mal le commerce vers l’Angleterre. On peut dire que, de 1379 à 1430, le pastel fut majoritairement transporté par voie fluviale36. Mais parallèlement, les marchands toulousains ont essayé de substituer Bayonne à Bordeaux pour le commerce des draps. Bayonne était un bon débouché vers l’Angleterre, car il évitait les péages sur la Garonne. Mais la route terrestre, tout aussi coûteuse, fut rapidement abandonnée au profit d’un retour presque exclusif à la voie fluviale au milieu du XVe siècle37.
La dépendance à la culture française toulousaine et la création d’une politique de souveraineté de la culture du pastel en Angleterre (XVIe-XVIIe s)
Il apparaît clairement, à travers l’exploration des routes commerciales, que le débouché principal des marchands de pastel toulousain était l’Angleterre38 : un marché plus lointain à la fin de la guerre de Cent Ans, mais qui n’empêche pas la ville et les campagnes alentour d’écouler leur production. Pourtant, les Guerres de religion en France sont venues déstabiliser assez fortement la zone méridionale. Vers 1579, l’impact des troubles sur la production montre à l’Angleterre sa dépendance au pastel toulousain39.
Cette dépendance joue dans les deux sens, la culture de l’Isatis Tinctoria en Toulousain déclinant lentement au profit de la seule culture céréalière.
Ainsi, durant tout le XVIe siècle, le gouvernement anglais a martelé la nécessité du développement de la culture du pastel sur son sol. Dès 1582 on signale la culture du pastel en abondance dans le Hampshire, mais celle-ci peine à se développer sur le nord du territoire. Trop désorganisé par les Guerres de religion, le commerce avec la France s’est parfois même interrompu, l’Angleterre n’a eu d’autre choix que de soutenir plus énergétiquement la culture sur son sol. Après quatre siècles de dépendance40, le royaume a assuré ses propres besoins à partir 1650. L’implantation de la culture fut donc complexe et longue, et les réticences paysannes sûrement nombreuses41.
Alors qu’à partir du XVIe siècle la France, autrefois pays aux cultures diversifiées, se tourne un temps vers la monoculture céréalière sur cette frange méridionale, l’Angleterre fait un chemin inverse tout aussi singulier42.
Les tentatives de réimplantation du pastel sous le 1er Empire