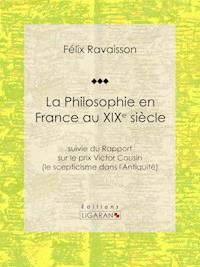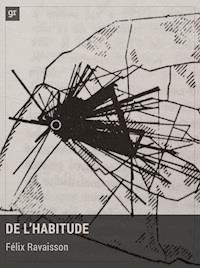
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: gravitons
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Réflexion sur les lois de l'habitude.
De son génie abstrait du XIXe siècle, Félix Ravaisson nous balise les distances entre permanence et changement à travers les lois de l'habitude. Il tisse la manière d'être à ses contraintes métaphysiques, dans un dessin allant du simple composé à la nature des êtres animés. Il publia en 1837, après l'obtention d'un prix pour son mémoire à l'Académie des sciences morales et politiques, un "Essai sur la 'Métaphysique' d'Aristote", un an avant sa thèse sur l'habitude.
Cet essai de métaphysique vous fera découvrir les idées de Félix Ravaisson.
EXTRAIT
C'est dans le courant non interrompu de la spontanéité involontaire, coulant sans bruit au fond de l'âme, que la volonté arrête des limites et détermine des formes.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Namur, 23 octobre 1813 – Paris, 18 mai 1900
Jean Gaspard Félix Ravaisson-Mollien était un philosophe et archéologue français, élève de Schelling et maître de Bergson. Il a été conservateur du département des antiquités au musée du Louvre, président du jury de l’agrégation de philosophie et inspecteur général des bibliothèques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De l'habitude
Félix Ravaisson
2e édition ISBN 979-10-95667-02-5 Copyright © gravitons 2015 Tous droits réservés
Paru en 1838, De l'habitude fait suite à la thèse de doctorat de Félix Ravaisson. L'ouvrage connut un vif succès, suscitant l'admiration de Martin Heidegger et influençant la pensée d'Henri Bergson. La présente édition est basée sur l'édition originale Félix Ravaisson, De l'habitude, Paris : Imprimerie de H. Fournier et Cie, 1838.
De L'habitude
Ωσπερ γἀρ φὐσις ἤδη τὁ ἔθος.
Aristote, De mem.
I
L’habitude, dans le sens le plus étendu, est la manière d’être générale et permanente, l’état d’une existence considérée, soit dans l’ensemble de ses éléments, soit dans la succession de ses époques.
L'habitude acquise est celle qui est la conséquence d'un changement.
Mais ce qu'on entend spécialement par l'habitude, et ce qui fait le sujet de ce travail, ce n'est pas seulement l'habitude acquise, mais l'habitude contractée, par suite d'un changement, à l'égard de ce changement même qui lui a donné naissance.
Or, si l'habitude, une fois acquise, est une manière d'être générale, permanente, et si le changement est passager, l'habitude subsiste au-delà du changement dont elle est le résultat. En outre, si elle ne se rapporte, en tant qu'elle est une habitude, et par son essence même, qu'au changement qui l'a engendrée, l'habitude subsiste pour un changement qui n'est plus et qui n'est pas encore, pour un changement possible ; c'est là le signe même auquel elle doit être reconnue. Ce n'est donc pas seulement un état, mais une disposition, une vertu.
Enfin, à l'exception du changement qui fait passer l'être du néant à l'existence, ou de l'existence au néant, tout changement s'accomplit dans un temps ; or, ce qui engendre dans l'être une habitude, ce n'est pas le changement, en tant qu'il modifie l'être seulement, mais en tant qu'il s'accomplit dans le temps. L'habitude est donc une disposition, à l'égard d'un changement, engendrée dans un être par la continuité ou la répétition de ce même changement.
Rien n’est donc susceptible d’habitude que ce qui est susceptible de changement ; mais tout ce qui est susceptible de changement n’est pas par cela seul susceptible d’habitude. Le corps change de lieu ; mais on a beau lancer un corps cent fois de suite dans la même direction, avec la même vitesse, il n’en contracte pas pour cela une habitude ; il reste toujours le même qu’il était à l’égard de ce mouvement après qu’on le lui a imprimé cent fois1. L’habitude n’implique pas seulement la mutabilité ; elle n’implique pas seulement la mutabilité en quelque chose qui dure sans changer ; elle suppose un changement dans la disposition, dans la puissance, dans la vertu intérieure de ce en quoi le changement se passe, et qui ne change point.
I. La loi universelle, le caractère fondamental de l’être, est la tendance à persister dans sa manière d’être.
Les conditions sous lesquelles l’être nous apparaît sur la scène du monde sont l’espace et le temps.
L’espace est la condition et la forme la plus apparente et la plus élémentaire de la stabilité, ou de la permanence ; le temps, la condition universelle du changement. Le changement le plus simple, comme le plus général, est aussi celui qui est relatif à l’espace même, ou le mouvement.
La forme la plus élémentaire de l’existence est donc l’étendue mobile ; c’est ce qui constitue le caractère général du corps.
Si tout être tend à persister dans son être, toute étendue mobile, tout mobile (car il n’y a de mobile que ce qui est étendu) persiste dans son mouvement ; il y persiste avec une énergie précisément égale à la quantité de ce mouvement même ; cette tendance à persévérer dans le mouvement est l’inertie2.
Dès le premier degré de l’existence se trouvent donc réunis : la permanence, le changement et, dans le changement même, la tendance à la permanence.
Mais l’inertie n’est pas une puissance déterminée, susceptible d’être convertie en une disposition constante. C’est une puissance indéfiniment variable comme le mouvement même, et indéfiniment répandue dans l’infinité de la matière. Pour constituer une existence réelle, où l’habitude puisse prendre racine, il faut une unité réelle ; il faut donc quelque chose qui, dans cette infinité de la matière, constitue, sous une forme ou sous une autre, l’unité, l’identité. Tels sont les principes qui déterminent, sous des formes de plus en plus compliquées et de plus en plus particulières, la synthèse des éléments, depuis l’union extérieure dans l’espace jusqu’aux combinaisons les plus intimes, depuis la synthèse mécanique de la pesanteur et de l’attraction moléculaire jusqu’à la synthèse la plus profonde des affinités chimiques.
Mais, dans toute l’étendue de ce premier règne de la nature, ou les éléments qui s’unissent ne changent, en s’unissant, que de rapports entre eux ; ou ils s’annulent réciproquement, en se faisant équilibre ; ou ils se transforment en une résultante commune, différente des éléments. Le premier de ces trois degrés est l’union mécanique, le second, l’union physique (par exemple des deux électricités), le troisième, l’union, la combinaison chimique.
Dans les trois cas, nous ne voyons pas de changement qui s’accomplisse dans un temps mesurable. Entre ce qui pouvait être et ce qui est, nous ne voyons pas de milieu, aucun intervalle ; c’est un passage immédiat de la puissance à l’acte, et, hors de l’acte, il ne demeure pas de puissance qui en soit distinguée et qui y survive. Il n’y a donc point là de changement durable qui puisse donner naissance à l’habitude, et de puissance permanente où elle trouve à s’établir.
En outre, le résultat et le signe de la réalisation immédiate de leurs puissances en un acte commun, c’est que toutes les différences des parties constituantes disparaissent dans l’uniformité du tout ; mécanique, physique ou chimique, la synthèse est parfaitement homogène.
Or, quelle qu’ait été la diversité originelle de ses éléments constitutifs, un tout homogène est toujours indéfiniment divisible en parties intégrantes semblables entre elles et semblables au tout. Si loin que pénètre la division, elle ne trouve pas l’indivisible. La chimie cherche vainement l’atome, qui recule à l’infini. L’homogénéité exclut donc l’individualité ; elle exclut l’unité véritable, et par conséquent le véritable être. Dans un tout homogène il y a de l’être, sans doute, mais il n’y a pas un être.
En toute synthèse homogène, il n’y a qu’une existence indéfiniment divisible et multiple, sous l’empire de forces diffuses, où le fait semble se confondre avec la loi, et la loi avec la cause dans l’uniformité d’une nécessité générale. Il n’y a point là de substance déterminée et d’énergie individuelle où la puissance réside, et où puisse s’établir et se conserver une habitude.
L'habitude n'est donc pas possible dans cet empire de l'immédiation et de l'homogénéité qui forme le règne Inorganique.
II. Dès que le changement qui opère la synthèse dans la nature n’est plus une réunion ou une combinaison immédiate, dès qu’il y a un temps mesurable entre la fin et le principe, la synthèse n’est plus homogène. Comme il faut, pour y arriver, une suite d’intermédiaires dans le temps, de même il faut dans l’espace un ensemble de moyens, il faut des instruments, des organes. Cette unité hétérogène dans l’espace, c’est l’organisation. Cette unité successive dans le temps, c’est la vie ; or, avec la succession et l’hétérogénéité, l’individualité commence. Un tout hétérogène ne se divise plus en parties semblables entre elles et semblables au tout. Ce n’est plus seulement de l’être, c’est un être.
C’est donc, à ce qu’il semble, un seul et même sujet, une substance déterminée qui développe, sous des formes et à des époques diverses, sa puissance intérieure. Ici paraissent réunies à la fois, du même coup, toutes les conditions de l’habitude.
Avec la vie, commence l’individualité. Le caractère général de la vie, c’est donc qu’au milieu du monde elle forme un monde à part, un et indivisible. Les choses inorganisées, les corps, sont livrées sans réserve et immédiatement soumises aux influences du dehors, qui font leur existence même. Ce sont des existences tout extérieures, assujetties aux lois générales d’une nécessité commune. Au contraire, tout être vivant a sa destinée propre, son essence particulière, sa nature constante au milieu du changement. Sans doute, tout ce qui change est dans la nature, comme tout ce qui est, est dans l’être. Mais seul, l’être vivant est une nature distincte, comme seul il est un être. C’est donc dans le principe de la vie que consiste proprement la nature comme l’être.
Le règne inorganique peut donc être considéré, en ce sens, comme l’empire du destin ; le règne organique, comme l’empire de la nature.
Ainsi l’habitude ne peut commencer que là où commence la nature elle-même.