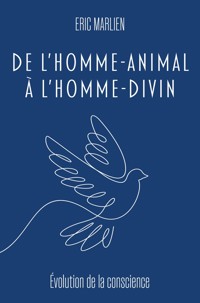
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Dans cet ouvrage, Éric Marlien, ostéopathe et observateur attentif des souffrances humaines, nous invite à une exploration profonde des expériences de l’âme qui caractérisent notre existence. Au-delà de son riche parcours et de son expérience personnelle, l’auteur puise parmi les innombrables documents qu’il a étudié et se livre à un examen minutieux des douleurs, névroses, émotions débordantes et états d’âme qui touchent chacun d’entre nous.
Ce livre audacieux propose un triple portrait de l’être humain en détaillant ses trois dimensions essentielles. Ainsi, nous découvrons l’homme-animal, incarné dans un corps de chair et animé par des instincts hérités de l’évolution des espèces. Puis nous rencontrons l’homme-personnalité, avec son caractère, son tempérament et sa psyché qui façonnent sa personne unique. Enfin, nous sommes invités à explorer l’homme-spirituel, cet aspect immatériel de notre être, source de vie et de conscience, qui transcende notre pure matérialité et qui donne un sens à notre existence terrestre.
Au fil des pages, en puisant dans l’histoire, les sciences humaines, les philosophies, les religions et les grandes pensées anciennes et modernes, l’auteur déploie une analyse approfondie de chaque aspect de l’humain, révélant les liens étroits entre nos composantes neurologiques, psychologiques et spirituelles. En s’appuyant sur des idées scientifiques et des concepts libres de toute contrainte, une perspective à la fois simple et ancrée dans les problématiques contemporaines et une réflexion inspirante sur notre nature humaine nous sont offertes. L’auteur nous encourage à dépasser les limites qui nous entravent et à embrasser la joie inhérente à notre existence, en traversant courageusement les paires d’opposés que sont le bonheur et le malheur, en proposant de surcroît certaines méditations inédites.
Préparez-vous à un voyage captivant au cœur des mystères et des potentialités de l’espèce humaine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Éric Marlien
De l’homme-animal à l’homme-divin
Évolution de la conscience
Du même auteur
• Le système nerveux autonome : de la théorie polyvagale au développement psychosomatique. Applications thérapeutiques et ostéopathiques, éditions Sully,2018.
• La gestion du stress, éditions Désiris,2010.
Quiconque connaîtra l’homme verra que c’est un ouvrage de grand dessein, qui ne pouvait être conçu ni exécuté que par une profonde sagesse.
–Jacques-Bénigne Bossuet
Préface
« C’est toujours un nouveau bienfait, qu’un livre nouveau », disait LéonBloy.
Voici donc un nouveau bienfait.
Nouveau par le ton, nouveau par l’esprit. Toutefois, comme le souligne lui-même Éric, ce n’est pas à une nouvelle anthropologie que nous avons à faire ici, mais à une manière plus claire, plus nette, et surtout plus ouverte, d’articuler nos connaissances sur l’homme.
« Articuler » devant être pris dans sa double acception, vocale et anatomique.
On connaît le « tout a été dit » de La Bruyère ; à quoi un philosophe d’humeur badine répondait : « mais comme personne n’écoutait, il faut le répéter ».
C’est la tâche à laquelle s’est attelé Éric : répéter, redire, dans le langage du XXIe siècle, ce qui a été dit sur l’homme depuis Platon et Zarathoustra.
Pour cela, Éric ne cesse d’interroger l’homme, et l’histoire de l’homme, afin de trouver — et de prouver — les lois de son évolution.
C’est là, on l’imagine bien, le fruit d’un labeur considérable, auquel notre auteur ne s’est probablement déterminé qu’en se sentant poussé par une nécessité intérieure.
Par ailleurs, je suis frappé du ton de modestie et de modération dans lequel est écrit ce livre, tandis qu’un souffle puissant en traverse les pages, et monte vers nous, pour nous inviter à l’optimisme.
Éric parvient en effet à nous faire partager la conviction qui est la sienne, que l’homme — l’homme vraiment humain — est une espèce en voie d’apparition.
À cette thèse, il apporte de solides arguments, qui pourraient aller jusqu’à toucher la population des inquiets et des sceptiques, laquelle constitue aujourd’hui dans l’humanité la majorité du genre.
Non, nous laisse-t-il entendre, une civilisation ne se mesure pas à la rapidité des voyages, ni au nombre de records battus dans la production des biens matériels ; mais, comme le Royaume, elle réside au dedans de nous, et se rattache à certaines forces présentes dans notreâme.
Ces forces, longtemps endormies, ne s’éveillent pas toutes seules : il y faut l’étroite alliance « des générations et de Dieu », comme disait Barrès : des siècles de perfectionnement sont nécessaires, poursuivis à travers maintes incarnations et tribulations, pour qu’un individu, à un moment de son histoire, se pare tout à coup des qualités de son âme. Une histoire nous est donc contée : celle de la façon dont les forces de la vie et de l’évolution s’y prennent pour faire passer l’homme d’une adolescence impure à une magnifique plénitude.
Il y a là un thème — au sens musical — qu’on n’entend plus guère dans le dur siècle qui est le nôtre.
Pour le réécouter, il nous faudrait aller demander à Bergson et à Teilhard de nous faire à nouveau entendre leurs voix. Mais trop d’années se sont écoulées depuis que les yeux de ces deux grands voyants se sont fermés.
Aussi, il n’est que temps de réorchestrer ce thème.
Une telle entreprise suppose de se relier à certaines Sources, intemporelles. C’est ce que fait Éric, en remettant au jour, et en nous rappelant l’efficacité des vertus qui se cultivaient jadis dans l’ombre des sanctuaires.
La large culture de l’auteur le met à la hauteur de cette tâche.
Cette culture est un confluent : familier avec ce que les sciences naturelles nous apprennent du corps humain, Éric nous apparaît aussi comme ce navigateur qui a beaucoup navigué sur le fleuve des sciences spirituelles, lesquelles, de leur côté, ont tout à nous apprendre sur l’âme humaine.
Mais cette belle érudition ne nous serait pas si précieuse si elle n’était mise, comme on pourra le constater, au service d’une Vision.
Vers cette Vision, Eric s’avance, et nous emmène, avec précision et fermeté, soucieux de ne rien énoncer qu’il ne puisse appuyer d’une référence ou d’un exemple.
C’est que, dans une époque où ce qui se publie dans les domaines de la spiritualité et de l’ésotérisme apparaît souvent superficiel et hâtif, Éric sait combien l’acte d’écrire est sérieux et grave, lourd de conséquences, et qu’il engage infiniment plus que nous-même.
D’où cette exigence de concentration que suppose de la part du lecteur l’étude de son livre.
Le lecteur ! Éric ne lui concède rien. Il n’est pas tourné vers lui, ne cherche pas à le séduire, mais, tout entier concentré sur le sujet qui l’occupe, il déroule sa démonstration.
En quoi consiste-t-elle ? À pointer, dans les passions humaines les plus basses, le signe d’une Présence, la promesse d’une métamorphose.
Et tout son art consiste à rendre perceptible cette Présence, probable cette métamorphose.
Le récit d’Éric — car, encore une fois, ce livre se lit comme un récit — vient témoigner que le Royaume des âmes, dont le Christ a dit qu’il est au dedans de nous, est à la fois l’aboutissement, et le point d’un nouveau départ, pour cette quête ininterrompue que la partie la plus avancée de l’espèce humaine poursuit sur toutes les routes intérieures. Le propos est ferme, mais jamais fermé. D’une plume vigoureuse, Éric nous montre comment l’Adam de limon devient peu à peu l’Adam de lumière ; il déroule sous nos yeux le long-métrage de l’évolution créatrice. En suivant sa narration, il nous est possible de voir de quelle façon une humanité baignant tout d’abord au plus épais de l’animalité primitive se redresse ensuite pour s’acheminer inexorablement vers une spiritualité définitive.
Dans un temps où le pessimisme est la règle, et l’optimisme l’exception ; où « se plaindre » est devenu le plus pronominal de tous les verbes, ce livre arrive à l’heure dite pour faire entendre tout à la fois un chant d’espoir ainsi qu’une pressante invitation au détachement.
Une des conclusions possibles de ce bel ouvrage est peut-être celle-ci : que la nappe profonde qui alimente le génie humain n’est pas près de s’épuiser.
Donnez-vous la peine d’entrer dans ce récit, vous que passionnent les mystères de l’homme, ou qui êtes simplement curieux de ce qui est humain, vous ne le regretterezpas !
Jacques Sourmail
Avertissement
En cette période de crispation autour des questions raciales, d’identité, de transidentité, de féminisme, de néo-féminisme et de wokisme, en ces temps où certains s’autorisent à réécrire des passages d’œuvres classiques au nom de valeurs d’apparence libertaire qui cachent mal leur sectarisme et leurs tendances inquisitoriales, la question peut se poser de l’emploi de certains termes lorsque l’on aborde l’écriture d’un ouvrage.
Pour ma part, j’ai très vite répondu à cette question et assume pleinement l’emploi des substantifs qui désignent les objets principaux du présent essai. Ainsi, j’emploierai « homme » ou « être humain » indifféremment. « Homme » véhicule une vibration, un son, qui serait dilué et perdrait de sa force si je devais préciser à chaque fois « l’homme, ou la femme ». Le mot « homme » vient du latin humus, la terre. C’est précisément cette signification que je souhaite soutenir dans ce livre, en parlant de l’être humain incarné sur terre, un humus à partir duquel peut croître tout autre chose. Selon la légende, le premier être humain fut formé à partir de l’humus de la Terre. L’homme n’a d’autre choix que de marcher sur Terre. Sa bipédie le fait tenir vertical, entre ciel et terre, parce qu’il a également reçu une âme vivante.
Ici une compensation sera donnée aux irréductibles du genre : « âme » est un mot féminin. Il sonne comme « femme », tandis que « homme » résonne avec le OM, le mot sacré, le verbe créateur.
En évoquant le parcours de l’homme dans les pages qui suivent, la division des genres, pas plus que celle des races, n’auront la moindre place dans mon esprit. L’humanité estUne !
Note de l’auteur
Comme pour vous, peut-être, la question de la mort est venue très tôt me questionner douloureusement. Vers l’âge de sept ans, je connus des moments d’angoisse à l’idée que mes parents puissent disparaître. Simultanément, je me questionnai sur le sens de l’existence, dans une forme que de telles questions peuvent prendre dans l’esprit d’un enfant.
La religion n’occupait pas une place prépondérante dans ma famille, au sens d’une pratique régulière, mais n’était pas complètement absente non plus. Mes parents étaient en recherche spirituelle, laquelle ne se confinait pas à la seule religion catholique. Je ne suis jamais allé au catéchisme et n’ai reçu comme sacrement que le seul baptême, dont je ne garde bien sûr aucun souvenir. J’étais par ailleurs un enfant assez dissipé, ce qui conduisit mon père à me menacer plusieurs fois de m’envoyer au Tibet chez les moines où, paraît-il, je serais obligé de rester des heures sans bouger. Cette menace représentait la pire des punitions pour moi. Mais une chose m’importait plus que tout : voir Dieu, ou Jésus (je ne faisais alors pas trop la différence), ou bien qu’Il revienne sur Terre ou, encore mieux, qu’Il vienne me chercher car je trouvais l’existence plutôt ennuyeuse.
Progressivement, grâce aux discussions qui avaient cours chez moi, puis dès l’adolescence à travers mes lectures, je me fis une idée assez ouverte de la religion et de la spiritualité et cette dernière m’apparut comme l’élément essentiel, celui qui pouvait donner un sens à l’existence.
J’aurais pu embrasser une carrière de prêtre, ou de philosophe mais la première m’apparaissait comme trop contraignante, contraire à l’esprit de liberté qui m’animait, et la seconde comme trop sèchement intellectuelle.
Le mystère des impulsions profondes qui nous animent et qui président souvent à nos destinées m’a fait choisir un métier centré sur le corps, celui d’ostéopathe. Choix paradoxal car, passée la phase narcissique de l’adolescence et du tout jeune adulte, le corps ne fut jamais l’objet de mon attention première. Mais ce métier, et la carrière d’enseignant que j’ai très vite exercée en parallèle, m’ont obligé à nuancer mes tendances mystiques qui ne s’embarrassent jamais des faits et de la rationalité. Confronté à la vérité des corps qui souffrent d’une part, et à l’obligation d’une démarche expérimentale, logique et méthodique par les diverses fonctions que j’ai pu occuper d’autre part en tant que directeur des mémoires de fin d’études en ostéopathie et responsable de la recherche pendant de nombreuses années, j’ai ainsi pu me nourrir de nombreuses connaissances scientifiques et me forger un mental plus rationnel. C’est ainsi armé que j’ai, de façon parallèle, continué ma quête spirituelle, à la lumière de l’esprit des philosophes et des traditions spirituelles et religieuses qui ont ensemencé la conscience de l’humanité à travers les siècles.
Ce parcours m’a forgé une spiritualité vivante, incarnée et, chose la plus précieuse, libératrice. Il m’a permis de construire une spiritualité qui est en mesure de nous libérer de multiples conditionnements. Ceux de notre propre histoire personnelle premièrement, conditionnements familiaux, souffrances et traumatismes que nous avons pu connaître dès l’enfance. Ensuite, ceux qui proviennent de notre socioculture qui circonscrivent, au moyen de murs, ce que nous nous autorisons à faire et surtout à être. Murs de la culpabilité, murs du politiquement correct, murs des opinions dominantes et murs du consumérisme sur lesquels sont affichées les possessions censées nous rendre heureux.
Deux raisons principales m’ont poussé à écrire ce livre.
La première a trait au domaine qui couvre spiritualité, ésotérisme et les autres branches qui attirent les personnes en recherche d’autres dimensions que celles qu’apportent les valeurs à court terme de l’existence : argent, possessions, satisfaction des sens, excitations émotionnelles de toutes sortes… Un écueil majeur les guette, celui de la spiritualité refuge se déclinant en systèmes et pratiques qui alimentent de nombreux fantasmes.
Il existe en l’être humain des besoins et des peurs primaires, qui seront décrits dans la première partie de ce livre, sources d’insécurité, d’inhibitions et même de failles narcissiques qui nous conditionnent fortement et dont nous aimerions tous être libérés. Lorsqu’ils ne sont pas identifiés pour ce qu’ils sont, puis assumés et traversés lucidement, ils sont refoulés et peuvent nous conduire dans des voies apparemment salvatrices qui vont nous donner l’illusion de les avoir dépassés. Gare au retour du refoulé comme Freud nous en avait mis en garde ! La spiritualité et les approches connexes sont des candidats de choix pour aspirer ceux qui ne peuvent ou ne savent voir leur réalité en face. Et lorsque la démarche spirituelle se construit sur de tels sables mouvants, elle a toute les chances de s’enliser. À terme, la déception éprouvée est telle qu’elle conduit à la détestation de soi-même qui prend la forme d’une dépression existentielle profonde. Pour ceux qui ne savent s’exécrer eux-mêmes, c’est le monde qui devient alors l’objet de leur détestation.
J’entends montrer à travers cet ouvrage le fil conducteur qui tisse et relie les différentes parties de l’être humain, depuis ses besoins primaires jusqu’à ses dimensions les plus transcendantes, en passant par ses caractéristiques psychologiques.
La seconde raison est le fruit de ma pratique en tant que thérapeute du corps, à laquelle s’ajoute mon expérience de la dimension psychologique. Outre les études que j’ai suivies dans ce domaine, je côtoie et forme de nombreux psychothérapeutes avec lesquels j’ai d’abondants et fructueux échanges. Après plus de trente-cinq ans de confrontation avec la maladie et la souffrance, aussi bien physiques que morales, il m’apparaît avec une totale certitude que la guérison est le fruit d’une évolution. Évoluer signifie passer d’un état à un autre. Et en effet, lorsque nous souffrons c’est que nous sommes figés dans un état particulier ; guérir correspond alors à se mouvoir dans un état nouveau. Si mon métier d’ostéopathe implique que l’on requière le plus souvent mes services pour des souffrances corporelles, ce sont bien souvent les tourments de l’âme, causaux ou parallèles à ceux du corps, qui sont impliqués dans le fait de demeurer immobilisé dans l’état de souffrance. Il en va de même évidemment lorsque cette souffrance est purement morale. La vie m’a appris que l’état de figement est d’abord et avant tout lié à notre conscience. La conclusion s’impose alors : ce sont les changements dans la conscience qui constituent le facteur déterminant pour guérir. La guérison, au vrai sens du terme, est donc synonyme d’évolution de la conscience.
L’évolution de la conscience est précisément le cœur de cet ouvrage que j’ai souhaité partager avecvous.
Introduction
Si je regarde dans le rétroviseur de ma propre existence et y ajoute la somme des souffrances morales de mon entourage et celles des milliers de personnes que j’ai reçues en consultation, je pense avoir acquis une certaine expérience des peines, chagrins, deuils, mais aussi des névroses, émotions débordantes, peurs, anxiétés, jalousies, mesquineries et que sais-je encore qui constituent la palette de tous les états d’âme de l’être humain.
J’ai aussi assisté à de belles choses au sein de la communauté des hommes, nul besoin d’assombrir le tableau plus que nécessaire. Cependant je suis nourri de l’espoir que la famille humaine est potentiellement capable d’en réaliser mille fois plus et de créer un monde où il ferait bon vivre et exister ensemble, un monde dans lequel nature et culture cohabiteraient dans la plus grande harmonie.
Cette utopie, ou plutôt cette espérance, m’anime et je la crois possible. Mais je ne commettrai pas l’erreur grossière de lui donner un délai ou une borne dans le temps et peu m’importe que cela advienne dans cent ans ou dans dix mille ans ! Nos idéaux ne doivent pas créer une illusion d’optique, gardons en conscience que ce sont des télescopes qui voient très loin en avant. S’ils nous guident par leur vision du Beau ou du Bien à venir, les imaginer à portée de main ne peut conduire qu’à d’amères désillusions pouvant mener au cynisme ou à la misanthropie. Ce qui produirait l’exact opposé de l’idéal qui m’anime.
Il convient avant tout de distinguer les obstacles qui s’opposent à l’accomplissement de ce à quoi nous aspirons, individuellement et collectivement, puis de se concentrer sur ceux qui sont immédiatement compréhensibles et donc surmontables. Chaque âge, chaque cycle de l’existence comporte ses propres difficultés comme ses propres ressources pour évoluer et nous ne pouvons ni assumer ni gérer celles qui sont à venir encore loin devantnous.
Notre humanité actuelle, en moyenne et au niveau d’évolution psychobiologique et moral auquel elle est parvenue, rencontre un certain nombre de difficultés, de conflits, de peurs, en un mot d’obstacles, qui se retrouvent à des degrés divers dans les individus qui la composent. La quête éternelle du bonheur se trouve quasiment toujours, et tôt ou tard, entravée d’une manière ou d’une autre. Pour certains, les événements extérieurs peuvent ou semblent jouer le plus grand rôle – nous en discuterons – tandis que pour d’autres, autant dire une majorité dans nos pays modernes, les causes sont aisément identifiables au sein des dispositions inhérentes à notre nature.
Ce sont elles que cet ouvrage entend présenter, afin de mieux en discerner les racines et les ressorts, puis de tenter d’ouvrir quelques pistes pour apprendre à jouer avec, voire de comprendre comment la force motrice que ces dispositions apparemment préjudiciables contiennent peut se révéler être également l’énergie même pour nous en affranchir. Tel est le paradoxe : ce qui nous limite par nature peut, si l’on sait le comprendre puis le transformer, être ce qui nous fait grandir, évoluer et nous rendre plus libre. J’ai bien conscience que l’objectif est immense et me sens, au début de cette entreprise, quelque peu écrasé par l’ampleur du sujet. Les principales religions, comme de nombreuses philosophies, n’ont-elles pas déjà répondu chacune à leurs manières à ces questions cruciales ? Sans en sous-estimer l’apport extraordinaire, mon ambition n’est pas de me porter à ces hauteurs considérables, ce qui serait folie, mais plus simplement d’apporter un regard plus proche des problématiques que vivent de nombreuses personnes en cette époque moderne (le caractère moderne étant, du fait de l’écoulement temporel, toujours très éphémère). J’emprunterai à cette fin des idées, des découvertes et des concepts qui pour partie sont dits « scientifiques », et d’autres qui s’en absolvent en toute liberté. Fervent admirateur de l’esprit scientifique véritable, celui-là même qui ne s’enferme dans aucun dogme et qui sait que toute formulation du Réel est limitée et en évolution constante, mon admiration n’est pas moindre pour tous les grands esprits qui, au cours des siècles, ont contribué par leur génie à enrichir notre conscience de la grande Vie au sein de laquelle nous avons la nôtre.
J’ai pris le parti de ne pas citer avec précision toutes les sources dont je me suis inspiré comme il est d’usage dans un ouvrage ou une publication scientifiques. J’ai eu à travailler ainsi auparavant, mais estime ici que cela nuirait à la fluidité de l’exposé. De plus, ma conviction est que ce qui compte pour chacun d’entre nous, c’est ce que nous avons pu vraiment intégrer dans notre conscience au travers de notre apprentissage, et non pas d’être capable de réciter ou de citer les propos de tel ou tel auteur. Ce qui m’importe est une philosophie vivante et vécue, non pas d’être cultivé au sens où on l’entend couramment.
Le lecteur doit savoir que je ne revendique rien de véritablement personnel. Ma pensée actuelle s’est forgée au cours des dernières décennies à partir de lectures et d’études variées. Elle a été nourrie de la pensée de très nombreux personnages, scientifiques, spécialistes des sciences humaines, philosophes, religieux ou grands penseurs modernes et anciens. Je considère ma propre capacité à réfléchir comme minuscule par rapport à tous ces illustres inspirateurs.
Que le lecteur veuille bien considérer que tout ce qui d’aventure ne lui semble pas intéressant ou éloigné de la vérité est le fruit de ma propre réflexion. Et que ce qui lui semble enrichissant et digne d’intérêt émane de ces grands personnages. Il se peut qu’une minuscule fraction de ce qui va suivre puisse être considérée comme originale. Dans ce cas, il est possible que l’auteur ait bénéficié de quelques averses fécondes provenant du « nuage de pluie des choses connaissables », pour se référer à ce grand sage Indien que fut Patañjali, le père du Yoga indien. Cette infime inspiration peut aussi avoir puisé à l’inconscient collectif défini par Jung ou encore avoir transpiré de la noosphère, néologisme forgé par Vladimir Vernadsky et Pierre Teilhard de Chardin, et qui désigne la sphère de la pensée humaine. Une nappe pensante issue de toutes les productions mentales humaines qui croît au fur et à mesure de l’émergence et de l’intensification de la conscience.
Mon intention est de présenter au lecteur un triple portrait de l’être humain. Chacun de ses portraits esquisse une dimension spécifique possédant sa propre logique et, pourvu que l’analyse soit suffisamment élaborée, qui semble expliquer l’homme pleinement. Pour ma part, chaque portrait me semble incomplet s’il n’est pas mis en relation avec les deux autres et si les trois ne n’assemblent pas en un tout cohérent. Alors, autre chose se dessine, de bien plus vaste et de bien plus sensé. Quelque chose qui donne du cœur pour traverser l’existence et en accepter toutes les facettes, les joyeuses comme les douloureuses. Alors, la tragédie humaine n’est plus soit refoulée, soit acceptée servilement ; au contraire, nous pouvons en devenir les acteurs responsables et connaître la joie que nous avons en héritage, une joie qui se situe entre les paires d’opposés que sont le bonheur et le malheur, par nature éphémères.
Nous commencerons par observer l’homme-animal, poursuivrons notre étude par celle de l’homme-personnalité et finirons notre périple à travers ce qui semble être l’intention de l’évolution : l’avènement de l’homme-spirituel.
Nombreuses sont les religions et les spiritualités qui considèrent l’être humain comme un esprit incarné dans un corps de chair. Le grand philosophe que fut Henri Bergson écrivait : « La grande erreur des doctrines spiritualistes a été de croire qu’en isolant la vie spirituelle de tout le reste, en les suspendant dans l’espace aussi haut que possible au-dessus de la terre, elles les mettaient à l’abri de toute atteinte. […] Elles ont raison de croire à la réalité absolue de la personne et à son indépendance vis-à-vis de la matière ; – mais la science est là, qui montre la solidarité de la vie consciente et de l’activité cérébrale. Elles ont raison d’attribuer à l’homme une place privilégiée dans la nature, de tenir pour infinie la distance de l’animal à l’homme ; – mais l’histoire de la vie est là, qui nous fait assister à la genèse des espèces par voie de transformation graduelle et qui semble réintégrer l’homme dans l’animalité.1 » Ces propos nous introduisent tout droit au cœur du présent ouvrage, qui propose un essai sur la constitution de l’être humain ainsi que sur les métamorphoses qu’il subit par le jeu d’un courant évolutif qui emporte toute la vie, celle de l’univers comme celle de toutes ses parties.
La thèse ici développée montre que l’être humain se décline selon trois grands principes :
–son corps de chair, à la fois sensible et mis en mouvement par son système nerveux, fruit de l’évolution des espèces, qui lui donne son corps animal et ses instincts : c’est l’homme-animal.
–son caractère, son tempérament, la somme de ses défauts et de ses qualités, son psychisme qui détermine sa personne particulière : c’est l’homme-personnalité.
–enfin son esprit, son âme, la source de sa vie et de sa conscience, ce qui est irréductible en lui : c’est l’homme-spirituel.
Chacun de ces trois aspects est étudié en détail dans ce livre, qui peut ainsi se percevoir comme une étude anatomique, physiologique et pathologique de l’être humain, dans ses composantes neurologiques, psychologiques et spirituelles.
Ces trois principes dominent successivement la conscience de l’individu au cours d’un processus évolutif spontané et involontaire au début, mais que l’on peut accompagner et favoriser une fois prise toute la mesure de l’enjeu : l’actualisation de l’être humain dans toute sa plénitude. C’est précisément l’objet de ce livre que d’en décrire les étapes, les pièges et les difficultés, et de proposer des pistes pour en favoriser l’avènement.
Bergson nous offre encore une image éloquente sur laquelle nous pouvons nous appuyer : « Elles [les âmes] ne sont pas autre chose que les ruisselets entre lesquels se partage le grand fleuve de la vie, coulant à travers le corps de l’humanité. Le mouvement d’un courant est distinct de ce qu’il traverse, bien qu’il en adopte nécessairement les sinuosités. La conscience est distincte de l’organisme qu’elle anime, bien qu’elle en subisse certaines vicissitudes.2 »
Cette métaphore du fleuve nous permet d’entrevoir une compréhension de l’être humain particulièrement éclairante. L’eau du fleuve est son essence même, sa cause première, le flux de l’esprit, l’âme de l’homme qui donne la vie et le courant de la conscience. Le sol est la chair, la matière qui reçoit ce courant de vie. Le lit du fleuve, qui fut d’abord torrent puis rivière, est le produit de l’action de l’eau et de la résistance du sol, creusé et dessiné au cours des âges par ce phénomène d’érosion dont la forme, la profondeur, ses tours et ses détours dépendent essentiellement de la nature géologique du sol, de sa résistance, de sa solidité et de la solubilité des roches, de la proportion de matière meuble, de sa pente générale et des obstacles qu’il rencontre.
La géologie est l’équivalent de notre biologie, avec les contraintes inhérentes à notre corps et à notre cerveau issues de l’évolution animale.
Produit de l’union des deux, la personnalité humaine se construit et se déploie au fil de l’influence grandissante des eaux de l’esprit sur la terre qu’est le corps. Très imparfaite au début de son évolution, elle trouve la capacité d’agir et de modifier le cours de la rivière. Elle commence par gaspiller cette eau nourricière qu’elle ne peut contenir dans les débuts tant son lit est peu profond, puis va apprendre à en détourner le cours pour son unique profit personnel. Elle comprendra ensuite comment l’utiliser pour irriguer des cultures afin de se nourrir puis d’en faire profiter d’autres qu’elle-même, et saura même créer des retenues pour en intensifier la puissance afin de produire de l’énergie. Fort de cette énergie, l’homme-spirituel devient capable d’éclairer le monde…
Je souhaite faire part d’une dernière remarque avant d’entrer dans le vif du sujet. Si cet ouvrage se veut généraliste, du fait de mon parcours professionnel d’une part et en raison de mes activités d’enseignement qui m’ont amené à côtoyer des centaines de psychothérapeutes, une partie des idées que je vais partager possèdent une vocation pédagogique destinée à tous ceux qui ont en charge, d’une façon ou d’une autre, les difficultés morales et psychologiques de leurs prochains. J’estime également avoir une idée assez précise de la palette des plaintes d’ordre psychologique des individus de notre société actuelle d’une part, et des paradigmes principaux de l’approche psychothérapeutique moderne d’autre part. Cependant les idées présentées ici risquent de surprendre car elles sont parfois nettement à contre-courant des concepts qui ont la faveur des psychothérapeutes.
L’individu moderne est caractérisé par une aptitude de plus en plus grande à se plaindre et à accuser la vie, son histoire personnelle, son passé ou son futur, les gouvernements… tout élément pourvu qu’il soit situé à l’extérieur de lui-même. Une abondance de nouveaux produits, méthodes, promesses, thérapies naissent chaque année pour accueillir cette plainte et la remplacer par le bonheur, enfin, et sans le moindre effort !
L’être humain est plus enclin à se lamenter qu’à se corriger ! Le programme proposé dans cet ouvrage risque de ne pas être très vendeur puisqu’il s’appuie sur la vertu de l’effort, de l’amendement, de la discipline personnelle, en bref sur ce qui nous permet de croître et d’évoluer, de passer de l’enfance quémandeuse à l’adulte responsable.
Première partie Que reste-t-il de l’animal en l’homme ?
Il est dit que l’homme n’est rien de plus qu’un animal, trônant au sommet de l’arbre phylogénétique retraçant l’évolution des espèces. D’autres affirment sa nature divine, créé dès le commencement humain, sans commune mesure avec l’animal. Ces conceptions antinomiques ne s’opposent qu’en apparence et contiennent peut-être chacune une part de vérité, comme j’essaierai de l’exposer. Mais en attendant, la progression des découvertes scientifiques a montré, sans qu’il soit désormais impossible de s’y opposer, que notre corps de chair et notre système nerveux possèdent des caractéristiques communes avec le règne animal et procèdent d’un long cheminement évolutif des espèces.
Nous allons voir dans cette partie de quelle manière l’animalité continue à sous-tendre un bon nombre de nos comportements et de nos réactions.
1 . Bergson Henri, L’évolution créatrice, PUF, p. 268.
2 . Ibid., p. 270.
Remarques préliminaires
Un fait survenu six mois après l’achèvement de l’écriture de ce livre et peu avant qu’il soit publié m’amène à devoir insérer ici quelques précisions.
En préparant une formation s’appuyant sur la présente première partie et concernant les peurs et besoins fondamentaux, je me souvenais d’avoir entendu parler de la pyramide des besoins d’Abraham Maslow3. Je connaissais son nom, je savais qu’il avait modélisé une pyramide des besoins humains mais curieusement – au vu de toutes les lectures que j’avais faites au cours des trente dernières années dans le domaine de la psychologie – je ne m’étais jamais arrêté à étudier cet auteur. Durant l’écriture de ce livre, je l’avais seulement cité par respect, en l’identifiant comme l’un des pères de la psychologie humaniste, mais sans rien connaître de sa pensée. Mes études personnelles en matière de psychologie humaniste et transpersonnelle m’avaient amené à travailler essentiellement sur Carl G. Jung et Roberto Assagioli.
Un peu par hasard, j’allais donc voir de plus près cette pyramide des besoins reproduite ci-dessous et qui, je suppose, est bien connue de nombreux psychothérapeutes.
Quelle ne fût pas ma stupéfaction de constater que les trois besoins primaires que j’avais identifiés correspondaient exactement, et dans l’ordre, aux trois besoins psychologiques que décrit Maslow. À ceci près qu’il fait précéder ces besoins psychologiques par des besoins physiologiques vitaux pour notre organisme et les fait suivre, au sommet de sa pyramide, par un besoin plus élevé d’auto-réalisation et d’auto-accomplissement.
Pour ma part, j’ai négligé les besoins vitaux dans cette étude du fait de leur évidence et parce qu’ils ne représentent aucun intérêt au vu des objectifs qui sont les miens et que je souhaite porter à l’attention des lecteurs.
Quant au besoin d’un ordre supérieur, je ne le considère pas comme un besoin mais comme une donnée fondamentale, une impulsion vitale de l’âme humaine.
En faisant le constat que j’ai décrit les besoins humains fondamentaux de la même manière que Maslow, des sentiments mêlés m’habitent. En premier lieu, celui de satisfaction car cela valide et appuie les idées que j’ai formulées à la suite de mon parcours et de mes nombreuses réflexions ; mais aussi une gêne, un embarras, car cela me fait courir le risque d’être traité de plagiaire.
Mon but, en écrivant ces lignes, n’est pas de convaincre de mon innocence, chacun pourra se faire sa propre opinion, en particulier ceux qui ont étudié les travaux de Maslow, mais d’expliquer de quelle manière est construite la modélisation proposée ici et les éléments qui me différencient de la pensée de Maslow à qui je rends hommage au passage et auquel je ne saurai me comparer. Je suis également animé d’un souci de transparence et souhaite signaler que je ne suis pas le premier à avoir identifié ces besoins et à les classer de cette manière.
Voici les éléments fondamentaux qui ont été présents à mon esprit dans la conception que je propose.
Pour commencer, le principe nécessaire et incontournable pour moi était d’utiliser une structuration tripartite de l’être humain et de l’appliquer aux trois dimensions abordées dans ce livre : neurologique, psychologique et spirituelle. Cette tripartition se retrouve dans presque toutes les traditions spirituelles.
Ainsi, en commençant à réfléchir sur la question des besoins fondamentaux, je savais que je devrai nécessairement en retrouver trois. Le premier, le besoin de sécurité, m’était bien connu en tant qu’enseignant et praticien expérimenté de la théorie polyvagale qui sera rappelée plus loin. Le second, le besoin de plaisir et d’être aimé, faisait aussi partie des connaissances bien établies, y compris dans ses soubassements neurologiques. Le troisième, le besoin d’estime de soi et d’être capable, s’est vite imposé à mon esprit. Mon intérêt pour l’être humain, que ce soit via l’observation directe, l’étude des sciences humaines et même la littérature ou le cinéma, m’a vite mené sur cette piste et j’ai même découvert a posteriori que les voies neurologiques de cette troisième tendance primaire avaient déjà été identifiées.
Deux principes importants me différencient des concepts de Maslow.
En premier lieu, je pars du principe que tout besoin repose sur une peur et lui est intimement lié. La peur est une donnée majeure des êtres vivants animés, et elle atteint même une intensité encore plus forte chez l’être humain, du fait de notre conscience autoréflexive. Être conscient d’avoir peur élève l’intensité de celle-ci au carré et cela est bien pire que d’avoir peur et d’être simplement engagé dans une réponse comportementale instinctuelle. Si la peur première est celle de la mort, d’être détruit ou simplement de n’être plus, la peur peut se décliner sous d’autres aspects et avoir des conséquences aussi invalidantes. Pour certains par exemple, parler en public engendre une peur bien plus intense que s’ils devaient affronter une meute de chiens agressifs. C’est que leur principale peur concerne d’avantage un besoin d’être aimé ou estimé que celle de perdre la vie.
En second lieu, ma conception de l’être humain place notre partie spirituelle au centre et comme étant le facteur premier et dernier. Maslow semble considérer que la partie la plus « humaine », la plus noble, se situe au sommet de la pyramide et ne peut advenir qu’une fois les besoins des étages sous-jacents pleinement ou suffisamment satisfaits. Pour ma part, si je ne nie pas l’importance de ceux-ci dans l’établissement d’une personnalité suffisamment épanouie et leur capacité à envahir toute l’économie psychique et à parasiter tous les comportements lorsqu’ils sont trop envahissants, je ne crois pas qu’ils obturent complètement l’expression et l’actualisation de notre part spirituelle. Je connais de nombreux exemples d’individus qui témoignent de cette possibilité, même en présence de carences importantes dans la satisfaction de leurs besoins.
Je crois que l’accomplissement de soi ne vient pas d’une transformation progressive du « moi », comme un blanc d’œuf visqueux devenu mousse légère une fois monté en neige. L’individuation, comme en a parlé Jung, ou l’actualisation du Soi en psychologie transpersonnelle, est la survenue de « tout autre chose ». Ce Soi réel, transpersonnel, l’âme immortelle, procède dès le commencement à l’avènement de l’être humain mortel et limité, et constitue l’impulsion première et la dynamique permanente qui poussent le moi à se développer. Et ce développement, cette croissance, se poursuivent en dépit et même à l’aide des besoins jamais pleinement satisfaits et de toutes les caractéristiques de la personnalité qui seront abordées dans la deuxième partie. Vient alors le moment où ce moi, cette personnalité, peut offrir un écrin, devenir l’instrument docile à la pleine expression du Soi qui en attendait patiemment l’opportunité. L’âme, l’alpha et l’oméga de l’être humain, c’est la thèse développée dans cet ouvrage.
3 Abraham Maslow (1908 – 1970), est un psychologue américain, considéré comme l’un des fondateurs de la psychologie humaniste.
Peur et instinct de survie
En réfléchissant à la caractéristique commune aux êtres vivants, nous distinguons un facteur essentiel, celui d’une force qui pousse chaque espèce et chaque unité de celle-ci à l’existence et à se maintenir vivant aussi longtemps que possible. Nous pourrions l’appeler l’impulsion vitale, coexistante à notre univers observable, et qui se traduit par l’instinct de vie au sein de chaque forme. Cette forme peut être une espèce dans son ensemble, dès lors que la notion d’individu est difficilement démontrable, comme les graminées dans le règne végétal ou les termites dans le règne animal. Mais dès qu’un certain degré d’individualité se dessine plus nettement, l’instinct de survie opère alors de façon évidente au sein de chaque unité individuelle. Difficilement identifiable dans le règne végétal, à l’exception peut-être des grands arbres majestueux, cette forme est nettement plus facile à saisir chez les mammifères les plus évolués, et devient évidente en abordant le règne humain.
C’est ce cas précis qui nous intéresse, en laissant de côté les influences vitales et leurs principes génériques œuvrant dans les formes plus collectives, situées au début des branches évolutives de chaque espèce.
Nous limiterons encore davantage nos réflexions aux unités vivantes possédant un système nerveux suffisamment évolué, tel celui des mammifères, avant de ne considérer plus que l’être humain, dont les tribulations sont au centre de cet ouvrage.
Il existe donc, selon toute évidence, une impulsion vitale qui a conduit à l’organisation de plus en plus complexe de formes vivantes. Quelles sont l’origine et la nature de cette impulsion, voilà une question à laquelle il est impossible de répondre de façon formelle. L’approche scientifique dite matérialiste peut répondre d’une façon que nous connaissons tous plus ou moins. Les constantes physiques qui ont présidé à la naissance de l’univers sont si absolues et si précises qu’elles ont permis l’organisation de la matière telle qu’elle nous apparaît, et que cette matière (qui est une matière-énergie, plus aucun scientifique n’en doute) a pu s’organiser en des agencements de plus en plus complexes, atomes, molécules, aux propriétés potentielles d’organisation, pour constituer des assemblages minéraux et organiques capables d’être doués de vie. Cette vie elle-même contenait dès le départ, de manière potentielle au début, puis actualisée, les propriétés de la conscience. Bien sûr cette explication n’en est pas une, il s’agit plus exactement d’une description. Sans sous-estimer, loin de là, le génie nécessaire pour que l’intelligence humaine puisse formuler de telles descriptions des mécanismes de la vie, cela ne nous renseigne pas sur les éléments causaux, leur nature, leur éventuelle intentionnalité. En effet, y répondre appartient exclusivement, du moins pour le moment, au domaine de la métaphysique. L’histoire des religions et des philosophies qui a jalonné toute l’épopée de l’aventure humaine nous renseigne sur les différentes formulations métaphysiques proposées. C’est d’ailleurs une étude formidablement intéressante, et qui ne manque pas de nous interroger sur les points communs essentiels qui se cachent derrière les idiosyncrasies propres à chaque civilisation, culture et peuple.
Mais là n’est pas notre sujet, et nous retenons pour le moment ce fait observable de l’impulsion vitale se traduisant en instinct de vie et de survie chez les différentes unités du monde animal.
Pour que cet instinct de vie puisse opérer, les êtres vivants doivent être équipés de mécanismes qui en assurent le bon fonctionnement ou, en d’autres termes, doivent bénéficier d’un substrat biologique qui permette ce fonctionnement et assure des dynamismes qui mobilisent leur organisme pour répondre à cet impératif.
Ces mécanismes et ce substrat biologique ont vu leur parfait couronnement au sein de ce tissu spécialisé appelé le système nerveux. D’autres systèmes importants concourent au fonctionnement vital bien entendu, cardio-vasculaire, respiratoire, digestif, etc. mais la dynamique de l’instinct de vie se situe exclusivement dans le système nerveux. Et plus précisément dans le système nerveux central.
Constitution schématique du système nerveux
Il ne s’agit pas ici de présenter un cours d’anatomie neurologique, mais de donner au lecteur les bases, présentées d’une façon volontairement simple, pour mieux appréhender les propos développésici.
Le système nerveux est constitué des cellules nerveuses (ou neurones) et de leurs prolongements (axones et dendrites), protégés et emballés par d’autres types de cellules (les cellules gliales). Ces neurones font circuler des signaux qui viennent du cerveau et de la moelle épinière vers toutes les parties du corps (via les axones), ou des parties du corps vers la moelle épinière et le cerveau (via les dendrites).
Le système nerveux peut être subdivisé comme suit :
1.Sur le plan anatomique (cf. figure1) :
a. le système nerveux central constitué du cerveau et de la moelle épinière, protégés respectivement par le crâne et par la colonne vertébrale ;
b. le système nerveux périphérique : c’est l’ensemble des nerfs qui sortent du crâne et de la colonne vertébrale et qui se disséminent dans toutes les parties du corps.
Figure 1. Système nerveux central et périphérique du corps humain, Wikimedia Commons.
2.Sur le plan fonctionnel, nous trouvons :
a. Le système nerveux somatique, qui est le système de la vie de relation. Il nous permet de recevoir les informations du monde extérieur via nos cinq sens d’une part, et d’autre part de mettre en route des séquences motrices, grâce à notre système musculosquelettique, qui sont la base de tous nos comportements et de toute action que nous mettons en place dans le monde extérieur. Grâce à lui, nous percevons le monde, d’une manière certes partielle et qui nous est propre – dépendant aussi de la sensibilité spécifique et limitée de chacun de nos sens – et nous agissons dans le monde et sur le monde, au point même de le modifier. Selon Bergson, ce système nerveux permet d’assurer la perception du corps et du moi comme être unifié et distinct de son environnement, d’insérer l’entité consciente dans son milieu, triant et sélectionnant les informations qui lui paraissent signifiantes ou pertinentes (à tort ou à raison), afin d’organiser la réponse motrice, c’est-à-dire l’acte approprié (ounon).
b. Le système nerveux autonome, qui est le système de la vie végétative. Contrairement au précédent qui est dit « volontaire », celui-ci est un système involontaire du fait de son indépendance vis-à-vis de la conscience et de la volonté et de sa propre organisation anatomique. Il régule et coordonne le fonctionnement des organes, en l’adaptant aux besoins de l’organisme afin d’assurer le maintien de l’homéostasie. Il permet à l’organisme de s’adapter en permanence à toutes les modifications qui peuvent survenir à l’extérieur du corps (par exemple les changements de température) comme à celles qui se produisent à l’intérieur (par exemple l’apport de nourriture). Il contrôle tout ce qui est automatique dans le fonctionnement de l’organisme4.
Instinct de survie etpeur
La dynamique primordiale qui permet l’efficacité opérative de l’instinct de survie est sans conteste la peur, l’affect le plus fondamental des espèces douées d’un système nerveux central. C’est un affect et c’est aussi l’une des premières manifestations de la conscience. Celle-ci repose au départ sur la sensation, sous-tendue elle aussi par le système nerveux, et existe déjà chez des formes animales très frustres. Les autres affects supposent déjà une conscience plus élaborée. On pourrait dire que la sensation autorise une conscience purement subjective, passive, tandis que les affects apportent un caractère d’objectivité à la conscience. Ce n’est pas encore le plein déploiement de la conscience tel qu’on l’observe chez l’être humain appelé Homo sapiens sapiens, c’est-à-dire conscient d’être conscient. Cette conscience humaine est dite objective, active et autoréflexive, en comparaison avec un niveau de conscience plus frustre, subjectif et passif.
La peur est donc très certainement l’affect le plus fondamental.
Qu’est-ce qu’un affect ? Un affect correspond à une activité neurologique spécifique, mettant en jeu certaines structures cérébrales centrales, et déterminant une réponse des systèmes nerveux somatique et autonome. La perception de l’affect repose alors sur des changements neurochimiques dans le cerveau, des modifications de l’activité de certains organes (le cœur qui bat plus vite et plus fort, une transpiration accrue, etc.) et une activité motrice corrélative (expressions du visage, tension musculaire, posture affectant le corps entier). S’y ajoutent parfois des vocalisations automatiques, une odeur corporelle ou d’autres signes plus discrets. En général, l’affect est affiché sur le visage, bien avant d’être expérimenté ailleurs dans le corps.
Les affects correspondent à ce que l’on nomme émotions primaires : peur, colère, joie, surprise, tristesse et dégoût. Celles-ci peuvent se lire au travers d’une expression faciale typique et universelle, reconnaissable par tous, quelle que soit la culture d’origine. Ces émotions primaires sont à différencier des émotions secondaires, que l’on pourrait appeler émotions sociales ou sentiments, et qui s’inscrivent dans une gamme très différenciée. Ces sentiments ont la possibilité d’être maintenus dans la durée, contrairement à l’affect qui est une réaction neurophysiologique brève. Les sentiments sont aussi très liés à nos conditionnements familiaux, culturels et raciaux. Ils supposent donc mémoire, apprentissage (souvenirs antérieurs d’émotions et valeur expérientielle qui leur est donnée), anticipation du futur et enfin processus cognitif (pensée).
La fonction des affects est d’attirer notre attention sur le stimulus qui l’a provoqué. Ils possèdent une base physiologique innée. La peur nous renseigne sur un danger réel ou potentiel de nature à nous nuire, et donc à mettre en péril la continuité de notre existence. C’est pourquoi la peur est la force dynamique qui permet à l’instinct de survie de fonctionner.
Chez l’être humain, nous rencontrons la peur-affect, réaction brève à l’approche ou à la rencontre d’un danger réel ou supposé mais aussi la peur-sentiment qui est la permanence affective et cognitive de cet état de peur, déterminant une sensibilisation et une orientation psychique récurrente. C’est très certainement la peur-sentiment qui détermine autant de conséquences préjudiciables. On peut la rapprocher de l’anxiété, qui constitue une anticipation imaginative de dangers, difficultés ou catastrophes à venir… et qui dans l’immense majorité des cas ne surviendront jamais. « J’ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, la plupart ne sont jamais arrivés. » (Mark Twain)
En considérant l’être humain, admettre que l’instinct de survie et la peur sont consubstantiels à notre nature animale et sont inscrits dans notre neurologie ne signifie pas que nous réduisons l’homme à cet état, loin de là. Nous aurons l’occasion de développer les autres principes dynamiques que nous lui reconnaissons. Mais pour une progression sérieuse dans la compréhension de ce que nous sommes, il convient de partir de la base incontournable, notre corps, et d’éléments vérifiables sur lesquels nous appuyer.
Nous allons dans le chapitre suivant détailler des circuits qui sous-tendent l’expression de la peur et les distinguer des autres grandes dynamiques qui expliquent nos comportements et qui s’appuient sur plusieurs ramifications de lapeur.
4 . La description précise du fonctionnement du système nerveux autonome et de son implication dans la santé et dans les décompensations psychosomatiques est l’objet de mon précédent ouvrage, nettement plus technique et destiné surtout aux professionnels de la santé du corps ou de l’esprit.
Les trois axes neurophysiologiques
Comme nous venons de le voir, la peur semble découler d’une nécessité, celle de la survie, que l’on peut décrire comme la pulsion de maintenir la forme qui permet (ou qui abrite) la vie aussi durablement que possible.
Il nous faut donc chercher dans la structure neurologique le substrat de ce fonctionnement. Les connaissances que j’ai pu acquérir progressivement à travers l’étude des neurosciences m’ont amené à différencier trois axes neurophysiologiques. Ces trois axes ou circuits conditionnent les besoins fondamentaux de l’être humain et s’articulent autour de trois déclinaisons fondamentales de la peur. Pour être plus précis, ils conditionnent les besoins de l’homme-animal pour les deux premiers, ce qui signifie que l’on en trouve déjà les mécanismes chez de nombreux animaux, alors que ce n’est sans doute pas le cas pour le troisième.
Ces trois axes sont :
–axe de l’hypervigilance par défaut : besoin de sécurité et peur de lamort.
–axe plaisir-aversion : besoin de plaisir et peur de souffrir.
–axe de l’estime de soi : besoin d’être puissant et peur d’être sans valeur.
Le premier se rencontre déjà chez des espèces très anciennes, pourvu qu’elles soient dotées d’un cerveau rudimentaire, le deuxième chez des espèces plus évoluées, probablement à partir des mammifères. Quant au troisième, il est possible qu’un début de structuration soit apparu chez les espèces animales les plus évoluées, mais si c’est le cas, ses manifestations dans leurs comportements n’apparaissent pas de façon évidente. Plus vraisemblablement il semble être propre au règne humain. Acquisition plus tardive dans l’évolution, concomitante avec le développement de l’encéphale et l’acquisition du langage.
Décrivons maintenant les trois axes ou couples besoin-peur.
1/ Axe de l’hypervigilance par défaut : besoin de sécurité et peur de lamort
L’évolution des espèces animales au sein d’un monde potentiellement dangereux a privilégié très précocement cette fonction. Elle favorise la survie des individus et des espèces dans un milieu où règne ce que l’on a coutume d’appeler « la loi de la jungle » : manger et ne pas être mangé à son tour pour survivre. À cela s’ajoute la compétition pour le territoire qui n’est rien d’autre qu’un espace vital pour se mettre à l’abri et se protéger, trouver sa nourriture et se reproduire.
C’est ainsi que le cerveau des animaux, celui de l’homme également, est câblé pour fonctionner dans un état constant d’hypervigilance. C’est le mode par défaut, ce qui signifie qu’il est activé de façon permanente, à moins qu’un autre mécanisme plus élaboré ne vienne l’inhiber.
En tant qu’animal, l’homme est programmé pour vivre dans la peur en permanence, mais en tant qu’être humain social, il apprend dès le début de son existence à se sentir en sécurité dès lors qu’il bénéficie de conditions propices. Celles-ci sont d’abord naturellement créées par le milieu familial, puis par le milieu sociétal. Néanmoins, cet accès au sentiment de sécurité est fragile et peut rencontrer des difficultés précoces lors de son établissement, ou être érodé par les événements rencontrés au cours de l’existence.
Ces mécanismes sont aujourd’hui parfaitement décrits. Les travaux du XXe siècle sur la réaction « combattre ou fuir » ont été considérablement affinés et approfondis au cours des deux dernières décennies. Nous commencerons par présenter de manière simplifiée la théorie polyvagale de Stephen Porges5 qui a pris un essor considérable ces dernières années dans le domaine scientifique comme dans le champ des approches psychothérapeutiques.
La théorie polyvagale
J’ai décrit cette théorie dans le détail dans un précédent ouvrage destiné à un public plutôt averti. Ici, j’en ferai une présentations succincte.
Notre système nerveux procède à chaque instant à une évaluation de la situation présentée par le monde extérieur en termes de sécurité ou de danger. Il le fait d’ailleurs aussi pour les conditions régnant à l’intérieur même de notre corps. C’est ce que Stephen Porges appelle la neuroception, pour signifier que ce processus a lieu en dessous du niveau de notre conscience. En fonction de nos conditionnements qui débutent dès notre premier souffle, et peut-être même dans le ventre de notre mère, chaque signal, chaque information ou chaque événement est classé selon une grille triple qui se définit ainsi :
–« Je » suis en sécurité, ce « Je » représentant un inconscient relevant exclusivement du système nerveux.
–« Je » suis en danger.
–« Ma » vie est directement menacée.
La réaction qui s’ensuit est strictement conditionnée et stéréotypée, bien qu’elle puisse varier en intensité et se situer sur une échelle allant de légère et discrète à intense et extrême. Cette réaction est médiée tout particulièrement par le système nerveux autonome, incluant de nombreuses structures cérébrales ainsi que des réactions hormonales.
–Tant que règne une neuroception de sécurité, c’est la branche la plus évoluée du système nerveux autonome (SNA) et la plus récemment acquise (présente seulement à partir de l’apparition des mammifères) qui est activée et contrôle et régule les autres branches du SNA. Cette branche se nomme nerf vague ventral ou nerf vague nouveau. Elle exerce aussi une action régulatrice et positive sur les autres grands systèmes responsables de notre santé, comme le système hormonal et le système immunitaire. La plupart des études sur le nerf vague concernent cette branche. Elles se comptent aujourd’hui par milliers et les chercheurs démontrent chaque jour l’action bénéfique ou préventive du bon fonctionnement de ce nerf concernant de nombreuses maladies physiques, tout comme son implication dans la nature des réponses émotionnelles et cognitives. C’est aussi cette branche qui régule en grande partie la fréquence cardiaque et ses fines variations, d’où la recrudescence actuelle de techniques respiratoires de cohérence cardiaque qui ont pour effet de renforcer ce nerf vague nouveau.
–Dès que des signaux de danger sont perçus, qu’ils soient réels ou simplement dus à notre imagination ou à des réminiscences intempestives qui font suite à un traumatisme émotionnel, c’est cette autre branche du SNA qu’est le système sympathique qui est activé. Ce système est conçu pour mobiliser notre énergie et nous mettre en mouvement. S’il nous est utile dans un niveau de fonctionnement normal pour avoir du dynamisme, son hyperstimulation détermine la réaction de défense face à un danger :
–Combattre, dès lors que nous pensons pouvoir être en mesure de le faire ou si les réflexes créés par les conditionnements de notre histoire personnelle ont facilité ce type de réponse.
–Fuir de façon active, se mettre à l’abri si le combat semble inégal ou perdu d’avance, ou bien si notre structure générée par nos conditionnements privilégie cette réponse.
–Enfin, parce que la situation est parfois telle qu’elle ne laisse aucune autre option, ou parce que c’est pratiquement la seule réponse adaptative que nous avons été en mesure d’apprendre dès notre première enfance, le système nerveux détermine que la survie est immédiatement compromise. C’est la réaction d’immobilisation passive, de fermeture et de réduction drastique de toutes les fonctions vitales.
Prenons un exemple afin de bien faire comprendre ces mécanismes. Il me faut utiliser une situation dont l’évocation peut être difficile pour quelques-uns, et je prie le lecteur de bien vouloir m’en excuser. Supposons un groupe de personnes réunies pour participer à un événement plaisant. Certaines se connaissent et discutent entre elles de façon amicale. Nous pouvons observer leur visage, la plupart sont souriantes, expriment des émotions positives, les yeux sont bien ouverts et les regards se croisent. C’est précisément là que repose la neuroception de sécurité : être en relation avec autrui de façon bienveillante. C’est pourquoi le nerf vague nouveau a été baptisé par Porges nerf de l’engagement social. La sécurité s’apprend donc dès nos premières interactions avec l’autre, cet autre étant le plus souvent représenté par les parents. Prendre soin de son enfant, le nourrir, lui parler sur un ton agréable, le porter, le nommer, en un mot le reconnaître, tels sont les ingrédients qui nourrissent la neuroception de sécurité et permettent de développer les structures cérébrales qui peuvent inhiber le mode d’hypervigilance par défaut. Toutes les maladies, séparations, traumatismes émotionnels, peuvent compromettre plus ou moins cette nécessaire acquisition. Tout comme les modes d’interactions que les parents tissent avec leur enfant, qui ne sont pas toujours optimaux. La psychologie moderne s’intéresse de plus en plus aux modes d’attachements (parents-enfant) et comprend de mieux en mieux les conséquences et les fragilités psychiques que des modes non sécurisants peuvent entraîner.
Continuons notre exemple. De nouvelles personnes arrivent avec un peu de retard pour rejoindre cette assemblée. Observez-les (ou mieux, essayez de vous souvenir et d’identifier vos propres comportements automatiques dans des situations semblables) : en arrivant dans un lieu nouveau, où de nombreuses personnes sont présentes, ces personnes mobilisent leurs yeux pour regarder dans différentes directions. Que cherchent-elles, ou plutôt que fait leur système nerveux ? Il est à l’affût d’indices de sécurité ou de danger. Avant cela, il y a une légère activation, que l’on pourrait mettre en évidence en mesurant l’activité cardiaque, la respiration, le niveau de transpiration, l’ouverture des pupilles… Dès que des visages connus et familiers sont repérés, la neuroception de sécurité s’installe. Tout va bien, on peut se détendre. Ce qui est loin d’être le cas si, au contraire, on est interpellé par le visage d’inconnus qui évoquent pour nous, à tort ou à raison, une personnalité inamicale, voire agressive.
Mais supposons que l’ensemble des personnes présentes se sentent bien, l’ambiance est joyeuse et détendue. Tous les systèmes nerveux communiquent et se renforcent dans cette neuroception de sécurité, ce qui a pour effet d’améliorer encore la qualité des échanges interpersonnels.
Tout à coup, des cris se font entendre suivis d’un coup de feu. Chaque personne va connaître un instant plus ou moins bref de figement, le temps pour le système nerveux d’évaluer la situation et entraîner une réaction selon l’un des trois modes. C’est seulement dans un second temps que, en termes d’expérience consciente, nous serons habités par telle ou telle émotion (peur, colère, surprise…) et que nos processus cognitifs vont entrer en jeu. Cette cognition peut prendre la forme du discours intérieur suivant : « oh il y a un individu qui a un pistolet – il a l’air complètement fou furieux – mais il a tiré sur quelqu’un ! – oh mon dieu, elle est au sol !? – il faut que… » Et c’est là que, selon la structure, les conditionnements mais aussi les apprentissages conscients, la réaction va changer selon chaque individu.
Parmi cette assemblée, quelques-uns vont « descendre » immédiatement dans la réaction de figement : prostration, attitude recroquevillée et incapacité de se mouvoir. Le champ de conscience se réduit, allant d’une sensation de dissociation, de flou, jusqu’à la perte de conscience et l’évanouissement (le flux sanguin cérébral est alors drastiquement réduit).
D’autres, les plus nombreux, vont être sous activation sympathique et leurs ressources énergétiques vont se trouver décuplées afin de fuir le plus vite possible, quitte à accomplir des prouesses physiques totalement inhabituelles, comme se jeter du deuxième étage. Malheureusement, cette activation sympathique ne va pas souvent avec l’intérêt pour autrui, et il est alors possible de marcher sur le corps de quelqu’un d’autre pour sauver sa propre peau, même si à froid nous ne nous sentions pas capable d’un tel geste.
Un plus petit nombre va aussi connaître une activation sympathique, mais cette fois-ci sur le mode attaque. Cela tombe bien, il y avait dans le groupe un ancien militaire formé aux techniques de combat qui a, étant donné son entraînement, appris à maîtriser ses réactions face au danger. Son cursus militaire a modifié ses circuits nerveux et, même sous le feu, sa neuroception de menace vitale n’est jamais activée. La contrepartie à cela est que pour lui, la neuroception de sécurité occupe une couche très mince, et il en faut peu pour activer le mode agression. Il y a aussi dans ce groupe une personne qui a connu un environnement violent dès sa plus tendre enfance, et les rapports humains qu’elle a appris avec ses parents au début, puis dans la rue ensuite, ont surdéveloppé sa réponse sympathique sur un mode agression. Ceux-là vont essayer de faire quelque chose pour neutraliser l’agresseur. De potentiels héros !
Enfin, il existe une dernière catégorie de personnes qui, en partie grâce à leur structure héritée ou innée et en partie grâce aux interactions précoces favorables, ont pu construire une neuroception de sécurité très solide. Devant toute situation dans laquelle des êtres humains sont impliqués, elles chercheront avant toute chose la relation, le dialogue, parce qu’elles se sentiront suffisamment sûres d’elles-mêmes pour agir dans ce sens. Elles vont donc essayer de communiquer avec l’agresseur, tenter de le raisonner. Cette stratégie peut s’avérer efficace mais connaît des limites, imposées par celui qui est en face. Un individu fanatisé ou un sociopathe est imperméable à la relation ; pour lui l’altérité ne trouve aucun écho dans son psychisme.





























