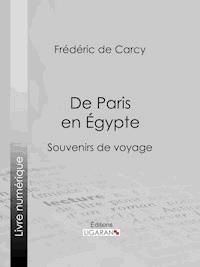
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Extrait : "Nous avions quitté Paris dans les premiers jours du mois de janvier, au moment où la neige et le froid y étaient installés ; nous avions hâte de fuir ces frimas et d'aller les oublier à Nice, pour nous préparer à notre prochain voyage en Égypte. Nous avons trouvé Lyon notre première étape, tout à fait métamorphosé depuis vingt ans. C'était alors une grande ville peu sympathique, rappelant les vilains quartiers du Paris d'autrefois..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nancy, 14 mars 1874.
Ce livre contient la relation sommaire d’un séjour que nous avons fait en Égypte pendant le printemps de 1873.
Nous voulons, en publiant cet ouvrage, mettre en pratique une règle dont nous avons toujours prêché la théorie : nous pensons qu’au retour d’un voyage un peu lointain, notre devoir est de faire connaître au public nos observations et nos souvenirs quand ils ont paru intéressants aux personnes avec lesquelles nous sommes en rapports journaliers.
Les Anglais, ces explorateurs du monde entier, ont depuis longtemps popularisé dans leur pays le goût des voyages. Ils y sont arrivés par la coutume de livrer à la publicité le récit de leurs excursions, plus ou moins excentriques, sur tous les points du globe.
De pareils récits n’exigent pas une grande aptitude littéraire ; il leur suffit d’avoir un certain cachet d’opportunité et de sincérité, que les narrateurs consciencieux donnent naturellement à ce qu’ils décrivent.
Nous désirons montrer combien est devenu facile un voyage en Égypte, autrefois si compliqué, souvent dangereux, et inabordable comme prix.
Nous lutterons ainsi contre le peu d’entraînement à visiter les pays étrangers, reproché, avec raison, aux Français et plus encore aux Lorrains, nos compatriotes.
La facilité de locomotion, ce bienfait de la civilisation, fait apprécier la supériorité de notre époque, si souvent calomniée par des esprits chagrins. Quoi qu’il en soit, leurs craintes exagérées ne peuvent arrêter le flot civilisateur envoyé si libéralement par la Providence pour améliorer les hommes et transformer par la liberté les peuples des temps modernes.
L’Égypte, lorsqu’on la parcourt en curieux, est intéressante à observer, dans toutes les phases de son existence, à tous les points de vue où l’on désire se placer ; – histoire, religion, art ; – le passé, le présent et l’avenir, tout peut y être également étudié.
Pour le passé : elle est soixante fois séculaire.
On trouve décrit, sur ses monuments, le degré de civilisation de ses habitants pendant les siècles les plus reculés.
Les murailles des temples des Égyptiens sont, en effet, couvertes par des tableaux sculptés qui représentent leurs mœurs, leurs costumes, leurs pratiques religieuses, plus de quatre mille ans avant l’ère chrétienne ; et Champollion, en découvrant l’alphabet hiéroglyphique, a permis de lire les récits historiques qui se rapportent aux temps de la création de ces édifices, les plus anciens du monde.
Pour le présent : la modification des coutumes et des mœurs sous l’influence moderne doit être constatée.
On peut suivre en Égypte, plus qu’en tout autre pays de l’Orient, l’évolution graduelle des traditions et des idées musulmanes, par suite du contact avec les occidentaux ; et l’affaissement des préjugés religieux qui s’opposaient aux progrès les plus utiles et au développement du commerce et de l’industrie dans la vallée du Nil.
Pour l’avenir enfin : on pressent déjà une transformation complète du pays.
On doit apprécier l’influence que le pouvoir et l’activité du gouvernement égyptien auront bientôt sur les progrès des institutions civiles, par l’instruction, et sur la richesse du pays, par les chemins de fer, les canaux, les usines, les cultures nouvelles et l’adoption des idées générales qui font la force et la grandeur de l’Occident.
Il suffit d’ailleurs d’avoir visité l’isthme de Suez pour comprendre les conséquences impérissables de cette œuvre grandiose, l’une des plus belles conceptions de notre siècle. Le canal de M. de Lesseps ouvre l’Égypte au transit commercial de la moitié du globe, et les déserts qu’il traverse seront un jour, c’est notre conviction, aussi cultivés et aussi peuplés que les bords du Nil.
Tels sont les trois principaux points de vue vers lesquels nous avons dirigé nos pensées et nos recherches pendant et après notre trop court séjour en Égypte.
Nous joindrons, sur Lyon, Marseille et Nice, quelques notes succinctes prises avant de nous embarquer, et quelques réflexions sur Naples et Rome, en regagnant, par l’Italie et la percée du Mont-Cenis, la Lorraine et Nancy que nous habitons.
Nous avions quitté Paris dans les premiers jours du mois de janvier, au moment où la neige et le froid y étaient installés ; nous avions hâte de fuir ces frimas et d’aller les oublier à Nice, pour nous préparer à notre prochain voyage en Égypte.
Nous avons trouvé Lyon, notre première étape, tout à fait métamorphosé depuis vingt ans. C’était alors une grande ville peu sympathique, rappelant les vilains quartiers du Paris d’autrefois, et ne donnant pas le désir de l’habiter au voyageur qui la visitait. Maintenant, au contraire, Lyon est devenu une superbe cité, où l’air et la lumière circulent à l’aise dans de belles rues nouvellement percées, où de magnifiques quais ont été établis sur le Rhône et la Saône, et où les sombres et informes maisons-casernes, qui attristaient jadis les regards de l’étranger, ont fait place à des constructions du meilleur aspect.
Une très belle promenade a été créée ; les chevaux et les voitures peuvent circuler dans un parc spacieux qui complète les accessoires indispensables à une grande ville.
Lyon est une vraie capitale. L’on doit certainement employer, sans regret, plusieurs jours à visiter avec soin ses édifices, ses musées et ses environs.
De Lyon à Marseille, 350 kilomètres, parcourus en dix heures de chemin de fer, font apprécier la modification de la température en avançant à toute vapeur vers le Midi. On a quitté l’hiver à Paris, on retrouve le printemps à Marseille. À notre arrivée, la ville, toute dorée par le soleil, est d’un aspect splendide.
Nous n’avons pas plus à Marseille qu’à Lyon, la pensée de décrire ces villes, qui mériteraient chacune un volume, pour les faire bien connaître, et qui sont au nombre des cités les plus vastes et les plus intéressantes de notre pays.
Ne disons qu’un mot du palais de Longchamps, situé dans le haut quartier de Marseille. Nous avons admiré sa grandeur et la beauté de la fontaine monumentale à laquelle aboutit le canal de dérivation de la Durance. Les sculptures sont sévères et bien réussies. La masse d’eau qui s’échappe de l’arcade du milieu a toute l’importance désirable, les pavillons sont bien agencés ; c’est une œuvre artistique d’un grand style.
Longchamps est donc venu consacrer dignement l’aqueduc colossal dont la création a donné aux Marseillais un véritable luxe d’approvisionnement d’eau douce, tout en permettant d’alimenter, sur le parcours du canal, des irrigations qui ont décuplé la valeur des terrains avoisinants.
Le port de la Joliette, que nous avions vu commencer, est terminé : il est d’une utilité incontestable. Le nouveau quartier est bâti sur le quai ; on y a construit des maisons d’une architecture monumentale, trop monumentale, car elles sont restées désertes, attendant en vain les riches locataires qu’on avait supposé devoir les habiter.
Cette grande entreprise, dans laquelle M. Mirès a enfoui tant de millions, n’a eu encore aucun succès ; c’est très regrettable : mais on ne peut, même dans une ville de l’importance de Marseille, modifier assez les anciennes habitudes, pour faire émigrer facilement vers un quartier improvisé, dix ou quinze mille personnes qu’il pourrait contenir à l’aise, et qui, depuis longtemps, sont casées selon leurs traditions de famille, leurs besoins et leurs goûts.
Aussi le quai resté inachevé et les superbes maisons désertes de la Joliette donnent l’impression pénible d’une ruine moderne et d’une ruineuse opération financière.
Nous engageons les étrangers à ne pas quitter Marseille sans monter, comme nous l’avons fait, à Notre-Dame-de-la-Garde. De ce point élevé on a une admirable vue sur la mer, sur les ports et sur la ville entière, dont on comprend très bien ainsi l’ensemble topographique. Une promenade plus longue, mais charmante à faire, consiste à suivre les allées du Prado jusqu’au château Borelli et, après avoir vu le musée Borelli et le jardin des fleurs, à revenir par la belle route qui longe les bords de la mer jusqu’au vieux port. Il faut environ trois heures pour faire agréablement cette petite excursion.
De Marseille à Nice, huit heures de chemin de fer.
Nous ne pouvons trop conseiller, à ceux qui peuvent le faire, une visite ou un séjour d’hiver à Nice. Cette ville, devenue tout à fait française, est certainement la plus agréable des résidences européennes où, fuyant les froids du Nord, on puisse trouver un délicieux climat avec toutes les ressources de société, toutes les distractions mondaines que donnait, pendant la saison d’été, Baden-Baden avant la guerre avec l’Allemagne.
On trouve à Nice, en villégiature, des familles riches et distinguées de toutes les parties du monde. On y mène la vie des eaux ; les relations sont faciles ; de nombreux et très bons hôtels ne donnent, pour se loger, que l’embarras du choix. Pour les santés délicates, pour les malades, on fuit le bord immédiat de la mer, et l’on va sur les collines de Carabacel. Ceux qui ne viennent que pour leur agrément habitent les hôtels qui bordent la Méditerranée. La promenade journalière, la promenade des Anglais, est une allée double, pour les piétons et pour les voitures ; elle longe la mer d’un côté, de l’autre elle est ornée d’une série de superbes hôtels et d’élégantes villas, bâtis entre cour et jardin, enguirlandés de verdure et de ces belles fleurs qui, poussant en pleine terre pendant tout l’hiver, font toujours croire au printemps.
Les lames de la Méditerranée déferlent jusqu’à quelques mètres de cette route charmante, fréquentée à Nice en janvier, comme le sont, à Paris, les Champs-Élysées dans la belle saison. Ce climat exceptionnel exige cependant beaucoup de précautions ; il faut se couvrir de vêtements chauds et éviter avec soin de s’exposer aux inconvénients des brusques changements de température, qui sont fréquents et perfides pour la santé.
Les environs de Nice sont très pittoresques ; le petit port de Villefranche, situé à quatre kilomètres, était animé par notre escadre. À bord de l’Océan, modèle le plus perfectionné de nos frégates cuirassées, l’amiral Renault a offert, pendant notre séjour, des fêtes charmantes dont les honneurs ont été faits par les officiers de ce navire. Ces messieurs ont prouvé aux étrangers invités par l’amiral, que la marine française avait conservé les traditions de parfaite courtoisie qui a distingué de tout temps les officiers de notre marine militaire.
Je ne veux rien dire de Monaco, si ce n’est qu’on a réuni dans ce site ravissant, tout ce qui peut charmer comme pittoresque, à tout ce qui peut séduire comme plaisir mondain. Ce serait une création idéale, si la triste réalité du jeu, la roulette, ne venait jeter une ombre sur Monte-Carlo, cette sirène enchanteresse qui domine, avec un attrayant regard, les profondeurs et les horizons de la Méditerranée.
Monaco est à une demi-heure de Nice ; des trains vont et viennent sans cesse entre ces villes. Ils permettent aux curieux, après avoir admiré les splendeurs du site de Monte-Carlo, de s’envoler à tire-d’aile, sans trop laisser de plumes aux entraînements coûteux qu’offre le tapis vert de M. Blanc, seul vrai gagnant à la banque des jeux dont il est le riche fondateur.
Nous devons ajouter que les gros joueurs sont généralement des étrangers et que les habitants de Monaco, n’étant pas autorisés à entrer dans les salons des jeux, ceux-ci ne présentent guère un danger sérieux qu’aux joueurs riches venus exprès pour satisfaire des émotions qu’ils iraient aussi bien chercher ailleurs.
Le mois de février s’écoulait et déjà nous trouvions avancée la saison où le voyage en Égypte devait avoir le plus d’attrait. Les considérations de famille qui nous avaient fait différer notre départ ne présentant plus d’obstacles, nous quittons Nice le 17 février, non sans nous promettre d’y revenir une autre année passer un hiver plus complet.
Nous allons, à notre retour à Marseille, retenir nos places au bureau des Messageries maritimes, sur la Cannebière. Nous nous dirigeons ensuite, munis de nos billets, vers le port de la Joliette, pour visiter le Péluse, qui devait nous emmener à Alexandrie ; nous choisissons sur ce bateau nos cabines, assez près du centre pour avoir en mer le minimum de mouvement, et assez rapprochées de l’escalier intérieur qui conduit sur le pont, pour avoir le plus d’air possible pendant la traversée.
Le matin du départ, nos gros bagages ont été conduits de l’hôtel à l’agence des Messageries, qui se charge de leur embarquement, et vers midi, nous nous sommes rendus directement au quai du port, où est placée l’escale de la Compagnie pour les navires en partance. Ces détails, donnés à titre de simples renseignements, ne sont pas sans importance pour le voyageur et il est utile de les connaître à l’avance.
La Compagnie des Messageries maritimes fait partir chaque jeudi, à une heure, un paquebot pour Alexandrie. La traversée dure six jours.
Les bateaux sont excellents, parfaitement aménagés, et nous n’avons eu qu’à nous louer de tous les soins qu’on donne aux passagers.
Le jeudi 20 février, nous quittons Marseille à une heure, par un temps superbe. Le Péluse, sur lequel, avons-nous dit, nous étions installés, est un grand navire de cent quinze mètres de longueur, de la force de 400 chevaux ; il a place pour quatre-vingts passagers de première classe, distribués dans des cabines contenant chacune deux, quatre ou six personnes.
La grandeur et le poids du Péluse rendent moins sensible le mouvement du navire ; nous eûmes le bonheur d’avoir, pendant toute la traversée, une mer tellement calme que pas une personne n’en fut incommodée et que chacun put se promener sur le pont, s’occuper et prendre ses repas sans aucun des inconvénients qui font tant redouter les voyages sur mer.
Le troisième jour, à neuf heures du matin, nous relâchions à Naples. Pendant cinq heures d’arrêt, nous avons le temps de nous faire promener en voiture dans cette grande ville si riante, si pittoresque, si animée, et que nous n’abandonnons qu’avec la pensée d’y faire, au retour d’Égypte, une station de quelques semaines.
En reprenant notre route, nous admirons la baie justement célèbre de Naples, dominée par le Vésuve, encadrée par Herculanum, Pompéi, Sorrente d’une part, et de l’autre par les îles classiques d’Ischia et de Caprée à la grotte d’Azur.
Le soleil radieux, la mer toujours calme, laissaient les passagers jouir pleinement de ce panorama ; il fuyait devant nous, les masses succédaient aux détails, puis se fondaient elles-mêmes dans des tons violacés de la perspective aérienne, pour disparaître ensuite au-dessous de l’horizon.
Les côtes d’Italie reparaissent parfois de Naples au détroit de Messine, mais la nuit était venue et ce ne fut que vers le matin que nous pûmes voir les deux rives du détroit. Sur la côte de Sicile se dresse l’Etna, avec son manteau de neiges éternelles, montagne grandiose, plus imposante que le Vésuve ; nous regrettons de nous en éloigner, mais emportés par la vapeur, il nous fallait perdre de vue la terre jusqu’à la côte d’Afrique. Nous n’avons pu apercevoir Candie, quelquefois visible du bateau par les temps très clairs.
Une traversée sur la Méditerranée, lorsque la mer est belle, est pleine de charme et de poésie. Notre énorme navire glisse comme un colossal patin ; il ne laisse qu’un sillon profond qui, le soir, prend un aspect phosphorescent qu’on ne peut se lasser de suivre des yeux. C’est avec peine qu’on s’arrache à ce spectacle, pour aller chercher dans sa cabine le sommeil dont la clémence de la mer nous a laissé chaque jour la complète jouissance.
La vie à bord, par le beau temps, est facile et agréable. On y fait vite connaissance, et le capitaine du Péluse, M. Boubée, ancien officier de la marine militaire, faisait les honneurs de son bateau avec un tact et un entrain de bon aloi qui mettaient en disposition de sociabilité ses hôtes cosmopolites.
Le matin, chacun prend à sa guise, à son lever, thé, chocolat ou café. À neuf heures et demie, on sonne le déjeuner. Il est servi à la française, fort copieux et bien accommodé. Vins, café et liqueurs font partie du menu.
À midi et demi, lunch à la manière anglaise, viandes froides, thé, vin ou bière.
À sept heures et demie, dîner complet, varié, bien servi, avec des viandes diverses, des légumes frais, des fruits, des glaces, tout le confort enfin d’un très bon hôtel du continent. Le temps aidant, chacun était à son poste à chaque repas et fonctionnait avec l’appétit que la mer sait exciter quand elle a la bonté de ne pas y venir mettre l’obstacle trop connu par les victimes du mal de mer.
Le soir, la salle à manger est transformée en salon, les parties s’organisent, le piano, souvent occupé, accompagne et harmonise les accents variés des causeries de cette tour de Babel.
Le septième jour, à sept heures du matin, nous découvrons Alexandrie ou plutôt son phare, élevé par un Ptolémée sur l’ancienne île de Pharos, maintenant jointe à la terre ferme et dont le nom est resté aux phares des côtes maritimes.
Avant de quitter la longue route que nous venons de parcourir si promptement, souvenons-nous qu’elle avait été suivie en partie, en 1798, par la flotte française, qui portait en Égypte Bonaparte et son armée. Partie de Toulon le 9 mai, elle avait mis cinquante et un jours pour exécuter la traversée que nous venons d’accomplir en une semaine.
Il est vrai que Bonaparte s’était détourné pour faire, en quelques jours, la conquête de Malte ; il ne s’était remis en route que le 19 juin, après la cession, par les chevaliers de Malte, de l’île dont ils étaient propriétaires.
Plusieurs de ces chevaliers étaient Français, entre autres Chanaleilles, du Boure, Saint-Simon, La Panouze, etc. Ils allèrent partager les chances aventureuses de l’expédition d’Égypte, tenue longtemps secrète à l’étranger.
Cette expédition comptait parmi ses chefs : Kléber, – Desaix, – Menou, – Berthier, – Lannes, – Murat, – Davoust, – Duroc, – Junot, – E. Beauharnais, – La Salle, etc. Les célébrités de la science s’étaient réunies à ces généraux : les médecins Desgenettes, – Larrey ; – les géomètres Fourrier, – Say ; – les chimistes Berthollet, – Régnault ; – le naturaliste Geoffroy Saint-Hilaire ; – le chirurgien Dubois ; – le peintre Redouté ; – le dessinateur Denon ; et une centaine d’autres savants, entraînés par le prestige irrésistible qu’avait déjà acquis, en France, le vainqueur d’Italie, avaient obtenu de prendre rang dans l’armée qu’il commandait.
Bonaparte, pendant le voyage, se livrait à la conversation de ces hommes d’élite. Monge, – Berthollet, – Caffarelli, – l’amiral Brucys, – étaient ceux avec lesquels il s’abandonnait le plus volontiers, développant alors, pour la première fois, ses idées hardies sur la guerre offensive, et donnant, pour en assurer le succès, la plus large part à la rapidité et à l’audace.
La traversée ne se fit pas sans préoccupations sérieuses et sans alertes : Nelson, avec son escadre, était dans les mêmes eaux, une attaque eût été redoutable et pouvait être fatale à notre flotte, trop encombrée pour résister aux Anglais avec avantage.
Deux jours avant l’arrivée de l’armée française, Nelson, en croisant à la recherche de nos vaisseaux, avait été devant le port d’Alexandrie ; mais il n’y était pas entré, dans son incertitude sur les projets de Bonaparte. Il venait, fort heureusement pour nous, de s’éloigner de la côte, le 1er juillet 1798, jour du laborieux débarquement de quatre mille hommes de l’armée française.
Les transbordements avaient été dangereux ; – la Méditerranée était mauvaise, – elle ne ressemblait pas à la mer d’huile qui avait favorisé notre voyage.
Alexandrie fut prise de vive force, sans trop de pertes ; quarante soldats, tués pendant l’assaut, furent enterrés avec les honneurs militaires, au pied de la colonne de Pompée, – que nous voyons à l’horizon, et dont l’apparition dut être acclamée par nos soldats, en 1798, avec une joie incomparablement supérieure à notre satisfaction de touristes sur le point de débarquer.
Le Péluse s’arrête, – nous jetons l’ancre dans le port de la ville fondée par Alexandre le Grand, et qui a vu depuis tant d’illustrations diverses.
Alexandre, maître de l’Asie mineure, après avoir pris Tyr, – Damas, – Jérusalem (332 av. J.-C.), passa en Égypte, s’empara de Péluse, d’Héliopolis et de Memphis, et bâtit, sur l’emplacement de Racotis, la ville à laquelle il donna son nom. Après sa mort, à Babylone (en 324 av. J.-C.), son corps, rapporté embaumé à Alexandrie, fut couché dans un cercueil en or qu’on déposa dans un magnifique sarcophage en basalte. Ce sarcophage est encore un des monuments antiques les plus remarquables du musée de Londres, où il est conservé.
Ampère, dans l’excellent ouvrage qu’il a écrit sur l’Égypte, a consacré à l’étude de l’ancienne Alexandrie un chapitre très intéressant, dont nous conseillons la lecture aux voyageurs :
« Je ne pense pas, dit-il, qu’il y ait dans le monde une seule ville, Rome comprise, qui recueille et concentre des souvenirs si nombreux et si divers. Je me bornerai à citer trois noms, les trois plus grands peut-être de l’histoire, et qui ne se sont jamais rencontrés qu’ici : qu’on me montre une autre ville fondée par Alexandre, défendue par César et prise par Napoléon. »
Un des charmes des voyages maritimes est de faire arriver sans transition au milieu de pays, de peuples si différents de ceux qu’on a quittés en s’embarquant. Ce contraste existe dans toute sa force en arrivant à Alexandrie, malgré l’aspect un peu trop européen des moulins à vent qu’on voit aux environs de la ville et qui ont été importés par des Français.
Le bateau, à peine arrêté, est environné d’une nuée de petites embarcations qui viennent s’arracher à l’envi, non sans dispute et sans cris, les voyageurs et leurs colis : c’est le moment difficile. Un drogman, en costume albanais, – muni de recommandations plus ou moins authentiques, – nous propose ses services ; – j’accepte, ne parlant pas un mot des langues du pays. – À partir de ce moment, je deviens sa propriété, – il est responsable, – fait descendre nos bagages, – nous ouvre un passage et nous fait embarquer sans ennui. Nous ne quittons le Péluse qu’après avoir donné à son excellent capitaine et à nos compagnons de traversée de bonnes poignées de main et des souhaits bienveillants qu’ils nous rendent de grand cœur.
La douane d’Alexandrie est tout orientale : les douaniers sont en turbans rouges ou blancs, en longue robe flottante de cotonnade bleu clair, passée sur des vêtements blancs à la mode égyptienne. Ils ont l’air intelligent, et, au rebours de nos contrôleurs, ils cherchent à être agréables et, tout en faisant leur métier, sont peu exigeants avec les simples touristes.
Un employé supérieur de la police, en costume oriental, est à son guichet pour recevoir les passeports ; il parle français et nous reçoit avec une complaisance empreinte de dignité qui nous plaît.
Tout cela dure peu de temps ; un des douaniers grimpe sur le siège de notre voiture et nous partons pour l’hôtel Abbat, où nous devons nous caser pendant que notre drogman soignera l’arrivée de nos malles et fera la distribution des nombreux bakchichs, qui ont peut-être aplani bien des lenteurs et des tracas.
À propos de bakchich, M. Raoul Lacour, dans un voyage en Égypte, commence ainsi un chapitre intitulé bakchich : « Le mot bakchich est le premier mot arabe qui frappe l’oreille du nouveau débarqué. Les Français ont le pourboire, le pot-de-vin, la bonne-main ; les Allemands, le trinkgeld ; les Italiens, la mancia ; les Égyptiens, le bakchich. Mais le bakchich d’Égypte a un sens plus large et est d’un usage bien plus fréquent. On donne deux piastres (40 centimes) de bakchich à son ânier ; le khédive a, dit-on, donné dix millions de bakchich à Constantinople ; tout se fait en Égypte par et pour le bakchich. »
Ce n’est pas une aumône, c’est une gracieuseté, un bon procédé ; il n’y a aucune honte à le recevoir ; mais nous avouons que nous sommes vite arrivés à considérer le bakchich comme une plaie de l’Égypte moderne : – son usage est continuel, – partout et toujours.
Notre équipage était, comme tous ceux que nous rencontrons, une bonne calèche découverte, avec des chevaux de fiacre passables, conduits adroitement par un cocher nègre dont la robe blanche faisait mieux encore ressortir la face et les mains noires. Le douanier nous sert de passeport et de passe-avant pour franchir la porte de la ville, gardée, comme en France, par un poste de la garnison.
Pendant notre trajet à travers la foule, nous ne nous lassons pas de regarder, d’admirer de tous côtés les costumes originaux les plus variés. Il nous semblait voir un marché continu, animé, mouvant, un public sans cesse renouvelé par des types présentant les effets les plus disparates.
Tantôt c’est l’Européenne de la colonie en élégante toilette, – la modiste en course avec son carton, – la cuisinière en bonnet blanc faisant son marché ; – tantôt c’est la juive aux couleurs voyantes, – l’Égyptienne à la figure voilée, – ou les femmes fellahs, – drapées à l’antique, – au menton tatoué d’indigo, – aux anneaux passés dans le nez, – à la tête surmontée d’un fardeau ou coiffée des bras bronzés de son jeune enfant, à cheval sur l’épaule gauche de sa mère.
Nous reviendrons sur tous ces costumes, sur toutes ces choses dont nous ne saisissions que l’ensemble en traversant la ville pour nous rendre à l’hôtel Abbat, qui nous paraît un bon hôtel, tenu à la française. Les chambres sont vastes et propres, mais leurs moustiquaires troués nous protègent peu contre les bruyants cousins qui nous tourmentent toute la nuit.
L’Occident et l’Orient sont également représentés à Alexandrie, qui, de nos jours, doit sa prospérité à la colonie européenne, comme autrefois, à la colonie grecque, sa célébrité. Les consuls généraux résident dans cette ville, afin de pouvoir mieux traiter les affaires multipliées qui sont la suite des transactions commerciales de cet important marché.
Un grand nombre d’habitants, portant le nom de protégés, forment une population à part, attachée au sol de père en fils, comme les sujets du vice-roi, mais soumise à la seule juridiction consulaire des pays dont ils sont considérés comme les nationaux, les protégés. Les conflits avec les Égyptiens sont fréquents et difficilement dénoués, les lois différentes qui régissent les parties intéressées entraînant des procès qui durent indéfiniment. Quoique le consulat général de France soit un palais digne d’un ministère, les agents n’y sont pas assez nombreux, pour terminer promptement les affaires judiciaires et litigieuses qui se présentent chaque jour.
Nouvellement nommé à Alexandrie, le marquis de Casaux venait de prendre possession de son poste. Nous avons trouvé dans son accueil une courtoisie et un bon vouloir dont nous avons souvent éprouvé les effets pendant notre séjour en Égypte.
Le gouvernement de la République, en choisissant M. de Casaux, a suivi le principe de faire occuper les positions consulaires en Orient par des membres du corps diplomatique, par des hommes étrangers aux spéculations commerciales et n’ayant pas les intérêts personnels qui peuvent absorber leur temps ou influencer la droiture de leurs décisions.
Le climat d’Alexandrie est tempéré, souvent pluvieux, mais l’été y étant très chaud, les habitants riches vont passer cette saison à Ramleh, le Saint-Germain d’Alexandrie, bâti nouvellement au bord de la mer, sur un point élevé de la côte. On a créé en cet endroit une série de villas et de maisons de plaisance, dans lesquelles les hommes d’affaires vont retrouver chaque soir leurs familles qui, avec celles des principaux fonctionnaires, forment la société agréable de cette ville commerçante.
Un chemin de fer mène en une demi-heure à Ramleh. Le khédive y possède un palais spacieux, où s’installe son harem dès la fin de l’hiver. Près de Ramleh, nous avons employé, pour courir sur la plage et voir le commencement des sables du désert, les ânes ou baudets, montures habituelles et traditionnelles pour toutes les pérégrinations en Égypte. Nous pouvons noter, en passant, que le cheval n’y fut introduit qu’à la suite des premières guerres avec la Syrie.
Les baudets sont de deux espèces en Égypte : les uns sont de petits ânes chétifs, – sans apparence, mais solides, – sobres et infatigables ; – les autres, – les purs-sangs de la race asine, – sont de grands baudets, – gris rosé, – le poil lisse, rasé autour des jambes, – très vifs, – ayant les mêmes qualités que les précédents, – et faisant les plus longues marches avec un entrain sans pareil. Les riches Égyptiens en possèdent de fort beaux dont les prix atteignent jusqu’à deux mille francs.
Les selles sont primitives, elles sont faites avec un coussin très rembourré et un pommeau assez élevé pour placer facilement un paquet ; le tout est couvert d’un tapis en laine rouge ou bleue. Le reste du harnachement est en maroquin plus ou moins orné de broderies.
Les loueurs ayant des selles médiocres, il est bon, pour les longs trajets, de se procurer des selles anglaises ; elles sont préférables pour les hommes et indispensables pour les dames. Autrefois il fallait apporter ces selles d’Europe. Maintenant on en trouve partout à louer à raison d’un franc par course.
Avant de quitter Alexandrie, nous allons visiter les seules antiquités qui aient survécu à sa grandeur passée, les aiguilles de Cléopâtre et la colonne de Pompée.
Les aiguilles de Cléopâtre étaient deux obélisques en granit rose, qui avaient été érigés par cette reine devant le temple de César. L’un est renversé sur le sol ; l’autre, resté debout à la place où il avait été dressé, exprime en vain la stabilité d’un temple dont les ruines mêmes ont disparu. On sait, en effet, qu’en style hiéroglyphique, obélisque est une lettre qui signifie stabilité.
Le monolithe que nous admirons a trente mètres de hauteur ; il a l’aspect de l’obélisque de Louqsor, qui orne la place de la Concorde. Rome et Paris sont les seules villes d’Europe où des obélisques aient été transportés.
« La France, dit Ampère, avait droit à se parer d’un pareil trophée, elle qui a conquis l’Égypte moderne par Bonaparte, et l’Égypte ancienne par Champollion. »
L’obélisque de Cléopâtre vient évoquer les faits historiques de la vie aventureuse de la reine courtisane qui lui a donné son nom. Avec Cléopâtre s’éteignit la dynastie des Ptolémées ; dès lors l’Égypte, devenue province du grand empire, n’aura plus à sa tête qu’une succession de proconsuls envoyés de Rome plus encore pour pressurer que pour administrer le pays.
On doit aux Ptolémées, dont Alexandrie était devenue la capitale, la construction des temples de Denderah, – Edfou, – Esneh, – Ombos, – Philé ; l’histoire de leurs règnes est donc utile à connaître pour un voyage sur le Nil. Voici seulement quelques-uns des faits qui ont précédé l’agonie de la royauté égyptienne, la plus ancienne monarchie du monde.
Ptolémée Alexandre, en mourant (73 ans av. J.-C.), avait, par son testament, donné l’Égypte au peuple romain. Rome, engagée dans une guerre incertaine, avait d’abord refusé ce legs ; mais César et Pompée ayant démontré l’opportunité d’accepter une aussi riche donation, Ptolémée Dionysius acheta la protection de ces deux hommes tout-puissants au moyen de grands sacrifices, et fit ainsi confirmer à Rome son autorité royale en montant sur le trône. Bientôt après, à la suite d’une émeute, il laissa échapper la couronne et s’enfuit dans l’île de Rhodes, où il resta malgré les sages avis de Caton qui, en mission dans cette île, l’engageait à retourner à Alexandrie.
Après la mort de ce roi (53 ans av. J.-C.), son fils Ptolémée Dionysius II, âgé de treize ans, épousa sa sœur Cléopâtre, âgée de dix-sept ans. Selon la volonté de leur père, ils régnèrent ensemble, restant d’ailleurs sous la tutelle du sénat, avec le titre d’amis et d’alliés du peuple romain.
Ptolémée, sacré roi à Memphis à sa quinzième année, reçut à sa cour, vers cette époque, la visite de Pompée, venu pour lever des troupes en Égypte. Comme reine, Cléopâtre accueillit avec de grands honneurs le protecteur de son père ; comme femme, elle se fit aimer de ce jeune guerrier, s’éprit de lui et bientôt la publicité des excès de cette liaison motiva, à Alexandrie, une révolte populaire qui força la reine à quitter sa capitale pour se réfugier en Syrie.
Pompée, de retour en Europe, fut battu par Jules César à la bataille de Pharsale, en Thessalie (48 ans av. J.-C.). Il revint alors en Égypte demander un asile à Ptolémée, au mari de Cléopâtre encore exilée : le gouvernement égyptien, loin d’accueillir Pompée, le fit assassiner au moment où il débarquait à Péluse, et fit offrir sa tête à son vainqueur, à César, arrivé trois jours après la mort de l’ennemi qu’il poursuivait jusqu’en Afrique.
César s’efforça de réconcilier Cléopâtre et Ptolémée ; mais celui-ci ne voulant pas consentir à recevoir son épouse coupable, elle alla trouver César dans sa tente, et usant encore du pouvoir de ses charmes, elle fit donner à Ptolémée l’ordre de lui abandonner la couronne. César défendit Alexandrie contre l’attaque du parti hostile à Cléopâtre, battit les mécontents, et Ptolémée péril dans le Nil, la barque sur laquelle il se sauvait ayant sombré au milieu du fleuve.
Cléopâtre, restée veuve sur le trône d’Égypte, se fiança avec son second frère Ptolémée le Jeune, qui n’avait que onze ans, et continua sa liaison avec César, dont elle eut un fils nommé Césarion. Elle avait inspiré une si vive passion à l’illustre capitaine, qu’il la fît venir à Rome, la logea dans son palais avec Césarion, dédia en son honneur un temple à Vénus génitrice, et alla même jusqu’à faire placer, au grand scandale des Romains, la statue de sa maîtresse à côté de celle de la déesse.
Après la mort de Jules César (44 ans av. J.-C.), la reine d’Égypte, revenue comblée de présents à Alexandrie, fit empoisonner son jeune mari, et garda seule un pouvoir qu’elle était enfin parvenue à affermir à Rome par ses intrigues.
Antoine, l’un des triumvirs, ayant engagé Cléopâtre à venir à Tarse en Cilicie, pour le règlement de quelques affaires, elle résolut de faire encore la conquête de ce puissant du jour.
Elle partit donc d’Alexandrie sur une galère magnifiquement dorée, – aux voiles de soie pourpre, – prit le costume de Vénus amphitrite, se fit suivre par des musiciens et par ses femmes vêtues en nymphes, et reçut Antoine à son bord avec tant de séduction et de coquetterie, qu’elle n’eut pas de peine à le captiver. Après les fêtes et les orgies de son séjour à Tarse, elle l’entraîna à Alexandrie pour mener la vie débauchée qu’elle savait plaire à ce jeune Romain.
Antoine, après avoir épousé Octavie, sœur d’Octave César, revint plus tard en Égypte, se laissa séduire encore par Cléopâtre et fit avec elle, à Alexandrie, de si révoltantes folies en public, qu’un sénatus-consulte, sollicité par Octave, déclara Antoine et Cléopâtre ennemis du peuple romain. La guerre leur étant déclarée, ils quittèrent l’Égypte avec une flotte et une armée nombreuses pour aller combattre les forces romaines ; mais ils ne revinrent qu’en fugitifs, après avoir été vaincus honteusement par Octave, à la bataille navale d’Actium.
Ils reprenaient déjà leur déplorable vie, quand Octave, débarquant avec ses troupes, vint les attaquer dans Alexandrie. Antoine, vaincu après une défense acharnée, se perça de son épée, et Cléopâtre, devenue prisonnière dans son palais, se donna volontairement la mort par la morsure d’un aspic qu’elle avait fait apporter, dit-on, dans un panier de figues (31 ans av. J.-C.).
Telle fut la fin tragique de cette reine célèbre, morte à trente-huit ans, après avoir, dit un auteur, changé d’amant chaque fois que Rome changeait de maître, et après avoir joué dans l’histoire le rôle important dont nous avons rappelé les scènes principales avant de quitter la ville remplie de ses souvenirs.
En quittant les aiguilles de Cléopâtre, notre voiture nous conduit à la colonne de Pompée, située à quelque distance de la ville, sur un tertre isolé, formé d’un amas de décombres d’où sortent quelques misérables maisons de fellahs, dont les habitants, à peine vêtus, ne cessent de nous importuner par leurs demandes de bakchichs. Une autre cause de mauvaise humeur est de voir celle colonne monumentale criblée de signatures insignifiantes et d’inscriptions déplacées.
La colonne de Pompée a trente-deux mètres de hauteur ; c’est un bloc de granit qui n’a d’égal en volume que la colonne de Saint-Isaac, à Pétersbourg. Pompée n’est pour rien dans l’érection du monument qui porte son nom, quoique l’inscription grecque gravée sur sa base soit une dédicace à Dioclétien. M. Letronne pense que cette colonne est d’origine romaine, de la même nature que les colonnes triomphales Trajane et Antonine à Rome. M. Ampère, et je partage son avis, la croit grecque, élevée sous un des premiers Ptolémées, en même temps que le Sérapéum, édifice considérable qu’elle dominait du milieu d’une des cours intérieures, d’après le récit d’Aphtonius, qui visita le Sérapéum d’Alexandrie vers le quatrième siècle de notre ère.
« Pour moi, dit Ampère, la colonne d’Alexandrie est le résultat le plus mémorable et le plus heureux de la lutte dans laquelle l’art grec essaya de donner à ses types les dimensions colossales dont l’art égyptien offrait le modèle. »
Ne disons qu’un mot des regrets traditionnels et très justifiés qu’a laissés au monde savant l’incendie de la bibliothèque d’Alexandrie, d’abord sous César (en 47 av. J.-C.), et ensuite au VIIe siècle (en 641) par l’ordre d’Amrou, a-t-on toujours assuré. Ce dernier fait est remis en discussion ; mais, ce qui est indiscutable, c’est l’importance des matériaux historiques qui ont ainsi disparu. On comprendra mieux encore la grandeur de ces pertes en se souvenant que, sous la domination romaine, Alexandrie était la ville ou s’éditaient la plupart des œuvres des auteurs grecs et romains : on y envoyait, de tous les points de l’empire, les manuscrits à publier. Les éditeurs avaient des copistes habiles organisés par chambrées de douze écrivains ; une page leur était dictée, elle était ensuite reproduite dans douze chambrées nouvelles, donnant cent cinquante-six copies ; en continuant à procéder de la même façon, page par page, l’ouvrage entier se trouvait édité au nombre d’exemplaires demandés par l’auteur.
La bibliothèque devait donc être enrichie des meilleures publications de tout genre, par suite du commerce de librairie dont Alexandrie, depuis longtemps, était le centre le plus renommé.
Notons que ce fut dans cette ville que, par l’ordre de Ptolémée Philadelphe, fut faite, par soixante-dix docteurs, la version des livres sacrés hébreux, document si connu sous le nom de version des Septante.
Nous quittons la colonne de Pompée pour aller voir le canal de Mahmoudieh, commencé en 1818 et terminé en 1830, par les ordres de Mehemet-Ali. En créant cette belle et utile communication avec la haute Égypte, Mehemet a rendu un immense service au commerce de son royaume.
La promenade élégante de la fashion d’Alexandrie suit, le long du canal, un chemin bordé d’arbres d’une superbe végétation, et de nombreuses villas à l’européenne, bien construites, mais d’un abord difficile. La route, mal entretenue, est coupée de trous boueux et profonds dans lesquels on croit, à chaque cahot, laisser une des roues de la voiture : notre cocher nègre est heureusement fort adroit à conduire ses vigoureux chevaux. Ils sont de petite taille, rappellent la race de Tarbes et ont les allures des bons chevaux des loueurs de Paris.
Nous avons commencé à voir à Alexandrie les Saïs, ces coureurs qui précèdent dans les rues les voitures de maître.
Au Caire ils sont plus nombreux et plus élégants ; leur costume est celui des Palycares, la fustanelle blanche, – la veste brodée d’or, – la calotte grecque à long gland de soie bleue, – une ceinture rouge ; – deux espèces d’ailes en mousseline blanche, attachées aux épaules, flottent lorsqu’ils prennent leur course – leur donnant une apparence de grands papillons. Ils marchent jambes et pieds nus, une longue baguette en main, criant sans cesse : – Bal-ek, gare à toi ; – yemin-ek, prends ta droite ; – chemal-ek, prends ta gauche, – pour faire écarter les passants.
Les Sais, inutiles dans les rues nouvelles qui sont larges, sont indispensables dans les rues anciennes lorsque les voitures peuvent les parcourir, ce qui est exceptionnel. Ils ouvrent un passage, – font garer, à force de cris, – les enfants qui grouillent, – les petits marchands qui pullulent et leurs étalages qui garnissent partout le sol. La population ne réclame pas trop, les baudets seuls mettent peu de bonne volonté, et se font accrocher par les roues. Lorsqu’ils sont montés, leur cavalier doit lever agilement la jambe menacée d’un abordage dangereux avec les roues des voitures.
Le transport des matériaux se fait encore à dos d’ânes et de chameaux ; ils se suivent en longues files, et forment toujours un embarras là où ils passent. Les chameaux marchent d’un pas mesuré et précautionneux ; leur tête, placée au loin, garde l’air sérieux et observateur qui les caractérise et semble l’avant-garde de leur corps. Ils portent sur leur dos les moellons, les pierres de taille, la chaux, ou traînent à leur suite de longues poutres ; les angles des rues sont les points difficiles et provoquent à chaque tournant les cris et les rumeurs de la foule.
Le pavage récent de plusieurs rues d’Alexandrie, de la rue Scherif-Pacha entre autres, permet maintenant au roulage de fonctionner assez régulièrement pour le transit du port et du canal à la gare du chemin de fer. Ce dernier trajet est très onéreux pour les bagages des voyageurs. Nous avions un nombre de colis très restreint, et cependant, du bateau à l’hôtel, le compte de notre cher drogman a été de trente francs ; même prix pour le même trajet à notre retour du Caire.
Nous recommandons aux voyageurs de ne pas laisser séjourner en gare les colis qu’ils adressent bureau restant, le droit d’emmagasinage est de 1 fr. 20 c. par jour et par colis ; j’ai dû payer une somme assez forte pour des colis insignifiants restés huit jours en gare à Alexandrie. En pareil cas, il faut adresser les objets, avec leur récépissé, à un hôtel ou à une agence.
Nous avons, entre temps, visité Ras-el-Tin, palais du vice-roi : c’est une grande demeure peu confortable mais richement meublée, ornée de remarquables parquets ; nous y avons retrouvé les superbes candélabres que la cristallerie de Saint-Louis avait envoyés à l’Exposition de Paris, en 1855.
Pendant notre séjour à Alexandrie, un aimable compatriote alsacien, M. Burnat, nous aidait à visiter sa ville d’adoption. Il nous offrit avant notre départ un dîner et une soirée à l’européenne, où Mme Burnat (née de Waldener) nous fit oublier un instant l’Orient, en nous faisant avec une grâce parfaite les honneurs de son installation parisienne.
Un matin, nous avons été, près de l’hôtel Abbat, voir en détail l’École gratuite des Frères de la Doctrine chrétienne, placée sous le protectorat de Teufik-Pacha, fils du khédive et prince héritier.
Nous avons été frappés de la bonne organisation de cet important établissement qui reçoit environ 500 élèves de toute religion et de toute nationalité. Les classes sont bien tenues, les écoliers séparés d’après leur âge, comme dans nos lycées. Leurs vêtements, leurs types, font reconnaître leurs origines diverses. Ils sont dirigés avec douceur, et leurs chefs paraissent avoir une grande entente des méthodes nouvelles de l’instruction.
Si, comme nous l’espérons, cette école dirigée par l’institution des Frères peut, quoique catholique, garder la tolérance qu’elle annonce ; si on n’y exerce aucune pression pour obtenir des conversions forcées, il est certain qu’elle est appelée à rendre de grands services aux habitants d’Alexandrie, en les forçant, dès l’enfance, à vivre entre eux en bonne harmonie, quels que soient leur nationalité et leur culte.
L’éducation, comprise ainsi, est conforme au plus divin des principes enseignés par le Christ, à l’amour du prochain, à la véritable charité chrétienne si souvent oubliée, si cruellement violée par les fanatiques des diverses religions, dont les exagérations se transforment en haines passionnées.
Constatons néanmoins, en nous reportant aux anciens récits, que depuis un siècle de grands progrès de tolérance ont été accomplis en Orient.
Il faut s’être rendu compte des changements obtenus pour calmer le désir, peut-être prématuré, des améliorations qui sont encore à faire et pour mieux juger la transformation moderne, dont le point de départ a été certainement l’occupation française.
Louis Norden, envoyé en Égypte en 1737 par le roi de Danemark, raconte les difficultés de son départ de Livourne, son arrivée à Alexandrie, après trente jours de navigation, et son séjour au Caire. – Il conseille de s’habiller à la turque, – afin d’éviter les dangers et les ennuis continuels qui menacent – les chiens de chrétiens. – Les Égyptiens faisaient un mauvais parti à ceux qui voulaient mesurer ou examiner de trop près leurs anciens monuments et faire fouiller le sol. Un consul français à Alexandrie, faisant déblayer le pied de l’obélisque de Cléopâtre, dut y renoncer : chaque nuit on comblait le travail qu’il avait dirigé la veille pour ses recherches scientifiques.
Savary, en 1777, ne trouve pas de sérieuses modifications dans la situation des chrétiens en Égypte :
« Le grand Caire, dit-il, est une immense cité où les Européens rampent dans la poussière, et où le nom de Franc est un opprobre. Le fanatisme de la religion musulmane y triomphe ; le musulman, rongé d’ignorance, se croit l’être le plus sublime de l’univers. Pour n’être pas insulté par la populace, il faut prendre l’air et les habits d’un Turc ; le voyageur n’est véritablement à l’abri des avanies que lorsqu’un châle couvre sa tête, cache ses cheveux, et qu’une longue moustache ombrage ses joues. »
Enfin, James Bruce, jeune Anglais d’abord consul à Alger, qui parlait les langues turque et arabe et qui a fait un voyage très connu, dans l’intérieur de l’Afrique, en 1768, raconte ce qui existait alors.
À Alexandrie, – où il n’éprouve aucune gêne, étant parfaitement bien déguisé en Arabe, – les vaisseaux des chrétiens ne pouvaient entrer dans le grand port, – afin que les femmes musulmanes ne fussent pas vues lorsqu’elles prenaient l’air sur leurs terrasses. – Le petit port était détestable, – grand nombre de navires s’y perdaient chaque année, – la peste venait de ravager la ville ; – depuis deux jours seulement, les habitants sortaient de leurs maisons pour communiquer entre eux. Une rosée miraculeuse tombée après la Saint-Jean avait fait disparaître, selon la croyance superstitieuse d’alors, le danger de la contagion.
Pour aller au Caire, on devait s’embarquer sur le Nil, à Rosette, qu’on allait rejoindre par le chemin de terre à travers un désert infesté de pillards. Rosette avait alors la réputation d’être plus habitable par les étrangers qu’Alexandrie. Bruce parle plus loin de son séjour au Caire, où il garde son déguisement : « Les Français qui sont au Caire, dit-il, sont des hommes pleins d’honneur, de politesse et d’esprit, mais qu’une fatalité cruelle a fait condamner à cette vie de galères. Je puis attester que, d’après la constance qu’ils montrent à supporter des vexations continues, je ne connais pas de nation plus noble et plus courageuse… »
Nous avons hâte d’arriver au Caire, mais nous ne passerons plus, comme Bruce, par Rosette, – nous garderons nos costumes de voyage, – sans penser à tous les déguisements indispensables autrefois. – Nous partirons le vendredi 28 février, à 9 heures du matin, en chemin de fer, pour faire en quelques heures notre première étape de voyage en Égypte.
Avant d’arriver au Caire, remettons-nous en mémoire le nom des pachas qui ont gouverné l’Égypte depuis 1801, époque du départ de Menou, qui commandait l’expédition française après l’assassinat de Kléber.
Mehemet-Ali, né en 1769, matelot rouméliote d’abord, puis commerçant de tabacs, se fit remarquer par sa valeur à la bataille d’Aboukir ; il réussit plus tard à s’emparer du pouvoir, à la tête des Albanais ses compatriotes. Il rendit des services à la suite desquels il devint assez populaire pour être élu pacha par les scheiks du Caire et reconnu par la Porte en 1805. Esprit distingué, – entreprenant, – novateur, – Mehemet avait le désir d’opérer les réformes que le contact de la civilisation lui faisait juger nécessaires. Il se mit résolument à l’œuvre et arriva à ses fins.
En 1811, Mehemet-Ali fit massacrer les mameluks, afin d’anéantir leur domination. Il confisqua leurs biens et ceux des mosquées, pour se procurer les moyens de créer une armée nouvelle. Il prit à son service, en 1815, plusieurs officiers étrangers : – notamment un Français, – ancien officier d’ordonnance de Marmont, – le colonel Sèves, connu depuis sous le nom de Soliman-Pacha. C’est à cet officier qu’est due la réorganisation qui assura, plus tard, les grands succès de l’armée égyptienne.
Ismaël, fils de Mehemet-Ali, ayant été surpris et brûlé avec sa suite, pendant une expédition dans le Soudan, son père ordonna dans ce pays de sanglantes représailles, à la suite desquelles il fonda la ville de Kartoum, pour assurer sa puissance dans le sud.
En 1824, l’armée égyptienne, sous les ordres d’Ibrahim, second fils du pacha, envahit la Morée, soumit Candie, prit Missolonghi ; elle allait conquérir la Grèce entière sans la coalition des grandes puissances, la France, la Russie et l’Angleterre, qui en détruisant, à Navarin, la flotte turco-égyptienne, assurèrent l’indépendance future de la Grèce.
L’intervention européenne enleva encore à Mehemet la Syrie, qu’il avait annexée à son gouvernement, à la suite de la brillante campagne de 1833.
Mehemet-Ali ayant perdu la raison vers la fin de sa vie, son fils aîné Ibrahim prit les rênes du gouvernement et mourut quelques mois après, en 1848. Il laissa pour successeur, selon la loi musulmane, le petit-fils de Mehemet-Ali, Abbas-Pacha, dont le père, Toussoun, était déjà mort, et qui venait d’être exilé dans l’Hedjaz par Ibrahim son oncle.
Abbas détestait les Francs ; il réagit contre les utiles innovations de ses prédécesseurs, – licencia l’armée, – ferma les écoles, – et ne laissa après lui qu’une seule création importante, – l’établissement du chemin de fer d’Alexandrie au Caire.
Abbas, assassiné, en 1854, par deux esclaves, mourut sans avoir eu le temps d’accomplir tous ses projets de réformes rétrogrades.
Après Abbas, le pouvoir revint à Saïd, troisième fils de Mehemet. Animé du même esprit que son père, aussi humain qu’Abbas avait été cruel, Saïd reprit les institutions civilisatrices interrompues par son neveu Abbas ; il seconda de tout son pouvoir M. de Lesseps dans sa grandiose entreprise du canal de Suez, et mourut, en 1863, des suites d’une maladie incurable qu’il était venu faire soigner en France.
Ismaël, le khédive actuel, fils d’Ibrahim et par conséquent petit-fils de Mehemet-Ali, succéda à son oncle Saïd. Ismaël, élevé en Europe, à Paris et à Londres, imprima une vigoureuse impulsion aux idées modernes, à l’industrie et à toutes les branches du commerce national. Nous aurons souvent l’occasion de parler, avec plus de détails, de la personne du khédive et de son gouvernement.
Résumons ainsi :
1° Mehemet-Ali régna jusqu’en 1848 ;
2° Ibrahim, son fils aîné, ne régna que 4 mois ;
3° Abbas, neveu d’Ibrahim, petit-fils de Mehemet, régna jusqu’en 1854 ;
4° Saïd, troisième fils de Mehemet, régna jusqu’en 1863 ;
5° Ismaël, fils d’Ibrahim, le khédive actuel, est au pouvoir depuis 1863.
On a peine à se familiariser en Europe avec cet ordre indirect de succession. Le khédive vient d’obtenir à Constantinople, non sans peine et sans argent, dit-on, un firman qui permet, à l’avenir, la transmission du pouvoir vice-royal en ligne directe.
Les chemins de fer, en faisant disparaître la diversité des moyens de locomotion, rendent analogues les trajets dans tous les pays où ils ont été construits.
En Égypte comme en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, nous avons trouvé les mêmes voitures, – les mêmes arrêts aux gares, – les mêmes effarements de gens en retard, – les mêmes embarras de petits paquets à la main, – les mêmes sifflets aigus des locomotives. Les voyageurs de première classe étant rares, nous avons presque toujours été seuls dans notre compartiment garni de drap jaune poussière. Les voitures de troisième classe sont longues, – les indigènes sont assis à la turque, – des divans en bois remplacent nos bancs.
La distance d’Alexandrie au Caire est de 130 milles (le mille est de 1 609 mètres), soit environ 210 kilomètres. Il y a un mouvement considérable de voyageurs entre les stations. Le service des trains et des gares est bien fait ; beaucoup d’Égyptiens sont employés et s’acquittent de leurs fonctions avec zèle et politesse.
Certaines localités des environs du Caire sont, aux jours de fêtes, le but des excursions champêtres. On y va passer la journée en villégiature, – manger sur l’herbe, – se promener à baudet, – prendre l’air frais, – et on reprend le train du soir, – comme les Parisiens le font après une partie à Saint-Germain ou à Montmorency.
L’arrivée à la gare du Caire nous rappelle celle de la gare de Versailles, rive droite, par une belle journée d’été. Nous avions eu le soin de télégraphier ; – grâce à cette utile précaution, – un homme de l’hôtel nous attendait, – nous mettait en voiture, – se chargeait de nos bagages et des bakchichs à distribuer.
Le trajet jusqu’à l’hôtel se fait par le nouveau quartier ; – les rues sont larges, – les constructions presque françaises ; – en quelques minutes nous étions rendus à New-Hotel, – installés dans de très grandes chambres bien aérées et pourvues d’un mobilier confortable.
New-Hotel a un aspect grandiose. C’est un bâtiment à deux étages, dont les portes-fenêtres, s’ouvrant sur des galeries à arcades qui ornent la façade tout le long des étages, – permettent, depuis les chambres, de prendre l’air, – d’éviter le soleil, – de suivre le mouvement de la rue et de voir la verdure des jardins de l’Esbékieh sur lesquels donne l’hôtel.
Un beau rez-de-chaussée, de sept mètres de hauteur, contient de vastes salons et des salles à manger où cent cinquante personnes se tiennent à l’aise à l’heure des repas, dont voici la distribution. Le matin, – café, thé ou chocolat, – œufs et confitures, – servis, soit dans sa chambre, soit au salon à manger. – À midi, copieux déjeuner ; – le soir, à sept heures, dîner complet, – le tout à la française, à l’instar de nos meilleurs restaurants.
Le prix est de seize schellings (vingt francs) par jour, tout compris, sauf le vin, compté à part et fort cher. On le paye cinq francs la bouteille ; aussi, quoiqu’il soit généralement bon, on se fait vite à l’arroser avec l’excellente et bienfaisante eau du Nil, – servie dans des gargoulettes, – bouteilles en terre poreuse qui, par suite de l’évaporation à travers leurs parois, acquièrent la propriété de rendre extrêmement froide l’eau qu’on y laisse séjourner.
Le service est fait par des domestiques européens, aidés, pour celui des chambres, par de jeunes nègres en larges et pittoresques robes blanches ; malgré leurs robes, ils ne font toutefois que de médiocres femmes de chambre, – mais il n’y en a pas d’autres !
New-Hotel est, au Caire, ce qu’est le Grand-Hôtel à Paris : mais les étrangers peuvent trouver beaucoup d’autres hôtels, qu’on dit fort bons et moins chers. Les guides de voyageurs les renseigneront à cet égard. Quant à nous, nous avons été très satisfaits de notre choix et nous nous faisons un devoir de le dire ici.
Aussitôt bien installés au Caire, nous pensons à commencer nos pérégrinations dans la ville et dans ses environs.
Les heures passées à l’hôtel composent une vie qui n’a rien d’oriental ; elle est semblable, pour la vie matérielle, à celle des séjours, en Suisse, à l’hôtel des Bergues ou de la Métropole à Genève, sauf qu’ici on rencontre, dans les vestibules, des drogmans au lieu des guides de montagnes, et des autorités coiffées de tarbouchs au lieu de chapeaux ronds. On est au milieu du même personnel d’Anglais – d’Américains – qu’on retrouve partout. Par contre, dès que l’on sort de l’hôtel et du quartier avoisinant, on est vraiment dans un pays nouveau, on est surpris, on est charmé de tout ce que l’on voit ; on revient à la nuit, après une journée en Orient, passer une soirée mondaine qu’on peut au Caire, comme à Paris, finir à l’Opéra ou au Théâtre-Français, ces deux théâtres étant à deux pas de l’hôtel. Si on a des velléités d’installation pour tout l’hiver, on trouve à louer des hôtels particuliers et des appartements meublés, à des conditions très acceptables.
L’hospitalité du monde est exercée largement au Caire, plus qu’à Paris, qui a perdu beaucoup de son attrait à cet égard depuis son immense développement. Les fêtes sont plus fastueuses, mais plus rares, les centres de la société française d’autrefois ; les salons toujours ouverts, les réceptions quotidiennes à causeries littéraires ou artistiques, ont presque entièrement disparu.
Nous avons retrouvé au Caire quelques-uns de ces salons anciens ; nous citerons celui de M. Barrot et la façon charmante dont Mme Barrot sait faire les honneurs de son élégant hôtel ; sa gracieuseté n’a eu d’égale que l’extrême obligeance avec laquelle M. Barrot nous a facilité toute chose pour rendre notre séjour en Égypte exceptionnellement agréable. Je reviendrai sur ma gratitude, mais j’en parle ici pour compléter, par une citation, l’idée des relations qu’on peut avoir en séjournant un hiver au Caire, et pour rassurer les personnes qui craindraient de ne pas trouver dans cette ville les habitudes de la vie d’Europe. Hôtels bien tenus, voitures commodes, excursions curieuses, bons théâtres et bonne compagnie, forment l’ensemble d’une existence qui peut satisfaire les plus difficiles à contenter parmi les gens du monde.
La part faite à cette vie mondaine est, selon les goûts, plus ou moins importante ; pour nous, bien que fort restreinte, elle a été très appréciée entre les tournées qui ont absorbé la plus grande partie de notre séjour.
Nos jours de repos étaient employés en promenades dans les vieilles rues du Caire. Il faut alors beaucoup de temps pour faire peu de chemin : on s’arrête à chaque pas pour mieux voir tous les types différents, – leurs costumes orientaux, – les petites boutiques de fellahs, – les enfants vêtus d’étoffes bariolées aux vives couleurs, – les conflits continuels des fiacres, des baudets, des chameaux, des voitures à bras, – les passants et les marchands ambulants de toutes sortes. Nous allions à pied, sauf à prendre des baudets dans la ville afin de rentrer pour le déjeuner de midi, heure à laquelle on est rôti dans les rues du Caire.
Voici une de nos pérégrinations matinales.
New-Hotel donne sur l’Esbékieh, grand terrain autrefois vague, transformé par le vice-roi en un superbe jardin qui rappelle, par la manière dont il est entretenu, gazonné, arrose et fleuri, les dispositions du jardin réservé de l’Exposition parisienne de 1867, ou du parc Monceaux. Une rivière artificielle entretient la fraîcheur ; – des cafés européens ou maures sont installés ; – une musique militaire joue chaque jour de quatre à neuf heures du soir, – dans un kiosque élégant, – les airs de nos concerts du même genre.
L’Esbékieh est entouré de belles grilles, comme le jardin des Tuileries. Il est déjà éclairé luxueusement au gaz : on paye pour entrer une légère rétribution, – quinze centimes à peine, – assez toutefois pour exclure les mendiants et la classe infime de la population : c’est un parc ombragé dans la journée et fort recherché le soir pour trouver la fraîcheur à laquelle on aspire si souvent en vain en Égypte.
En sortant de l’hôtel, nous traversons ce beau jardin verdoyant, – parfumé par les grosses fleurs blanches des Datura





























