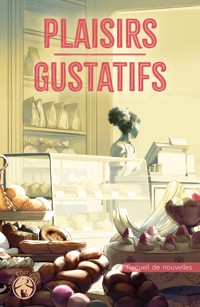23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Comme autant de défis à la dépossession et à l'inégalité coloniales, bien des combats que l'on peut qualifier de « démocratiques » ont été menés dans l'Algérie sous domination française par des membres des deux communautés, ensemble ou séparément. Nés du refus des discriminations comme de l'irrépressible aspiration individuelle et collective à se faire reconnaître, à s'exprimer, à s'organiser, à s'émanciper, ils ont investi tout à la fois l'activité sociale et professionnelle, les formes diverses de l'art et de la culture, l'espace civique et politique. D'espoirs en déconvenues, d'échecs en nouvelles formes d'action, autant de mobilisations qui, conduites au nom d'un idéal républicain ouvertement bafoué pour le plus grand nombre, ou en quête d'une identité algérienne à retrouver / à construire, auront ouvert la voie à l'affirmation nationale.
Sans prétendre à l'exhaustivité, ce volume rassemble une trentaine d'études, d'une focale plus ou moins resserrée, dues à des chercheurs de spécialités et de convictions diverses, représentant au moins trois générations et venus des deux rives de la Méditerranée, ou d'encore ailleurs. Ils illustrent la variété des pistes s'ouvrant dans ce vaste chantier que reste l'histoire de la colonisation et des forces qui se sont dressées contre elle. À interroger le cheminement obstiné de la revendication démocratique dans un contexte aussi oppressif, de tels travaux en appellent, chacun à sa manière, au pouvoir des idées, à l'acceptation du pluralisme et de la tolérance et au défi qu'en toutes circonstances, des hommes et des femmes savent relever pour plus de liberté. Textes réunis et présentés par Afifa Bererhi, Naget Khadda, Christian Phéline et Agnès Spiquel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DÉFISDÉMOCRATIQUESETAFFIRMATIONNATIONALEALGÉRIE, 1900-1962
TextesréunisparAfifaBERERHI, NagetKHADDA, ChristianPHÉLINE, AgnèsSPIQUEL
DÉFISDÉMOCRATIQUESETAFFIRMATIONNATIONALEALGÉRIE, 1900-1962
CHIHAB EDITIONS
© Editions Chihab, 2016.
ISBN : 978-9947-39-201-0
Dépôt légal : 2e semestre 2016.
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
www.chihab.com
E-mail : [email protected]
Avant-propos
« Défis démocratiques » : appliquée à l’Algérie sous domination française, la formule souligne un paradoxe. Par essence, le système colonial n’est rien moins que démocratique : il se fonde sur le présupposé d’une hiérarchie entre les peuples (on disait alors les « races »), pour habiller en projet de « civilisation », la dépossession et un pouvoir déniant l’accès à la citoyenneté à la grande majorité d’un peuple. Mais, comme autant de défis à un tel ordre, des combats que l’on peut qualifier de « démocratiques », des « travaux de démocratie » ainsi que le dit d’une manière suggestive l’un des auteurs de cet ouvrage, ont été menés de bien des manières par des membres des deux communautés, ensemble ou séparément. Des combats que nourrit l’irrépressible aspiration, individuelle et collective, à se faire reconnaître et à faire reconnaître ses droits, à s’exprimer, à s’organiser, à s’émanciper. Des combats qui investissent tout à la fois l’activité sociale et professionnelle, les formes diverses de l’art et de la culture, l’espace civique et politique. Des combats conduits au nom d’un idéal républicain que la puissance en place proclame hautement pour mieux le contredire, ou des combats déjà menés en quête d’une identité algérienne à retrouver ou à construire. Autant de mobilisations qui, même si elles ne visaient pas d’emblée l’indépendance, auront de facto mis en cause le principe même de l’ordre colonial.
Ni nouveau procès ni justification rétrospective d’un système aujourd’hui révolu de longue date, cet ouvrage veut contribuer à une connaissance plus profonde et plus subtile des rapports établis entre colonisateurs et colonisés à travers la longue durée de leur coexistence. De part et d’autre de la Méditerranée, et ailleurs, ces dernières décennies ont vu en effet se développer un intérêt grandissant des chercheurs pour le processus multidimensionnel de la colonisation et de la décolonisation et un besoin accru de porter sur lui des regards croisés. Leurs travaux ne partent certes pas du même « point de vue », au sens propre du terme : cette histoire « commune » entre France et Algérie, chacun en a eu une expérience différente, voire opposée, mais tous peuvent désormais l’aborder avec une exigence partagée d’objectivité critique. Non pas désir d’étouffer une réalité toute de bruit et de fureur ; non pas tentation de gommer les antagonismes pour apaiser à bon compte les esprits ; non pas mise en exergue de rares réalisations humanistes pour occulter l’iniquité globale d’un siècle d’oppression et d’inégalité. Mais volonté – modeste en même temps qu’audacieuse – d’observer les modes contradictoires de différenciations, tant sociales ou culturelles que proprement politiques, à l’œuvre dans les dernières décennies de la société coloniale – des différenciations, qui sans nullement dépasser la polarité constitutive de cette société, en réaménagent les modalités et y développent tout un réseau secondaire de lignes de partage. Manière aussi d’éclairer, par-delà les simplifications ou les concurrences mémorielles, le mouvement profond des forces qui, minant l’ordre en place, ont fait bouger l’Histoire et, en particulier, les défis démocratiques qui, de mobilisations en déconvenues, d’échecs en nouvelles formes de l’action, auront ouvert la voie à l’émancipation nationale.
Aujourd’hui l’Algérie est indépendante depuis plus de cinquante ans. Elle peine encore à fédérer ses forces vives autour d’un projet commun qui fasse destin ; en partie, sans doute, parce que la construction de son unité nationale s’est élaborée sur l’utopie d’un retour aux sources qui éradiquerait la « parenthèse » coloniale. Or, le futur ne peut se concevoir sur la simple négation de ce qui lui préexiste, surtout lorsqu’il s’est agi d’une colonisation de peuplement ayant imprimé sa marque pendant plus de cent trente années. Ce serait ignorer la complexité des emprunts, interférences, échanges qui, même s’ils furent pour l’essentiel imposés par la force, ont alors façonné dans la durée le tissu socioculturel du pays. L’avenir ne saurait non plus se bâtir sans donner voix à la diversité présente des idées et des aspirations. L’Algérie actuelle souffre à cet égard d’une carence démocratique faute d’avoir su, jusqu’ici, concilier la nécessité étatique de construire des institutions solides et un cadre pluraliste de légitimité permettant aux divers groupes (régionaux, économiques, idéologiques, catégoriels, d’âge et de sexe, etc.) de faire valoir leurs attentes ou leur vision du bien public. Dès lors s’interroger sur ce que fut le cheminement de la revendication démocratique dans le contexte si oppressif de la colonisation, c’est également en appeler au pouvoir des idées et à la lutte que toujours des hommes engagent, quelles que soient les circonstances, pour plus de liberté.
Le présent ouvrage se veut donc une pierre de balisage sur les chemins qui montent. Pour ses auteurs, dans leur diversité, regarder en face leur passé commun est manière aussi de tenter d’y voir plus clair dans l’avenir qui s’avance vers nous tous – anciens colonisés et anciens colonisateurs – sans céder à l’illusion qu’une hâtive conciliation suffirait à dissiper les séquelles qui affectent encore aussi lourdement chacun de nos pays, comme leur relation.
Un certain nombre de rencontres internationales visaient déjà à mieux évaluer les interactions qui ont modelé l’une et l’autre des sociétés au cours de cette cohabitation dans l’inégalité que fut la colonisation. Ainsi le colloque organisé par le Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (CNRPAH d’Alger) en 2012 sous l’intitulé : « Algérie, 50 ans après : libérer l’histoire ». Ainsi la journée d’étude qui s’est tenue en 2013 à l’Institut du monde arabe (Paris), « Réformistes et libéraux dans l’Algérie coloniale (1830-1962) », à l’initiative notamment de l’association Coup de soleil : c’est d’ailleurs d’un souhait alors exprimé par son président, Georges Morin, qu’est née l’idée, ici matérialisée, de poursuivre ici une réflexion algéro-française, également ouverte au point de vue, utilement décalé, de quelques spécialistes d’autres pays.
Le présent volume réunit des chercheurs venus de plusieurs disciplines et représentatifs d’au moins trois générations : celle à l’œuvre à partir des années soixante-dix, dont plusieurs membres avaient déjà compris que l’on ne pourrait complètement « décoloniser l’Histoire » sans explorer aussi la dimension d’anthropologie sociale et culturelle de la colonisation ; celle qui, vingt ans plus tard, a repris ce flambeau en voulant, à la fois, poursuivre une histoire politique dépassant les mythologies partisanes et approfondir une histoire sociale aux multiples registres ; la pléiade, enfin, des jeunes chercheurs qui, dans ce sillage, s’attachent depuis une décennie à documenter des sujets souvent neufs et à explorer de nouvelles sources en Algérie comme en France : nous sommes heureux d’accueillir ici un échantillon particulièrement stimulant de leurs recherches.
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce volume – dont chaque contribution n’engage que son auteur – rassemble des « travaux », d’une focale plus ou moins resserrée, mais qui illustrent la diversité des voies s’ouvrant dans ce vaste chantier que reste l’histoire de la colonisation et des forces qui se sont dressées contre elle. Centré sur la seconde moitié de ce cycle historique (soit entre 1900 et 1962), il éclaire les enjeux et les acteurs de certains au moins des « défis démocratiques » ayant marqué cette phase de maturité et de crise finale de l’ordre colonial, défis dont les quelques acquis aussi bien que l’évidente limite auront conduit à ce que le principal et le plus élémentaire d’entre eux – l’exercice par la majorité de la population de son droit à l’autodétermination – ne se réalise vraiment qu’au prix d’un violent affrontement armé. Il n’entend cependant pas reprendre systématiquement l’analyse, maintenant mieux connue, des courants et des événements politiques qui, de 1919 à 1936, puis de 1945 à 1954, ont jalonné cette évolution : des mises au point récentes ont bien résumé ce que l’historiographie des dernières décennies nous apprend du rôle de l’Émir Khaled, de l’Association des oulémas, du mouvement des élus et des figures comme le docteur Salah Bendjelloul et Ferhat Abbas, des déconvenues ayant fait suite au Front populaire et au Congrès musulman de 1936, puis aux réformes de 1944, de l’évolution complexe du mouvement syndical et du Parti communiste algérien (PCA)1... De nouvelles recherches en cours, comme celles de Malika Rahal sur l’Union de défense du Manifeste algérien (UDMA), de Affaf Zekkour ou de Charlotte Courreye sur le réformisme musulman, de Nadjib Sidi-Moussa sur le courant messaliste et le Mouvement national algérien (MNA), de Tassadit Yacine sur la dimension berbère dans la lutte de libération, pourraient bientôt contribuer à en renouveler l’analyse.
L’ouvrage qui suit s’organise à partir de quelques angles d’approche, pour chacun desquels les divers articles seront présentés chronologi-quement. On passera ainsi de l’évocation de lieux, de moments, de milieux qu’illustrèrent la volonté de rencontre aussi bien que l’affirmation identitaire, à ces vecteurs majeurs d’expression et de combat que furent la presse, la littérature ou les images, pour en arriver à certaines des formes organisées ou des figures individuelles de la mobilisation et de la solidarité.
Toute Histoire s’inscrit dans un espace et le drame de la colonisation et de son délitement s’est joué dans des lieux, plus souvent de ségrégation ou d’affrontement, parfois, mais d’une manière plus précaire, de partage ou de dialogue. Ainsi du Cercle du Progrès dont Nacim El Okbi rappelle que, dès la fin des années vingt, il fut tout à la fois le siège d’initiatives parmi les plus fortes d’expression de l’identité algérienne et d’un échange ouvert à toutes les cultures. De même avec les rencontres sans lendemain qui, comme le relate Afifa Bererhi, réunirent en 1948 à Sidi Madani des intellectuels de toutes origines, ou encore début 1956, avec l’Appel pour une trêve civile en Algérie, initiative de la dernière chance dont Agnès Spiquel rappelle qu’elle fut portée, au moins à parité, par des personnalités algériennes engagées dans la lutte nationale. Autre espace d’une action commune, les centres sociaux éducatifs, dont Michel Kelle retrace la création par Germaine Tillion en 1955 et le rôle qu’ils jouèrent jusqu’à ce que leurs dirigeants, Mouloud Feraoun, Max Marchand et leurs compagnons, succombent en mars 1962 sous les balles de l’OAS.
On le sait, l’assujettissement de la grande masse des Algériens aura, pendant plus d’un siècle, à la fois limité leur scolarisation de base, privilégié leur orientation ultérieure vers des filières « indigènes » spécifiques et réservé, de droit ou de fait, aux Européens les emplois supérieurs publics ou privés. Ces discriminations n’auront pu faire obstacle à ce que des éléments en nombre restreint réussissent à conquérir une instruction moderne leur ouvrant l’accès aux métiers intermédiaires de l’enseignement ou de l’administration, voire aux professions libérales. Côtoyant non sans disparités leurs homologues européens, les membres de cet embryon de couche moyenne pouvaient osciller entre tentatives d’intégration à la société en place et affirmation d’un rôle politique propre. Alternative dont cet ouvrage explore la complexité à travers les exemples des postiers « indigènes » de l’entre-deux-guerres (Annick Lacroix), des membres d’origine musulmane du barreau d’Alger sur les derniers trois quarts de siècle de la colonisation (Christian Phéline) ou des mobilisations propres au milieu des instituteurs et des enseignants au cours des quelques années enjambant l’indépendance (Aïssa Kadri). En contrepoint, deux articles donnent à mesurer combien l’équivoque coloniale surdétermine les développements les plus variés de l’activité sociale : ainsi de l’expérimentation de la vaccination antituberculeuse opérée dans la Casbah durant deux décennies, avancée sanitaire obtenue au prix d’un viol massif des principes éthiques (Clifford Rosenberg) ou de l’essor d’un cyclisme de compétition où une nouvelle fierté « algérienne » n’émerge que de pratiques et d’enjeux restant largement intercommunautaires (Niek Pas).
La conquête d’une presse libre et plurielle reste pour tout système d’oppression le défi le moins tolérable. Si des feuilles locales tout acquises à l’ordre en place foisonnèrent précocement à l’ombre de quelques titres dominants, Dépêche algérienne ou Écho d’Alger, la création d’organes indépendants manifeste dès le début du siècle la rupture croissante de l’unanimisme colonial. Cette bataille multiforme pour l’expression publique, Augustin Jomier l’évoque ici à travers la précoce activité journalistique de la minorité ibadiste du M’zab ; Djanina Messali-Benkelfat, fille du fondateur du Parti du Peuple algérien (PPA), avec cette réappropriation de l’exigence démocratique dans la perspective indépendantiste dont témoigne, dès 1939, Le Parlement Algérien ; Barkahoum Ferhati et Marie-Joëlle Rupp en retraçant l’engagement des minorités européennes libérale et progressiste de l’après-1954 autour de L’Espoir Algérie ou des combats de presse d’Henri Alleg et de Serge Michel.
S’approprier la langue et la culture du colonisateur pour les retourner en vecteurs de son identité est l’un des ressorts de la démarche de libération. Deux études analysent à cet égard les enjeux du développement de la littérature algérienne de langue française : Christiane Chaulet Achour propose un vaste panorama des « élans émancipateurs » qui, d’une génération à l’autre, traversent les œuvres où s’inventent les voix/voies littéraires de l’aspiration à l’indépendance ; Naget Khadda parcourt la même période en s’attachant à la manière dont le roman algérien crée peu à peu les formes spécifiques de sa modernité. Denise Brahimi nous rappelle comment Taos Amrouche a été la première, avant plusieurs générations de romancières algériennes, à en faire la matière intime de son œuvre : la conquête de soi ne va pas sans affrontement avec les partages établis d’ethnie, de classe ou de sexe. Mourad Yelles analyse pour sa part comment, en réhabilitant les répertoires poétiques populaires, Mostefa Lacheraf a travaillé à « nationaliser » des composantes culturelles algériennes hétérogènes. Ahmed Bedjaoui, enfin, fait droit au cinéma et à la manière dont il a rendu compte de la guerre d’indépendance, pendant et après la colonisation.
La dernière étape du parcours, « Mobilisations », s’ouvre sur un épisode qui ne concerne pas directement l’Algérie mais qui, au milieu des années 1920 en métropole, a mobilisé fortement la solidarité de l’Étoile nord-africaine (ENA) et, à travers elle, constitué une référence majeure pour la naissance même du combat indépendantiste algérien : l’éphémère République du Rif, dont Stève Bessac-Vaure dépeint l’origine et les grands traits. Les études qui suivent s’attachent, sous divers aspects, aux formes d’action ou d’organisation que requiert l’action sociale et politique. Oissila Saaidia rappelle, au sujet du statut des mosquées, les formes de résistance que suscita, au tout début du siècle, le refus du pouvoir colonial d’étendre à l’Islam le nouveau principe républicain de séparation des Églises et de l’État. Pour la période qui s’ouvre à partir des années 1930 , Hassan Remaoun analyse la récurrence aux diverses étapes d’affirmation du mouvement national, de regroupements de type frontiste où s’entrelacent de manière complexe les dimensions démocratiques, sociales et nationales des aspirations du peuple algérien. Pendant la guerre de libération, la mobilisation étudiante joue un rôle important que Dominique Wallon, alors président de l’UNEF française, analyse, à travers les rapports de solidarité mouvementés se nouant entre ce syndicat et la nouvelle UGEMA. Sont aussi évoquées des figures marquantes qui, chacune selon des formes d’action qui lui étaient propres, ont accompagné et soutenu le combat du peuple algérien pour la dignité et la reconnaissance de ses droits dans la période décisive s’ouvrant à partir de 1945, puis de 1954 : l’abbé Jean Scotto (évoqué par Henri Teissier, qui l’a bien connu) ; Pierre Popie, avocat libéral sauvagement assassiné dans son cabinet fin janvier 1961, à quelques jours de la création de l’OAS (Barkahoum Ferhati) ; le psychiatre Frantz Fanon, ou André Mandouze, professeur à l’université d’Alger, dont le témoignage d’Alice Cherki rappelle le rôle essentiel.
Tel un contrechant harmonique faisant écho à ces diverses mises au point pour les rapporter au cours le plus profond de l’Histoire, l’ouvrage se clôt sur un texte que singularisent sa facture aussi bien que son sujet : Mireille Djaider y propose une longue analyse de Nedjma, suggérant comment, avec la figure centrale si énigmatique de ce « roman en révolution » paru il y a exactement soixante ans, Kateb Yacine a su donner la juste métaphore d’une identité algérienne se forgeant aussi bien à travers toutes les ambiguïtés de la relation coloniale que sous le choc de sa violence extrême.
Nous avons voulu aussi placer l’ensemble des travaux ici présentés sous le signe d’Omar Carlier, défricheur généreux et subtil d’une réflexion sur la sociabilité algérienne et d’un dialogue intellectuel renouvelé entre les deux peuples, et de Jean-Robert Henry qui, après avoir contribué de manière décisive avec le regretté Claude Collot à restituer la richesse de la pensée politique algérienne tout au long du XXe siècle, s’est employé à éclairer la dialectique de ses rapports avec le contexte politique, idéologique et culturel de la société coloniale. Le premier nous a autorisés à republier la dernière partie – traitant de la période 1880-1930 où la conscience nationale émerge et commence à s’organiser – d’un de ses grands textes consacré à « L’espace et le temps dans la recomposition du lien social dans les cent premières années de la colonisation en Algérie » (1998) ; le second propose ici une très stimulante synthèse de ses travaux sur les interactions entre l’émergence d’un discours national algérien et une pensée « algérianiste », quasi nationalisme colonial qui se cristallise en 1930 autour des célébrations du « Centenaire » de la conquête, avec des rebonds jusqu’au milieu des années 1950. Il ne pouvait être de meilleures ouvertures pour ce recueil de « travaux en démocratie ».
Afifa Bererhi, Naget Khadda, Christian Phéline, Agnès Spiquel
Ouvertures
Espace et temps dans la formation et la formulation de l’identité nationale algérienne (1880-1930)2
OmarCarlier
Explorer le territoire, expérimenter la chaîne et la gamme des relations, imaginer et inventer la nation, tels sont donc les défis qu’ont pu et su relever en Algérie, de la Belle Époque au Front populaire, certains des acteurs sociaux du temps. Sans disposer de la distance critique et des concepts qui sont les nôtres aujourd’hui, ils ont ébauché une praxis, recherché une voie, un style, jour après jour, en tâtonnant, dans l’ignorance inévitable du dernier mot de leur histoire.
Rapprochée des bourgs et des centres de l’intérieur, ou installée dans les vieilles casbahs et les « villages nègres » des grandes métropoles de la côte et du Tell, une partie de l’ancien monde rural algérien, 5 à 6 % peut-être de la population musulmane, parvient à faire siennes, au tournant du siècle, certaines de ces pratiques et représentations nouvelles de l’espace et du temps. Versée dans « l’armée roulante » du dépierrage et des moissons, insérée dans le salariat saisonnier de la vigne et de l’alfa, conduits par Gallieni jusqu’à Madagascar, la remue nouvelle des tribus agro-pastorales et des villages de crête se continue dans la noria de la mine, jusqu’à Gafsa – avant de traverser la mer, vers 1906, jusqu’à Marseille, Paris, Anzin. Dix ans plus tôt, certains de ces hommes, rejoints par leurs familles, ou faisant souche, ont commencé à se fixer près des fermes européennes ou à gagner leur vie en ville, dans la maintenance du rail, la manutention du commerce, ou la logistique des ports et des docks.
Ici, sur le domaine du colon, ou à un jet de pierre, les ouvriers agricoles, les hommes de pelle et de pioche voisinent avec les bergers des douars limitrophes, mais aussi avec les premiers tailleurs de vigne et garçons de ferme sortis du rang. Ils circulent autrement entre les villages et les marchés. Beaucoup vont encore à pied, mais sur la route, et la charrette ou la carriole servent déjà à ceux qui ne prennent pas encore la diligence ou le train. À portée de la ville, attirés par elle, ils créent un nouvel espace de relation, entre le rural et l’urbain. D’autres s’installent à meilleur compte, et peuplent les menus métiers des petits centres, intermédiaires obligés entre ville et campagne, salariat agraire émergeant et petite bourgeoisie foncière ascendante3. Bouchers et boulangers, épiciers et tailleurs, gargotiers et cafetiers, ils sont eux aussi les agents d’une nouvelle mise en ordre du monde rural, et les passeurs privilégiés des mots, des objets, des usages entre les deux mondes. Les plus cossus, avons-nous dit, portent le gilet et la montre, les plus instruits lisent le journal, et prennent le train, où ils retrouvent les militaires, et même les notables, sans partager il est vrai la même classe.
Là, en ville, à Alger et dans les capitales régionales, venus pour beaucoup de l’intérieur, s’affairent les petits commis et garçons de courses, les mini-transporteurs et micro-revendeurs, au contact des Européens, et de leurs coreligionnaires enrichis par le bétail et les grains. Autant d’hommes familiers des itinéraires et des horaires de trains, de voitures et de bateaux. En Mitidja, dès l’avant-guerre, les familles utilisent le tramway, ou plus exactement les CFRA, accessibles aux couches populaires4. Voilà vingt ans que l’axe Blida-Alger est encombré. De la carriole à la diligence et au rail, l’afflux s’est banalisé. Avec la ligne Oran-Colomb-Béchar, ouverte en 1904, les jardiniers oasiens remontent vers le nord et participent à la refonte de tout l’Ouest algérien, acteurs encore insouciants de la régionalisation en cours. Mieux armés en savoir, en revenu et en statut, les auxiliaires de justice, les interprètes civils et militaires, les gens de la basoche dépassent le petit monde des chaouchs. Ils sont rejoints par les tout premiers employés du service public : traminots, cheminots, hospitaliers, postiers, venus eux aussi, pour partie, de Kabylie, du Sud et du Tell. Quelques dizaines à Alger, sans doute, vers 1900 ; plusieurs milliers, dans tout le pays, trente ans plus tard. Mais les uns et les autres sont débordés, sinon bousculés, par une nouvelle corporation de portefaix et d’hommes de peine, les dockers5. Voici le nouveau monde des trimardeurs, pour reprendre un titre d’Isabelle Eberhardt. En 1904, ils entrent dans la grève. De tous les travailleurs de la ville, ce sont les moins pourvus en capital social et culturel, et pourtant les plus en prise sur le temps du monde. Ils savent ce qui se passe, presque le jour même, à Marseille et Gênes, sinon à New York et Tokyo. Viennent enfin les femmes. À la veille de 1914, elles commencent tout juste à remplacer les Espagnoles : domestiques à Alger, cigarières à Blida. La Grande Guerre assurera l’entrée des musulmanes sur le marché du travail salarié.
Tous ces hommes et ces femmes se rapprochent ainsi des 3 à 4 % restés en ville, sans trop se mélanger avec ces derniers, citadins de vieille souche. Artisans, commerçants, jardiniers et maraîchers, religieux et petits lettrés, les héritiers de la médina s’accrochent à l’art de vivre d’autrefois, mais sans tourner le dos à la nouvelle citadinité. Certains d’entre eux commencent à adapter leur commerce et leur échoppe, à modifier leur gestion. Les plus agiles suivent les techniques et les modes nouvelles, se mettent à la comptabilité. Les uns s’initient à la photographie, à l’imprimerie, à l’horlogerie. D’autres ouvrent des magasins de denrées coloniales, ou suivent la demande touristique. Salons, carillons et photos de famille entrent dans les maisons. Quelques propriétaires, enrichis par la hausse de l’immobilier, mais aussi les premiers médecins et avocats, achètent des limousines, et font pièce à la morgue du caïd qui vient dépenser à Alger, en torpédo6. Les meilleurs artisans participent aux expositions universelles. Ils vont jusqu’à Bruxelles ou Londres, sans oublier leurs attaches avec Fès, Istanbul ou Damas. Ils reçoivent des articles de Paris, mais aussi des revues, des images et des nouvelles du Caire.
Tous ces hommes, à de rares exceptions près, restent attachés au statut personnel, symbole d’appartenance à la communauté des croyants, mais s’ils se gardent du monde, ils regardent ce monde avec des yeux moins prévenus et mieux informés que ceux de leurs pères. Ils s’interrogent désormais sur leur propre savoir et commencent à espérer, pour leurs enfants, une place dans la fonction publique – sans oublier pour autant le prestige de la Zitounza ou d’Al-Azhar. Les rejetons les plus brillants de ces citadins voudraient déjà rejoindre les fils de caïds et de notables sur les bancs très clairsemés du lycée, et même de l’université, le Saint des Saints de l’Algérie coloniale. Leurs quartiers, il est vrai, sont encerclés, ou traversés, leurs habitudes sont bousculées, hier par l’intrusion étrangère, aujourd’hui par le flux des ruraux.
Une nouvelle tension s’installe de ce fait entre khassa et ʻamma, entre l’élite et la masse. Toutefois, le maintien réajusté des hiérarchies sociales n’exclut pas la reformulation de solidarités horizontales. Le croît démographique, la refonte rurale, la reprise urbaine, la circulation sans précédent des hommes, des idées et des biens, tout y prédispose. Et puis, la conscription et la guerre vont bientôt peser de tout leur poids. Avec la Grande Guerre, qui les révèle à eux-mêmes, les « indigènes » prennent la mesure de leur autochtonie au regard d’un nouvel état du monde, à partir d’une nouvelle vision du monde, ils se mettent à l’écoute d’une nouvelle histoire, leur histoire7.
Il faut à ces hommes8des porte-plume et des porte-voix. Les journalistes et les élus commencent à l’être de métier, en partage avec la nouvelle élite des professions libérales, des médersas officielles, et des lettrés et religieux réformistes. Toutefois, à la veille de 1914, aucun groupe professionnel n’est aussi créatif que celui des instituteurs. Ces dreniers outrepassent, en effet, les limites du rôle qui leur a été dévolu par le pouvoir colonial : réguler la relation inégale entre Européens et indigènes, en formant des intermédiaires sociaux, les travailleurs indigènes qualifiés et bilingues dont ce pouvoir estime avoir besoin. Soutiens et relais essentiels de la presse jeune-algérienne, quand ils n’en sont pas les initiateurs ou les rédacteurs, les maîtres d’école indigènes fondent les premiers cercles intellectuels, participent à la formation des premiers clubs sportifs. Plus que quiconque, ces anciens de l’École normale sont les entrepreneurs du mouvement associatif naissant, les inventeurs de la société civile musulmane moderne. Rivaux et complémentaires, parfois alliés et amis, les oulémas eux-mêmes se mettront à leur école, à la génération suivante, avec la toute-puissance que confère la reformulation du lien primordialiste avec le religieux. Francophones par métier, souvent francophiles et même patriotes français par idéal, les instituteurs indigènes et leurs camarades européens vont servir de levier intellectuel et culturel à l’imaginaire national algérien.
Plus importante encore est la masse, certes relative par le nombre, des hommes socialisés dans l’école deJules Ferry, puis dans les premières écoles coraniques réformées. Une mince frange d’entre eux parvient chaque année jusqu’à la classe de fin d’études. Une génération avant l’adhésion aux partis nationalistes et à l’Association des oulémas (1926-1931), ces enfants et adolescents de treize à quinze ans apparaissent comme le principe actif essentiel de la catalyse nationale en cours. Toutes choses égales, ils sont pour l’Algérie algérienne une sorte de génération des « Lumières ». Nés dans la nouvelle culture de l’écrit, qui est aussi celle de la prédication laïque, insérés dans la circulation du livre, la lecture du journal, l’échange de courrier, le commentaire de la nouvelle, les « intellectuels du certificat d’études » sont les premiers soutiens de l’opération historiographique esquissée en filigrane parEl Haqq, le plus combatif des journaux algériens du temps. Dans la ville effervescente, ils se donnent corps et âme à « l’horizon d’attente » du moment. Armés de la nouvelle carte du temps, positivistes et croyants, les scolaires sont les porteurs, les diffuseurs et les chroniqueurs de la nouvelle conscience historique.
Telle est donc la sociologie de groupe à l’œuvre dans la nationalisation en cours du lien social. Mais qu’en est-il des formes de relation et de représentation dont ces groupes sont à la fois les agents et les acteurs ? Lors même qu’ils persévèrent dans leur être, ces hommes nouveaux sont pris, on l’a vu, dans les nouvelles normes de l’espace et du temps, mais ils endossent en retour, à leur rythme et à leurs conditions, les structures et la logique de relation sous-jacentes à ces normes, qui induisent, ou favorisent, une nouvelle identité de groupe et de nouveaux registres d’action. En construisant une nouvelle relation dialogique avec les Européens, tout à la fois conflictuelle et mimétique, ils expérimentent et contribuent à développer une formation sociale inédite, une configuration socio-historique nouvelle.
Dans un territoire où le marché, le savoir et le pouvoir sont agencés et distribués autrement, sous l’œil d’un pouvoir central qui a vocation à tout contrôler, à l’intérieur de strictes frontières de souveraineté, les jeunes musulmans des années 1900 découvrent et s’approprient un nouvel ordre de territorialité. Inchangé dans sa géographie physique, l’ancien territoire de la Régence est bouleversé dans sa géographie humaine, comme espace économique et politique administré, comme matrice physique d’un système ordonné de relations sociales, autant internes qu’externes. À la frontière, tracée et institutionnalisée, la police et la douane font le départ, non pas entre le musulman et le chrétien, mais entre le national et l’étranger. À l’intérieur, la gendarmerie distingue moins entre Nemamcha et Haractas (tribus de l’Est) qu’entre individus en règle ou en infraction. Bien que sujets et non citoyens, assujettis au permis de voyage, des musulmans en nombre croissant se déplacent ou communiquent toujours plus loin, plus vite et plus souvent. Ils déploient leurs activités, changeant de travail et de résidence, à l’intérieur d’un ensemble hiérarchisé de terroirs et de cités dont la place, les fonctions, le nom même et le sens ont changé pour eux.
Alger n’est plus seulement la ville du dey ou du gouverneur, ni le quartier général des colons, mais bien la capitale du pays, el-ʻacima. Entre le douar et Alger, les lieux et liens de résidence et d’appartenance ont changé, dans un système rural et urbain profondément remanié. La commune mixte, matrice du nouvel ordre territorial, définit un principe de classement où la résidence locale l’emporte sur la parenté gentilice. Mohand Ouachour se dit de Fort-National, et non plus des Beni Aïssi. Si différents soient-ils par l’origine et le statut, les musulmans progressivement inscrits dans cet ordre ont en partage non seulement des références très anciennes, la langue et la religion, mais aussi l’acculturation aux contraintes de la société nouvelle, dans l’espace physique et normatif où ils sont fixés, unifiés, rassemblés. Assignés par la carte d’identité et le visa, unifiés par le Code de l’indigénat, ils sont encore regroupés, mélangés, uniformisés par la conscription puis la guerre.
Lorsque l’armée les emmène ensemble, en masse, loin de la terre ancestrale, loin de la terre musulmane, pour la première fois de leur vie, et pour la première fois dans l’histoire du pays, ils ont à découvrir et maîtriser des procédures et des projections identificatoires d’une tout autre ampleur : près de deux cent mille hommes ont alors à se connaître et se reconnaître, par cette interaction multipliée, et condensée, dans une nouvelle unité de la diversité. Ils se révèlent alors à la fois compatriotes et contemporains ; compatriotes quand le sentiment d’appartenance à une terre natale, exprimé par le terme watan, s’élève de la petite patrie à la grande nation. Contemporains par le rapport commun au temps simultané du monde9.
Précisément, c’est leur familiarité croissante avec la diversité des temps sociaux qui fait de tous ces hommes les ouvriers et ingénieurs sociaux du temps. Ils prennent la mesure des modalités économiques, techniques et politiques du temps « homogène, linéaire et vide » de la modernité industrielle ultérieurement dénoncé par Walter Benjamin. Ils combinent la patience d’hier et l’impatience d’aujourd’hui, la lenteur répétitive des pratiques et des rites et la simultanéité des informations, le trais-train persistant de la petite vie locale et les implications d’une économie, et bientôt d’une guerre, à l’échelle du monde. Ils sont aux prises avec l’aléa et l’imprévu de ce monde, ils expérimentent et diffusent en pratique un nouvel ordre de temporalité qui trouve déjà, chez les publicistes, les enseignants et toute la population scolarisée, en filigrane, et en projection réactive sur le modèle français, « une formulation savante de l’expérience du temps qui, en retour, modèle nos façons de dire et de vivre notre propre temps », autrement dit, l’affirmation en quête d’autonomie d’un véritable « régime d’historicité10 ».
Les Algériens en train de se définir comme tels, face à l’algérianité proclamée des Européens, tentent d’accomplir en deux générations ce que Français et Allemands ont mis plus d’un siècle à maîtriser, un « véritable » retournement de l’économie du temps » : 1789 et 1907 sont pour eux contemporains. Certes, pour nombre de ceux qui suivent prudemment le cheikh Abdouh dans sa relecture au présent de la grande histoire arabe, le passé éclaire encore l’avenir. Mais l’aile encore plus avancée des Jeunes-Algériens – parente des Jeunes-Turcs et des Jeunes-Égyptiens –, celle qui se réclame de Comte, sinon de Marx, et qui déborde l’idée constitutionnelle par l’idée de révolution, demande au contraire à l’avenir d’éclairer le passé.
Quelques dizaines d’hommes contribuent à formuler, vers 1910, une demande d’histoire qui trouve sa réponse entre 1926 et 1930, mais en formulant aussi les termes d’une querelle historiographique et identitaire encore insurmontée aujourd’hui11. Un frémissement hédoniste accompagne l’émergence des élites de 1910, et a fortiori l’effervescence des années vingt, en réaction à l’immense boucherie. Le cri de Rimbaud, « être résolument moderne », commence alors à toucher les adolescents qui ouvriront la voie aux artistes des années 1930, au poète Jean Amrouche, au musicien Yguerbouchen. Plus prosaïquement, des projets personnels et des situations de groupe se dotent d’un sens nouveau. Un nouvel avenir se dessine, individuel et collectif, plan de carrière pour les uns, programme de réforme pour les autres. Les plus avisés, ou les plus audacieux, distinguent de mieux en mieux le court et le long terme. Bientôt, les politiques parleront tactique et stratégie. Les références du passé, le comput même du temps s’ajustent à l’articulation du projet et de l’idéal, le présent s’ouvre aux perspectives, aux prévisions, à la programmation. Il ne fait pas disparaître les attentes eschatologiques, mais il crée pour le futur un horizon de pensée et d’action où se recoupent l’utopie mobilisatrice et les limites de la raison pratique – même si, comme le disent encore les sages, Dieu est plus savant.
Il reste à discerner, autour de 1900, l’avènement d’une nouvelle problématique du sujet et de l’action. La multiplication des métiers, des rôles sociaux et des situations d’expérience, jointe à l’inscription commune dans une nouvelle chaîne d’interdépendance et à la perception d’une nouvelle historicité existentielle, favorise l’émergence presque simultanée d’un nouvel ordre de socialité, d’un nouveau type d’ipséité et d’un nouveau système d’action historique12. Sujets individuels et sujets collectifs convergent en direction d’une nouvelle pensée d’action, d’une nouvelle logique de l’action collective. Le journal intime, la grève et la manifestation en témoignent à l’orée du siècle, comme autant d’indices d’une refonte de la sphère privée et de l’espace public13. Au même degré, la mode, le voyage, les premiers débats sur le voile, ou le mariage mixte, l’idée même de parti (hizb) ou de constitution (destour) mettent le Maghreb en connexion, viaTunis, avec Le Caire et Paris.
Il est vrai que ces bouleversements ne concernent encore qu’une poignée d’hommes, en 1914. Mais les effectifs vont grossir fortement en 1919. Le moi ausculté et clivé, le nous combatif et festif s’investissent désormais dans la lutte partisane et s’exposent à force ouverte au conflit politique, au plus près d’un mouvement social désormais organisé mais syncopé, secoué d’émotions populaires où font parfois retour dissidents et bandits d’honneur, insurrections et mouvements messianiques. Le sujet individuel et l’idée patriotique avancent de conserve, dans la tension entre loyalisme et irrédentisme, dans l’ambivalence entre le nationalisme français et le patriotisme algérien, et dans la rivalité naissante entre les formulations laïcisantes et arabo-musulmanes du premier nationalisme algérien.
Ces tensions sont déjà lisibles en 1911 et 1912, au temps d’El Haqq. Dès ce moment, les Algériens sont parvenus à reprendre l’initiative, grâce à un savoir plus opérationnel stimulé par la technologie associative, l’essor du journalisme, l’éveil d’une opinion publique, et la synergie entre les premières formes de la mobilisation politique : délégation, pétition et élection14. Avant-garde sociale et élite intellectuelle s’allient dans la reconnaissance d’un territoire, la reprise d’une mémoire, la refonte d’une histoire. Le terrain est préparé pour les leaders de l’après-guerre15. Entre 1890 et 1914, dates rondes, quelques centaines de milliers d’hommes, sans doute moins de 10 % de la population musulmane, socialisés par l’école et le cercle, le café et la caserne, relayés par le parti et le syndicat, se sont donc mis en mouvement, glissant progressivement dans les cadres sociaux d’une nouvelle unité d’intégration et de représentation collective, l’unité maussienne de la nation16.
Ils ont à la fois adopté et adapté les normes, sans idées claires, mais en interaction forte avec une élite du salariat, du lectorat et de l’électorat, tirée par les scolarisés des quartiers centres, dans le creuset des villes nouvelles et des nouvelles médinas. Les uns l’ont incorporée, les autres l’ont imaginée. Il en est résulté, à la génération suivante, celle des fondateurs de la politique moderne et des initiateurs de l’opération historiographique, une première mise en réseau et en action de la nouvelle idée collective. La ville liseuse et frondeuse en a aiguisé l’attente et soutenu la mobilisation, avant que de nouveaux venus, plus jeunes, les jeunes, ceux qui se désignent et que l’on désigne comme tels, solidarisés eux aussi dans la chaleur festive du quartier, mais portés par le flux et le reflux du Front populaire, socialisés dans la culture du cinéma, du corps et du sport, politisés dans le culte du parti, puis fascinés par la guerre et les armes, portent le cri d’indépendance jusqu’au dernier douar de l’intérieur.
Le discours national algérien au défi de l’algérianisme
Jean-RobertHENRY
Sous ce titre, sont présentées quelques observations sur les interactions entre la pensée coloniale algérianiste et l’émergence d’un discours national algérien, plus précisément sur la façon dont l’énoncé d’un quasi nationalisme colonial au début du XXe siècle a influencé par réaction et contribué à forger les revendications politiques des mouvements algériens.
Les leçons d’une expérience
À l’occasion d’un colloque sur « la pensée politique algérienne » tenu à Alger en septembre 200517, les organisateurs m’avaient invité à faire des propositions pour rééditer et enrichir l’ouvrage publié avec Claude Collot en 1978, un an après sa mort, Le Mouvement national algérien, qui regroupait et commentait une centaine de textes élaborés par les partis politiques algériens entre 1912 et 195418. Cet ouvrage, publié en France et en Algérie, était épuisé depuis longtemps malgré un retirage fait par l’OPU, qui souhaitait désormais réactualiser le produit plutôt que d’offrir aux lecteurs une nouvelle réimpression.
À la réflexion, il est vite apparu que l’enjeu était moins de faire bénéficier la réédition de cet ouvrage des recherches historiques récentes et de nouvelles explorations des archives que de prendre en compte les changements dans l’approche du sujet et dans les attentes des lecteurs qui s’étaient opérés depuis trois décennies19. En particulier, la réédition pouvait être une occasion de porter remède à ce qui paraissait une faiblesse de l’ouvrage initial, c’est-à-dire la trop faible attention portée au contexte politique et idéologique colonial qui avait généré ces documents produits par les différentes composantes du mouvement national
Il est vrai que les années 1970 étaient très propices à une relecture de l’histoire algérienne cherchant à dégager de la gangue coloniale des dynamiques proprement algériennes et donc à isoler, à côté de l’univers mental colonial, une pensée politique algérienne et ses porteurs. Au risque de pousser cette démarche trop systématiquement.
Face à une historiographie française qui avait, de façon dominante, exalté la présence ou la colonisation française, la tentation était forte, au lendemain de l’indépendance, de décoloniser l’histoire, et même de la retourner. Plus encore, s’affirmait un très fort besoin de donner droit de cité à une histoire algérienne. Contrairement au Maroc et à la Tunisie, l’Algérie avait été niée dans son identité, et d’une certaine façon privée de son histoire au profit de celle du colonisateur. Des historiens français, notamment ceux qui exerçaient en « coopération », ont prêté la main à cette entreprise de réécriture de l’histoire aux côtés de leurs collègues algériens. À la fin des années soixante et au début des années soixante-dix, leurs enseignements touchaient un grand nombre d’étudiants. Chez ceux-ci, l’intérêt pour le sujet était évident. Les séminaires de 3e cycle à la Faculté de Droit d’Alger prenaient la forme de débats avec un public important et passionné, composé pour partie d’anciens militants, devenus « étudiants fonctionnaires ». C’était de l’histoire en direct, avec la participation de chercheurs invités principalement algériens et français. Les travaux qui en ressortaient étaient ensuite publiés dans des numéros spéciaux de la Revue Algérienne. Ces séminaires ne portaient pas seulement sur le mouvement national, mais aussi sur le droit colonial, la littérature coloniale, la littérature algérienne ou le cinéma.
C’est dans ce contexte qu’est né le projet de mettre à la disposition des étudiants et du public algérien et français un recueil des principaux textes du mouvement national. Parce qu’ils étaient eux-mêmes « coopérants », la seule voie ouverte aux deux auteurs sur un sujet touchant de près à l’identité algérienne était de se mettre avec rigueur et respect au service des textes.
Dans l’introduction de l’ouvrage, nous avions toutefois souligné que la production des textes des différents courants du mouvement national s’inscrivait dans un jeu dialectique complexe. Les textes nationalistes interagissaient entre eux, mais répondaient aussi au discours colonial, qui était lui-même dédoublé. « Au pseudo-nationalisme des colons répond, écrivions-nous, une assertion d’identité contraire des colonisés ». Mais, plus souvent, le discours du colonat faisait fonction de repoussoir qui incitait le mouvement national à s’adresser systématiquement à la métropole pour faire entendre ses revendications. C’est donc surtout par rapport au discours colonial métropolitain, à ses promesses assimilationnistes, à ses illusions et à ses variations, que le discours national semblait se forger.
Tout en formulant ces observations, nous n’en avions pas totalement tiré les conséquences : aucun texte colonial, métropolitain ou local, n’était reproduit dans l’ouvrage, et nous avions privilégié de fait la recherche d’un discours national algérien « authentique », sans faire ressortir suffisamment que la colonisation avait tellement et durant si longtemps agi sur la société algérienne que tout discours revendiqué comme « algérien » avait subi l’empreinte de cette histoire imbriquée à celle de la colonisation. Le discours revendicatif algérien de type assimilationniste n’y échappait évidemment pas, mais tous les autres discours étaient touchés à des degrés divers par cette réalité. Dès les années 1960, Maxime Rodinson avait pointé à juste titre la particularité des mouvements politiques algériens de l’époque coloniale par rapport aux autres pays arabes20. À trop isoler l’histoire algérienne de son contexte, on négligeait de prendre en considération les caractères qui la spécifiaient par rapport à ce qui était observable dans d’autres pays, y compris au Maroc et en Tunisie. En Algérie, la confrontation avec le pouvoir colonial avait été plus lourde et structurante que dans d’autres sociétés colonisées. L’observation valait encore plus pour le rapport des courants nationalistes algériens à la culture politique produite par les Européens d’Algérie sous le nom d’algérianisme. Cette idéologie politique et culturelle qui détournait au profit de la minorité coloniale la référence à une identité algérienne obligeait les nationalistes algériens à inventer un autre vocabulaire revendicatif et poussait à sa radicalisation. C’est une expérience relativement unique dans le monde arabe, dont il faut tenir compte en analysant l’histoire de la pensée nationale algérienne moderne : elle s’est forgée pour une part non négligeable contre l’idéologie algérianiste. Nous en étions bien conscients pour la littérature mais moins pour la culture politique21.
*
Une autre dérive de notre relecture a posteriori du « mouvement national » consistait à valoriser le processus unitaire imposé sous le FLN et qui avait prolongé ses effets après l’indépendance. En partant du point d’arrivée, on remontait le « mouvement national » comme un long fleuve – pas toujours tranquille – qui avait recueilli, rejeté ou légitimé les affluents des diverses sensibilités politiques. La pluralité et la diversité des expressions étaient sacrifiées à la logique unanimiste, qui ne s’était en réalité imposée qu’avec peine.
Cette question se posait surtout à propos de la place des textes du parti communiste algérien. Pour certains militants et chercheurs, le PCA ne faisait pas partie du mouvement national, en raison de l’importance de sa clientèle européenne, et de ses positions incertaines dans des moments cruciaux comme le 8 mai 1945. Mais il est certain que son évolution l’avait rapproché à partir de la fin des années quarante des revendications de l’Algérie musulmane. Et l’observation de l’interaction des discours entre les mouvements politiques algériens montrait par ailleurs qu’il était impossible d’occulter son influence.
Un problème un peu similaire concernait la sensibilité messaliste, dont l’appartenance au mouvement national sera longtemps délégitimée, en raison du refus de Messali Hadj de rejoindre le FLN. De même, la « crise berbériste » qui avait touché le PPA à la fin des années 1940, était totalement absente – involontairement ? – de notre ouvrage.
Quant aux confréries qui revendiquent aujourd’hui leur inscription dans la résistance à la colonisation, le problème ne se posait même pas : seule était mise en avant la collaboration des plus connues d’entre elles avec le pouvoir colonial.
Une autre limite implicite de notre travail était de privilégier le nationalisme politique et pacifique en s’appuyant sur une datation de l’histoire de l’Algérie séparant en 1954 l’action politique de l’action armée. Le choix de faire de la période 1940-1945 un clivage majeur dans l’histoire du mouvement national nuançait toutefois ce parti-pris. Plus tard, nous avons davantage bousculé les dates conventionnelles à l’occasion de l’exposition sur « l’Algérie et la France. Destins et imaginaires croisés », réalisée en 200322.
*
Dépasser ces diverses limites de l’édition initiale de l’ouvrage sur les textes du mouvement national invitait donc à raisonner de façon plus structurelle pour la réédition, en élargissant le regard sur l’univers discursif dans lequel se déployaient les discours nationalistes et en faisant davantage référence auxacteurs ayant évolué dans cet univers.
Sur le plan discursif, il convenait de rattacher la dialectique propre aux discours nationalistes à un champ discursif plus complexe, celui de l’Algérie coloniale et de ses rapports avec l’espace métropolitain, en contexte colonial puis en contexte de décolonisation. Cet univers discursif complexe n’était pas figé : les discours revendicatifs ou nationalistes algériens répondaient à des discours politiques coloniaux et à des pratiques qui ont beaucoup évolué en un demi-siècle.
Ainsi, le sénatus-consulte de 1865 avait largement fixé les termes du débat politique algérien jusqu’au Statut de l’Algérie (1947), tout en étant soumis à des réinterprétations moins libérales que le texte originel. Il a été d’une certaine façon le moteur de la revendication assimilationniste. Jusqu’en 1936, les perspectives ouvertes par le sénatus-consulte de 1865, complétées par les dispositions de 1919 et par les avatars successifs du débat parlementaire français sur la question algérienne, paraissent une base revendicative légitime pour une part importante des élites algériennes, attachées à l’obtention de la citoyenneté dans le statut. Ce sont des positions qu’elles abandonneront progressivement au fil du processus de décolonisation, même si on peut en trouver des traces jusqu’à nos jours dans l’aspiration à une double nationalité franco-algérienne.
Pour restituer l’univers discursif colonial dans sa diversité, il importe aussi de ne pas ignorer le rôle qu’y tient la littérature. Celle-ci apporte à l’histoire sa capacité à inscrire les destins individuels dans une trame collective et à suggérer avec réalisme ce qui ne peut être dit plus explicitement, par exemple sur la façon dont les individus font le lien entre discours politique et passage à l’action23.
L’intérêt d’un élargissement du champ discursif valait à des degrés divers pour toutes les sensibilités nationales, des réformistes modernistes aux communistes et aux radicaux de l’ENA-PPA, soumis à l’influence de l’Internationale en émigration, avant d’effectuer un « repli » significatif en Algérie. Même pour les Oulémas, on peut se demander si le modèle du protectorat marocain n’a pas pesé dans l’affirmation par Ben Badis en 1936 d’une patrie algérienne solidaire de la France : « Nous, Algériens musulmans, qui vivons dans notre patrie algérienne à l’ombre du drapeau tricolore français… ».
Alors que dans les années soixante-dix, il fallait simplifier le roman national pour faire ressortir l’Algérie musulmane et les Algériens d’une histoire coloniale qui les avait écrasés, il faut donc aujourd’hui réintroduire la complexité dans une histoire franco-algérienne longtemps et fortement imbriquée, dont les effets se prolongent partiellement après 1962.
*
Une telle approche permet aussi de réintégrer les acteurs et notamment les « groupes-frontières », enfants plus ou moins naturels de cette histoire commune. L’émigration n’a pas été seulement une étape vers le nationalisme. Il est symptomatique que le 17 octobre 1961 soit devenu pour l’émigration d’origine algérienne en France une date fondatrice, un repère identitaire. La constitution de cette société franco-algérienne (qui s’est fortement manifestée lors de l’Année de l’Algérie) a concrétisé d’une certaine façon ce qui avait été envisagé par les accords d’Évian pour les Européens d’Algérie.
Cette remarque conduit aussi à réintroduire, dans l’observation du jeu des acteurs de la scène coloniale, la communauté européenne24. On ne peut saisir le développement du nationalisme algérien en faisant abstraction de son existence. Il s’est forgé nécessairement contre une domination coloniale multiforme, incarnée par des discours, des hommes et des pratiques. La relation inégale qui en découlait était un système humain complexe. Les écrivains l’ont compris depuis longtemps.
L’histoire des Européens d’Algérie est une pièce du puzzle qui manque pour situer dans toute sa complexité l’histoire de l’Algérie moderne ; il n’y a aucun intérêt à en laisser l’exclusivité à des milieux associatifs qui en font une histoire confite dans l’amertume. Mais il est utile en même temps d’analyser les attentes mémorielles contradictoires de cette communauté, exprimées notamment lors de la fameuse loi de février 2005 : l’attitude très offensive sur la reconnaissance des aspects positifs de la colonisation ou sur les « martyrs » de l’OAS cohabite avec la multiplication des voyages dans l’Algérie nouvelle. La reconstruction de « racines de papier » chez les pieds-noirs25 est un processus qui intéresse l’histoire des deux sociétés.
La réintroduction du rapport aux autres dans le développement de l’idéologie nationale passe aussi bien sûr par la prise en considération des Juifs algériens et de leurs propres aspirations identitaires et mémorielles. Enfin, n’oublions pas la constellation des dialogueurs ou médiateurs : saint-simoniens, militants anti-coloniaux comme Spielmann, assimilationnistes, « compagnons du Jardin » de tout poil26.
Ce retour à la complexité est nécessaire pour restituer le jeu de la pensée et des acteurs nationalistes dans l’« inter-discours franco-algérien » (Siblot). Même si au total une des confrontations les plus structurantes pour le mouvement national algérien reste celle qui l’a opposée à l’idéologie algérianiste portée par les Européens d’Algérie.
L’émergence d’une pensée algérianiste
La pensée algérianiste s’est progressivement construite à partir de la fin du XIXe siècle au sein du colonat algérien, pour contrer « l’arabophilie » de Napoléon III et des bureaux arabes. À la chute du Second Empire, les colons se rallient au nouveau régime républicain qui adopte rapidement des mesures en leur faveur.
L’insurrection de 1871, dernier grand soulèvement de la société algérienne, est durement réprimée par l’armée qui rappelle ainsi son rôle essentiel dans le maintien de la sécurité dans la colonie et bouscule le rêve d’ « Algérie libre » caressé par quelques colons27. Dans les décennies qui suivent, les Européens d’Algérie, seuls bénéficiaires de la politique d’assimilation et des avantages liés à la nationalité française, se contentent d’exercer leur pouvoir d’influence à Paris à travers le puissant « lobby algérien », qui obtient l’extension de la colonisation. De leur côté, les Algériens sont soumis à partir de 1874 à un code de l’indigénat humiliant et contraignant, qui confirme l’abaissement de la société musulmane et le rapport de plus en plus asymétrique entre les deux communautés.
Au tournant du siècle, en réaction aux dispositions « indigénophiles » ou « libérales » d’hommes politiques ou de gouverneurs français, la volonté d’autonomie des Européens s’affirme avec force, à l’occasion de manifestations antisémites qui traduisent la peur de voir des « indigènes » accéder au même statut que les Européens. La « révolution manquée » (Ageron) de 1898 est un feu de paille, mais obtient de Paris des concessions importantes qui renforcent le pouvoir des colons : création d’une assemblée élue, les Délégations financières, puis octroi à l’Algérie en 1900 de la personnalité civile et de l’autonomie financière. La tension avec le pouvoir métropolitain reste néanmoins forte sur des sujets sensibles comme la scolarisation des enfants musulmans : le recteur Jeanmaire qui exercera son activité pendant vingt-cinq ans parviendra à faire progresser celle-ci malgré la résistance des élus européens28.
*
La revendication autonomiste du colonat n’est pas seulement politique. Elle trouve aussi, depuis la fin des années 1890, son expression culturelle et symbolique dans les romans « algérianistes ». Ceux-ci entendent donner la parole au « peuple neuf » des Européens d’Algérie, en réaction contre l’exotisme « importé » des écrivains, peintres et voyageurs qui chantent trop à leur goût l’Algérie musulmane, son désert et ses hommes, et dont l’influence s’exerce en Algérie même avec Isabelle Eberhardt ou Étienne Dinet. Paradoxalement, les auteurs majeurs de cette littérature « algérienne » sont moins des colons que des fonctionnaires : Louis Bertrand est professeur au lycée d’Alger, Robert Randau et Musette sont administrateurs, Ferdinand Duchêne magistrat… Cette littérature est fortement contaminée par sa proximité avec des discours politiques qui dénoncent les menaces pesant sur la colonie ou exaltent l’aspiration autonomiste. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la diversité des styles et des postures de ces écrivains : par peur ou mépris, Bertrand ignore l’indigène, « l’arabe », alors que Randau manifeste une empathie certaine pour le monde colonisé d’Algérie ou d’Afrique noire et soutient Isabelle Eberhardt, qui essaie de parler au nom des musulmans.
*
Pendant plus de trente ans, jusqu’à la célébration du « Centenaire de l’Algérie » en 1930, le discours politico-littéraire « algérianiste » va dominer en Algérie le débat sur l’avenir de la colonie, avec ses thèmes redondants : affirmation identitaire du « peuple neuf », légitimation de sa présence au nom de l’œuvre accomplie et parfois de l’héritage romain, exaltation du pouvoir « civil » des colons contre le pouvoir militaire, minoration ou dénigrement des « indigènes musulmans», appropriation de leur identité d’« Algériens » par les « Européens », et enfin appel au soutien de la métropole, qui est le véritable allocutaire de ce discours. En effet, il n’y a pas de véritable dialogue avec le mouvement « Jeune algérien », qui émerge à partir de 1912 sur le modèle du mouvement « Jeune turc », mais qui ne sera jamais à même d’inquiéter le colonat, car il est fondamentalement assimilationniste29. Le discours séparatiste algérien qui se fait jour au lendemain de la guerre dans les débats du Congrès de la paix puis dans l’émigration nord-africaine en France est plus menaçant pour la prépondérance coloniale, même si son audience en Algérie reste limitée dans un premier temps30. Mais la guerre du Rif va rendre de plus en plus crédible la revendication indépendantiste.
Le discours algérianiste s’ajuste en réalité aux nouveaux enjeux politiques : après la Première Guerre mondiale, qui a coûté la vie à 25 000 Algériens musulmans et à presque autant d’Européens d’Algérie, une sourdine est mise à la revendication autonomiste car le colonat est moins que jamais en situation de dominer seul la « question algérienne ». Il essaie par contre de faire valoir que l’Algérie constitue une « terre de résurrection » pour la France exsangue.
La littérature algérianiste des années 1920 accompagne cette évolution du rapport à la France. Elle devient de plus en plus démonstrative, engagée, soucieuse de mettre l’art au service d’un message politique qui sera aussi celui du Centenaire : il faut convaincre la France de l’effort réalisé en Algérie par le colonat et de la nécessité d’aider celui-ci à construire la « nouvelle France » algérienne, où les indigènes ont vocation à n’occuper qu’une place politique mineure (alors que leur nombre s’accroît). Certains romans alertent sur les risques à venir au cas où la métropole ne reviendrait pas sur les errements de sa politique algérienne31. Le rapport littérature/politique se formalise explicitement : des textes doctrinaux invitent à considérer la plume comme une épée (Rimbault) et la littérature coloniale comme un « instrument de propagande » au service de « la plus belle Algérie» (Randau)32 ; des préfaces omniprésentes – notamment dans les rééditions qui reprennent en les remaniant parfois des titres anciens – insistent sur la « vérité » et le message politique des romans en disant au lecteur ce qu’il doit en retenir. En 1921, un Grand Prix Littéraire de l’Algérie est créé sur des critères plus administratifs que littéraires33. Enfin, dans le corps même des œuvres, les intertextualités fourmillent entre discours politiques, scientifiques et littéraires. Chez Ferdinand Duchêne par exemple, on trouve par pages entières des citations de textes politiques ou juridiques.
Tous ces procédés renforcent le message politique mais tuent la littérature. Il y a épuisement des virtualités d’une littérature engagée, où la fiction n’est plus que le faire-valoir d’un discours politique qui la submerge. À la fin des années vingt, la littérature algérianiste semble déjà fortement installée dans la décadence. C’est le sentiment dePierre Martino, doyen (métropolitain) de la Faculté des Lettres d’Alger, dans une des rares publications du Centenaire consacrées à la littérature34 : « Pas de public indigène pour une littérature “algérienne” : les très rares indigènes qui, à l’heure actuelle, accèdent jusqu’à notre haute culture préfèrent entrer de plain-pied dans les beaux jardins de la littérature française. Le public des Français cultivés se tient en relations étroites avec Paris… les livres qui se vendent le moins sont ceux où l’on parle de l’Algérie ». Il faudra attendre les auteurs de l’École d’Alger pour qu’une telle affirmation soit démentie.
Le paradoxe est que l’épuisement de la veine littéraire de l’algérianisme va de pair avec son triomphe comme idéologie politique à l’occasion du Centenaire. Mais c’est une victoire à la Pyrrhus qui parachève l’invasion du littéraire par le politique et ôte sa raison d’être à la littérature : le roman algérianiste ne survivra pas de façon significative au Centenaire…
Le « Centenaire de l’Algérie », aboutissement de la pensée algérianiste
Les années trente sont une importante période de basculement culturel et politique dans l’histoire de l’Algérie coloniale et du Maghreb35. Au début de la décennie, le triomphalisme colonial s’exprime de façon ostentatoire : Congrès eucharistique de Carthage, Dahir berbère au Maroc, expositions coloniales en France et célébration du « Centenaire de l’Algérie » en 1930. En même temps, la région méditerranéenne est troublée à cette époque par les ambitions impériales de l’Italie et par une radicalisation de la résistance anticoloniale : la très sanglante guerre du Rif qui s’est achevée en 1926 a laissé des traces durables dans l’opinion publique au Maroc, en Espagne et en France. Et, à partir de 1936, c’est la guerre d’Espagne qui bouleverse pour plusieurs années la Méditerranée occidentale.
Sur le plan culturel, on observe aussi des processus contradictoires : la pensée algérianiste, qui régnait depuis trente ans en Algérie, triomphe comme idéologie politique à l’occasion de la célébration du « Centenaire de l’Algérie ». Mais elle s’épuise sur le plan littéraire au profit d’une littérature d’inspiration méditerranéenne, qui va acquérir en quelques années une résonance mondiale et marginaliser la pensée algérianiste.
*
Le « Centenaire de l’Algérie », fêté en 1930, occupe une place à part dans les célébrations de la colonisation française. Ce n’est pas le fruit d’une initiative métropolitaine, mais une opération de communication menée par des acteurs majeurs du colonat européen d’Algérie pour défendre et illustrerleur vision du rapport colonial.
En Algérie, le Centenaire de la conquête française est l’événement politico-culturel le plus notable de l’entre-deux-guerres, une période-clé pour l’évolution du pays. Mais cette démonstration de force idéologique, qui a fortement marqué les imaginations, est contradictoire : c’est à la fois le triomphe du colonat algérien, l’aveu de ses faiblesses et un accélérateur du « malaise algérien ». Le Centenaire est un aboutissement dans les deux sens du terme : il consacre et accomplit le discours politico-culturel de l’« algérianisme », tout en épuisant jusqu’à la lie sa portée36. Dès l’époque, il est ressenti comme un point de basculement vers des horizons incertains et comme une « occasion ratée » de mieux maîtriser le destin colonial.
*
L’idée de célébrer avec solennité le « Centenaire de la prise d’Alger par les Français » remonte à fin 1923. Mais c’est sous le gouverneur général Maurice Viollette, nommé en 1925 par le Cartel des gauches, que le projet prend corps. Une commission des Publications, composée de fonctionnaires et d’universitaires, est instituée en juillet 1925 pour dresser un « état de nos connaissances » sur le pays, un siècle après l’Exploration scientifique de l’Algérie.
Viollette voudrait saisir l’occasion du Centenaire moins pour exalter la conquête française que pour promouvoir des réformes politiques en faveur des Musulmans algériens, dans le prolongement des gestes faits en métropole après la Grande Guerre. Ce n’est pas la position des Délégations financières – où le colonat est surreprésenté – qui créent en avril 1927 une « Commission inter-délégataire pour le Centenaire », composée de « six colons, six non-colons, trois arabes et deux kabyles » et présidée par Gustave Mercier. À son tour, Viollette institue un Conseil supérieur du Centenaire et un Commissariat général, confié à Charles Brunel, maire d’Alger. Mais, sous la pression du lobby colonial algérien, il est remplacé en décembre 1927 par un nouveau gouverneur général, Bordes. Celui-ci nomme Gustave Mercier commissaire général et assure lui-même la présidence du Conseil supérieur du Centenaire. À celui-ci sont rattachées diverses commissions spécialisées. Une loi de mars 1928 avalise ces structures et institue une « Caisse de célébration du centenaire » gérée depuis Alger. Au total, la célébration du Centenaire est donc une opération massivement « algérienne », même si elle est relayée à Paris par un Comité métropolitain très actif.
Les hommes qui administrent les instances de préparation du Centenaire appartiennent à la haute administration coloniale, à la classe politique locale, à l’Université d’Alger ou aux pouvoirs économiques. Les musulmans algériens sont extrêmement minoritaires : on n’en compte que 4 sur 22 dans le Conseil supérieur du Centenaire, et beaucoup de commissions n’en comptent aucun.
À la différence des expositions coloniales, le Centenaire de l’Algérie n’est pas une manifestation unique, mais un ensemble de cérémonies, de festivités et défilés, de colloques et congrès qui s’étalent sur six mois, de janvier à juin 1930, dans toute l’Algérie. Il est également l’occasion de créer ou moderniser des équipements culturels pour accueillir ces manifestations. S’ajoute enfin le programme de publications scientifiques, pilotées par des universitaires algérois.
*
Malgré ses volets culturel et scientifique, la célébration du Centenaire est lourdement chargée de sens politique. C’est avant tout une opération de propagande, comme le confirme le rôle majeur donné à la commission chargée de cette fonction. Il s’agit d’une part de frapper les esprits en Algérie : ceux des indigènes, mais aussi ceux des colons, d’où l’importance des monuments commémoratifs37 et la symbolique quasi-romaine des « Maisons